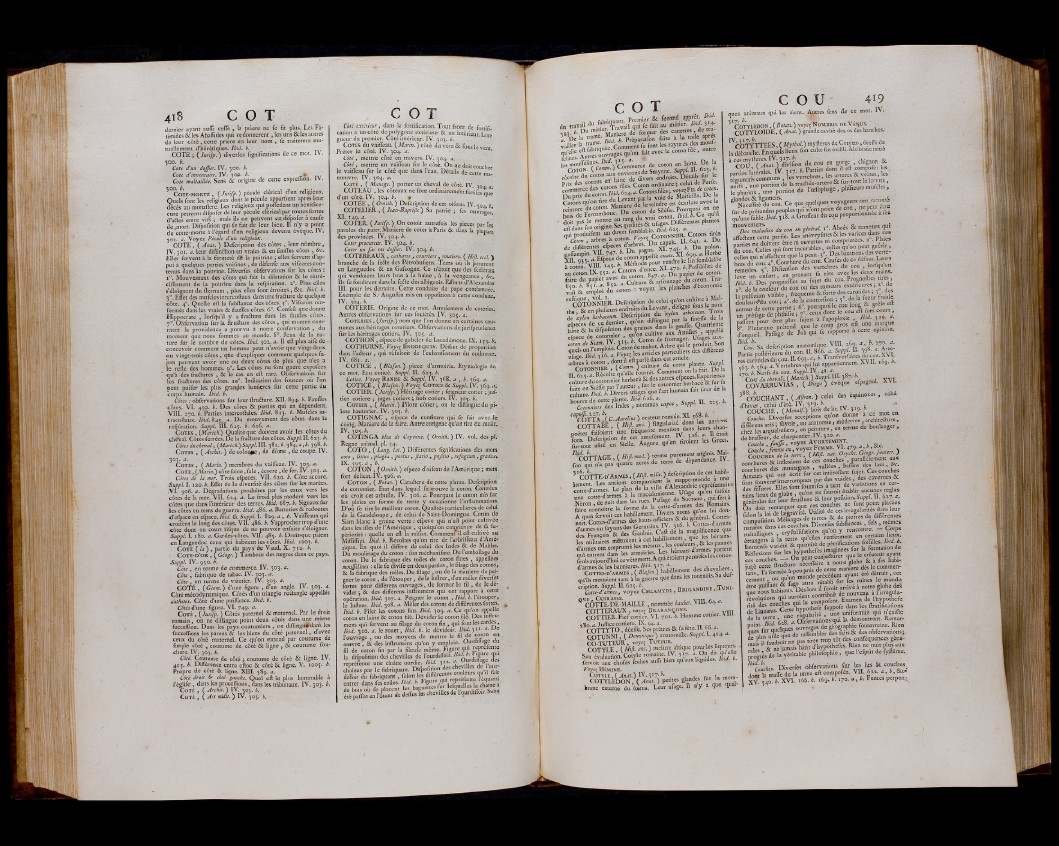
418 C O T
dernier ayant aufli ceffé , la priere ne fe fit plus. Les Fa-
timides & les Abafiides qui ordonnèrent | les uns &les autres
de leur côté, cette priere en leur nom , fe traitèrent mutuellement
d’hérétiques. Ibid. b.
COTE ; ( Jurifp. ) diyerfes fignifications de ce mot. IV.
300. b.
Cote d'un dojjîer. IV. 300, b.
Cote d'inventaire. IV. 300. b.
Cote maltaillée. Sens & origine de cette expreflion. IV.
C o te -m o r te , (Juri/p.) pécule clérical d’un religieux.
Quels font les religieux dont le péçule appartient après leur
décès au monaftere. Les religieux qui poffedent un bénéhee-
cure peuvent difpofer de leur pécule clérical par toutes fortes
d'aftes entre vifs ; mais ils ne peuvent en, difpofer à caufe
de .mort. Difpofition qui fe fait de leur bien. Il n’y a point
de cotte-morte à l’égard d’un religieux devenu évêque. IV.
301. a. "Voyez Pécule d'un religieux.
COTE, ( Anàt. ) Defcription des côtes , leur nombre,
IV. 301. a. leur diflinétion en vraies & en fàufles côtes , &c.
Èllqs fervent à la fermeté dê la poitrine ; elles fervent d’appui
à quelques parties voifines , de défenfe aux vifeeres contenus
dans la poitrine. Diverfes obfervations fur les côtes :
i°. Mouvement des côtes qui fait la dilatation & le rétré-
ciflement de la poitrine dans la refpiration. 20. Plus elles
s’éloignent du fternum , plus elles font étroites, &c. Ibid. b.
30. Effet des mufclesintercoftaux dans une frailure de quelque
côte. 40. Quelle eft la fubftance des côtes. 50. Vifeeres renfermés
dans les vraies & fàufles côtes. 6°. Confeil que donne
Hippocrate , lorfqu’il y a fraélure dans les fàufles côtes.
70. ôbfervarion fur la ftrufture des côtes , qui montre comment
la providence a pourvu à notre confervation , du
moment que nous fommes au monde. 8°. Jeux de la nature
fur le nombre de côtes. Ibid. 30a. a. Il eft plus aifé de ■
concevoir comment un homme peut n’avoir que vingt-deux
ou vingt-trois côtes , qùe d’expliquer comment quelques fu-
jets peuvent avoir une ou deux côtes de plus que n’en a
le refte des hommes. 90. Les côtes ne font guere expofées
qu’à des ffaôures , & le cas en eft rare. Obfervations fur
les fraftures des côtes. io°. Indication des fources où l’on
peut puifer les plus grandes lumières fur cette partie du
corps humain. Ibid. b. _ „
Côtes : obfervations fur leur ftruéhire. XII. 894. b. Faufies
côtes. VI. 430. b. Des côtes & parties qui en dépendent.
VIII. 270. b. Parties intercoftales. Ibid. 813. b. Mufcles in-
tracoftaux. Ibid. 843. a. Du mouvement des côtes dans la
refoiration. Suppl. III. 623. b. 626. a. ■
C o te s , (Maréch.) Qualité que doivent avoir les côtes du
chëVal. Côtes ferrées. De la fraéture des côtes. Suppl.II. 623. b.
Côtes du cheval, (Maréch.") Suppl.Hl. 381. b. 384 ,a,b. 398, b.
C o t e s , ( Archit.-) de colonie, de dôme , de coupe. IV.
303. a. I •
C o t e s , ( Marin. ) membres du vaifleau. IV. 303. a.
C o t e , (Marin!) côte faine, fale | écorre, de fer. IV. 303. a.
Côtes de la mer. Trois efpeces. VII. 620. b. Côte accore.
SuppL I. 120. b. Effet de la diverfité des côtes fur les marées.
,VI. 906. a. Dégradations produites par les eaux vers les
côtes de la mer. VII. 624. a. Le froid plus modéré vers les
côtes que dans l’intérieur des terres. Ibid. 687. b. Signaux fur
les côtes en tems de guerre. Ibid. 486. a. Batteries & redoutes
d’efpace en efpace. Ibid. & Suppl. I. 829. a , b. Vaifleaux qui
croifent le long des côtes. Vil. 486. b. S’approcher trop d’une
côte dont on court fifque de ne pouvoir enfuite s’éloigner.
Suppl. I. 180. a. Gardes-côtes. VII. 483. b. Droit-que paient
en Languedoc ceux qui habitent les côtes. Ibid. 1003. b.
C o t e ( la ) , partie du pays'de Vaud. X. 712. b.
C o te -d ’o r , ( Géogr.) Tambour des negres dans ce pays.
Suppl. IV. 930. b.
Côte, en terme de commerce. IV. 303. a.
Côte , fabrique de tabac. IV. 303. a.
Côte, en terme de vannier. IV. 303. a.
CO T É , ( Géom.) d’une figure , d’un angle. IV. 303. a.
Côté mécodynamique. Côtés d’un triangle reâangle appellés
cathetes. Côté d’une puiflance. Ibid. b.
Côtés d’une figure. VI. 749. a. .
C o t é , (Jurifp. ) Côtés paternel & maternel. Par le droit
Tomain, on ne diftingue point deux côté; dans une même
fuccefliou. Dans les pays coutumiers , on diftingiw’dans les
fucceffions les parens & les biens du côté paternel, d’avec
ceux du côté maternel. Ce qu’on entend par coutume de
fimple côté , coutume de côté & ligne, & coutume fou-
chere. IV. 303. b.
Côté. Coutume de côté ; coutume de côté & ligne. IV.
■413. b. Différence entre eftoc & côté & ligne. V. 1005. b.
Propre de côté & ligne. XIII. 389. a.
Côté droit & côté gauche. Quel eft le plus honorable à
l’églifé , dans les procédions, dans les tribunaux. IV. 303. b.
C o t é , ( Archit. ) IV. 303. b.
C o t é , ( Art milit. ) IV. 303. b, ■
C O T
Côté extérieur, dans la fortification. Tout front de fortification
a un côté depolygone extérieur & un intérieur. Longueur
du premier. Côté intérieur. IV. 303. b.
C o té s du vaifleau. ( Marin. ) côté du vent 8c fous le vent
Prêter le côté. IV. 304. a.
Côté, mettre côté en travers. IV. 304. a.
Côté , mettre un vaifleau fur le côté. On ne doit coucher
le vaifleau fur le côté que dans l’eau. Détails de cette manoeuvre.
IV. 304. a.
C o t é , ( Manege. ) porter un cheval de côté. IV. 304. a'
COTEAU ,les coteaux ne font ordinairement fertiles que
d’un côté. IV. 304. b. » “
’ COTÉE , ( Omith. ) Defcription de cet oifeau. IV. 40 j t. <
COTELIER, | Jean-Baptifle ) Sa patrie ; fes ouvraees*
XI.149.iz.
COTER. (Jurifp.) On cotoit autrefois les pièces par fes
paroles du pater. Maniéré de coter à Paris 8c dans la plupart
des provinces. IV. 304. b.
Coter procureur. IV. 304. b.
Coter un fac ou dojjîer. IV. 304. b.
COTEREAUX, catharis , courriers, routiers. ( Hift. teel. )
branche de la fe&e des Pétrobufiens. Tems où ils parurent
en Languedoc 8c en Gafcogne. Ce n’étoit que des fcélérats
qui vendoient leurs bras à la haine , à la vengeance , &c.
ils fe fondirent dans la fe£te des albigeois. Efforts d’Alexandre
III. pour les détruire. Cette conduite du pape condamnée.
Exemple de S.; Auguftin rais en oppofition à cette conduite,
IV. 304. b.
COTERIE. Origine de ce mot. Amufemens de coteries:
Autres obfervations fur ces fociétés. IV. 303, a.
C o te r ie s , (Jurifp.) nom que l’on donne en certaines coutumes
aux héritages roturiers. Obfervations de jurifprudence
fur les héritages côtiers. IV. 303. a.
COTHON, efpece de gobelet de Laccdémône. IX. 139. b.
COTHURNE. Voyez B ro d eq u in . Défaut de proportion
dans l’a£teur , qui réfultoit de l’exhauflement du cothurne.
IV. 681. tf.
COTICE , ( Blafon. ) . piece d’armoirie. Etymologie de
ce mot. Ecu coticé. Suppl. II. 623. b.
Cotice. Voyez BaNDE OC Suppl. ÍV. 368. a , b. 369. a.
COTICÉ, ( Blafon.) Voyei C o t i c e 8c Suppl. IV. 369. a:
COTIER. ( Jurifp. ) Héritage cotier ; feigneur côtier /juf- .
tice cotiere ; juges côtiers ; fiefs côtiers. IV. 303. b.
C o t ie r , ( Marin. ) Pilote côtier ; on le diftingue du pilote
haùturier. IV. 303. b.
COTIGNAC , efpcce de confiture qui fe fait avec le
coing. Maniéré de le faire. Autre cotignac qu’on tire du moût.. I
IV. 303. b.
COTINGA bleu de Cayenne. ( Omith. ) IV. vol. des plj
Règne animal, pl. 34.
GOTO, (Lang. lat.) Différentes fignifications des mots
coto , lit tus , plagia , port us, flatià, pojitio , refugium, graduss
IX. 393. tf , b.
COTON, ( Omith. ) efpece d’oifeau de l’Amérique ; mets
fort délicat. IV. 306. a.
C o to n , ( Botan.) Caradere de cette plante. Defcription
du cotonnier. Etat dans lequel fe >trouve le coton. Contrées '
où croît cet arbufte. IV. 306. a. Pourquoi le coton mis fur
les plaies en forme de tente y occafionne l'inflammation*.
D’où fe tire le meilleur coton. Qualités particulières de celui
de là Guadeloupe, dé celui de Saint-Domingue. Coton de
Siam blanc à graine verte : efpece qui n’eft point cultivée
dans les ifles de l’Amérique , quoiqu’on contienne de fa fu- .
périorité : quelle en eft la raifon. Comment il eft cultivé au
Mifliffipi. Ibid. b. Récoltes qu’on tire de l’arbrifleau d’Amérique.
En quoi il diffère de celui des Indes & de Malthe.
Du moulinage du coton : fon méchanifme. De l’emballage du
coton. De la fabrique des toiles de coton fines , appellées .
mouffelines : elle fe divife en deux parties, le filage des cotons,
8c la fabrique des toiles. Du filage , ou de la maniéré de peigner
le coton, de l’étouper, de le luftrer, d’en mêler diverfes
fortes pour différens ouvrages, de former le fil, de le dévider
; 8c des différens inftrumens qui ont rapport à cette
opération. Ibid. 307. a. Peigner le coton , Ibid. b. l’étoupcr,
le luftrer. Ibid. 308. a. Mêler des cotons de différentes fortes,
Ibid. b. Filer les cotons fins. Ibid. 309. a. Ce qu’on appelle
coton en laine 8c coton filé. Dévider le coton file. Des inftrumens
qui fervent au filage du coton fin , qui font les cardes ,
Ibid. 310. tf. le rouet, Ibid. b. le dévidoir. Ibid. 311- a. De
l’ouvrage , ou des moyens de mettre le fil de coton en ,
oeuvre, 8c des inftrumens qu’on y emploie. Ourdiflage du
fil de coton fin par la fileufe même. Figure qui repreiente
la difpofition des chevilles de l’ourdiffoir. | | |
repréfente une chaîne ourdie. Ibid.
chaînes par le fabriquant Difpofmon d« . . ^
oir d“ febnquan, * ton l * d ™ me j
entrer dans fes odes (J, lef^elles la eltaine a
C O T
d n t r a v a i H u ^ r a . r ^ f S ; Ï Ï tA U m k D» mc% S f d f former des canettes , de tra-
Ï De la Préparation faite à la toile apref
¡ M L Comment fe font les rayutes des monf
es. tfutres ouvrages qu’on | t avec le coton file . outre
les moulfellnes. dc COIOn en hine. De la
commerce des cotons filés. * Mon.
coton. W S m B ^ Ê Ê Ê t
de différentes efpeces darbres. ^ ]P ^ Du polon.
golfampin. VII. 747- *• Du ' S n i l 699. a. Herbe
XII. 93Î- S MS?ho^ oour rendre le linfemblable
i coton. Vin. Mi. ^ ¿ . ¿ e . XI. 47a- i. Poffibilite de
au coton. IX. 35a , f q a Du papier de coton,
faire du papier avec du 84;^ P âefiton. Tra- «Si ÏÜÎ du coton : voyca les ¡¡¡¡¡g
rU COTONNIER. Defcription de celui
th., & en plufieurs endroits d u.e v ait. Trois
l e t r d e 41 e S e ° equ4 diflingue par 1
, ! ee tu d i fp o
efpece de cotonnier , B de fromagcr. Ufages auxcoton
dt ¿ CL „ ,i£ mahit; Arbre qui le produit. Sor
COU 419
qiies animaux qui les aient- Autres fens de ce mot. IV.-
^ C o t y lé d o n t (Botan.) voye^ N o m b r i l de Vehus. • .
COTYLOIDE, ( Anat.) grande cavité des os des hanches.'
IV/4y?^TTÉES ( Mvthol. ) myfteres de Cotytto, dèeffe de
la débauche. En ouels lieux fon culte fut établi. Alcibiade initié
à c e s j 3d’ vifion du cou en gotge , cliignon &
■ . l^éVdes IV 417. 8 Parties dont il eft çomçofe: les.
Ï ^ C T o f o è n de 'W » . M i | | :
gli'M S f f iJ fm c S Ce que quelques voyageurs on. raconté
sr^tesssss"«ssii;
la'pulfation vifible , fréquente &^orted» carondes ,3
r ^ lu êm ie 6'prétend ! . 1 lu tar^ p reie _ iou,pal^ingorortse" eàf tc ^euttnee ompminiqoune.
coton de iirnn.IV. ,.5 . « to n ..e Son
gr U° S Ï : ^ r r i e s S s Ap tcS fo r s L différens
arbres à coton \ de' cmte plante. Suppl.
RA«,lte elle' fourrdu Comment on la fait. De la
h B W „fages'que l’art humain fait tuer de la OE ||
I f m us Grecs-
. A S î î K ^îâsr.'sAs M.cfoS.de,nu.r^uis lp sw s M B ffes Romains.
noit. Cottes-datmes des a j Cottes-d’armes
d’armes ou fayons des Germaine 3 magnificence que
des François & des G^lois..CeK
les militaires mettoicnt a couleurS| & les pannes
d ’a rmes ont emprunté les » hératus-d’armes portent
^lsauJonrihcdcevêtemeimAquiétoientpermifeslescottcsqii’ils
3' r :nTTF d’A rmïs , ( Hilt. milit.) defcription de cet habilu
mettoient tant à la guerre que dans
Cr& Æ “ vo^ea Chcamvde , BU.GANU.« ,-Tuni-
Q C Ô T tÈ RDEEMA1LLE , nommée htmhr. VIII. 64. e.
COTTERAUX, voyez B r a b a n ç o n s . . VT1T
COTTIER. Fief cottier. VI. 701. b. Homme cotuer. v
a80.tf.Juftice co ttie re.lX .94 .tf. o . T» */•
COTTYTO, déeffe. Ses prêtres & fa fête. II. 60. a.
COTUNN1, ( Dominique) anatômiûe. Suppl. I. 4*4- a"
CO-TUTEUR, voyez T u t e u r . H
COTYLE ( Hift' anc') mefurc altique pour les liqueurs.
Son évaluation. Cotyle romaine. IV. 317. a. On.dit quelle
fervoi. aux chofes feches aufli bien quaux bquides. lbtd. b.
Voye{ HÉM1NE.
M I I la memp
w i i æ p w * à P P S
Partie poftèrieure de, cmi. IL cou.XVI.
rescarotidesducou.II.693-.‘'.? - ver“ XV1I. t6o .4.
,6 , b. 364. «.Vertebres qui lui apparuenuent. i v i c 109.
¡70. b. Nerfs du cou. Suppl. IV- 4?H E „ ,
Cou duchevaby (Marcch.) S«pp/.III.3 7* \- i yV I
COVARRUVIAS , (Diego) éveque efpagnoL XVI.
38COUCHANT. iAflrtm.) celui des équinoxes , celui
d’hiver, celui d’été. IV. 319. é- 1
rntlGHE ( Menüif.) bois de lit. IV. 319. b.
de brafleur, de charpentier. IV. 320. a.
Couche , faujfe , voyez AVORTEMENT, •
T é 'fo T fm & m 1 l “urê&leur pofition.Seppi.II.
métalliques c r y f t f t l ^ W e ” n Æ
ces couches. —— Lin pe, J „orre elolie & à fes nabi-
¡„gè cette ¡}éc ^ Je cctte maiiiere dès le commentans,
1 a formée sa-p1eu p ayant été détruit, cet
cernent , OU quirn m p ^ ^ ^ }um^ le monde
être puiflant & fage . , j arrivé à notre globe des
nue nous habitons. Des.lora dfermtJ.mv a f e g S ï l
rèvoluuons B y É K S g g p . Examen le l’hypothcfe
nté des couÿ .T ^m h e fe fuppofe dans les ftrauhcations
de Linnæus. Cette hvw tele uniformité qui u’çxifte
d=’m W Obfervanons qui la démonttent. Remarpoint,
rom. o»». ie géographie fouterreine. Rien
ques fur i f fl““ “urS bler Ses faits & des obfetvations;
de ■Ç'fitoLïne pS firer trop tôt des conféqueuces géné-
mais il tau«ou 7^ ^ hefo Rien ne nuit plus aux
progtès^e la véritable philoiophie, que l’efptit de fyftême.
iCo uhchihes. DDiivveerrtfeess oobrnfeerrv.a-t-i-o-n--s- fur les lits & couches