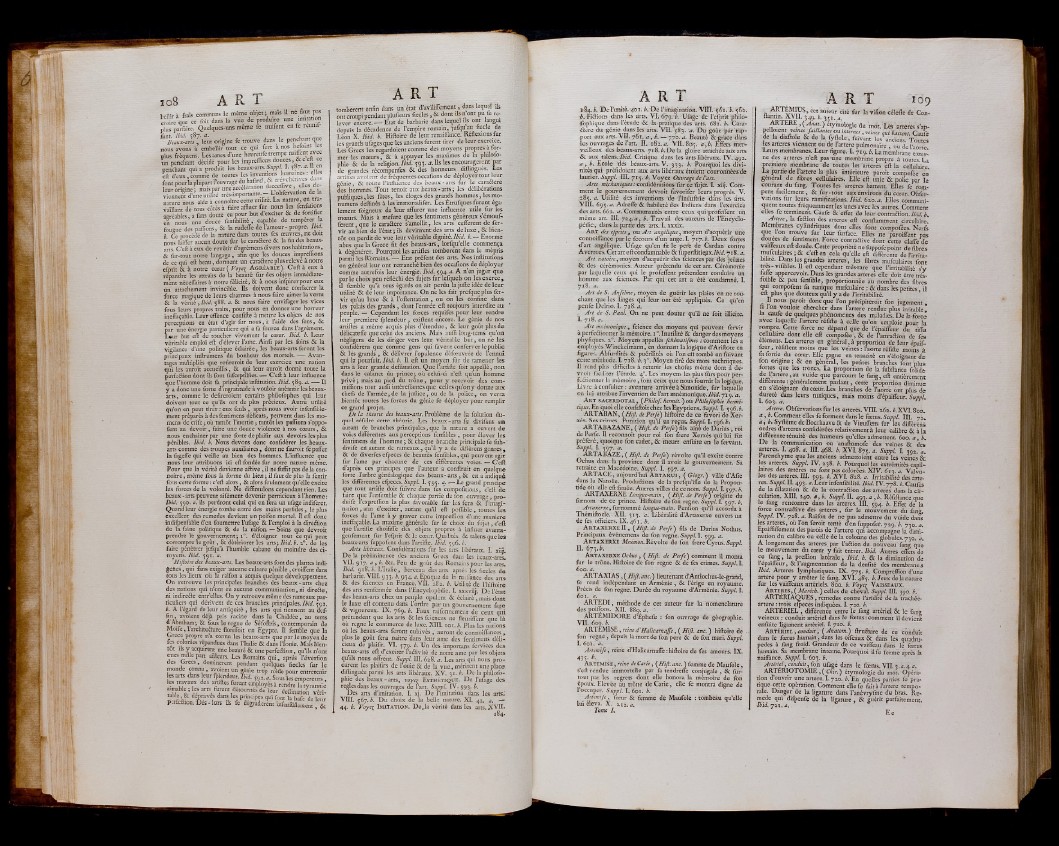
1 0 8 A R T Sjlff plus parfaite. Quelques-uns même le nuifent en fe réumf
^ cmÎ -M s 7, leur origine fe trouve dans le penchant que
nous avons à embellir tout ce qui fert a nos Moins les
plus frèquens. Lesames d’une heureufetrempe n a t o p a voe
un penchant décidé pour les impreffions douces, & c elt ce
penchant quia produit les beaux-arts.Suppl. I. 587.« .u n i
ell d’eux,comme de toutes les inventions humaines elle
font pour la plupart l’ouvrage du hafard » n lip n fve edes iîeleur
origine; mais par une accélération iu«effive ellesde
viennent d’une utilité très-importante - L obfervanon de la
nature nous aide à connoître cette utilité. La nature, en tra
vaillant de tous côtés à faire affluer fur nous les fenfations
agréables, a fans doute eu pour but d exciter & de fortifier
èn nous une douce fenfibilité, capable de tempérer la
fougue des pallions, & la rudeffe de 1 amour - propre. lbid.
b. Ce procédé de la nature dans toutes fes oeuvres, ne doit
nous laiiïer aucun doute fur le caraftere & la fin des beaux-
arts. C’eft à eux de revêtir d’agrémens divers nos habitations,
& fur-tout notre langage, afin que les douces impreffions
de ce qui eft beau, donnent un . caraftere plus releve à notre
efprit 8c à notre coeur ( Voye\ A gréable). C’eft à eux à
répandre les attraits de la beauté fur des objéts immédiatement
néceffaires à notre félicité, 8c a nous infpirerpour eux
un attachement invincible. Us doivent donc confacrer la
force magique de leurs charmes à nous faire aimer la vertu
8c la vérité, lbid. 588. a. 8c nous faire envifager les vices
fous leurs propres traits, pour nous en donner une horreur
ineffaçable. Leur effence confifte à mettre les objets de nos
perceptions en état d’agir fur nous, à l’aide des fens, 8c
par une énergie particulière qui a fa fource dans l’agrément.
Leur but eft de toucher vivement le coeur. lbid. b. Leur
véritable emploi eft d’élever l’ame. Ainfi par les foins 8c la
vigilance d’une politique éclairée, les beaux-arts feront les
principaux inftrumens du bonheur des mortels. — Avantages
multipliés que retireroit de leur exercice une nation
qui les auroit accueillis, 8c qui leur auroit donné toute la
perfeftion dont ils font fufceptables. — C’eft à leur influence
que l’homme doit fa principale inftitution. lbid. 589. à. — Il
y a donc une forte d’ingratitude à vouloir anéantir les beaux-
arts, comme le defireroient certains philofophes qui leur
doivent tout ce qu’ils ont de plus précieux. Autre utilité
qu’on en peut tirer : eux fculs, après nous avoir infenfible-
ment préparés à des fentimens délicats, peuvent dans les mo-
mens de crife, où tantôt l’inertie, tantôt les paffions s’oppo-
fent au devoir, faire une douce violence à nos coeurs, 8c
nous enchaîner par une forte de plaifir aux devoirs les plus
pénibles, lbid. b. Nous devons donc confidérer les beaux-
arts commè des troupes auxiliaires, dont ne fauroit fe paffer
la fageffe qui veille au bien des hommes. L’influence que
nous leur attribuons ici eft fondée fur notre nature même.
Pour que la vérité devienne aftive, il ne fuffit pas de la connoître
, même fous la forme du bien ; il faut de plus la fentir
fous cette forme : c’eft alors, 8c alors feulement qu’elle excite
les forces de la volonté. Ne diffimulons cependant rien. Les
beaux-arts peuvent aifément devenir pernicieux à l’homme:
lbid. 500. a. ils perdront celui qui en fera un ufage indiferet.
Quana leur énergie tombe entre des mains perfides, le plus
excellent des remedes devient un poifon mortel. Il eft donc
indifpenfable d’en foumettre l’ufage 8c l’emploi à la direftion
de la faine politique 8c de la raifon. — Soins que devroit
prendre le gouvernement; i°. d’éloigner tout ce qui peut
corrompre le goût, 8c détériorer les arts; lbid. b. 20. de les
faire pénétrer jufqu’à l’humble cabane du moindre des citoyens.
lbid. 591. a.
Hiftoire des beaux-arts. Les beaux-arts font des plantes indigènes
, qui fans exiger aucune culture pénible, croiffent danc
tous les lieux où la raifon a acquis quelque développement.
On retrouve les principales branches des beaux-arts chez
des nations qui nont eu aucune communication, ni direfte,
ni indirefte entr’elles. On y retrouve même des rameaux particuliers
qui dérivent de ces branches principales. lbid. 591.
b. A l’égard de leur antiquité , les arts qui tiennent au def-
fin, avoient déjà pris racine dans la Chaldée, au tems
d'Abraham; 8c fous le regne de Séfoftris, contemporain de
Moîfe, l’architefture florifloit en Egypte. Il fomble que la
Grece propre n’a connu les beaux-arts que par le moyen de
fes colonies répandues dans l'Italie 8c dans l’Ionie. Mais bientôt
ils y acquirent une beauté 8c une perfeftion, qu’ils n’ont
eues nulle part ailleurs. Les Romains qui, après l’éverfion
des tarées, dominèrent pendant quelques fiecles fur le
r 0nÎ P U * ÎÉ 8 1 1Un §énie tr0P roide Pour entretenir I I S 'eur 1 1 1 I IS Sous les empereurs,
les travaux des milles furent employés à rendre la Vyranme
deftinarioi véri-
S > J t tl‘£ ,? véÎ dim? f e P™C,P=S S font la bafe de leur
P-rfcition. Dés - lors Us fe dégradèrent infeiifiblement, &
ART tombèrent enfin dans un état d’aviliffement, dans lequel ils
ont croupi pendant plufieurs fiecles, 8c dont ils n ont pu fe relever
encore. — Etat de barbarie daps lequel ils ont langui
depuis la décadence de l’empire romain, *jufqu au iiecle de
Léon X. lbid. b. Hiftoire de leur renaifïance. Réflexions fur
les grands ufages que les anciens furent tirer de leur exercice.
Les Grecs les regardoient comme des moyens propres a former
les moeurs, 8c à appuyer les maximes de la philoio-
phie 8c de la religion, lbid. 593. ¿.Ils les encouragèrent par
de grandes récompenfes 8c des honneurs diftingues. Les
arriites avoient de fréquentes occafions de déployer tout leur
génie, 8c toute l’influence des beaux-arts fur le caraftere
des hommes. Tout tenoit aux beaux - arts ; les délibérations
publiques, les fêtes, les éloges des grands hommes, lesmo-
numens deitinés à les immortalifer. Les Étrufques furent également
foigneux de leur affurer une influence utile fur les
moeurs. Mais à mefure que les fentimens généreux s’émouf-
ferent, que le caraftere s’amollit, les arts ceflferent de fer-
vir au bien de l’état; ils devinrent des arts deluxe, ’8c bientôt
on perdit de vue leur véritable dignitè.lbid. b. — Enorme
abus que la Grece fit des beaux-ars, lorfqu’elle commença
à dégénérer. Pourquoi les artiftes tombèrent dans le mépris
parmi les Romains. — Etat préfent des arts. Nos inflitutions
en général leur ont retranché bien des occafions de déployer
comme autrefois leur énergie, lbid. 594.a. A n’en juger que
par le choix peu réfléchi des fujets fur lefquels on les exerce,
il femble qu’à tous égards on ait perdu la jufie idée de leur
utilité & de leur importance. On ne les fait prefque plus fer-
vir qu’au luxe 8c à l’oftentation, ou on les confine dans
les palais des grands , dont l’entrée eft toujours interdite au
peuple. — Cependant les forces requifes pour leur rendre
leur première fplendcur, exiftent encore. Le génie de nos
artiftes a même acquis plus d’étendue, 8c leur goût plus de
déliçateffe que celui des anciens. Mais auffi long-tems qu’on
négligera de les diriger vers leur, véritable but, on ne les
confiaérera que comme gens qui favent conferver le public
8c les grands, 8c délivrer l’opulence défoeuvrée de l'ennui
qui la pourfuit. lbid. b. Il eft un moyen fur de ramener les
arts à leur grande deftination. Que l’artifte foit appelle, non
dans le cabinet du prince; où celui-ci n’eft qu’un nomme
privé ; mais au pied du trône, pour y recevoir des com-
miffions tout auffi intéreffantes que celles qu’on y donne aux
chefs de l’armée,de la juftice,ou de la police, on verra
bientôt toutes les forces du génie fe déployer pour remplir
ce grand projet.
De la théorie des beaux-arts. Problème de la folution duquel
réfulte cette théorie. Les beaux-arts fe divifent en
autant de branches principales, que la nature a ouvert de
voies différentes aux perceptions fenfibles , pour élever les
fentimens de l’homme; 8c chaque branche principale fe fub-'
divife en autant de rameaux, qu’il y a de différens genres,
8c de diverfes efpeces de beautés fenfibles, qui peuvent agir
fur l’ame par chacune de ces différentes voies. — C’efl:
d’après ces principes que l’auteur a confirait en quelque
forte .l’arbre généalogique des beaux-arts, 8c en a indiqué
les différentes efpeces.Suppl. I. 59«. a. •— Le grand principe
que tout arrifte doit fuivre dans fes compofitions, c’eft de
faire que l’enfemble 8c chaque partie de ion .ouvrage , produire
l ’expreffion la plus favorable fur les fens 8c l’imagi-
- nation,'afin d’exciter, autant qu’il eft poffible, toutes fes
forces de l’ame à y graver cette impreffion d’une maniéré
ineffaçable. La maxime générale fur le choix du fujet, c’eft
que l’artifte choififfe des objets propres, à influer avanta-
eeufement fur l’efprit 8c le coeur. Qualités 8c talens que les
Beaux-arts fuppofent dans l’arrifte. lbid. 596. b.
Arts libéraux. Confidérations fur les arts libéraux. L xiiî.
De la prééminence des anciens Grecs dans les beaux-arts.
VII. 917. a , b. 8cc. Peu de goût des Romains pour les arts.
lbid. 9x8. ¿. L’Italie, berceau des arts après les.fiecles de
barbarie. VIII. 933. A 934.¿.Epoque de la naiffance des arts
8c des fciences en France. VII. 282. b. Utilité de l'hiftoire
des arts renfermée dans l’Encyclopédie. I. xxxviij. De l’état
des beaux-arts chez un peuple opulent 8c éclairé, mais dont
le luxe eft contenu dans l’ordre par un gouvernement fage
8c vigoureux. IX. 769. b. Faux raifonnement de ceux qui
prétendent que les arts 8c les fciences ne fleuriffent que là
où regne le commerce de luxe. XIII. 101 .b. Plus les nations
ou les beaux-arts feront cultivés, auront de connoiffances,
plus le goût fera naître ‘dans leur ame des fentimens délicieux
de plaifir. VI. 579. b. Un des importons fervices des
beaux-arts eft d’exciter l’aftivité de notre ame par les objets
qu’ils nous offrent. Suppl. III. 628. a. Les arts qui nous procurent
les plaifirs de l’ouie 8c de la vue, méritent une place
diftinguée parmi les arts libéraux. XV. 31. b. De la philofb-
phie des beaux-arts, voycç E s t h é t iq u e . De l’ufage des
réglés dans les ouvrages de l’art. Suppl. IV. 593. b.
Des arts d’imitation. I. xj. De l’imitation dans les arts.’
VIII. 567. b. Du choix de la belle nature. XI. 42. a. —
44. b, Voyei Im it a t io n . De. la vérité dans les arts. XVII.
284.
ART 184. b. De l ’unité.'401. A De l’imagination. VHÏ. *}6t.'b. 362.
■é. Fiftions dans les arts. VI. 679. A Ufage de l’efprit'philosophique
dans l’étude 8 c. fa pratique des arts. 681. b. Caractère
dii génie dans les arts. VIL 583. a. Du goût'par 'rapport
aux arts. VII. 761. a , b. — 770. a. Beauté 8c grâce dàns
les ouvrages de l ’art. II. 182.a. VII. 805. a ,k Effets merveilleux
des beaux-arts. 718. ¿.'De la gloire attachée aux arts
8c aux talens. lbid. Critique dans les arts libéraux. IV. 492.
a? b. Ecole dés beaux-arts. V . 333. b. Pourquoi lés divinités
qui préfidoient aux arts libéraux étoiehf couronnées de
laurier. Suppl. III. 7 15 .A Voyez Ouvrage de l'art.
Arts méchantques : confidérations ftir ce 'ftijét. 1. xiij. Coih-
ment le gouvernement devroit favorifer leurs progrès. V.
1183. a. Utilité des inventions 'de 'l’hidüftrie dans les arts.
VIII. 6 ^ . a. Adreffe 8c habileté des Indièrfs dans l’exércicè
des arts. 662. ¿.’Communautés entre ceux qui:pröfeflent un
même art. III. 724. <z, b. Travail des àüteürs de l’Encyclopédie,
dans la partie des arts. Lxxxix.
A r t des efprits, ou Art angélique, moyen d’acquérir une
connoiffànce parle fecours d’un ange.I. 717.b. Déux fortes
d’art angélique. Ufage qu’en fit le pété de Cardan contre
Averroés. Cet art eft condamnable 8c'iupefftitießx./£i</. 718. ¿.
Art notoire, moyen d ’acquérir des fciences par dés jeûnes
8c des cérémonies. Auteur prétendu de cet art. Cérémonie
par laquelle ceux qui le profeffent prétendent conduire un
iiomme aux fciences. Par qui cet art a été condamné. I.
y 18. a.
Art de S. Anfclme, moyen de guérir les plaies en ne touchant
que les linges qui leur ont été appliqués. Ce qü’en
penfe Delrio. I. 718. a.
. Art de S. Paul. On ne peut douter qu’il ne foit illicite.
I . 7 i 8 . < x.
Art mnémonique, feience des moyens qui peuvent fervir
à perfeftionner la mémoire. i°. Inutilité 8c danger des moyens
phyfiques. 20. Moyeris appelles fchématifmes : comment les a
employés Winckelmann, en donnant la logiqùe d’Ariftote en
figures. Abfurdités 8c puérilités oii l’on eft tombé en fùivant
cette méthode. 1 .718. b. 30. Moyen tiré des mots techniques.
Il rend plus difficiles à retenir les chôfts même dont il devroit
faciliter l’étude. 40. Les moyens les plus fürs pour per-
feftionner la mémoire, font ceux que nous fournit là logique.
Livre à confulter : aventure arrivée à Simonide, ftfr laquelle
011 lui attribue l’invention de l’art mnémonique. Ibid. yio. a.
A r t SACERDOTAL, ( Philoft hermét. •) oft Philofophie nervié-
tique. En quoi elle corififtôit chez les Egyptiens. Suppl. 1. 396. b.
ARTAB AN, {Hift, dePerfe) hiftoire de ce favori de Xér-
xès. Ses crimes. Punition qu’il en reçut. Suppl. 1. 396.‘b.
ARTABAZANE, (&ï/î. de Pérfe') fils aîné de Darius, roi
de Perfe. U reconnoît pour roi fon frere Xerxès qui lui fut
préféré; quoique fon cadet, 8c meurt enfiiite en le fêrvànt.
Suppl. I. 397. a.
ARTABAZE, ( Hiß. de Perfè) révolte qu’il excite contre
Ochus dans la province dont il avoit ie gouvernement. Sa
retraite en Macédoine. Suppl. I. 397. a.
ARTACE , aujourd’hui A r t à k u i , ( Géogr. ) ville d’Afie
dans la Natolie. Produftions de la prefqu’ifle de la Propon-
tide ou elle eft fituée. Autres villes de ce nom. Suppl. 1. 397, b.
ARTAXERXE Longue-main , ( Hiß. de Perfe j origine du
furnom de ce prince. Hiftoire de fon regne. Suppl. I. 397. b.
Artaxerxe ,{nrnommh longue-main. Penfion qu’il accorda à
Thémiftocle. XII. 313. à. Libéralité d’Artaxerxe envers un
de fes, officiers. IX. 461. b.
A r t a x e r x e I I , {Hiß. de Perfe) fik de Darius Nothus.
Principaux événemens de fon regne. Suppl. I. 399. a.
A r t a x e r x e Mnémon. Révolte de fon frere Cyras. Suppl.
II. 673. b. J rr
A r t a x e r x e Ochus, ( Hiß. de Perfe) comment il monta
fur le trône. Hiftoire de fon regne 8c de fes crimes. Suppl. I,
600. a. . . . .
ARTAXIAS, ( Hiß.anc.) lieutenant d’Antiochus-le-grand,
fe rend indépendant en Arménie, 8c l’érige en royaume.
Précis de fon regne. Durée du royaume d’Arménie. Suppl. I.
601. a.
ARTEDI, méthode de cet auteur fur la nomenclature
des poiffons. XII. 889. a. '
AÏITÉMIDORE d’Éphefe : fon ouvrage de géographie.
VII. 609. b.
ARTEMISE, reine d'Halicamajfc, ( Hiß. anc.) hiftoire de .
fon régné , depuis là mort de fon pere 8c de fon mari. Suppl,
I. 6oi. a.
Artcmife ; réine d’Halicarnafîe : hiftoire de fes amours. IX.
435- b' r - ; B
A rt em ise, reine de Cane, {Hiß. anc.) femme de Maufole,
S’eft rendue immortelle par fa tendreffe conjugale , 8c fur-
tout par. les regrets dont elle honora la mémoire de fon
époux. Elevée au trône de Carie, elle fe montra digne de
l’occuper. Suppl. I. 601. b.
Artcmife, ioeur 8c femme de Maufole : tombeau qu’elle
lui éleva. X. 2x2. ¿,
Tome /,
A R T 1 0 9
h A^TÈMIUS, cet àùteûr cité fur la vîfion célefte de Con-
ftannn. XVII. 349. b. 3 0 . a.
nè.lÆT f RE' ’ ^Ar ati ^ m M m du môt.LèS artefés s’ap-
°de la diaftole 8c de la fyfat o\lneU, Tfuiv ’avneti nlefís anWcienasr. .T Couautefsc
les arteres viennent ou de l’artere pulmonaire , ou de l’aortè
Leurs membranes. Leur figure. I. 719. b. La membrane externe
des arteres n’eft pas rane membrane propre à toutes. La
premierê membrane de touîés les arteres eft la cellulaire»
La partie de l’artere la plus intérieure paroît cómpofée en
général de fibres cèllülaires. Elle eft unie 8c polie par le
courant du fàhg. Toutes les arteres battent. EUes fe rompent
facilement, 8c Air-tout aux environs du coeur. Ôbfer-
vations fur leurs ramifications. ïbid. 620. ¿. Elles communi-
*1“ ent toutes fréquemmeiitles üiies'avec les autres. Comment
elles fe terminent. Càufe 8c effet de leur contraftion. lbid; %
. , ly ej fiction des arteres eft conftamment circulaire»
Membranes cylindriques dont elles font compofées. Nerfs
que loft trouve fur leur fiirface. EUes ne paroiffent pas
doirées de fentiment. Force contraftive dont cette daffe de
vaiffeaux eft douée. Cette propriété ne fuppofo point de fibres
mufculaires;8c c eft en cela qu’elle çft différente del’irrita-
bmté. Dans les grandes arteres , les fibres mùfculaires font
tres- vifibles. Il eft cependant très-rare que l’irritabilité s’v
foffe appercevoir. Dans les grandes arteres elle doit êtretrès-
foible 8c peu fenfible, proportionnée au nombre des fibres
qui compofent fa tunique mufculaire : & dans les petites, il
eft plus que douteux qu’il y a de l’irritabilité.
Il nous paroît donc que l’on précipiteroit fon jugement,
fi Ion vouloit chercher dans l’artere rendue plus irritable,
la caufe de quelques phénomènes des maladies. D e la-force
avec laqueüc lartere refifte à celle qu’on emploie pour la
rompre. Cette force ne dépend que de 1 epaiffeur du tiffu
cellulaire dont eUe eft compofée , 8c de l ’attraftion de fes
élemens. Les arteres en général, à proportion de leur épaîf-
leur, réfiftent moins que les veines : l’aorte réfifte moins à
fa fortie du coeur. Elle gagne en ténacité en s’éloignant de
fon ongine ; 8c en général, les petites branches font plus
fortes que les trônes, La proportion de la fubftance folide
de lartere,an vuide que parcourt le farig, eft entièrement
différente : généralement parlant, cette proportion diminue
en s éloignant du coeur. Les branches de l’aorte oiit plus de
dureté dans leurs tuniques, mais moins d’épaifleur. Suppl.
I. 603. a. cr
Artère. Obfervations fur ies arteres. VIII. 262. b. XVI. 800.
a i b. Comment elles fe forment dans le foetus. Suppl III. jÇ .
a, b. Syftême de Boerhaave 8c de Vieuffens fur les différens
!$%§§ d’arteres confidéréès relativement à leur calibre 8c à la
dutérente ténuité des humeurs qu’elles admettent. 600. ¿ , b.
De la communication où ànaftomofo des veines 8c des
arteres. I. 408. a. III. 46S. b. XVL 873. a. Suppl I. 392. §f
Parenchyme que les anciens admettoient entre les veines 8c
les arteres. Suppl. IV. 238. b. Pourquoi les extrémités capillaires
des arteres ne font pas colorées. XIV. 61 y. a. Valvules
des arteres. III. 393* ^ XVI. 828. a. Irritabilité des arteres.
Suppl. H. 493. a. Leur infenfibilité. lbid. IV. 778. b. Çaufcs
de la dilatation 8c de la contraftion des arteres dans la circulation.
XIII. 240. ay b. Suppl 11. 493. a , b. Réfiftance que
le fang rencontre dans les arteres. IU. 394. b. Effet de la
force contraôive des arteres, fur le mouvement du fang.
Suppl. IV. 728. a. Raifon de ne pas admèttre du vuide dans
les arteres, où l’on feroit tenté d’en fuppofef. 729. b. 730. a.
Epaiffiffement des parois de l’artere qui accompagne la dimi^-
nution du calibre ou cellé de la colonne des globules. 730.
A longementdes arteres. par i’aftion du nouveau fang que
le mouvement du coeùr y fait entrer. lbid. Autres effets de
ce fang, la preffion latérale, lbid. b. 8c la diminution de
l’epaiffeur, 8c l’augmentation de la denfité des membrane.s
lbid. Arteres lymphatiques. IX. 773. b. Compreffion d’une
artere pour y arrêter le fang. XVI. 483. ¿.Jeux de la nature
fur les vàiffeaux artériels. 800. b. Voyez V aisseaux.
A rteres, ( Maréck, ) celles du cheval. Suppl. III. 390. b.
ARTÉRIÀQUES, remedes contre J’àridire de la traefiée-
artere : trois efpeces indiquées. I. 720. b.
ARTÉRIEL , différence entre le fang artériel 8c le fang
Veineux : conduit artériel dans le foetus : comment il devient
enfuite ligament artériel. 1 .710. b.
A rtériel > conduit, ( Anatom.) ftruéhire de ce conduit
dans le foetus humain, dans les oifeàux 8c dans íes quadrupèdes
à fang froid. Grandeur de ce vaiffeau dans lé foetus
humain. Sa membrane interne. Pourquoi il fe fermé après fa
naiffance. Sitppl I. 603. b.
Artériel, conduit, fon ufage dans le foetus. VII. r. a. 4. a.
ARTÉRIOTOMIE, ( Chir.) étymologie du mot. Opération
d’ouvrir une artere. 1. 720. b. En quelles parties fc pratique
cette opération. Comment elle fo fait à I’artere temporale.
Danger de la ligature dans l’anévryfme du bras. Remede
qui difpenfi de la ligature , 8c guérit parfaitement.
lbid. 721, ¿,
Ee