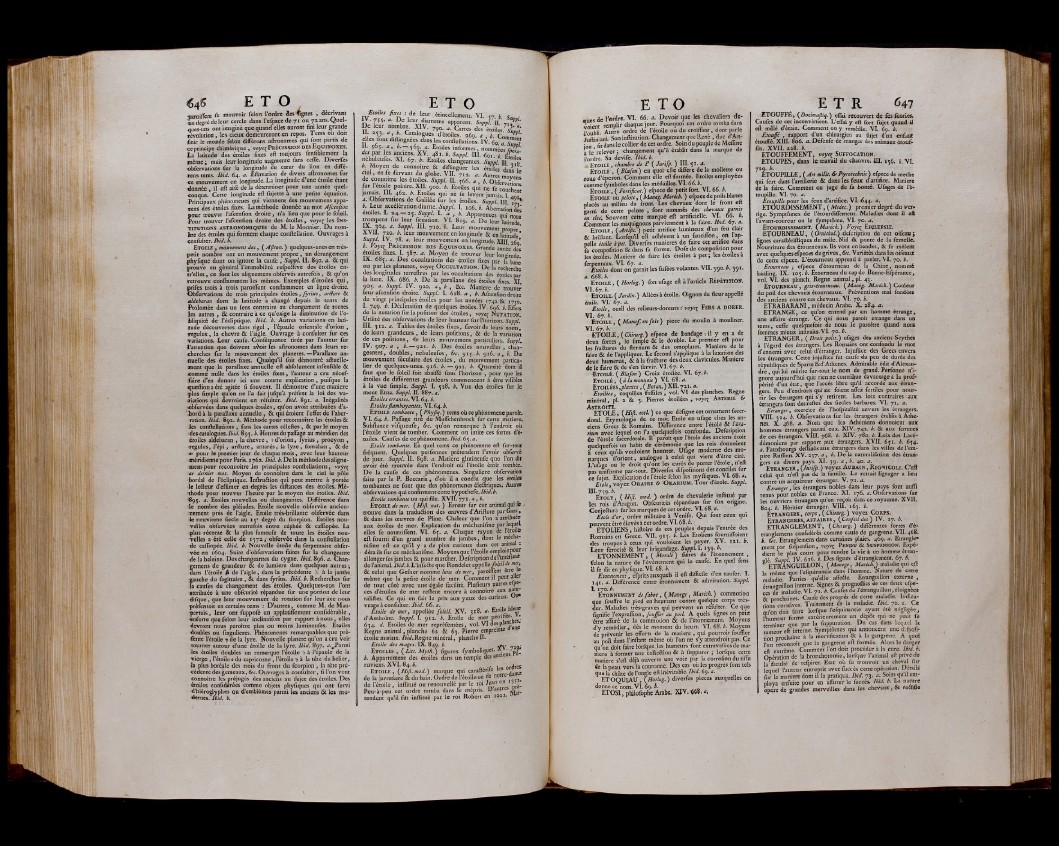
645 E T O
nnroiffem fe mouvoir félon l’ordre désignés , décrivant
‘un degré de leur cercle dans l ’efpace de 71 ou 72 ans. Quelques
uns ont imaginé que quand elles auroat fin» leur grande
révolution, les cieux demeureront-en repos. Tems ou doit
finir le monde félon différens aftronomcs qui font partis de
■ce principe chimérique , voyrçPRÉCESSiON d e s E q u i n o x e s .
La latitude des étoiles fixes eft toujours fenublement la
même; mais leur longitude augmente fans ceffe. Diverfes
obfcrvations iur la longitude du coeur du lion en difté-
rens tems. Ibid. 64. a. Eftimation de divers aftronomes fur
ce mouvement en longitude. La longitude d’une étoile étant
donnée, il eft aifé delà déterminer pour une année quelconque.
Cette longitude eft fujette à une petite équation.
Principaux phénomènes qui viennent des mouvemens appâtons
des étoiles fixes. La méthode donnée au mot Afcenfion
pour trouver l’afcenfion droite, n’a lieu que pour le foleil.
Pour trouver l’afcenfion droite des étoiles, voyrrles I n s t
i t u t i o n s a s t r o n o m i q u e s de M. le Monnier. Du nombre
des étoiles qui forment chaque conftellation. Ouvrages à
confulter. Ibid. b.
E t o i l e , mouvement des, ( Aflron. ) quelques-unes en très-
pctit nombre ont un mouvement propre , un dérangement
phyfique dont on ignore la caufe , Suppl. II. 890. a. & qui
prouve en général l’immobilité refpeâive des étoiles en-
tr’elles, ce (ont les alignemens obfervés autrefois, & qu’on
retrouve conftamment les mêmes. Exemples d’étoiles qui,
prifes trois à trois paroiftent conftamment en ligne droite.
Obfervations de trois pjincipales étoiles, fyrius, arffure &
aldcbaran dont la latitude a changé depuis le tems de
Ptolomée dans un fens contraire au changement de toutes
les autres , & contraire à ce qu’exige la diminution de l’obliquité
de l’édiptique. Ibid. b. Autres variations en latitude
découvertes dans rigel , l’épaule orientale d’orion ,
regulus, la chevre & l’aigle. Ouvrage à confulter fur ces
variations. Leur caufe. Conféquence tirée par l’auteur fur
l ’attention que doivent avoir les aftronomes dans leurs recherches
fur le mouvement des planetes. —Parallaxe annuelle
des étoiles fixes. Quoiqu’il foit démontré actuellement
que la parallaxe annuelle eft abfolument infenfible &
comme nulle dans les étoiles fixes, l’auteur a cru nécef-
faire d’en donner ici une courte explication, puifque la
¡queition a été agitée fi fou vent. Il démontre d’une maniéré
.plus fimple qu’on ne l’a fait iufqu’à préfent la loi des variations
qui devraient en réfulter. Ibid. 891. a. Inégalités
«bfervées dans quelques étoiles, qu’on avoit attribuées d’abord
à la parallaxe annuelle, & qui étoient l’effet de l’aberration.
Ibid. 892. b. Méthode pour reconnoîrre les étoiles &
les conftellations, fans les cartes céleftes, & par le moyen
des catalogues. Ibid. 893. b. Heures du paffage au méridien des
étoiles aldebaran , la chevre , t d’orion, fyrius, procyon ,
regulus, l’épi, arélure, antarés, la ly re, fomahan, &de
*v pour le premier jour de chaque mois, avec leur hauteur
-méridienne pour Paris. 1762. Ibid. b. De la méthode desaiigne-
mens pour reconnoître les principales conftellations, voÿe{
te dernier mot. Moyen de connoître dans le ciel le pôle
boréal de l’édipiique. Inftruétion qui peut mettre à portée
■le leâeur d’eftimer en degrés les diftances des étoiles. Méthode
pour trouver l’heure par le moyen des étoiles. Ibid.
$95. a. Etoiles nouvelles ou changeantes. Différence dans
le nombre des pléiades. Etoile nouvelle obfervée anciennement
prés de l’aigle. Etoile trés-brillante obfervée dans
4e neuvième fiecle au 15e degré du feorpion. Etoiles nouvelles
obfervées autrefois entre céphée 8c cafliopée. La
plus récente 8c la plus fameufe de toute les étoiles nouvelles
a été celle de 1572 p obfervée dans la conftellation
de caifiopée. Ibid. b. Nouvelle étoile du ferpentaire obfervée
en 1604. Suite d’obfervations faites fur la changeante
de la baleine. Des changeantes du cygne. Ibid. 896. a. Chan-
gemens de grandeur oc de lumière dans quelques autres ;
dans l’étoile f» de l’aigle, dans la précédente X à la jambe,
gauche du fagittaire, & dans fyrius. Ibid. b. Recherches fur
1a caufes du changement des étoiles. Quelques-uos l’ont
attribuée à une obfcurité répandue fur une portion de leur
difque, que leur mouvement de rotation fur leur axe nous
préfentoit en certains tems : D’autres, comme M. de Mau-
pertuis, leur ont fuppofé un applatifiement confidérablc ,
«nfortc que félon leur indinaifon par rapport à nous, elles
devront nous paraître plus ou moins lumineufes. Etoiles
■doubles ou fingulieres. Phénomènes remarquables que préfente
l’étoile y de la lyre. Nouvelle planete qu’on a cru voir
tourner autour d’une étoile de la lyre. Ibid. 897. ¿..Parmi
les étoiles doubles on remarque l’étoile y à l’épaule de la
vierge , l’étoile • du capricorne, l’étoile 7 à la tête du belier,
la plus boréale des trois du front du feorpiori, la tête précédente
des gemeaux, 6*c. Ouvrages à confulter, fi l’on veut
connoître les préjugés des anciens au fujet des étoiles. Des
étoiles confiderées comme objets phyfiques qui ont fervi
d’hiéroglyphes ou d’emblêmes parmi les anciens 8c les modernes.
Ibid, b.
E T O
T ' t ' r f V - 790. . . C a r t e s d c / w "
II. a « , a , i . Catalogues d'étoiles. 369. a b Comml!'
elles tout dtihnguécs ians les conftellations. IV. «o / S
des par les anciens. XV.
«^¿leufes. XI. éy.l'EtoHes^hMge™«: S à i / l f e ’
b. Moyen de connoître & diflinguer les étoiles ¿m t
ciel, enfe fervant du globe. VII. 712. a. Autre« ml
de connoître les étoiles. Suppl. II. «66. a b Ohfe? ^CnS
fur fétoile polaire. XII. 900. b. Etoiles qui ne fe couchent
jamais. III. 462. b. Etoiles qui ne fe lèvent jamais. 1 .40i
a. Obfervations de Galilée fur les étoiles. Suppl m *
b. Leur accélération diurne. Suppl. I. 106. b. Aben-ation Ü
étoiles. I. -24. i j . Suppl. I. a , b. Apparences qui nous
trompent fur leur fituation. VI. 819. 4. De leur latitude
y v i? ° 4’ d‘ f T p/' 71°*XV11. 720. b. leur mouveme n1‘t eLne luorn gmituoduev e&m eennt laptriotupdree *’
Suppl. IV. 78. a. leur mouvement en longitude. XIII 260*
b. Foyer P r é c e s s i o n d e s E q u i n o x e s . Grande année des
étoiles fixes. I. 387. a. Moyen de trouver leur longitude.
IX. 685. a. Des occultations des étoiles fixes par la lune
ou par les planetes, voyc{ O c c u l t a t i o n . De la recherche
des longitudes terreftres par les occultations des étoiles par
la lune. IX. 686. b. De la parallaxe des étoiles fixes. X I.
005. a. Suppl. IV. 920. a, b , 8cc. Maniéré de trouver
leur afcenfion droite. Suppl. I. 628. a , b. Afcenfion droite
de vingt principales étoiles pour les années 1742 8c 17*0.
I. 749. b. Déclinaifon de quelques étoiles. IV. 696. b. Effets*
de la nutation fur la pofition des étoiles, voye[ N u t a t i o n .
Utilité des obfervations de leur hauteur fur l’horizon. Suppl.
III. 312. a. Tables des étoiles fixes, favoir de leurs noms,
de leurs grandeurs , de leurs pofitions, & de la variation
de ces pofitions, de leurs mouvemens particuliers. Suppl.
IV. 907. a , b. — 921. b. Des étoiles nouvelles, changeantes,
doubles, nebuleufes, 6>c. 915. fi. 916. a, b. Du
mouvement féculaire des étoiles, du mouvement particulier
de quelques-unes. 916. b. — 921. b. Quantité dont il
faut que le loleil foit abaiffé fous l’horizon , pour que les
étoiles de différentes grandeurs commencent à être viûbles
à la vue fimple. Suppl. I. 528. b. Vue des étoiles fur Je
mont Etna. Suppl. II. 887. a.
Etoiles errantes. VI. 64. b.
Etoiles flamboyantes. VI. 64. b.
E t o i l e tombante, (Phyfiq.) tems où ce phénomène paraît.
VI. 64. b. Paffage tiré de Muffchenbrock fur cette matière.
Subftance vifqueufe, &c. qu’on remarque à l’endroit où
l’étoile vient de tomber. Comment on imite ces fortes d’étoiles.
Caufes de ce phénomène. Ibid. 65. a.
Etoile tombante. En quel tems ce phénomène eft fur-tout
fréquent. Quelques perfonnes prétendent l’avoir obfervé
de jour. Suppl. II. 898. a. Matière glutineufe que l’on dit
avoir été trouvée dans l’endroit où l’étoile étoit tombée.
De la caufe de ces phénomènes. Singulière obfervation
faite par le P. Beccaria, d’où il a conclu que les étoiles
tombantes ne font que des phénomènes éleétriques: Autres
obfervations qui confirment cette hypothefe. Ibid.b.
Etoile tombante ou qui file. XVII.771. a, b.
E t o i l e de mer. ( Hifl. nat. ) Erreur fur cet animal qui f* /
trouve dans la traduaion des oeuvres d’Ariftote par Gaza»
8c dans les oeuvres de Pline. Chaleur que l’on a attribuée
aux étoiles de mer. Explication du méchanifrae par lequel
elles fe nourriffent. VI. 6<. a. Chaque rayon ae l’étode
eft fourni d’un grand nombre de jambes, dont le mécha-
nifme eft ce qu’il y a de plus curieux dans cet animal :
détails fur ce méchanifmc. Moyens que l’étoile emploie pour
allonger fes jambes 8c pour marcher. Defcription de Pintérieur
de l’animal. Ibid. b. L’infeéle que Rondelet appelle foleil de mer,
8c celui que Gefner nomme lune de mer, paroiffent être le
même que la petite étoile de mer. Comment il peut aller
de tout côté avec une égale facilité. Plufieurs autres efpe-
ces d’étoiles de mer reftent encore à connoître aux natu-
raliftes. Ce qui en fait le prix aux yeux des curieux. Dit"
vrage à confulter. Ibid. 66. a. ,.
Etoile de mer, appellée foleil. XV. 518. a. E10?«*" y
d’Amboine. Suppl. I. 912. b. Etoile de mer pétrifiée. •
634. d. Etoiles de-mer repréfentées, vol. VI des plane •
Rcgnc animal, planche 62 & 63. Pierre empreinte
étoile marine. Ibid. Regne minéral, planche II.
Etoile des mages. IX. 840. b. ^ o;
E t o i l e s , ( Litt. Myth. ) figures fymboliques. a ’ s p|l
b. Appartement des étoiles dans un temple des ancien
ruviens. XVI. 84. h. .. . ' rj res
E t o i l e , (Hifl.mod.) marque qui caraftérife les 9
de la jarretiere 8c du bain. Ordre de l’étoile ou de notr
de l’étoile, inftitué ou renouvellé par le roi Jeai e
Peu-à-peu cet ordre tomba dans le mépris. Daut
tendent qu’il fût inftitué par le roi Robert en io»a*
E T O
«lies de I'«dre. VI. 66. a. Devoir tjue les chevaliers dévoient
remplir chaque jour. Pourquoi cet ordre tomba dans
l'oubli Autre ordre de l’étoile ou du croiftant, dont parle
duftiniani. Son inftitmion. Changement que René , duc d’An-
iou fit dans le collier de cet ordre. Soin du peuple de Meffine
4 le’ relever ; changement qu’il établit dans la marque de
l’ordre. Sa devife. Ibid.b.
a ETOILE, chambre de V { Jurifp. ) III. 51.4.
E t o i l e , ( Blafon) en quoi elle différé delà mollette ou ;
roue d’éperon; Comment elle eft formée. Etoiles employées
comme tymboles dans les médailles. VI. 66. b.
E t o i l e , ( Fortifient.) efpece de petit fort. VI. 66. b.
E t o i l e o u pelote, ( Maneg. Maréch. ) efpace de poils blancs .
placés au milieu du front, le s chevaux dont le front eft |
garni de cette pelote , font nommés des chevaux garnis
en tête'. Souvent cette marque eft artificielle. VI. 66. b.
Comment les maquignons parviennent à la faire. Ibid. 67. a.
E t o i l e , ( Artiflc.) petit artifice lumineux d’un feu clair
& brillant. Lorfqu’il eft adhérent à un fauciffon, on l’appelle
étoile ¿pet. Diverfes maniérés de faire cet artifice dans
fa compofmon 8c dans fa forme. Dofede compofition pour
les étoiles. Maniéré de faire les étoiles à pet; les étoiles a
ferpentaux. VI. 67. a.
Etoiles dont on garnit les fufées volantes. VII. 390. b. 391.
668. b. x_
E t o i l e , ( Horlog. ) fon ufage eft a 1 article R é p é t i t i o n .
VI. 67. b.
E t o i l e . ( Jardin.) Allées à étoile. Oignon de fleur appdlé
étoile. VI.' 07. a.
Etoile, outil des relieurs-doreurs : voye[ F e r s a d o r e r .
VI. 67. b. I ,
E t o i l e , ( Manuf. en foie ) piece du moulin à mouliner.
VI - 67.b. . . . »
ETOILE, ( Chirurg. ) efpece de bandage : il y en a de
deux fortes , le fimple & le double. Le premier eft pour
les fraftures du fternum & des omoplates. Maniéré de le
faire 8c de l’appliquer. Le fécond s’applique à la luxation des
deux humérus, & à la fraélure des deux clavicules. Maniéré
de le faire 8c de s’en fervir. VI. 67. b.
É t o i l é . ( Blafon ) Croix étoilée. VI. 67. b.
E t o i l é , {¿lamonnaie) VI. 68. 4.
E t o i l é e s XII. 721.4.
Etoilées, coquilles fofliles, vol. VI des planches. Regne
minéral, pl. 2 8c 3. Pierres étoilées , voye{ A s t e b j e 6»
A s t r o i t e . .
ETOLE, {Hifl. eccl.) ce que défigne cet ornement iacer-
dotal. Etymologie de ce mot. Etole en ufage chez les anciens
Grecs 8c Romains. Différence entre l’étole èc Cora-
rium avec lequel on l’a quelquefois confondu. Defcription
de l’étole facerdotale. Il paraît que l’étole des anciens étoit
quelquefois un habit de cérémonie que les rois donnoient
i ceux qu’ils vouloient honorer. Uiage moderne des monarques
d’orient, analogue à celui qui vient d’être cité.
L’uiaee ou le droit qu’ont les curés de porter 1 étole, nelt
pas uniforme par-tout. Diverfes difpofitions des conciles fur
ce fujet. Explication de l’étole félon les myftiques. VI. 68. a.
Etole, voyez O r a i r e & O r a r i u m . Tour d’étole. Suppl.
^ ¿ t o l e , ( Hifl. mod. ) ordre de chevalerie inftitué par
les rois d’Aragon. Obfcurités répandues fur fon origine.
Conjefture fur les marques de cet ordre. VI. 68.4.
Etole d’or, ordre militaire à Venife. Qui font ceux qui
peuvent être élevés à cet ordre. VI. 68. b. \
ETOLIENS, hiftoire de ces peuples depuis 1 entrée des
Romains en Grece. VII. 91 y b. Les Etoliens fourniffoient
des troupes à ceux qui vouloient les payer. XV. 121. b.
Leur férocité 8c leur brigandage. SuppL I.139. b.
ETONNEMENT, ( Morale) fuites de 1 étonnement,
félon la nature de l’événement qui le caufe. En quel fens
ü fe dit en phyfique. VI. 68. b.
Etonnement, efprits auxquels il eft difficile d en eau fer. I.
141. 4. Différence entte étonnement 8c admiration. Suppl.
î. ijo.b.
E t o n n e m e n t de fabot, ( Manege, Maréch. ) commotion
que fouffre le pied en heurtant contre quelque corps très-
dur. "Maladies très-graves qui peuvent en réfulter. Ce que
fignifie l’expreffion, foujjler au poil. A quels fignes on peut
être affuré de la commotion 8c de l’étonnement. Moyens
d’y remédier, dès le moment du heurt. VI. 68. b. Moyens
de prévenir les efforts de la matière , qui pourrait fouffler
au poil dans l’inftant même où l’on ne s y attendrait pas. Ce
qu on doit faire lorfquejes humeurs font extravafées de maniéré
à former une colleftion 8c à fuppurer ; lorfque cette
matière s’eft déjà ouverte une voie par la corrofion du tiflu
de la peau vers la couronne. Des cas où les progrès font tels
que la chûte de l’ongle eft inévitable. Ibid. 69. a.
ETOQULAU, {Horlog.) diverfes pièces auxquelles on
donne ce nom. VÉ 69. b.
ETOSI, philofophe Arabe. XIV. 668. o.
E T R 647
ÉTOUFFÉ, (Docimafiiq.) effai recouvert de iès feories.
Caufes de cet inconvénient. L’effai y eft fort fujet quand-il
eft mêlé d’étain. Comment on y remédie. VL 69. b.
Etouffé , rapport d’un chirurgien au fujet d’un enfant
étouffé. XUI. 806. 4 . Défenfe de manger des animaux étouffés.
XVII. 228. b.
ETOUFFEMENT, voye{ S u f f o c a t i o n .
ETOUPES, dans le travail du chanvre. III. 156. b. VL
7i£ ^TOUPILLE,r
( Art milit. & Pyrotechnie) efpece de meche
qui fert dans l’artillerie 8c dans les feux d’artifíce. Maniere
de la faire. Comment on juge de fa bonté. Ufkges de l’é-
toupille. VI. 70. 4.
E toupille pour les feux d’artifice. VL 6 44. a.
ETOURDISSEMENT, ( Médec. ) premier degré du ver*
tige. Symptômes de l’étourdiffement. Maladies dont il eft
’’avant-coureur ou le fymptôme. VI. 70. a.
E t o u r d i s s e m e n t . (Maréch. ) Voyeq_ E r j l e p s i e .
ETOURNEAU, {Omithol.) defcription de cet oifeau;
fignes caraétériftiques du mâle. Nid 8c ponte de la femelle.
Nourriture des étourneaux. Ils vont en bandes, 8c fe mêlent
avec quelques efpeces de grives, &c. Variétés dans les oifeaux
de cette efpece. L’étourneau apprend à parler. VL 70. b.
Etourneau -, efpece d’étourneau de la Chine, nommé
kaaling. IX. 105. b. Etourneau du cap de Bonne-Efpérance ,
vol. VI. des planch. Regne animal,pl. 43.
ETOURNEAU, gris-étoumeau. {Maneg. Maréch.) Couleur
du poil des chevaux étourneaux. Préventions mal fondées
des anciens contre ces chevaux. VI. 70. b.
ETRABARANI, médecin Arabe. X. 284. a.
ETRANGE, ce qu’on entend par un homme étrange,
une affaire étrange. Ce qui nous parait étrange dans uo
tems, ceffe quelquefois de nous le paraître quand nous
fommes mieux inttruits.VI. 70. b. .
ETRANGER, {Droit polit.) ufages des anciens Scythes
à l’égard des étrangers. Les Romains ont confondu le mot
d’ennemi avec celui d’étranger. Injuitice des Grecs envers
les étrangers. Cette injuftice fut caufc du peu de durée des
républiques de Sparte &d’Athènes. Admirable édit d’Alexandre
, qui lui mérite fur-tout le nom de grand. Perfonne n’ignore
aujourd’hui qtie rien ne contribue davantage à la prof-
périté d’un état, que l’accès libre qu’il accorde aux étrangers.
Peu d’endroits qui ne foient affez fertiles pour nourrir
les étrangers qui s’y retirent. Les loix contraires aux
étrangers font desreftes des fiedes barbares. VI. 71. a.
Etranger, exercice de l’hofpitalité envers les étrangers.
VIII. 314. b- Obfervations fur les étrangers établis-à Athènes.
A . 466. 4. Nom que les Athéniens donnoient aux
hommes étrangers parmi eux. XIV. 742. b. 8c aux femmes
de ces étrangers. VÍII. 368. b. XIV. 780. b. Loix des Lacé-
démoniens par rapport pux étrangers. XVII. 651. b. 654.
4. Fauxbourgs deftinés aux étrangers dans les villes de l’em-
[ pire Ruflien. XV. 237. a, b. De la naniralifation des étrangers
en divers pays. XI. 39. d , b. 40. a.
E t r a n g e r , {Jurifp.) voyez A u b a i n , R e g v i c o l e . Ceft
celui qui n’eft pas de la famille. Le retrait lignager a lieu
contre un acquéreur étranger. V .7 1 . a. _
Etranger, les étrangers nobles dans leur pays font auffl
tenus pour nobles en France. XI. 176. a. Obfervations fur
les ouvriers étrangers qu’on reçoit dans ce royaume. XVII.
804; b. Héritier étranger. VIII. 163. b.
. E t r a n g e r s , corps, {Chirurg.) voyez C o r p s .
E t r a n g è r e s , a f f a i r e s , {Confeildes) IV. 17. b.
ETRANGLEMENT, {Chuurg.) différentes fortes d’é-
tranglemens confidérés comme caul'e de gangrene. VII. 468.
b &c. Etranglemcns dans certaines plaies. 469. a. Etrangle*
ment par fufpenfion, voyn P e n d u 8c S u s p e n s io n . Expé-*
dient le plus court pour rendre la vie à un homme étranglé
Suppl. IV. 616. b. Des fignes d’étranglement, 67. b.
¿TRANGUJLLON, {Manege, Maréch.) maladie qui eft
la même que l’efquinancie dans l’homme. Nature de cette
maladie Parries qu’elle affefte. Etranguillon externe ,
¿tranquillón interne. Signes & prognoffics de ces deux cfoe-
ces de maladie. VI. 71. *. Caufes de l’itranguillon^éloigniej
& prochaines. Caufe des progrès de cette maladie. Indications
curatives. Traitement de la maladie. ¡M - je - a- Ce
qu’on doit faire lorfque l’efqnmancie ayant été négligée,
l’humeur forme extérieurement un dépôt qui ne peut fe
terminer que par la fuppurarion. Du cas dans lequel la
tumeur eft interne. Symptômes qui annoncent une difpoft-
tion prochaine à la mortification & à la gangrene. A quoi
l’on reconnoît que la gangrene eft formée. Alors le danger
eft extrême. Comment l’on doit procéder à la cure. Ibid. b.
Opération de la bronchotomie, lorfque l’animal eft privé de
la faculté de refpirer. Etat où fe trouvoit uii cheval fuf
lequel l’auteur entreprit avecfuccès cette opération. Détails
fur la maniere dont il la pratiqua. Ibid. 73. a. Soins qu il employa
enfuite pour en affurer le fuccèa. Ibid. b. La nature
opere de grandes merveilles dans les chevaux, 8c rectifie