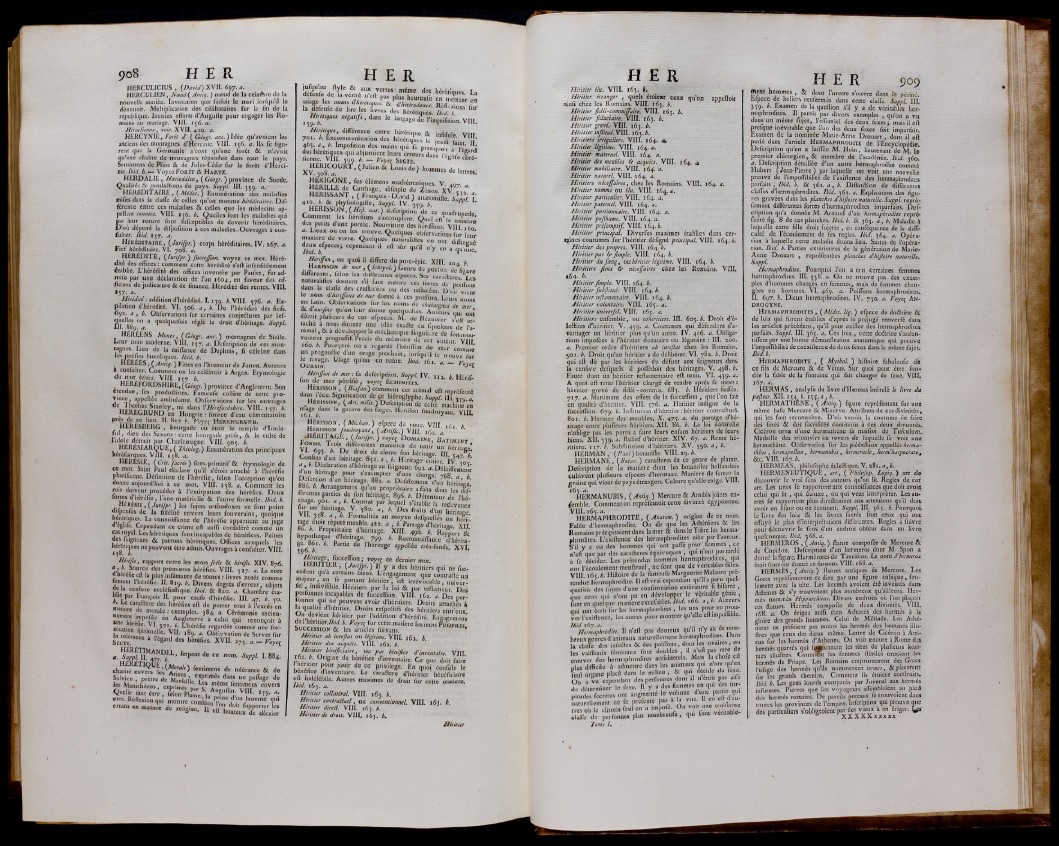
9 o 8 HER HER
HERCULICIUS , {D a v id ) X VII. 607. a.
HERCULIEN, N a u d {A n tiq . ) noeud de la eéîn/Vire de la
nouvelle mariée. Invocation que faifoit le mari lorfqu’il le
dénouoit. Multiplication des célibataires fur la lin de la
république. Inutiles efforts d’Augufte pour engager les R o mains
unon. Auteurs
Argos. Etymologie
au mariage. VIII. 15 6 .4 .
Hiracllennt, voie. X V II, 420. 4 .
HERCV NIÉ, Forêt £ ( Géogr. a n c .) Idée qu’a voient les
anciens des montagnes d’Hcrcinic. VIII. 156. 4 . Ils fe figurent
que la Germanie n’étoit qu’une forêt 8c n’avoit
qu’une chaîne de montagnes répandue dans tout le pays,
oemimens de Pline & de Julcs-Céfar fur la forêt d’H erci-
nie. Ibid. b. •— V o y e z F o r ê t & H a r t z .
H E R D A L IE , Harieddlen, ( Géogr. ) province de Suede.
Qualités & produétions du pays. Suppl. III. 350. 4 .
H É R ÉD ITA IR E , ( Midec. j Enumération des maladies
mifes dans la claffe de celles qu’on nomme héréditaires. D if férence
entre ces maladies 8c celles que les médecins appellent
connées. VIII. i c 6. b. Q u elles font les maladies qui
£iir leur nature font fulceptiblcs de devenir héréditaires,
ou dépend la dilpofirion à ces maladies.« Ouvrages à consulter.
Ibid. 157. 4.
. H é r é d i t a i r e , ( Jurifpr. ) corps héréditaires. IV . 267. 4 .
F ie f héréditaire. V I . 708. 4 .
H É R ÉD IT É , {Jur ifpr.) fuccejjîon. v o y e z ce mot. Hérédité
des offices : comment cette hérédité s’eft infenfiblement
établie. L hérédité des offices inventée par Pauiet, fut ad-
mife par une déclaration de l’an 16 0 4, en faveur des o fficiers
de judicature 8c de finance. Hérédité des rentes. V I I I .
157. 4 .
Hérédité: addition d’hérédité. 1. 139. é .V I I I . 576. 4 . Ex-
Pilation d’hérédité. V l . 306. a , b. D e l’hérédité des fiefs.
1*1 a f ^kfervations I"ur certaines conjeélures par lef-
Ü(1 88 0M 3 ^uc^ uc^°*s droit d’héritage. Suppl.
HÉRÉENS M o n t s , ( Géogr. anc. ) montagnes de Sicile.
Leur nom moderne. V l l l . 157. a. Defeription de ces montagnes.
Lieu de la naiffance de Daphnis, fi célébré dans
f û t *5UCO*i<Iue5* Ibid. b.
HÉRÉES, ( A n t iq , ) Fêtes en l’honneur de Jui
à confulter. Comment on lescélébroit à Areos.
du mot hérées. VIII. 157. b.
HÉRÉFORDSHIRE, ( Géogr. ) province d’Angleterre. Son
étendue, le s produirions. Fam.cufè colline de cette pio-
v in c e , appcllée ambulante. Obfervations fur les ouvrages
né dans l'Hêtêfordshirc. V I I I . 157. b.
H L R LG R U N D en Hongrie : fource d’eau cémcntatoire
u c o c * -Cl,‘ H« 8x2 b. Voy c\ H e r r n g r u n d .
HERESBERG , bourgade où étoit le temple d’Irmin-
1 *i jV ^u xons ’• cette bourgade p r ife , 8c le culte de
i truit Par Charlcmagne. V I I I . 905. b.
^ H É R É S IA R Q U E . ( Théolot. ) Enumération des principaux
héréfiarques. VIII. 158. a .
HÉRÉSIE, {C r it . facrée ) fens.primitif 8c étymologie de
h??** Saint Paul déclare qu'il s’étoit attache à l’héréfie
pharificnne. Définition de l’h é ré fiç , félon l’acception qu'on
donne aujourd’hui à ce mot. VIII. 158. a. Comment les
rois doivent procéder à l’extirpation des héréfics. D eu x
u l J , » l> ne matérielle 8c l’autre formelle. Ibid. b.
A'C W Ê Ë m Ê M Ê *cs fui « s orthodoxes ne font point
dupent es de la fidélité envers leurs fouverains, quoique
5» , es. La connoiffance de l’h éréfie appartient au juge
6l,fe' Cependant ce crime eft auffi confidéré comme un
cas royal. Les hérétiques font incapables de bénéfices. Peines
des Icigneurs 8c patrons hérétiques. Offices auxquels les
Jierenques ne peuvent être admis. O uvrages à confulter. V III.
2{o. b,
H ir lfit., rapport entre les mots f t l i t & hlréfit, X IV . 87«.
<1« premières héréfics. V I I I . 5 17. a. La note
il relie cil la plus inllmante de toutes : livres notés comme
ntant lhérélie. II. 819, b. Divers degrés d’erreur, objets
« U cenlurc eccléfiaftique. Ibid. & 8ao. a. Chambre éta-
S i par François 11. pour caufc d’héréfte. III. 47. b. ,0 .
marit.C*!t e df s h*r4fie* Ü dc porter tout il l’cxcés en
3 1 1 1 c« mJ>k s - 384- *• Cérémonie ancienune
héVAfi t n Cn ^ cBltïî qui renonçoit à
W Ê Ê Ê m Ë k E Si r i f ,e «gard ée comme une for-
la tolérance'4Un iC‘ Y î - 9’ Obfervatiçn de Sc rvet fur
S e c te | l é 8ard des héréftes. X V I I . a7 ! . Voyc^
a . W ? i M^ DtE L ’ fcrP ' " ‘ de c e nom. Suppl. I. 884.
charité eiî?ms H p l I ! de «oWnince 8c de
Salvien, prêtre de l | S l l l P i da"? P ^ S ' de
les Manichéens cxorimA. o î 1-”16 fcntimens envers
Quelle doit être, Iclon Pliton la S f u i S$Sü ' !9' È
erre. Réflexion qui montre eomblcnK, 4 •“" r "’' V
matière de
turquau ftyle & aux vertus même des hérétioue« I .
P l l l l gart/t, dans le langage de l’¡„q „ ifiti„ „ . VIII.
H é r f im u , différence entre hérétique & infidèle V I I I
70 1 . b. Excommunication des hérétiques le , , / ! î ’
463; | Impofition des mains q u i V p r a . i ^ ' f e “ i
des hérétiques qui abjuraient leurs erreurs dans IV.u r I 1
tienne. VÏII. jo n . b. - V o y . , Se c te lég l,fe cll' ré-
X V . r a 8 CuÜ U ’ (Ju li“ * ^ ° UiS ho,nmcs de lettres
» r«» élémens mathématiaites V .0 ,
HÉR S S A N T de ^énon. X V . 532 !'4
■ O ! t ^ ’ | ^ François - D..vid ) anaromifte. b l l p l l
4*0*1M 8c phyfiologifle, Suppl. IV . i ç o b
C d î i 1 1’ W W nat‘ î dcfcriPtio‘1 de ce quadrupède
Comment les hériifons s accouplent. O u e l eft 1*» „ J L i *
des petits d’une portée. Nourriture des hénffons. V l l l ^ & f
* Lieux ou on tes trouve. Quelques obfervations fur‘ lé ,if
mamere de v iv re. Quelques n a tu re lle s en ont diftingüé
deux efpeees; cependau. il eft sûr qu’il „ ’y en a q u ï t
H ir if fo n , en quoi il différé du porc-épic. X III toa i
HERtss°N i . m e r , ( I ch iy o l.) Genre de poitlhn de-figure
différente, lêlon les différentes elpeces. Ses c,-tráileres Les
naturaliftes doutent s il faut mettre ces limes de poilfons
tiens la «laffe des cruftaeées ou des icftacées. D'où vient
le nom À J t tr fo n s d , mer donné à ces poiffons. Leurs noms
en Uttn Oblervattons fur les noms de e/„/r.,i6„ * d. m e r ,
& A o ur fin , tpi on leur donne quelquefois. Autéur» qui onî
décrit plufieurs de ces efpeees. M. de Réaumur s\-ft at-
taché à nous donner une idée exaflc du fquelctre de l’animal
, 8e à développer la meehatuque finguliere de fon mouvement
progrcfftf. Frects du mémoite de cet auteur V I I I
id o . b. Pourquoi on a regardé l’hériffon de mer ranime'
un prognofltc d un orage prochain, lorfqu’il fe trouve lur
le rivage. Ufage qu on cn retire. Ibid. td i . a — V b 'i i i
O u r s in. r °y* \
Hérijfon de mer: fa defeription. Suppl. J V l -r
fon de mer pétrifié, voyeç É c h in í t e s , f"
H érisson , (B la fo n ) comment cet animal eft repréfenté
dans lieu.Signification d ç ç c hiéroglyphe.Suppl. H -
H é r is so n , ( .A , t . m ili,.);Defcrijn,on de cene machi,îe^'en
1 6 ? b Sucrre dc» fieges. Hcriffon foudroyant. V Í IL
H é r is so n , | Méchan. ) efpecc de roue. V I I I t,
{ A r l‘f lc' ) V lU - * ¿ 2 . a . ' *
.J iL R l I A G E , (Junfpr.) voyeç D om a in e , B â t im e n t •
F o n d s . TrotsL différentes manieres de tenir un héritage’
V I . 693. b. Du droit de clotre fon héritage. III - . - c"
Confins d tm hé ritage.;8 ,1.1 b. Héritage coder. Æ '
a , b. Déclarât,on d’hérttage au feigueur. tfÿa .e. Délaiffetieni
d u n héritage pour s exempter d’une charge. 7 fi8 a b
Defernon Jtm héritage 88a. e. Défiftemen, d'un héritage
886. b. Arrangemens qu un propriétaire a faits dans les J f- ‘
S 5 T - ? * 1" Í ‘ J ° " 1,ase; « b- Dérentcur de l’hé-
m a g e .9 0 . e , i . Contrat par lequel s’établit la redevance
f t r un Itémage, V . 3 0 a , b. D e , fruits d’un C “
V 1 F o™ al,ti‘ ? » moyen defqttelles un héritage
étot, réputé; meuble. 42». 4 , i . Partage d’héritage. X L
»5. b Propriétaire d’hérttage. XIII. 49S. b. Rapport &
hypotlteque d’ltérttagc. ™^. b. Reeonnoiffauée ’ t f ié r iu -
596 * I héritage appcllée trés-fonds. X V I .
B | n v °y ‘ l oe dernier mot.
H É R IT IE R , ( JunJpr. ) Il y p des héritiers qui ne fuc-
cedent qtt à certains biens. L ’engagement que contraélc un
hé r itie r , eft irrévocable, univer-
t mdtvifible. Héritiers par la loi 8c par teftamenr. Des
perfonnes incapables de fucccffion. VIII. 162. 4. D es per-
ionnes qui ne peuvent avoir d’héritiers. Droits attachés à
la qualité d héritier. Droits refpeflifs des héritiers efitr’eux.
O n devient hériuer par l’addition d’hérédité. Engagcmcns
de 1 héritier.Ibid. b. Voÿc£ fur cette matière les mots Pro pr e s .
S u cce ssio n 8c les articles fui vans. ?
Héritier ab inteflat ou légitime. V I I I . 162. b.
Héritier des acquêts. VIII. 162. b.
H lrm e r b ln lf i c u ïr . , ou par blntfice d ’inventaire. VIII.
i l s - i s ç m o du bénéfice d’inventaire. C n que doit faire
lh ém te r pour jouir de ce privilège. En quoi conftfte le
n • a îte f'," vc.n,alre’ L c “ « « e r e d’héritier bénéficiaire
elt mdéléhtle. Autres maximes de droit fur cette matie-re.
ibtd. 162. 4 .
Héritier collatéral. V I I I . 163. b.
Héritier contrañnel, ou conventionnel. V I I I . 163. b.
Héritier direfl. VIII. 163. b.
Héritier de droit. V I I I , 163. b.
Héritier
HER Héritier élu. V I IL 163. b.
Héritier étranger , quels étolent ceux qu’on Sppcllok
.-\iiifi chez les Romains. VIII. 163. b.
Héritier fidéi-commijfaire. VIII. 163. b.
Héritier fiduciaire, v l l l . 163. b.
Héritier grevé. VIII. 163. b.
H é r it ie r in J litu é .V lll. i6 x .b .
Héritiers irréguliers. V I I I . 164. 4.
Héritier légitime. V I I I . 164. a.
Héritier maternel. V I I I . 164. 4 .
Héritier des meubles 8* acquêts. VIII. 164. ai
Héritier mobiliairc. VIII. 16 4. a.
Héritier naturel. V I I I . 164. a.
Héritiers néccjfaires, chez les Romains. V I I I . 164. a.
Héritier nommé ou élu. VIII. 16 4 . a.
Héritier particulier. VIII, 164. a.
Héritier paternel. VIII. 164. a.
Héritier portionnaire. VIII. 164. a.
Héritier pofihume. V I I I . 164. a.
Héritier prêfomptif. V I I I . 164. b.
Héritier principal. Diverfes maximes établies dans certaines
coutumes ;fur l’héritier défigné principal. VIII. 164. b.
Héritier des propres. VIII. 164. b.
Héritier p u r O fimple. V I I I . 164. b.
Héritier du fa n g , o u héritier légitime. V I I I . 164. b.
Héritiers fiens 6* néccjfaires chez les Romains. VIII.
464. b.
Héritier fimple. V I I I . 164. b.
Héritier fubflituê. VIII. 164. b.
Héritier teflamentaire. VIII. 164. b.
Héritier volontaire. VIII. 165.-4.
Héritier univerfel. VIII. 165. a.
Héritiers cnfcmble, ou cohéritiers. III. 605. b. Droit d'é-
leélion d’héritier. V . 459. a. Coutumes qui défendent d’avantager
un héritier plus qu’un autre. IV . 416. a. Obligations
impofées à l’héritier donataire ou légataire : III. 200.
4 . Premier ordre d’héritiers ab inteflat chez les Romains.
•901. b. Droit qu’un héritier a de délibérer. V I . 782. b. Droit
qui cR dû par les héritiers du défunt aux feigneurs dans
la cenfive dcfquels il poffédoit des héritages. V . 498. b.
Faute dont un héritier teftamentaire cil tenu. V I . 439. a.
A quoi eft tenu l’hériticr chargé de rendre après fa mort :
héritier grevé de fidéi - commis. 683. b. Héritiers fieffés.
7 1 7 , a. Maní ment des effets de la fucceflion | que l’on fait
en qualité d’héritier. VIII. 576. a. Héritier indigne de la
fucceffion. 679. b. Inftitution d’héritier : héritier contractuel.
801. b. Héritier des meubles, X . 475« du partage d'hé-
HER 9 0 9
xitage entre plufieurs héritiers. XII. 86. b. La loi naturelle
n’oblige pas les pères à faire leurs enfans héritiers de leurs
biens. X II. 329. a. R e lie f d’héritier. X IV . 67. a. Rente héritière.
1 1 7 . b. Subftitution d ’héritiers. X V . 5 9 0 .4 , b.
H E RM A N , { P a u l ) boranifte. VIII. 29. b.
H E RM A N E , {B o ta n .) caraftcresdc ce genre de plante.
Defeription de la maniéré dont les botaniftes hollandois
cultivent plufieurs efpeees d’hermane. Maniéré de femer la
graine qui vient de pays étrangers. Culture qu’elle exige. V III.
X65.4. - . .
H E RM AN U B IS , ( Antia. ) Mercure 8c Anubis joints ensemble.
Comment on repréfentoit cette divinité égyptienne.
V l ll . 165.4. % j
H E RM A PH R O D IT E , {A n a tom . ) origine de ce nom.
Fable d’hermaphrodite. On dit que les^ Athéniens 8c les
Romains précipitoient dans la mer oc dans le Tibre les hermaphrodites.
L’exiftcnce des hermaphrodites niée par 1 auteur.
S ’il y a eu des hommes qui ont paffé pour femmes , ce
n’eft que par des carafteres équivoques, qui n ont pas tardé
à fe décider. Les prétendus hommes hermaphrodites, qui
ont l'écoulement mcnftrue!, ne font que de véritables filles.
V I I I . 165. b. Hiftoirc de la fameufe MargueriteMalaure prétendu*
hermaphrodite. Il eft vrai cependant qu’il a paru quelquefois
des fujets d’une conformation extérieure fi bifarre ,
que ceux qui n’ont pu en développer le véritable g én te,
font en quelque manière cxcufables. Ibid. 166. 4 , b. Auteurs
qui ont écrit fur les hermaphrodites , les uns ponr en prouv
e r l’exiftencc, les autres pour montrer qu elle eft impoffible.
lb,dH tm a p h ro Jitt. Il n’eft pas douteux qu’il n’y ait de nombreux
genres d’animaux naturellement hermaphrodites. ILins
la claffe des infeétes 8c des poiffons, dont les ovaires, ou
les vaiffeaux féminattx font double, , il n eft pas rare de
trouver des hermaphrodites accidentels. Mats la choie elt
plus difficile à admettre dans les animaux am n o a r quun
?cul organe placé dans le milieu , & qu; décide du fexe.
O n a vu cependant des perfonnes dont il nétott pas atfé
de déterminer le fexe. Il y a des femmes en qu, des terphudes
fccrètes ont augmenté le volume d’une parue qu,
’naturellement ne fe prêfente pas h la tiattirc lement ne i i Qn vvuoek. Itml een treoftt fdicamue-
claffe de perfonnes plus norobreufe, qui font véritable-
Tome ,
Aient hommes , & dont l’uretre s’ouvre dans le périné.
b fpece de beliers renfermés dans cette claffe. Suppl. III*
359. b. Examen d e là queftion s’il y a de véritables hermaphrodites.
Il paroi t par divers exemples , qu’on a vu
dans un même fu je t, l’effemicl des deux fexe s; mais il eft
prcfque inévitable que l’un des deux fexes foit imparfait.
Examen de la nommée Marie-Anne D ro u a r t , dont il eft
parlé dans l'article H erm aphro d ite de l’Encyclopédie.
Defeription qu’en a laiflêc M. Hoin, lieutenant de M. le
premier chirurgien , 8c membre de l’académie. Ibid. 360.
a. Defeription détaillée d’un autre hermaphrodite nommé
Hubert (Jean-Pierre) par laquelle on voit une nouvelle
preuve de l’impoflibilité de l’exiftcnce des hermaphrodites
parfaits, Ibid. b. 8c 361. a , b. Diftinétion de différentes
claffes d’hermaphrodites. Ibid. 362. a. Explication des figures
gravées dans les planches d'hifioire naturelle. Suppl. repré*
fe ntant différentes fortes d’hermaphrodites imparfaits. D e f eription
qu’a donnée M. Arnaud d’un hermaphrodite repré»
fenté fig. 8 de ces planches. Ibid. b. 8c 363. a , b. Maladie h
laquelle cette fille étoit fujette , en conféqucnce de la diffi*
culté de l’écoulement de fes regies. Ibid. 364. a. Opération
à laquelle cette maladie donna lieu. Suites de l’opération.
Ibid. b. Parties extérieures de la génération de Marie-
Anne Drouart , repréfentées planches d ’hifioire naturelle.
Suppl.
Hermaphrodites. Pourquoi l'on a cru certaines femmes
hermaphrodites. III. 538. 4 . On ne trouve pas des excm-»
pies d’hommes chaneés cn femmes, mais de femmes changées
en hommes. V I . 469. a.- Poiffons hermaphrodites.
II. 697. b. Dieux hermaphrodites. IV . 730. a. Voye,j; ANDROGYNE.
H erm aph ro d ite s , ( Mêdec. lêg. ) efpece de doétrine 8c
de loix qui furent établies d’après le préjugé renverfé dans
les articles précédens, qu’il peut exifter des hermaphrodites
parfaits. Suppl. III. 365. a. Ces loix., cette doélrine s’anéan-
tiffent par une bonne démonftration anatomique qui prouve
l’impolfibilitédc coëxiftence de deux fexes dans lc même fujet.
Ibid.b.
H e rm aph ro d ite , ( Mythol. ) hiftoire fabuleufc dé
ce fils de Mercure 8c de Vénus. Sur quoi peut être fondée
la fable de la fontaine qui fait changer de fe x e . VIII.
167. 4 .
H E RM A S , analyfe du livre d’Hermas intitulé le livre du
pafieur. XII. 154. b. 1 5 5. a , b.
HERMATHÊNE , ( Antiq. ) figure repréfentant fur une
même bafe Mercure 8c Minerve. Attributs de ces divinités , 3ni les font reconnoitre. D ’où venoit la coutume de faire
es fêtes 8c des facrifices communs à ces deux divinités.
Cicéron orna d’une hermathône fa maifon de Tufculum.
Médaille des triumvirs au revers de laquelle fe voit une
hermathêne. Obfervation fur les piédeftaux appelles henna-
thêne , hermapollon, her ni anubis, hermeracle, herm ’harpocrate B
8cc. VIII. 16 y .b .
HERMEAS, philofophc édeftique. V . 2 8 1 .4 , b.
HERMENEUTIQUE , a r t, { Philofop. Logiq. )
découvrir lc vrai fens des auteurs qu’on lit. Réglés de. cet'
art. Les unes fe rapportent aux connoiffances que doit avois
celui qui l i t , qui -écoute, ou qui veut interpréter. Les au»
très fe rapportent plus dircâeinent aux attentions qu’il doit
avoir en filant ou cn écoutant. Suppl. III. 365. b. Pourquoi
le livre des loix 8c les livres facrés font ceux qui ont
effuyé le plus d’interprétations différentes. Règles à fuivre
pour découvrir le fens d’un endroit oblcur dans un livre
quelconque. Ibid. 366. a.
HERMEROS , { A n t iq . ) ftatue compofée de Mercure &
de Cupidon. Defeription d’un hermeros dont M. Spon a
donné la figure. Hermérotes de Taurifcus. Le nom d ’hermeros
étoit fouvent donné en furnom. V II’1. 168. a.
HERMÈS, {A n t iq .) ftarues antiques de Mercure. Les
Grecs repréfenterent ce dieu par une figure cubique, feulement
avec la tête. Les hcrmés avoient été inventés dans
Athènes 8c s’y trou voient plus nombreux qu’ailleurs. Hermès
nommés Hipparchiens. Divers endroits où l’on plaçoit
ces ftatues. Hermès compofés de deux divinités. V I I I .
168. a. On érigea auffi dans Athènes des hcrmès à la
gloire des grands hommes. Celui de Miltiade. Les Athéniens
ne prifoiciit pas moins les hermês des hommes illu-
ftres que ceux des dieux même. Lettre de Cicéron à.Atti-
cus fur les hcrmès d’Athencs. On voit encore a Rome des
hcrmès quarrés qui fcjjjflennent les têtes de plufieurs hommes
illuftres. Comment les femmes ftèriles ornoient les
hermês de Priapc. Les Romains empruntèrent des Grecs
l’ufagc des Hermès qu’ils nommèrent termes, 8c placèrent
fur Tes grands chemins. Comment Us étoient conftruits.
Ibid. b. Les gens lourds comparés par Juvcnal aux hermês
informes. Pierres que les voyageurs affembloient au pied
des Hermès romains. D e pareils poteaux fe trouvoicnt dans
toutes les provinces de l’empire. Infcription qui prouve que
des particuliers s’obligeoient par des 'voeux a en ériger,
l x X X A A XXXXX