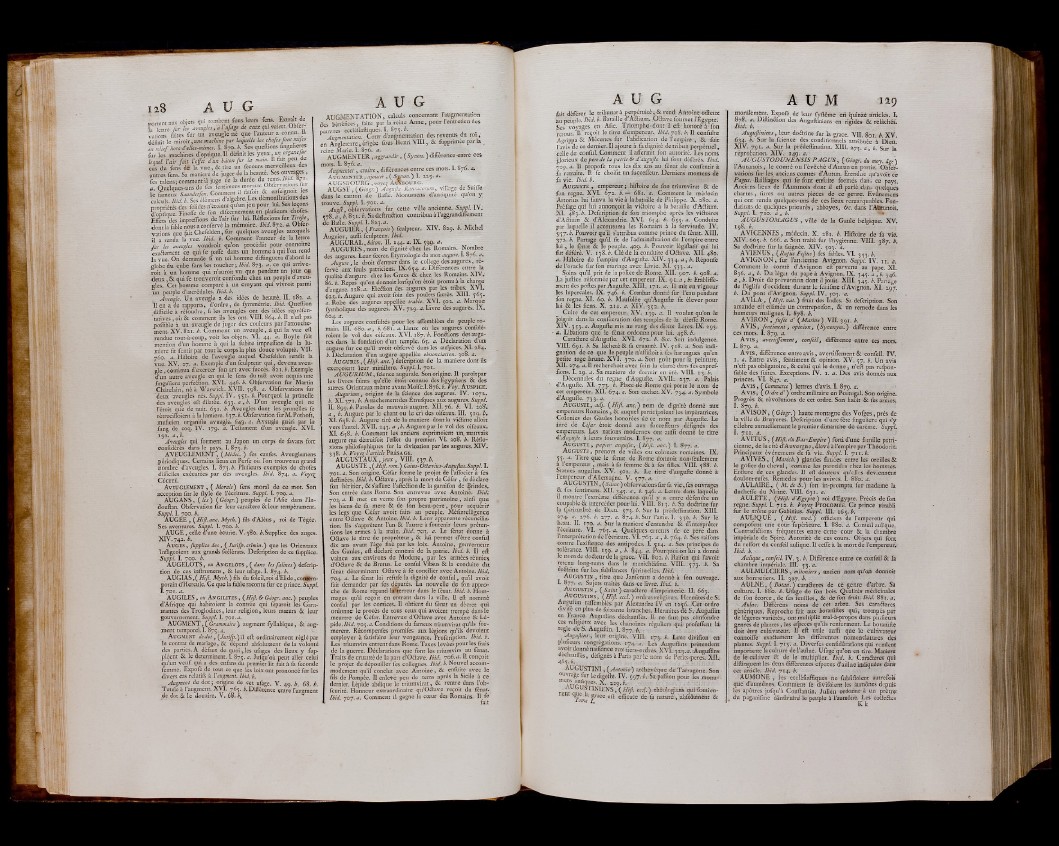
1 2 8 A V G A U G
_„v obiets qui tombent fous leurs fens. Extrait de
Fa lettre fur les aveugles , à l’ufage de ceux qui voient. Obfer-
rations faites fur un aveugle né que 1 auteur a connu. 11
définit le miroir, «ne machine par laquelle Us chofes Jont mtj es
en r e lie f hors d’elles-mêmes. I. 870. h. Ses queftions finguüeres
fur les machines d'optique. Il définit les yeux , un organeJur
lequel l’air fait l'effet d'un bâton fur la main. Il fait^peu de
cas du fens dê la vue, & tire un fecours merveilleux-des
autres fens. Sa manière de juger de la beauté. Ses ouvrages ,
fes talens; comment il juge de la durée du terns.1 1 . 87| |
a Ouelaues-uns de fes fentimens moraux. Obfen auons iur
le fameux Saunderfon. Comment il faifoit & enfoignoit les
calculs. Ibid. b. Ses élémens d’algebre. Les demonftrauons des
propriétés des folides n’étoient qu un jeu pour lui. Ses leçons
d’optique. Fincffe de fon décernement en plufieurs chofes.
Effets des impreflions de l’air fur lui. Réflexions fur Tirefie,
dont la fable nous a confervé la mémoire. ibid. 87a. a. UDier-
vations que fait Chefelden, fur quelques aveugles auxquels
il a rendu là vue. Ibid. b. Comment l’auteur de la lettre
fur Us aveugles voudroit qu’on procédât pour connoître
exactement ce qui fe paffe dans un homme a qui l’on rend
la vue. On demande fi un tel homme diftinguera d’abord le
globe du cube fans les toucher; Ibid. 873. a. ce qui arrive-
roit à un homme qui n’auroit vu que pendant un jour ou
deux, & qui fe trouyeroit confondu chez un peuple d’aveugles.
Cet homme comparé à un croyant qui vivroit parmi
un peuple d’incrédules. Ibid. b.
Aveugle. Un aveugle a des idées de beauté. II. 182. a.
Il en a de rapports, d’ordre, de fymmétrie. Ibid. Queftion
difficile à réfoudre, fi les aveugles ont des idées repréfen-
tatives, où & comment ils lés ont. VIII. 864. b. Il n’eft pas
poflïble à un aveugle de juger des couleurs par l’attouchement.
XV. 821. b. Comment un aveugle, à qui la vue eft
rendue tout-à-coup, voit les objets. VI. 44. a. Boy le fait
mention d’un homme à qui la fubite impreflïon de la lumière
fit fentir par tout le corps la plus douce volupté. VII.
760. a. Hiftoire de l’aveugle auquel Chefelden rendit la
vue. XV.. 27. a. Exemple d un fculpteur qui, devenu aveugle
,-continua d’exercer fon art avecfuccès. 821.¿.Exemple
d’un autre aveugle en qui le fens du taâ avoit acquis une
fmguliere perfection. XVI. 446. b. Obfervation fur Martin
Châtelain, né à Warwick. XVII. 598. a. Obfervations fur
deux aveugles nés. Suppl. IV. 351. b. Pourquoi, la prünelle
des aveugles eft dilatée. 633. a , b. D’un aveugle qui ne
l’étoit que de nuit. 631. b. Aveugles dont les prunelles fe
rétrecifloient à la lumière. 637.¿.Obfervation furM.Pothoft,
muficien organifte aveugle. 649. a. Aveugle guéri par le
fang de coq, IV. 179. a. Teftament d’un aveugle. XVI.
192. a,b.
Aveugles qui forment au Japon un corps de favans fort
Confidérés dans le pays. I. 873. b.
AVEUGLEMENT, (Médec. | fes caufes. Aveuglemens
périodiques. Certains lieux en Perfe où l’on trouve un grand
nombre d’aveugles. I. 873.b. Plufieurs exemples de chofes
difficiles exécutées par des aveugles. Ibid. 874. a. Voyeç
C écité.
A veuglement , ( Morale) fens moral de ce mot. Son
acception fur le ftyle de l’écriture. Suppl. I. 700. a.
AUGANS, ( /fi ) ( Géogr.) peuples de l’Afie dans l’In-
douftan. Obfervation fur leur caraécere Scieur tempérament.
Suppl. I. 700. b.
AUGÉE, ( Hijl.anc. Myth. ) fils d’Aléus, roi de Tégéç.
Ses aventures. Suppl. 1. 700. b.
AUGE, celle d’une écurie. V . 380. ¿.Supplice des auges.
XIV. 742 .b.
A uges , fupplicc des , ( Jurifp. crimin.') que les Orientaux
înfligeoient aux grands fcélérats. Defcription de ce fupplice.
Suppl. I. 700. b.
AUGELOTS, ou A ngelots , ( dans Us falines ) defcription
de ces inftrumens, 8c leur ufage. I. 874. b.
AUGIAS, (Hift. Myth.) fAs du foIeil,roi d’Elide ,conïemf
'orain d’Hercule. Ce que la fable raconte fur ce prince. Suppl.
701. a.
AUGILES, ou A nGILITES , ( Hijl. & Géogr. anc. ) peuples
d’Afrique qui habitoient la contrée qui feparoit les Gara-
mantès des Troglodites, leur religion, leurs moeurs 8c leur
gouvernement. Suppl. I. 701. a.
AUGMENT, ( Grammaire ) augment fyllabique, & augment
temporel. 1 .873. a.
A ugment de dot, (Jurifp.)W eft ordinairement réglé par
le contrat de mariage, & dépend abfolument de la volonté
des parties. A défaut de quoi, les ufages des lieux y fup-
pléent & le déterminent. 1.875. a. Jufqu’où peut aller celui
qu’un veuf qui a des enfans du premier lit fait à fa fécondé
femme. Expofé de tout ce que les loix ont prononcé fur les
divers cas relatifs à l’augment. Ibid. b.
Augment de dot; origine de cet ufage. V. 49. b. 68. b.
Tutelcà l’augmenr. XVI. 763. ¿.Différence entre l’auement
‘de dot 8c le douaire. V. 68. bK
AUGMENTATION, calculs concernant l’augmentation
des bénéfices, faite par la reine Anne, pour l’entretien des
pauvres eccléfiaftiques. I. 875. ¿.
Augmentation. Cour d’augmentation des revenus, du roi,
en Angleterre, érigée fous Henri V III, & fuppmnee parla
reine Marie. I. 876. a. H .
AUGMENTER, aggrandir, ( Synon. g difference-entre ces
mots. 1 . 876.«. • .
Augmenter, croître, différences entre ces mots. 1.070. a.
A u g m e n t e r , ajouter, ( Synon.) I. 223. a.
AUGSBOURG, voyc^ A ü S b o u r g . W.
AUGST, (Géogr.) Augufta Rauracprum, village de Su 1 lie
dans le canton de Baflè. Monumens d’antiquité qu’on y
trouve. Suppl. 1. 701. a.
Auglt, obfervations fur cette ville ancienne. Suppl. IV;
578.a,b. 831. b. Sadeftruâion contribuaàl’aggrandiffement
de Bafle. Suppl. 1. 823.4.
AUGUIER, (François) fculpteur. XIV. 829. b. Michel
Auguier, aufli fculpteur. Ibid.
AUGURAL, bâton. II. 144. a. IX. 599. a.
AUGURES, nom de dignité chez les Romains. Nombre
des augures. Leur fecret. Etymologie du mot augure. 1. 876. a.
Augure | le droit d’entrer dans le collège des augures, ré-
fervé aux feuls patriciens. IX. 634. u. Différences entre la
qualité d’augure chez les Grecs 8c chez les Romains. XIV.
86. b. Repas qu’on donnoit lorfqu’on étoit promu à la charge
d’au<mre. 128.-4. Elcâion des augures par les tribus. XVI.
623.^. Augure qui avoit foin des poulets facrés. XIII. 363.
a. Robe des augures appellée trabce. XVI. 302. a. Marque
fymbolique des augures. XV. 729. «.Livre des augures. IX.
604. a.
Les augures confultés pour les affemblées du peuple romain.
III. 680. a , ¿.681. a. Lieux où les augures confidé-
roient le vol des oifeaux. XVI. 187. b. Fonâions des augures
dans la fondation d’un temple. 63. a. Déclaration d’un
augure fur ce qu’il avoit obfervé dans les aufpices. XI. 284.
b. Déclaration d’un augure appellée obnonciation. 308. a.
A ugures ,(Hift. anc. ) defcription de la maniéré dont-ils
exerçoient leur miniftere. Suppl. I. 701.
AUGURIUM, fcience augurale. Son origine. Il paroîtpar
les livres faints qu’elle étoit-'connue dcsEgyptiens & des
autres Orientaux même avant Moïfe.1.876. b. Voy. A uspice:
Augurium, origine de la fcience des augures. IV. 1072.
b. XI. 371. b. Attachement des Étrufques aux augures. Suppl.
II. 899. b. Paroles de mauvais augure. XII. 76. b. VI. 208.
a 3 b. Augure par le chant ou le cri des oifeaux. III. 319. b.
XI. 638. ¿. Augure tiré de la maniéré dont la viâime alloit
vers l’autel. XVII. 243. a ,b. Augure par le vol des oifeaux.
XI. 638. b. Comment les anciens exprimoient un mauvais
augure qui détruifoit l’effet du premier. VI. 208. b. Réflexions
pliilofophiques fur la divination par les augures. XIV.
338. b. Voyez l’article PRÉSAGE.
AUGUSTAUX, jeux, VUI. 337. b.
AUGUSTE, (Hijl.rom.) Caius-Ottavius-Auguflus.Suppl. I;
701. a. Son origine. Céfar forme le projet de l’aflbcier à fes
deitinées. Ibid. b. Oélave, après la mort de Céfar, fe déclare
fon héritier, & s’aflùre l’afteâion de la garnifon de Brindes.
Son entrée dans Rome. Son entrevue avec Antoine. Ibid;
702. a. Il met en vente fon propre patrimoine, ainfi que
les "biens de fa mere & de fon beau-pere, pour acquérif
les legs que Céfar avoit faits au peuple, Méfintelligence
entre Oitave 8c Antoine. Ibid. b. Leur apparente réconciliation.
Us s’apprêtent l’un 8c l’autre à foutenir leurs prétentions
les armes à la main. Ibid. 703. a. Le fénat donne à
Oélave le titre de propréteur, & lui permet d’être conful
dix ans avant l’âge fixé par les loix. Antoine, gouverneur
des Gaules, eft déclaré ennemi de la patrie. Ibid. b. Il eft
vaincu aux environs de Modene, par les armées réunies
d’Oâave 8c de Brutus. Le conful Vibius 8c la conduite dit
fénat déterminent Oélave à fe concilier avec Antoine. Ibid.
. 704. a. Le fénat lui refùfe la dignité de conful, qu’il avoit
fait demander par fes députés. La nouvelle de fon approche
de Rome répand klSerreur dans le fénat. Ibid. b. Hommages
qu’il reçoit en entrant dans la ville. U eft nommé
conful par les comices. U obtient du fénat un décret qui
ordonne le procès de tous ceux qui avoient trempé dans le
meurtre de Céfar. Entrevue d’Oâave avec Antoine 8c Lé-
pide.Ibid. 703.4. Conditions du fameux triumvirat qu’ils formèrent.
Récompenfes promifes aux légions qu’ils devoient
employer à fatisfaire leur vengeance. Profcription. Ibid. b.
Les triumvirs entrent dans Rome. Taxes levées pour les frais
de la guerre. Déclarations que font les triumvirs au fénat.
Traits de cruauté de la part d’Oélave. Ibid. 706.4. Il conçoit
le projet de dépouiller fes collègues. Ibid. b. Nouvel accommodement
qu’il conclut avec Antoine, 8c enfuite avec le
fils de Pompée. Il enleve peu de tems après la Sicile à ce
dernier. Lépidc abdique le triumvirat, 8c rentre dans l’ob-
feurité. Honneur extraordinaire qu’Oâave reçoit du fénat.
Ibid. 707.4. Comment il gagne le coeur des Romains. U B
fait
A U G A U M 1 1 9
fait déférer le tribunarà perpétuité, 8c rend Antoine odieux
au peuple. Ibid. b. Bataille d’Aâium. -Oélave foumet l’Égypte.
Ses voyages en Afie. Triomphe, dont il eft-honoré à-fon
retour. Il reçoit le titre d’empereur. Ibid. 708. b. Il conful te
Agrippa 8c Mécènes fur l’abdication de l’empire , 8c fuit
l’avis de ce dernier. Il ajoute à fa dignité de tribun perpétuel,
celle de conful., Comment il affermit fon autorité. Les noms
glorieux de perede la patrie & d’augufte lui font déférés. Ibid.
709. 4. Il propofe tous les dix ans au fénat de confentir à
fa retraite. U fe choifit un fucceffeur. Derniers momens de
fa vie. Ibid. b. jcoiç;
A u g u s t e , empereur ; hiftoire de fon triumvirat 8c de
fon regne. XVI. 672. b.— 681. a. Comment le médecin
Artorius lui fauva la vie à la bataille de Philippe. X. 280. 4.
Préfage qui lui annonçoit la viâoire à la bataille d’Aélium.
XI. 483. b. Defcription de fon triomphe après les viétoires
d’Aélium Sc d’Alexandrie. XVI. 634. b. 633.4. Conduite
par laquelle il accoutuma les Romains à la fervitude. IV.
937. b. Pouvoir qu’il s’attribua comme prince du fénat. XIII.
372. b. Partage qu’il fit de l’adminiftration de l’empire entre
lu i, le fénat 8c le peuple, 409. b. Pouvoir légiflatif qui lui
fut déféré. V. 128. b. Clé de la conduite d'Oélave. XII. 480.
4. Hiftoire de 1 empire d’Àugufte. XIV. 334. 4 , b. Réponfe
de l’oracle fur fon mariage avec Livie. XI. 333. a.
Soins qu’il prit de la police de Rome. XII. 907. b. 908. a.
La juftice réformée par cet empereur. IX. 9 1 .4 , ¿: Etabliffe-
ment des poftes par Augufte. XÎII. 171. 4. Il mit en vigueur
les lupereales. IX. 740. b. Combat doniié fur l’eau pendant
fon regne. XL 60. b. Maufolée qu’Augufte fit élever pour
lui 8c- les fiens. X. 212. a. XIV. 332. b.
Culte dé cet empereur. XV. 139. a. Il voulut qu’on le
joignît dans la confécration des temples de la déefle Rome.
XIV. 333.4. Augufte mis au rang des dieux Lares. IX. 293;
1 4. Libations que le fénat ordonna pour lui. 438. b.
Caraélere d’Augufte. XVI. 672. b. 8cc. Son indulgence.
VIII. 691. b. Sa lâcheté 8c fa cruauté. IV. 318. 4. Son indignation
de ce que le peuple n’afliftoit à fes harangues qu’en
petite toge brune. XVI. 370. a. Sort goût pour la peinture.
XII. 274.4.11 recherchoit avec foin la clarté dans fes expref-
fions. I. 29. 4. Sa maniéré de dormir en été. VIII. 13. b.
Décennales du regne d’Augufte. XVII. 237. a. Palais
d’Augufte. XI. 773. b. Place"-de Rome dui porte le nom de
cet empereur. XII. 674. a. Son cachet. X.V. 734. 4. Symbole
d’Augufte. 733. 4. •
A uguste, adj. (Hiß. ancA nom de dignité donné aux
empereurs Romains, 8c auquel pafticipoient les impératrices.
Colonies des Gaules honorées de ce no'rn par Augufte. Le
titre de Céfar étoit donné aux fuccefleurs défignés des
empereurs. Les nations" modernes ont aüifi donne le titre
d’Augußc à leurs fouverains. I. 877. a.
A u g u s t e , papier augufle, (Hijl. anc.) I. 877. a.
A u g u s t e , prénom^ de villes ou colonies romaines. IX.
33. 4. Titre que le fénat de Rome donnoit non-feulement
à l’empereur , mais à fa femme 8c à fes filles. VIII. 388. b.
Statues auguftes. XV. 302. b. Le titre d’augufte donné à
l’empereur d’Allemagne. V. 377. a.
AUGUSTIN, (Samt ) obfervations fur fa vie, fes ouvrages
8c fes fentimens. XII. 343. a , b. 346. a. Lettre dans laquelle
il montre l’extrême différence- qu’il y a entre défendre utr
coupable 8c intercéder pour lui. VIII. 813. ¿.Sa doârine fur
la fpiritualité de Dieu. 373. b. Sur la prédeftination. XIII.
274. 4. 276. b. 277. 4. 874. b. Sur l’ame. I. 330. b. Sur le
contre l’exiftencc des antipodes. 1. 314. a. Ses principes de
tolérance. VIII. 130. 4 , b. 844. a. PourquoLon lui a donné
le nom de doéleur de la grâce. VII. 802. b. Raifon qui l’avoit
retenu long-tems dans le manichéifme. VlII. 373. b. Sa
doétrine fur les.fubftânces fpirituelles. Ibid.
A ugustin , titre que Janfenius a donné à fon ouvrage.
I. 877. 4. Sujets traités dans ce livre. Ibid. b. ■
A u g u st in , (Saint) caraélere d’imprimerie."H. 663.
A ugustins, (Hiß. eccl.) ordres religieux. Hcrmitcsde S.
Au gui tin ralîemblés par Alexandre ÎV en 123 6. .’Cet ordre
divife en plus de foixante branches. Hermites dé S. Auguftùt
en Frauçe. Atiguftins déchauffés. II ne faut pas confondre
ces religieux avec les chanoines réguliers dui1 proféflent là
regle de S, Augùftin. I. 877. b. v ’ .. „ . :
Auguflint-, leiif origirîe, VIIL 173. ¿. Leur divifion en"
plufieurs congrégations. 174, 4. Les Auguftins- prétendent
u u 2-nn nCe aux tiers-ordres. X V l^ s^ A u g u ftin s
4,63 J gnés à Paris Par!c Ä <*e Petits-peres. XII.
ÀUGUSTINI, ( Antonio) aréhéyêque de'Tarragone. Son
uvrnge fur le digefte. IV. 697.^ Sa paillon pour les monu- ■
X. 229. b. - . ’ , * •.-},••
• . , TINIENS, ( Hiß. cecf. YftîéologieiiS qui/foutien-
11 ^Tô/bc1 efficace de fa naturé, abfoluhiènt 8c
morâl'emént. Expofé^ de leur fyftême en quinze articles, h
,7. a' Dilunttion des Auguftiniens en rigides 8c relâchés.
Ibid. b.
Auguftiniens, leur doârine fur la grâce. VII. 801. b. XV.
634- | Sur la .fcience des.conditionnels attribuée à Dieu.*
XIV. 791. 4. Sur la prédeftination. XIII. 275. a , b. Sur la
réprobation. XIV. 1491 a.
AUGUSTODUNENSIS PAG US, (Géogr. du moy. âge)
l’Autunois, le comté où l’évêché d’Autun en partie. Obfe’r-
vations fur les anciens comtes d’Autun. Etendue qu’avôit ce
Pagus. Bailliages qui fe font enfuite formés dans ce pays.
Anciens lieux de l’Autunois dont il eft parié dans quelques
chartes, titres ou autres pièces de ce genre. Evénemens
qui ont rendu quelques-uns de ces lieux remarquables. Fondations
de quelques prieurés, abbayes, &c. dans l’AhtunoiS.
Suppl. L 710. 4 , b.
AUGUSTOMAGUS , ville de la Gaule bélgique. XV.
198. b.
AVICENNES, médecin. X. 281. b. Hiftoire de fa vie.
XIV. 663. b. 666. 4. Son traité fur l’hygienne. VlII. 387. b.
Sa doârine fur la faignée. XIV. 303. a.
AVIENUS, (RujiisFcjlus) fes fables. VI. 333.b.
AVIGNON, fur"l’ancienne Avignon. Suppl. IV. 11. 4.
Comment le comté d’Avignon eft parvenu au pape. XI.
836. a , b. Du légat du pape à Avignon. IX. 343. a t b. 346.
4 , b. Droit dé prévention dont il jouit. XIII. 343. i.P am se
de leghfe d occident durant le fci.ifme d Avignon. XI. 297,
b. Du pont d’Avignon. Suppl. IV. 303. a. ,
AV ILA , (Htjl.nat.) fruit des Indes. Sa defcription. Son
amahde eft eitimée un contrepoifon, 8c un remede dans fes
humeurs malignes. I. 878. b.
AVIRON , fufée d’ ( Marine) VII. 391. b.
AVIS, Jentiment, opinion, (Synonym. ) différence entre
ces mots. I. 879. a.
A v i s , avertijfement, confeil, différence entre ces mots.
I. 879. a.
A v is , différence entre avis, avertiffement 8c confeil. IV.
1. 4. Entre.avis, fentiment8c opinion. XV. 37. b. Un avi9
n’eft pas obligatoire, 8c celui qui le donne, n’eft pas rtfpon-
fable des fuites. Exceptions. lV . 1. a. Des avis donnés aux
princes. VL 847. a.
A v i s , ( Commerce) lettres d’avis. I. 879. a.
A v is , ( Ordre d’ ) ordre militaire en Portugal. Son origine.
Progrès 8c révolutions de cet ordre. Son habit 8c fes armes-.
I. 879. b.
. A VISON, ( Géogr.) haute montagne des Vofges, près de
la ville de Bruyeres. Defcription d'une fête fmguliere qui s’ÿ
célébré annuellement 1e premier dimanche de carême.- Suppl.
I. 711. 4.
_ ÀVITUS, (Hijl. du Bas-Empire) forti d’une Famille patricienne,
de la cité d’Auvergne, élevé à l’empire par Théodorîc.
Principaux événemens de fa vie. Suppl. I. 711. b.
AVIVES, (Maréch.) glandes fituées entre les oreilles8c
le gofier du cheval, comnie fes parotides chez fes hommes.
Enflure de ces glandes. U eft douteux qu’elks deviennent
douloureufes. Remedes pour fes avives. I. 880. a.
AULAIRE., ( M. de S.) fon in-promptu fur madame la
ducheffe du Maine. VlII. 631. a.
AULETE, (Hijl. d’Egypte ) roi d’Egypte. Précis de fon
regne. Suppl. I. 712. b. Voye% Ptolômée. Ce prince rétabli
fur le trône par Gabinius. Suppl. III. 163. b.
AULlQUE , (Hijl. mod.) officiers de l'empereur qui
compofent une coür fupérietire. I. 880. d. Confeil aulique.
Contradiâions fréquentes entre cette cour 8c la chambre
impériale de Spirè. Autorité de ces cours. Objets qui font
du reffort du confeil aulique. Il ceffe à la mort de l’empereur,
Ibid: b. •
Aulique, confeil. IV. 3. b. Différence entre ce confeil & là
chà mbre impériale. III. 33.4.
AULMULCIERS, mitonïers, ancien nom qu’on donnoit
aux bonnetiers. II. 32y. F.
AULNE, ( Botan. ) caraâeres de ce genre d’arbre. Sa
culture. I. 880. b. Ufage de fon bois. Qualités médicinales
de fon écorce, de fes feuilles, 8c de fon fruit. Ibid. 881.4,
. Aulne. Différens noms de cet arbre. Ses caraâeres
génériques. Reproche fitit aux botaniftes qui, trompés par
de légères variétés, ont multiplié mal-à-propos dans piufieurs
genres dé plantes, les eijjeces qu’ils renferment. Le botanifte
doit être cultivateur. Il eft utile auffi que le cultivateur
connoiffe exaâement les différentes nomenclatures des
plantes. Suppl. I. 713'. 4. Diverfes confid'éràtions qiii rendent
importante la culture de l’aulnè. Ufagë qu’on en tire. Maniéré
de lé.cultiver 8c de le- multiplier. Ibid. b. Caraâeres qui
diftinguent les deux différentes efpeces d’aulne indiquées dans
cet article, Ibid. 714. b\
AUMONE , les eccléfiaftiques • fie fubfiftôienr autrefois
que d’aunvônes. Comment fe divifoient les aumônes depuis
fes apôtres jufqu’à Conftantin. Julién ordonne à un prêtre--
du paganifme dünftruire -le peuple à l’aumône. Les coll'câcs