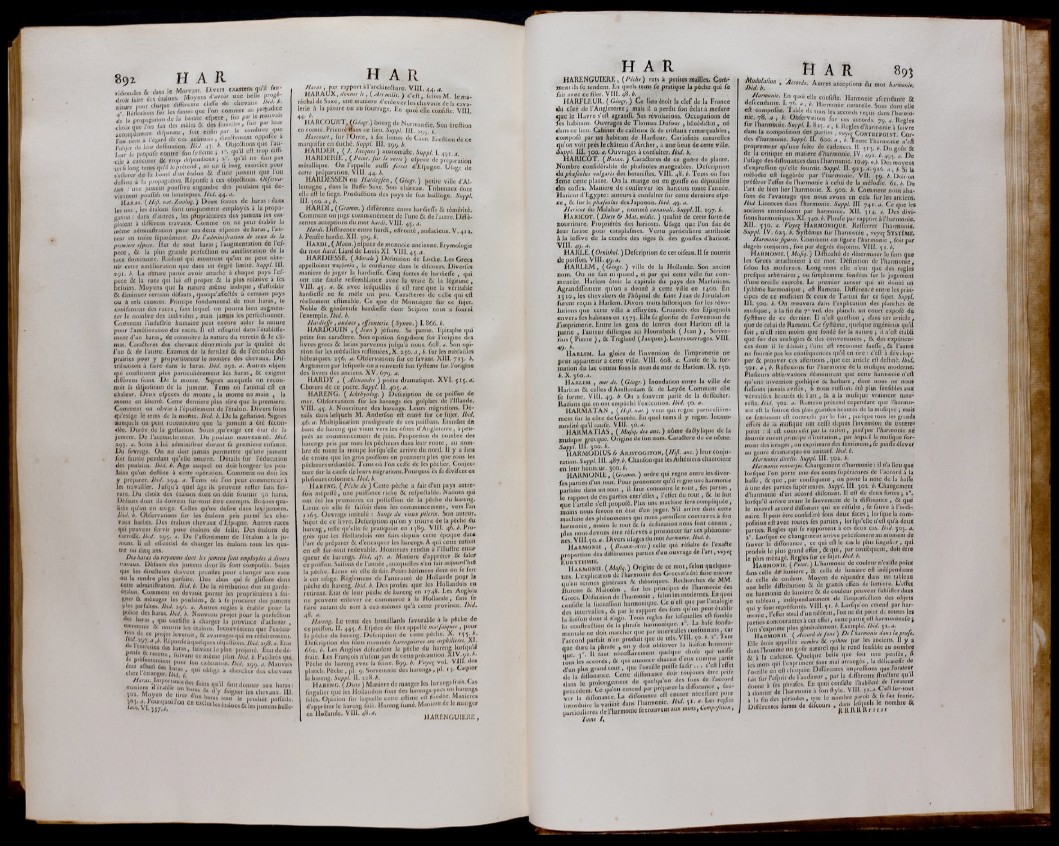
8 H A R
, o. .i1(15 ic Murvnnt, Divers examens qu’il feu*
droit faire de» étalons. Moyen» dtorojr une belle pro *£
Hitare pour disque différente claffe de ebevsux. '
j¡ tu iL io n » fur le« fautes ((lie I on commet au P ÿ l g
de la propagation de la bonne e fp e e e , fuit par le m iu '' * ‘ s
S i fait des miles & de. femelles, dut par leur
accouplement difparate, Toit enfin par i* c o a d u n e q u e
g ï „ à l'to rd de ces animai«, direftemem oppofée ît
1 ablet de leur «cftination. Ibid. a i- >• O b je i iam que lau -
lo ir fe propofe contre fou fyrtéme ¡ t". f l l f eft trop diffi-
clic à exécuter 8c trop diTpciidieux; a , tp itl ne faut pas
un fi long tema tpi’il le prétend, ni un fi long exercice pour
»•«mirer de la bonté d’un étalon & d’une piment que Ion
deftme à la propagation, Réponfe à ces objections, übferva-
i'm / une jument pou fftve engendre des poulains qui deviennent
pouflif* ou lunatiques. Ibid, 44» tu
HaRAS. ( Hifl. nais Zoolog. ) Deux iones de haras ; dans
les uns » les ¿talons font uniquement employés à le propagation
: dans d’autres, les propriétaire* des jumen* les cm-
ploient à diffère»* travaux. Comme qn ne peut établir la
même adminiftration pour ees deux efpeces de haras, l'auteur
en traite fenarément. D e l'adminijlration de ceux de la
première efpeee. ¡ lu t de tout haras ; l'augmentation de l’ef-
p e c e , fie la plu* grande perfection ou amélioration de la
race dominante, Raifou* qui montrent qu'on ne peut obtenir
cette amélioration que dan* un degré limité. Suppl, IIL
a j í , b. La nature paroit avoir attache à chaque pays l'ef-
v e c e fie la race qui lui eft propre fie ht plus relative à fes
befoins. Moyens que la nature même indique, d’affoiblir
fie diminuer certains défauts, quoiqu’affcétés à certains pays
o u & tels cantons. Principe fondamental de tout liaras, le
croifemew des ra c e s, fans lequel on pourra bien augmenter
le nom bre des individu*, mais jamais les perfectionner.
C om m en t Vinduttrie humaine p eu t en co r e aider la nature
pou r l'amélioration des races, 11 eft e/Jcyricl dans l’établiffc-
tnent d'un haras, de conno itre la nature du terrein fie le climat,
Caracteres des chevaux déterminés par la qualité de
¿’un fie de l’autre, Examen de la fertilité fie de l'étendue des
prairies pour y proportionner le nom bre des chevaux, D if-
«ributions à faire dans le haras, Ibid, 291, a. Autres objets
3ni constituent plus particulièrement les haras, fie exigent
iff’ércns foins, D e la m on te. Signes auxquels on rccon-
noit la diiuofition d e la jum e n t. Teins oit l'animai c/l en
chaleur. Deux e/peces de m on te , la monte en main , la
monte en libertó, Cette derniere plus sûre que la première.
Comment on o b v ie à i'éputfement de l'étalon. D iv er s foins
qu’exige le tenis de Ja monte, Ibid, b, D e la geStation, Signes
auxquels ou peut reconnoitre que la jument a été fécondée,
Durée de la gestation. Soins .qu exige cet état de la
jument, D e l'accouchement. D u poulain uouveaumé, Ibid,
293, a. Soins à lui administrer durant fa première enfance.
Du fevrage, O n ne doit jamais permettre qu'une jument
foie famée pendant qu'elle nourrit. Détails fur l'éducation
des poulains, Ibid. b. A g e auquel ou doit hongrer les pou*
tains qu'on deSiine à cette opération, Comment on doit les
Îf préparer, Ibid, 294, a, Tems oit l'on peut commencer à
es travailler, Jufqu’à quel âge ils peuvent r e lie r fans ferrure,
Du choix des étalons dont on ddit fournir rp haras.
Défauts dont ils doivent fur-tout être exempts, Bonnes qualités
qu'on en exige. Celles qu'on deftre dans lest jumens,
Ibid. b, Ohfervations Sur les étalons pris parmi les ch evaux
barbés. Des étalons chevaux d’Eipagne, Autres races
qui peuvent fervir pour étalons de feiie. D e s étalons de
carrofte, Ibid, *95. a, D e l'aftortiment de l'étalon à la jument,
11 ci! elîentiel de changer les étalons tous les quatre
ou cinq ans.
De s haras du royaume dont les jumens fo n t employées à divers
travaux. Défauts des jumens dont ils font compofés, Soins
que les directeurs doivent prendre pour changer une race
•ou la rendre plus parfaite. Des abus qui fe gliffcnr dans
cette adminiffration. Ibid, b, D e la rétribution due au garde-
« talon. Comment on devroit porter les propriétaires à fol
gner fit ménager les poulains, fit à fe procurer des jumens
plus parfaites, ibid, 10 6 , a, Autres regles h établir pour la
police des haras, Ibid, b, Nouveau projet pour la perfection
oes haras » qui confilte à charger la province n'a ch ete r,
wretenir fit nourrir les étalons, Inconvéniens que l'exécrn
I b i î l ' i x M ^ i i ï / * fit avantages qui en refulreroienr,
dé '• jt y | °» fe à quelques objections, Ibid, m 8, a, Iti,
nenfe iw lS 1 t y m , »oivant le plan projetté, Etat de dé
B f e s g l l l f ce mime pUn,/é/¿ k Facilité. qtt
drar aéhiel 1 " lÍÍÍMr 1 bxéetifiort, Ibid, s o n ,a , Mimyiti
î t e « £ £ . l K & g É l 4 d -v » *
nmtenÜíi'S' H ||11Í 39». Moyen be tirer S ? y A g ite r les cheveux. III.
tace, V I, 3 î 7?A «talons fit les jumen* belle-
H A R
H » w , iw rapport h l’archlteéluro, V I I I , M s a.
H AU A U X , donner l e , ( A r t mïltt. ) c ’e f t , (elon M . le maréchal
bc S a x e , une maniéré «’enlever le» chevaux de la cava-
lerie h la pâture ou au fourrage. En q „o i elle confiftc. VIII.
44. k
1 1ARÇ O Ü I lT , fG/egr.) hourg be Normandie. Son érefiion
comte, r rieurelians ce n e u , Suppl, 111, 299, b,
Harcour t, fur l’O rn e , h fix lieue* de Caen. ÉreClion de ce
marqnifat en duché, Suppï, 111, 299, b,
H A R D E R . ( / , Jacq u es ) a natomide. Stippl, 1, rt
I IA R U lilU E P e in t, Jnr It v m e ) e fp e e e d e préparation
métallique. U n 1 appelle suffi ferret d Lipagne. l/(âee de
cette préparation, V I il, 44, b,
H A RD LSSEN ou Hardegfen, ( Géogr, ) petite ville d’A llemagne
, dans la Üaffe-Saxc, Son château. Tribunaux dont
elle ert le fiegc, Productions des pays de fou bailliage, % / ,
III, 100,a * b,
H A R D I , {Grarnm, ) différence entre hardieffe fit témérité.
Comment 011 juge communément de l’une fit de l’autre. D ifférentes
acceptions du mot hardi, VIII, 45, a,
Mardi, D iffé r e n c e en tre hardi, effronté, audacieux, V . 41 a.
b. Penfée hardie. X II, 309, b,
H a r d i , ( Morin, ) efpeee de monnoie ancienne. Etymologie
du mot liard, Liard de Louis XI, V I I I , 45 ,4 ,
HARDIESSE, ( Morale ) Définition de Locke, 1 «es Grecs
appelaient mpfweici, la con fian c e dans le difeours. Diverfes
maniéré de jiiger la hardieffe, Cinq fortes de hardieffe , qui
ont une fauffe reffemhlance avec la vraie fit la légitime,
V I I I , 43, 4, fit avec icfquelles il e/t rare que la véritable
hardieffe ne fe mêle un peu. CaraCteres de celle qui eft
réellement effimable. C e que dit Montaigne fur ce fujer.
Noble fit généreufe hardieffe dont Scipion nous a fourni
l’exemple, Ib id. b.
Ha rd ieffe, audace % effronterie, (S y n on , ) 1 ,866. b,
H A R 0 O U IN , ( Jean ) jéfuite. Sa patrie, Epitaphe qui
peint fori caraCtere. Son opinion finguliere fur l’origine des
livre* grecs fit latins parvenus ju fqu u nous, do8, a. Son opinion
fur les médailles reffituées ,X, 250 , a t b, fur les médailles
hébraïques. 256, a, Ohfervations fur c e favant, XIII, 7 13 , b.
Argnmens par lefquels on a renverfé fou fyffême fur l’origine
des livres des anciens, X V , 679, a,
H A R D Y , ( Alexandre ) poète dramatique, X V I , 3 t f . a .
Choeurs de ce poète, Suppl, IL 403, a,
H A R EN G , ( Ic/ithyolog, ) Defcription de ce poiffon de
mer, Ohfervations Air les harengs des golphes de l’Iffande.
V 11L 43. b. Nourriture des harengs. Leurs migrations. D é tails
dans lefquels M, Anderfon eff entré fur c e fujer, Ibid.
46 . a. Multiplication prodigieufe de ces poiffon*. Etendue dn
b a n c de ha ren g qui vient vers les c ô te s d 'A n g le t e r r e , â-peu-
prés au com m en cem en t de juin. Proportion du nombre des
harengs pris par tous les pécheurs dans leur route « au nombre
de toute la troupe lorfqu’elle arrive du nord. Il y a lieu
de croire que les gros poiffons en prennent plus que tous les
pêcheurs enfemble, T e n u ou l’on ceffe de les pécher. Conjecture
fur la caufe de leurs m igrations,Pourquo i ils fe divifent en
plufieiirscolonnes. ib id , b,
H a u i îk g , ^Pêche d u ) Cette pêche a fait d'un pays autrefois
méprifé, une puiffauce riche fic refpeétahle, Nations qui
ont été les premières en poffeffton de la pêche du hareng.
Lieux oh elle fe faifoit dans les commencemcns, vers l'ait
1 163, Ouvrage intitulé ; Sonpe du vieux pèlerin, Son auteur*
Sujet de ce livre, Defcription qu'on y trouve de la pêche du
hareng» telle qu'elle fe pratiqiioit en 1389, VIII, 40. b, Pro*
grés que les rlollandois ont faits depuis cette époque dans
Fart de préparer fie d'encaquer les harengs, A qui cette nation
en eff lur-toiit redevable. Honneurs rendus h l'illuffre e n c »
queur de harengs, ib id , 47, a, Maniéré d'apprêter fit falcr
ce poiffon, Saifons de l'année, auxquelles s’en tait aujourd nui
la pêche, Lieux oh elle fe tait. Petits bâtimcns dont 011 fe (ert
â cet ufage. Régi cm eus de l'amirauté de Hollande poyr la
pêche du liareng, Jbid, b. Des proïits que les Hollandois en
retirent, Etat de leur pêche de hareng en iy/\d. Les Anglois
ne peuvent enlever ce com m e r c e a la Hollande» fans fc
faire autant de tort à eux-mêmes qu’k cette province. Ibid•
Hareng. Le tems des brouillards favorable & la pêche de
ce poiffon. II. 443. b, Efpéce de filet appellé ma rfnique s ? pour
la pêche du hareng. Defcription de cette pêche» X. x 5 T -‘ ‘
Defcription des Incm n<tinméQ harenguieres ou orphilleres.Jij.
66%. b. Les Anglois défendent la pêche du hareng lorfqu U
traie, Les François n'ufent pas de cette précaution. X IV .9 1 , b.
Pêche dn hareng avec la feine. 899. b. Voyesç vol. VIII. des
plancb, P ê ch e , pi, 9. Sorretterle des harengs, pl. i l - Laquer
le hareng, ¿suppl, II, a*8. b. „ . r
H AUkNO, (D i e t e ) Maniéré de manger les harengs irais, k , as
fniRiiller nue les Hollandois font des harengs pcçs ou liareng#
falès. Opinion fur laquelle cette ertime eff fondée, Manière#
d'apprêter le hareng talé. Hareng fumé. Maniéré de le manger
eu Hollande, VIII, 48,ru HARENG HIERE,
H A R
H A R E N G U IE R E , { P ê c h e ) rets k petites mailles, C o tú -
m en t ils fe tendent. En quels tems fe pratique la pêche qui fe
fait avec c e filer. V I I I . 48. b,
HA R F LEU R . ( Géogr, ) C e lieu étolt la c le f de la France
du côté de l'Angleterre mais il a perdu fon éclat â meCure
Î|ue le H a v r e s'eff agrandi. Ses révolutions. Occupations de
es habitan*. Ouvrages de Thomas Dufour » bénédiétin » né
<lan* ce lieu. Cabinet de cailloux fie de criffaux remarquables»
t'ompofé par un habitant de Hartleur. Curiofités naturelles
Su’on voit prés le château d’A rch er , à une lieue de cette ville.
uppl, III, 300» a. Ouvrages à confulter, Ibid, b,
H A R IC O T , ( Dotan, ) Caraétcres de ce genre de plante.
Nombre confidérahle de phaféoles mangeables. Defcription
du phafeolus vulgaris des botanifies, VIII. 48, b. Tems où l'on
feme cette plante. O n la mange ou en gouffe ou dépouillée
des coffcs. Maniere de conferver les haricots toute l'année.
Haricot d 'Eg yp te: auteurs à confulter fur cette derniere efpe-
c e , fie fur le phafeolus des Japonais, Ibid, 49, a,
H a r icot du Malabar » nommé canavali, Suppl1, II, 197, b,
HARICOT. ( Die te 6* Mat, m ¿die. ) qualité de cette forte de
nourriture. Propriétés des haricots. Ufage que l’on fait de
leu r farine pour cataplafmcs. Vertu particulière attribuée
à la lefiive de la cenare des tiges fie des gouffes d’haricot.
V I I I . 49. a,
H A liL E , ( Omithol. ) Defcription de cet oifeau. Il fe nourrit
depoiffon. VIII. 49, a,
H A R LEM » {G é o g r .) v ille de la Hollande. Son ancien
nom. O n ne fait ni quand » ni par qui cette ville fut commencée,
Harlem étolt la capitale du pays des Marlaiicns.
Agrandiffenient qu'on a donné k cette ville en 1400, En
13 10» les chevaliers de l'hôpital de faint Jean de JérufaLm
furent reçus à Harlem. Divers traits hifioriques fur les révolutions
que cette ville a effuyées. Cruautés des Efpagnol*
envers íes habítaos en 1373, Elle fe glorifie de l'invention de
¿’imprimerie. Entre les gens de lettres dont Harlem efi la
patrie . l'auteur di Ai ligue ici Hoornbcclc (Je an ) , Scrive-
xius ( Pierre ) , fie Trigland (Jacques). Leurs ouvrages. VIII.
49, b.
H a r lem . La gloire de l'invention de 1 imprimerie ne
peut appartenir à cette ville. VIII. 608. a, Caufe de la formation
du lac connu fous le nom de mer de Harlem, IX, 130.
b, X , 360, a.
H a r lem , merde, {G é o g r .) Inondation entre la ville de
Harlem fie celles d Amffertiam fie de Leydc. Comment elle
fe forme, VIII. 49. b, O n a Couvent parlé de la dcfféchcr.
JRaifous qui en ont empêché l'exécution, Jbid. 30. a.
H A RM A T A N t {H i jl, n a t,) vent qui rcgnc particulièrement
fur la côte de Guinée. En quel teins il y regne. Incommodité
qu'il caufe. VIII. 3o .a ,
H A R M A T IA S , ( MuJiq. des anc. ) nôme dacryhque de la
mufique grecque. Origine de Ion nom, Caraétere de ce nôme.
Suppl. IIL 300. b,
H A R M O D 1US éb A r i s t o g i t o n , ( H t f f anc. ) leur conjuration.
Suppl. III. 487./». Cliaiifo» que lesAihéniens chantoient
en leur honneur. 300, b.
H A RM O N IE , {Gramm. ) ordre qui regne entre les diverfe
s parties d'un tout. Pour prononcer qu'il régne une harmonie
parfaite dans un t o u t , il faut connoitre le tout » fes^parties »
le rapport de ces parties entr’elles » l'cfict du to u t , fie le but
que ('artifie s’eft propofé. Plus une machine fera compliquée,
moins nous ferons en état d’en juger. S’il arrive dans cette
machine des phénomènes qui nous j/aroifleiit contraires a ion
harmonie, moins le tout fit fa deffmaiion nous font connus,
plus nous devons être réfervês a prononcer iur ce*> phénomènes.
V III. 30. a. Divers ufages du mot harmonie. Ibtd. b.
Ha rm o n ie » {D e a u x -A r t s ) celle qui réfulte de 1 exacte
.Annrtinil ílfiS íllllél'ÜIHCfi DUI'UCS d 110 OUVtagC
ÍI A R
proportion bc» diliòreme» partie» d’un ouvrage be l’a r t , v c y n
EURYTHMIE, , . , ,
H a rm o n i e , {M u f iq .) Origine de ce mo t,fé lon quelques-
un», B p de riiarmonie de. Grec» n’a é t i f tu e encore
qu'en tel ine, génâraux fie théorique». Recherche» de MM,
Burette & Malcolm , fur les principe» be harmonie de»
iârcc», Oélinihon de l'harmonie , félon le» moderne», hn quoi
tonfifte la fiiccellion harmonique. C e n’eft que par I analogie
de» Intervalle», & par le rapport de» fou» qu on peut établir
la llalfon dont II »'agit, Trol* regie» fur lefqitcjle» cil fondée
la conftrnélion de la phrafe harmonique, t . La haie tonda-
mentale ne doit marcher que par Intervalle» confonnan», car
l'aecord parfait n'eu produit que de tels. VIII, <0. k » . Tant
que dure la phralè , on y doit ohlervcr la llalfon haratom-
uuc i ” . Il faut néceflalrement quelque chofe qui unifie
tou» le» accord», 6c qui annonce chacun d'eux cornine partie
d'un plu» grand tou r , que l'oreille puiffo faiftr. . . c cil I effet
de ladiffonance. Ce tte dlffot iiince doit totnemr. é t é pnfe
t » le prolonge,ne,.t de quelqu'.in de»,,4 .» < 1« '» « » » '
nrécédent. C e qu'on entend par préparer la dlffonanee , fan-
ver la dlffonancc, La dlffonanee eli encore -.éceflàlre pou
introduire la variété dan» l'harmonie. Ilml, 31. «■ Le» repie»
particulière» de i'Iiarmonle fc trouvent aux mot», Comi’ « / !"» " ,
Tome I,
8 9 3
M o d uU th n , Accord,. Antre» aceeption» du mot h td u n lr .
Harmonie, En quoi elle confiftc. Harmonie afeendame 8t
defeendanre, I. rli. e . â. Harmonie narurcllc. Son» don, elle
eft eompolée. 1 able de |cs accwd4 reçl|, dam p|lar)n0.
me. 7», a t b. C)hfe/valions fur ces accords. 7 9 . 4, Règles
fur 1 harmonie. Suppl. I. 8 2 3 .4 , b. Réglés d'harmonie k fuivre
clans la com p o ittion de* parues, voytr C o n t r e p o in t , Co r-
de» d’harmonie. Suppl, II, 600, a , k Toute l'harmonie o'cft
proprcmeni qu'une fuite de cadences. II. 313, /,, [ ) „ g0fo Qc
de la critique en matière d’harmonie. IV , 4 O c
l’ufage desdiffonances dans l’harmonie. 1049, « A Des moyens
d'expreffion qu’elle fournit, Suppl. II, 923 .4,9 26 . a * b. Si la
mélodie eft fuggérée par l’harmonie. VII, 30. b. Doit-on
préférer l'effet de l'harmonie à celui de la mélodie. 6 1 . b. De
l'art de bien lier l'harmonie, X, 900, b. C om m e n t nous abu-
fons de l’avantage que nous avons en cela fur les anciens«
Jbid Licences dans 1 harmonie. Suppl. III 7 4 1 ,4 . C e q u e les
anciens entendoient par harmonie. XII. 314, a. Des divi-
fions harmoniques. XI. 240. b. Phrafe par rapport h l'harmonie.
XII. 320. 4, Foyer Ha rm o n iq u e . RcïTcrrer l’harmonie.
Suppl. IV , 623. b. Syftémcs fur l'harmonie , voyc^ S ystème.
Harmonie figurée. Comment on figure l’harmonie , foie par
degré* conjoints, foit par degrés disjoints. VIII. 31, b.
Ha rm o n ie , f Muftq.‘\ Difficulté de déterminer le fen* que
les Grecs attacnoient a ce mot. Définition de l'harmonie,
félon leS modernes. Long-tems elle n'eut que des réglés
prefque arbitraires, ou fimplcment fondées fur le jugement
d'une oreille exercée. Le premier auteur qui ait donné un
fyffénle harmonique 3 eff Rameau. Différence entre le* principes
de ce mufteien 81 ceux de Tartini fur ce fujer. Suppl.
III, 300. b. O n trouvera dans l'exjdication des planches de
mufique, à la fin du 7* vol, des plancli. un court expofé du
fyffême de ce dernier. Il n’eff quel)ion , dans cet artic le .
que de celui de Rameau. C e fyftémc, quelque ingénieux qu'il
lo i t , n’eff rien moins que fondé fur la nature ; il n'eft établi
que fur de* analogies oc des convenances, fie des expériences
dont il le déduit ; l'une eff reconnue fauffe, fie l'autre
ne fournit pas les conséquences qu'il en tire : c'eft à développer
fie prouver ces affertions, que cet article eff dcftmé. Ibid,»
201. 4 , b, Réflexions fur l'harmonie de la mufique moderne»
Pluffenrs ohfervations démontrent que cette harmonie n'eft
qu'une invention gothique fie barbare, dont nous ne nous
ludions jamais av jfé s , fi nous enfilons été plus fcnfibles aux
véritables beautés de l'a r t, fit à la mufique vraiment naturelle.
Ibid, 302. 4, Rameau prétend cependant que l'harmonie
eff la fource des plus geande* beautés de la mufique ; mais
ce fcntiment eft contredit par le la i t , puifquetous le* grandi
effets de la mufique ont ccffé depuis l'invention du contrepoint
: il eff contredit par lu ra ilo n , pu i iju e l'harmonie n é
fournit aucun principe d'imitation, par lequel lu mufique for mant
des images, ou exprimant des fentimens, fe puiffe élever
au genre dramatique ou imitatif. Ibid. b,
Harmonie dtrelie, Suppl. III. 30a. b.
Harmonie renverjée. Changement d'harmonie ; ¡1 n'a lieu que
lorfque l’on porte une des note* fuj)ériciire* de l'accord â la
baffe , fit que , par conféquent, on porte la note de la baffe
h une des partie* fupérieures. Suppl. IIL 30a. b. Changement
d’harmonie d’un accord diffonant. Il eff de deux fortes; i 0.
lorfqu’il arrive avant le fauvement de la dlffonanee, fit que
le nouvel accord diffonant qui en réfulte , fe fauve h l’ordh
naire. Il peut être confidéré tous deux face«; lorfque la com-
pofition eff avec toutes fes parties, lorfqu’elle n’eft qu’à deux
parties. Règles qui fc rapportent à ces deux cas. Ibid. 303. a.
2". Lorfque ce changement arrive précifement au moment de
fan ver la dlffonanee , c e qui eft le cas le plus fingulier, qui
produit le plus grand effe t, fit qui, p a r conféquent, doit être
le plus ménagé. llegle* fur ce fujet./bid. b.
H a rm o n ie . ( Peint. ) L'barmomc de couleur n’exifte point
fans celle dtf lumière, fit celle de lumière eft indépendante
de celle de couleur. Moyen de répandre dans un wbleau
une belle diffribution fit de grands effets de himiere .L effet
ou harmonie de lumière fit de couleur peuvent fub ifter dans
un tableau , indépendamment de I imperfection des objets
uui V font repréfentés. VIII. 31 b. Lorfqu'on ci/tend par harmonie
. l’effet total d’un tableau, l’on ne dit point dt toutes les
Ha RMQN JE, ( Accord de Ions ) D e l harmonie dans la profs.
parties concourantes à cet effet, cette partie, eff harmomeufe ;
'on »'exprime plu» ginémle,tient. Exemple. I U . « ». a.
Elle étolt appellée nombre fit rythme par les anciens. Il y a
dans l’homme un goût naturel qui le rend fenfiblc au nombre
& à la cadence. Quelque belle que fq.t une penfée, fi
Ifï's mots nui l'expriment font mal arrangés, la déheateue de
iw i l l e en eft choquée. Différentes impreffioiw que I orateur
f'ait ftir l efprit de iW li r e u r , par la d.fféreiue M u r e qu’il
donne à fe» phrafe*, En quoi confiftc l'habileté de 1 orateur
â donner de L n n n n i« h Ion ftyle. VIII. ,0 .0 . C'eft for;o n t
¡1 lu fin des période», que le nombre »¡troll & <e feu fenttr.
Uiftérentct Forte, de d ife o u r ., u T r ’, r r r