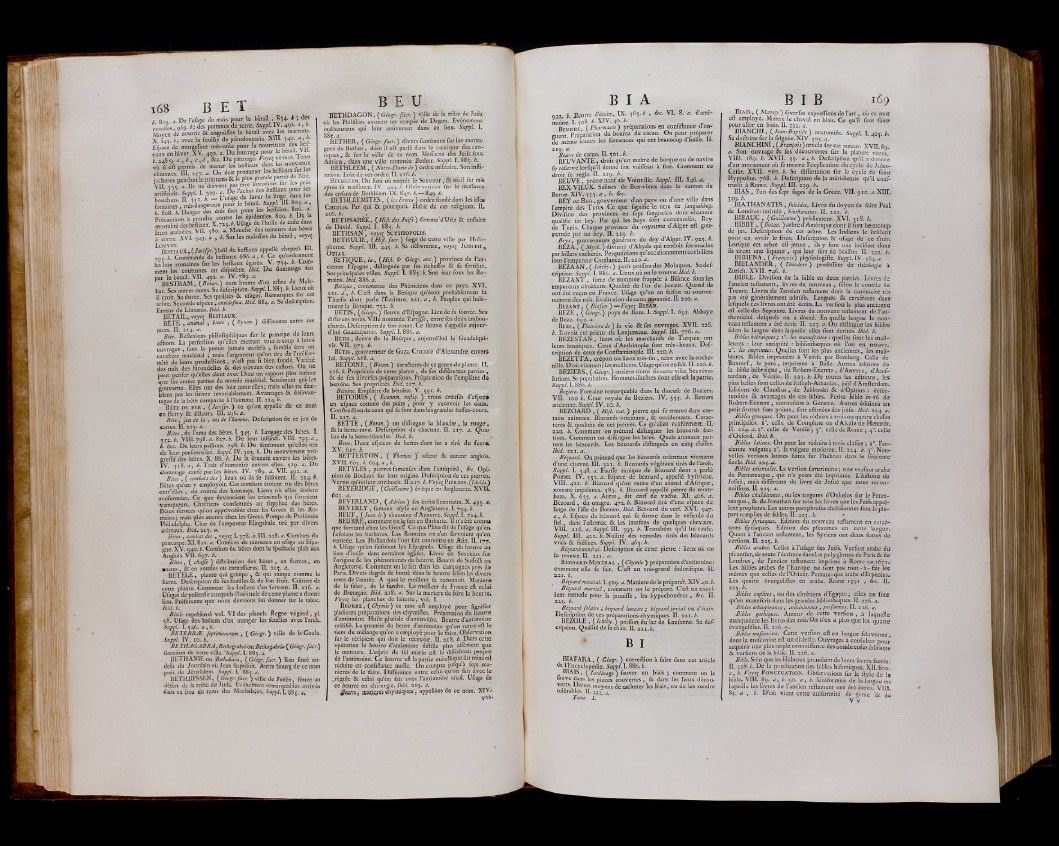
i68 B E T
Moyen de nourrir & engraiffer le bétail avec les marrons.
X. 14 5- b; avec la feuille de pfeudoacacia. XIU. 54°- a y
Efpece de morgeline très-utile pour la nourriture des bel-
tiaux en hiver. XV. 4*50. a. Du fourrage pour le bétaiLVll--
b 248 X!. a . b. c .d , &c. Du pâturage. Voyez ce mot. lems
o'if il eft permis de mener les beftiaux
chaumes 111. Ï S a. On doit promener les bgüiaux lur les
jacheres pendant le primeras & la plus grandeparue detlété-
VII H t « Ils ne doivent pas être introduits fur les près
Y ' C Wi T £Sw Vf De l’achat des beftiaux pour les
artificiels, m m m ¡ g | g | g ¡ | | y le linge dans les
bouchers. 11. 351. ». — c " .. c . oft<f a
fontaines, très-dangereux pour le bétail. Suppl. 111. « >
| 808. b. Danger des étés fecs
Précautions a prendre contre les épidémies. 809. b. Ue la
mor uîlfté des beftiaux. 1 !'“ = Í S ¡ | § |
leurs maladies. VII. 589: a. Mouche destumeure des betes
à corne. XVI. 943. a , ¿.Sur les maladies du bétail, voyez
Be s t ia u x , ( Jurifpr.) bail dé beftiaux appellé cheptel. III.
495. b. Commande de beftiaux. 686. à , b. Ce qu’ordonnent
les loix romaines fur les beftiaux égarés. V. 754. b. Comment
les coutumes en difpôferit. Ibid. Du dommage fait
par le bétail; VII. 49a- a- IV- 7^9- *• § | . ,
BESTRAM, (Botan.) nom brame dun arbre du Malabar.
Ses autres noms. Sa defcription. Suppl..1. 883. b. Lieux oii
il croit. Sa durée. Ses qualités & ùfàges. Remarques fur cet
arbre. Seconde efpece, antidefmà. Ibid. 884. a. Sa delcription.
Erreur de Linnaeus. Ibid. b.
BÉTAIL, voyez B e s t ia u x .
BÊTE , animal , brute f ( Synon. ) différence entre ces
mots. II. 214- a' „ , . . , 1 • _
Bête. Réflexions philofopHiques fur le principe de leurs,
avions. La perfeélion qu’elles mettent tout-à-coup à leurs
ouvrages , fans la porter jamais au-delà , femble être urt
caraétere machinal ; mais l’argument qu’on tire de l’uniformité
de leurs productions , n’eft pâs fi bien fondé. Variété
des nids des hirondelles & des travaux des caftors. On né
peut penfer qu’elles aient avec Dieu un rapport plus intime
que les autres parties du monde matériel. Sentiment qui les
gouverne. Elles ont des loix paturelles ; mais elles ne fem-
blent pas les fuivre invariablement. Avantages & défavan-
tages de la bête comparée à l’iibinihë. II. 214. b.
Bête de f e r , ( Jurifpr.) Ce qü’oh appelle de ce nom
en Berry & ailleurs. III. 296. a.
Bête, jeu de la', ou de Vhomme. Defcription de ce jeu de
cartes. II. 215. a.
Bêtes, de l’ame des bêtes. I. 343. b. Langage des bêtes. I.
352. b. VIII.798. a. 82j.b. De leur inftinét. VIII. 795. a,
b. &c. De leurs pallions. 798. b. Du fentiment qu’elles ont
de leur perfonnalité. Suppl. IV. 303. b. Dü mouvement prti-
greflif des bêtes. X. 88.. b. De la éruauté envers les bêtes.
IV. 518. 4, b. Trait d’humanité envers elles. 519. a. Du
dommage caufé par les bêtes. I V. 789. a. VII. 492. a.
Bêtes t (combats des) lieux où ils fe fàifoient. II. 214.
Bêtes qu’on y employoit. Ces combats étoient ou des bêtes
entr’elles , ou contre des hommçs. Lieux où elles étoient
■renfermées. Ce que devenoient les criminels qui fortoient
vainqueurs. Chrétiens condamnés au fimplice des bêtes.
Bêtes féroces qu’on apprivoifoit chez les Orees & les Romains
5 mais plus encore chez les Grecs. Pompe de Ptoléméfe
Philadclphe. Char de l’empereur Eliogabale. tiré par divers
animaux. Ibid.-an;, a. ,
Bêtes , combat des , voyez 1. 378. a. III. 228. a. Combats du
pânearpe. XI. 811. a. Combats de taureaux en ufage en Efpa-
gne. XV. 940. b. Combats de bêtes dont le fpeftacïe plaît aux
Anglois. "VII. 697. b.
\ Bêtes, ( chajje ) diftribution des bêtes , en fauves, en
aoires, & en rouffes ou carnaffiefes. II. 215. a.
BETELE , plante qui grimpe , & qui rampe comme le
lierre. Defcription de fes-feuilles 8c de fon fruit. Culture de
cette plante. Comment les Indiens s’en fervent. II. 216. a.
Ufages de poKteffe auxqúels’lliabitude deCétte plante a donné
lieu. Préférence que nous devrions lui donner fur le tabac.
Ibid. b.
Bétele repréfenté vol. VI des planch. Regne végétal, pl.
98. Ufage des Indiens 'd’en manger les feuilles avec l’arek.
Suppl. I.546. a , b.
BETERRÆ feptimanorutn , ( Géogr. ) ville de la Gaule.
Suppl. IV. 10. b.
BETHAGABRA, Bethograbri ou Bethagabria ( Géogr. facr.)
fituation de cette ville. *Suppl. ‘I. 885.4.
BETHANIE ou Bethabarà, - ( Géogr. facr. ) lieu fitué au-
. delà du Jourdain où Jean 'baptifott. Autre bourg de Ce nom
près de Jérufalem. Suppl. 1. 885. 4.
BETHBESSEN, (Géogr. facr. )• ville de Judée, fituée au
défert de la tribu de Juda. Évéhemens remarquables arrivés
dans ce lieu du tems des Machabées. Suppl. L 885. a.
BEU BETHDAGÓN, ( Géogr\ fàcr. ) ville de la tribu de Juda
où les Philiftins avoient un temple dé Dagon. Evénemcns
malheureux qui leur arrivèrent dans ce lieu. Suppl. I.
885. a.\ ) gf 1
BETHER, ( Géogr. facr. ) divers fenrimens lur les- montagnes
de Bether, dont il eft parlé dans le cantique des cantiques.,
& fur la ville de ce nom. Maffacre dès Juifs fous
Adrien,- dans une ville nommée Bether. Suppl. I. 885.
BETHLÉEM, ( Notre-Dame de ) ordre militaire. Son infti-
tution. Loix de cet ordre. II. 216. b.
B e thlé èm . Dii lieu où naqiiit le Sauveur, & où il fut mis
après fa naiffance. IV. 444. B. Obfervations fur le maffacre
des enfans de Bethléem. IX. 847. b.— 849. b.
BETHLÉEMITES, ( les Frères ). ordre fondé dans les ifles'
Canaries. Par qui & pourquoi. Habit de ces religieux. H.
6. b.- -
BETHSABÉÈ, (Hifl- des Juifs ) femme d’Urie & enfuite
de David. Suppl. I. 885. b.
BETHSAN, voye^ ScYTHOPôtis.
BETHULÏE, (Hifi. facr.) fiege de cette ville par Holo-
pherne. Suppl. I1L 445. b. Sa délivrance, voyez Ju d it h ,
OZIAS;
BÉTIQUE, la, (Hifl. 6» Géogr. anc.) province de l’an-*
cienne Efpagne , diftinguée par íes richelfes & fa fertilité.
Ses principales villes. Suppl. I. 88 5.''¿.Son état fous les Romans.
Ibid.2S6.a.
Bétique, commerce des Phéniciens dans ce pays. XVT.
221. a , b. C’eft dans la Bétique qu’étoit probablement la.
Tharfis dont parle l’Écriture. 221. a , b. Peuples qui habi-
toient la Bétique. 752. b.
BÉTIS, (Géogr.) fleuve d’Efpagne. Lieu de fa fource. Ses
différens noms. Ville nommée Tartejfe, entre fes deux embouchures.
Defcription de fon cours. Ce fleiïve s’appelle aujourd’hui
Guadalquivir. Suppl. I. 886. a.
B é t is , fleuve de la Bétique, aujourd’hui le Guadalquivir.
VII. 975. b.
B é t is , gouverneur de Gaza. Cruauté d’Alexandre envers
lui. Suppl. 268. a.
BEtOINE , ( Botan. ) carafteres de ce genre de plante. II.
216. b. Propriétés de cette plahte , de fes différentes parties ,
& de fes diverfeS préparations. Préparation de l’emplâtre dâ
betoine. Ses propriétés. Ibid. 21 y. b.
Béioine. Emplâtre de bétoine. V. 591. b.
BETOIRES , ( Êconom. rufliq. ) trous creufés d’efpacé
en efpace comme des puits , pour y recevoir les eaux.
Coüftruétion de ceux qui fe font dans les grandes baffes-cours.
II. 217. a.
BETTE, (Botan.) on diftingue la blanche, la rouge,'
& la bette-rave. Defcription de chacune, ü. 217. a. Qua*
lité de la bette-blanche. Ibid. b. .
Bette. Deux efpeces de bettes dont on a tiré du fucr«,
XV. 617. b.
BETTERTON, ( Thomas )* aéleur & auteur anglois.
XVII. 603. b. 604.4 , b.
BETYLES, pierres fameufes dans l’antiquité, &c. Opinion
de Bochart fur leur origine. Defcription de ces pierres.
Vertus qu’on leur attribuoit. II.217. b. Voyez Pier re s. (IdolâtS
BEYÉRIDGE, ( Guillaume ) évêque en Angleterre. XV IL
605. 4.
BEVERLAND, (Adrien) fes écritslicentieux. X .495.à.
BEVERLY j fameux afyle en Angleterre. 1. 794. b.
BEUF, f Jean le ) chanoine d’Auxerre. Suppl. 1. 724. b.
BEURRE, comment On le fait en Barbarie. Il n’a été connu
?ne fort tard chez les Grec^l Ce que Pline dit de l’ufage qu’ea
aifoient les barbares. Les Romains ne s’en fervoient qu’en
remede. Les Hollandois l’ont fait connoitre en Afie. ü. 177.
b. Ufage * qu’en fàifoient les Efpagnols. Ufage du beurre au
lieu d’huile dans certaines égufes. Livre de Scockius fur
l’origine_& les phénomènes du beurre. Beurré de Suffolk en
Angleterre. Comment on le fait dans les campagnes près do
Paris. Divers degrés de bonté dans le beurre lelon les divers
tems de l’année. A quoi le meilleur fe reconnoît. Manier®
de le faler , de le fondre. Le meilleur de France eft celui
de Bretagne. Ibid. 218. a. Sur la maniere de faire le beurre.
Voyez les planches de laiterie, vol. I.
B e u r r e , (Chymie) ce mot eft employé pour iignifier
pluficurs préparations des chymiftes. Préparation du beurre
d’antimoine. Huile glaciale d’antimoihe. Beurre d’antimoine
reétifié. La quantité du beure d’antimoine qu’on retire eft le
tiers du mélange qu’on a employé pour le faire. Obfervatiora
fur le récipient qui doit le recevoir. II. 218. b. Dans cette
opération de beurre d’antimoine diftille plus aifément que
le mercure. L’efprit de fel marin eft le diffolvant propre
dé l’antimoine. Ce beurre 'eft lapartie métallique du minerai
réduite en confiftance molle. On compte jufqu’à fept manieres
de le faire. Différence entre celui qu’on fait àvec le
.régule & celui qu’on fait avec l’antimoine crud. Ufage dé
ce beurre en chirurgie. 219. à. ■ r
ÿeurre, matines chymiques, appellées de ce nom. XIV;
922«
B I A B I B
022. b. Beurre d’étain, IX. 565. b , &c. VI. B. ai antimoine.
I. 508. b. XIV. -40. b. |
B e u r r e , ( Pharmacie) préparations en confiftance don-
euent Préparation du beurre de cacao. On peut préparer
de même toutes les femences qui ont beaucoup d’huile. D.
219. a.
Beurre de cacao. II. 501. b.
BEUVANTE, droit qu’un maître de barque ou de navire
fe réferve lorfqu’il donne ion vaifleau a fret. Comment ce
droit fe réglé. IL 219. b. _
BEUVE, prêtre natif de Voinville; Suppl. lu . 846. a.
BEX-VIEUX. Salines de Bex-vieux dans le canton de
Berne. XIV. 55?. « , h- 6t. PI • : •
BEY ou B e g , gouverneur un pays ou dune ville dans
l’empire des Turcs. Ce que fignifte le titre de fangiakbeg.
Divifion des provinces en fept fangiackis dont chacune
qualifie un bey. Par qui les beys font commandés. Bey
de Tunis. Chaque province du royaume d’Alger eft gou-
yernée par un bey. II. 219. b.
Beys, gouverneurs généraux du dey d’Alger. IV.-925. b.
BEZA, ( Myth.) divinité d’Abyde qui rendoit fes oracles
par billets cachetés. Perquifitions qu’occafionnerent ces billets
fous l’empereur Confiance. II. 220.4. •
BEZAAN, ( Ichthy;) petit poiffon des Moluques. Sa defcription.
Suppl. I. 886. 4. Lieux où on le trouve. Ibid. b.
BEZANT , forte de monnoie frappée à Bifance fous les
empereurs chrétiens. Qualité de l’or du bezant. Quand ils
ont été reçus en France. Ufage. qu’on en fàifoit. au couronnement
des rois. Evaluation de cette¿gonnoie. II. 220. a.
B e zan t, ( Blafon ) — Voyez Besân.
BEZE, ( Géogr.) pays de Beze. I. Suppl. I. 691. Abbaye
de Beze. 692. a. vrrrr
Beze, ( Théodore de ) fa vie & fes ouvrages. XVH. 226.
b. Il avoit été prieur de Lonjumeau. Suppl. III.-776. a.
BEZESTAN, lieux , où les marchands de Turquie ont
leurs boutiques. Ceux d’Andrinople font très-beaux. Defcription
de ceux de Conftantinople. III. 220. b.
BEZETTA, crêpon ou linon très-fin, teint avec la cochenille.
D’où viennent les meilleurs. Ufage qu’on en fait. II. 220. b.
BEZIERS, ( Géogr. ) anciens noms de cette ville. Ses révolutions.
Sa population. Hommesilluftres dont elleeftlapatrie.
Suppl. l.SH6.b. ......... : ..
Bezjere. Fontaine remarquable dans le diocefe de Beziers.
VII. 100 b. Cour royale de Beziers. IV. 355. b. Beziers
ancienne. Suppl. IV. 10. b.
BEZOARD , ( Hifl. nat. ) pierre qui fe trouve dans certains
animaux. Bézoards orientaux, & occidentaux. Caractères
& qualités de ces pierres. Ce qu’elles renferment. H.
220. b. Comment on prétend diftinguer les bézoards factices.
Comment on diftingue les bons. -Quels animaux portent
les bézoards. Les bézoards diftingués en cinq daffes.
Ibid. 221. 4.
Bèzpard. On prétend que les bézoards orientaux viennent
d’une chevre. III. 321. b. Bézoards végétaux tirés de l’arek.
Suppl. I. 548. 4. Fauffe tunique de bézoard dont a parlé
Pomet. Iv . 532.4 . Efpece de bézoard, appellé hyftricité.
VIII. 421. b. Bézoard qu’on retire d’un animal d’Afrique,
nommé impalanca. 583. b. Bézoard appellé pierre de mom-
baza. X. 633. a. Autre, dit oeuf de vache. XI. 406. a.
Bézoard , dit onagre. 472. b. Bézoard tiré d’une efpece de
finge de l’ifle de Bornéo. Ibid. Béàoard du cerf. XVI. 947.
a , b. Efpece de bézoard qui fe forme dans le véficule du
fiel, dans l’eftomac & les inteftins de quelques chevaux.
VIII. 216. 4. Suppl. III. 393. b. Tranchées qu’il lui caufe.
Suppl. III. 421. b. Nullité des remedes tirés des bézoards
vrais & faétices. Suppl. IV. 465. b.
Bézpard-minéral. Defcription de cette pierre : lieux où on
la trouve. II. 221. a.
Bézoard-Minéral , ( Chymie ) préparation d’antimoine :
comment elle fe fait. C’eft un très-grand fudorifique. II.
221. b.
Bézoard minéral. I. 509. a. Maniéré de le préparer. XIV.40. b.
Bézoard martial, comment on le prépare. C’eft un excellent
remede pour la jauniffe , les hypochondrcs , &c. H.
221. b.
Bézoard folaire ; bézoard lunaire ; bézoard jovial ou d'étain.
Defcription de ces préparations chymiques. ü . 221. b.
BEZOLE , ( Ichthy. ) poiffon du lac de Laufanne. Sa defcription.
Qualité de fa chair, ü . 221 .b.
B I
BIAFARA, ( Géogr. ) correction à faire dans cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. 1. 886. b.
BIAIS, (Jardinage ) fauver un biais ; comment on le
fauve dans les pièces couvertes, & dans les lieux décou-
v^ ts-,P‘vers moyens de cacheter les biais, ou de les rendre
tolérables. II. aia> a>
Tome I.
B i a i s , ( Manège) diverfes cxpreflîoris de l’art, ôti ce mot
eft employé. Mettre le cheval en biais. Ce qu’il faut faire
pour aller en biais. II. 222. a-.
BIANCHI, ( Jean-Baptifte ) anatomifte; Suppl. I. 40ç. A
Sa doélrine fur la faignée. XIV. 505.4/
BIANCHINI, (François) article fur cet auteur. XVII.8oi
4. Son ouvrage & fes découvertes fur la planete vénus*
VIII. 189. b. XVII. 35. 4 , A Defcription qu’il a donnée
d’un monument où fe trouve l’explication du cycle de Jules-
Céfar. XVII. 767« bt Sa differtation fur le cycle de faint
Hyppolite. 768. b. Defcription de la méridienne qu’il conf-
truifit à Rome. Suppl. III. 239. b.
BIÀ5 , l’un des fept fages de la Grece. VII. 910. 4.XIIL
3 ,1 î à t h a n a t e s , fuicides. Livre du doyen de faint Paul
de Londres : intitulé , biothanatus. II. 222. b. .
BIBÀUC , (Guillaume) prédicateur. XVI. 3181 À
BIBBY, (Botan. ) arbre d’Amérique dont il fort beaucoup
de jus. Defcription de cet arbre. Les Indiens le brûlent
pour en avoir le fruitj Defcription & ufage de ce fruit»
Lorfque cet arbre eft jeune , ils y font une incifion dont
ils tirent une liqueur , qui leur fert dé bôiffon. II. 222. fe
BIBIENA, (François) phyfiologifte. Suppl.IV. 364.4.
BIBLANDER, ( Théodore ) profeffeur de théologie à
Zurich.- XVII. 746. b.
BIBLE. Divifion de la bible en deux parties. Livres dé
l’ancien teftament, livres du. nouveau , félon le concile de
Trente. Livres de l’ancien teftament dont la canôhicité n’a-
pas été généralement admife» Langues & caraéleres dans
lefquels ces livres ont été écrits. La verfion la plus ancienne
eft celle des Septante. Livres du nouveau teftament de l’authenticité
defquels on a douté. En quelle langue le nouveau
teftament a été écrit, ü. 223. a. On diftingue les bibles
félon la langue dans laquelle elles font écrites. Ibid. fe
Bibles hébraïques ; i°. les manuferites : quelles font les meilleures
: leur antiquité : bibliothèques où l’on en. trouve;
a°. les imprimées. Quelles font les plus anciennes, les meilleures.
Bibles imprimées à Venife par Bomberg. Celle de
Buxtorf, le pere , imprimée à Bafle. Autres éditions de
la bible ^ébraïque, de Robert-Etie.nne., d’Anvers, d’Amf-
terdam , de Venife. II. 223. fe De toutes les éditions , les
tlus' belles font celles de Joleph-Athanias, juif d’Amfterdam;
éditions de Claudius $ de Jablonski & d’Opitius : défec-
tuofités & avantages de ces bibles« Petite bible in-26 de
Robert-Etienne , contrefaite à Géneve. Autres éditions en
petit format fans points, fort eftimées des juifs«- Ibid. 224. 4;
Bibles grecques. On peut les réduire à trois ou quatre claffes
principales. 1°. celle de Complute ou d’Alcale de Henarès.
II. 224. 4. 20. celle de Venife ; 30. celle de Rome ; 40. celle
d’Oxford. Ibid. b.
Bibles latines. On peut les réduire à trois claffes; i°. l’ancienne
vulgate; 20. lavulgate moderne. II. 224. fe 30. Nouvelles
verfions latines faites fur l’hébreu dans le feizieme
fiecle.Ibid. 225.4.
Bibles orientales. La verfion famaritaine; une verfion arabe,
du Pentateuque, qui n’a point été imprimée. L’hiftoire de
Jofué, mais différente du livre de Jouté que nous recon-
noiffons. II. 225. 4.
Bibles chaldéennes, ou les targums d’Onkelos fur le Pentateuque
, & de Jonathan fur tous les livres que les Juifs appellent
prophètes. Les autres paraphrafes chaldéennes fontia plupart
remplies de fables. IL 225 « fe »
Bibles fyriaques., Edition du nouveau teftament en carat1
teres fyriaques. Edition' des pfeaumes en cette langue»
Quant à l’ancien teftament, les Syriens ont deux fortes de
verfions. II. 225. fe
Bibles arabes. Celles à l’ufage des Juifs. Verfion arabe du
pfeautier, de toute l’écriture dans les polyglottes de Paris & 'de
Londres, de l’ancien teftament imprimé à Rome en 1671»
Les bibles arabes de l’Europe ne font pas tout - à - fait les
mêmes que celles de l’Orient. Pentateuque arabe d’Erpenius»
Les quatre évangeliftes en arabe. Rome 1591 , &c. IL
225. fe
Bibles cophtes ; ou des chrétiens d’Egypte ; elles üe font
qu’en manuferit dans les grandes bibliothèques. II. 226. a.
Bibles éthiopiennes , arméniennes, perfannes. ü; 226. 4.
Bibles gothiques. Auteur de cette verfion $ à laquelle
manquoient les livres des rois. On n’en a plus que les quatre
évangeliftes. II. 226. a..
Bibles mofeovites. Cette verfion eft en langue fclavonne *
dont la mofeovite eft un dialeéte. Ouvrages à confulter pour
acquérir une plus ample connoiffance desnorabreufes éditions
& verfions de la bible. II. 226. a.
Bible. Soin que les Hébreux prenoientde leurs livres facrés.
II. 228. b. De la pon&uation des bibles hébraïques. XII. 870
4 , fe Voyez Po n c t u a t io n . Obfervations fur le ftyle de là
bible. VIII. 89. 4, fe 90. 4 , fe Uniformité de la langue en
laquelle les livres de l’ancien teftament ont été écrits. VIII.
85. 4 , b. D’où vient cette uniformité de génie & de