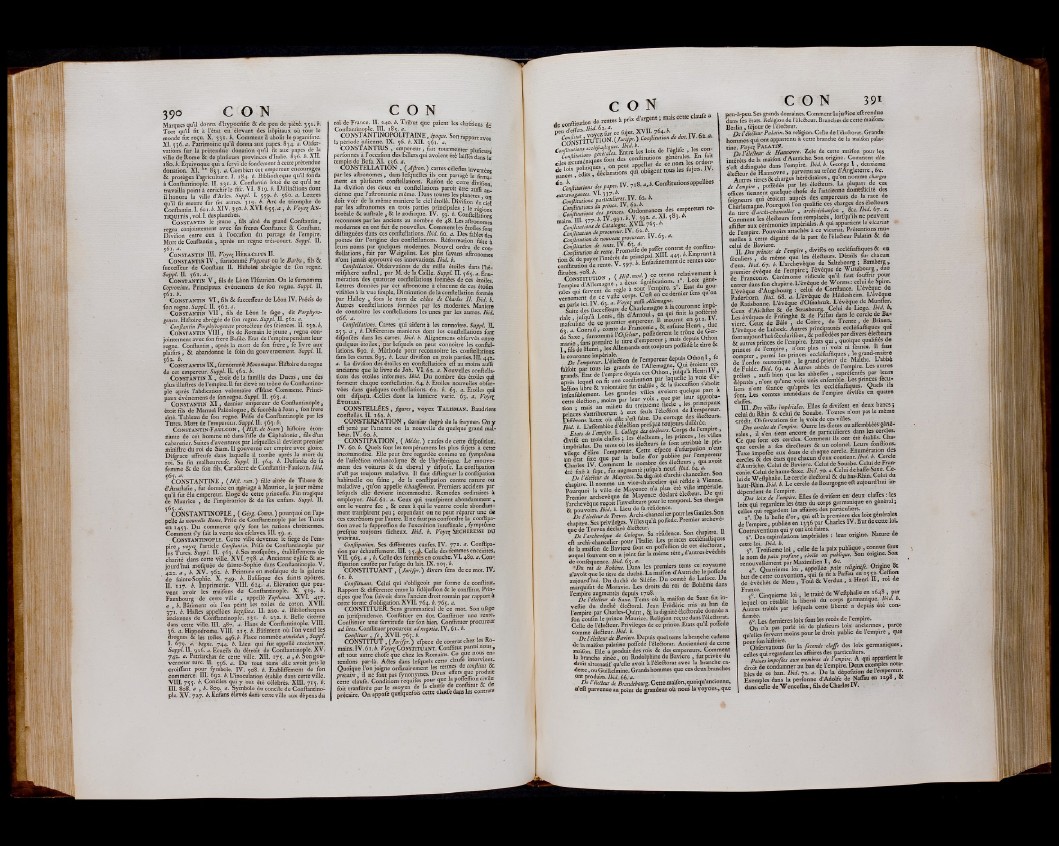
39° C O N
Marques qu’il donna «Thypocrifié & de peu de piété. 351. b.
Tort qu’il fit à l’état en élevant des hôpitaux où tout le
inonde fut reçu. X. 331. b. Comment il abolit le paganifme.
XI. ç36. a. Patrimoine qu’il donna aux papes. 834. a. Obfer-
vations fur là prétendue donation qu’il fit aux papes de la
ville de Rome ©t de plufieurs provinces d’Italie. 030. b. XII.
180. b. Équivoque qui a fervi de fondement à cette prétendue
donation. XL'** 833. a. Combien cet empereur encouragea
& protégea l’agriculture. I. 184. b. Bibliothèque qu’il fonda
à Conftantinople. II. 231. b. Conftantin loué de ce quil ne
travailla point à enrichir le fifc. VI. 819. b. Di limitions dont
il honora la ville d’Arles. Suppl. g 559. b. 560. a. Lettres
qu’il fit mettre fur fes armes. 319. b. Arc de triomphe de
Conftantin. I. 601. b. XIV. 3 50. b. XVI. 655.a , b. Voye.1 ANTIQUITÉS
, vol. I. des planches. ^
C o n s tan t in le jeune , fils aîné du grand Coniiantin,
régna conjointement avec fes freres Confiance & Confiant.
Divifion entre eux à l’occafion du partage de l’empire.
Mort de Coniiantin, après un regne très-court. Suppl. II.
<61. a.
C o n s ta n t in HI. Voyc{ H é r a c liu s IL
C o n s ta n t in IV , furnommé Pogonat ou le Barbu, fils &
fucceffeur de Confiant IL Hiftoine abrégée de fon regne.
Suppl. II. 561. a.
(C on s tan tin V , fils de Léon l’Ifaurien. On le furnomma
Copronime. Principaux événemens de fon regne. Suppl. II.
501. b. .
C o n s ta n t in V I , fils & fuccefieur de Léon IV. Précis de
fon regne. Suppl. II. 562. a.
C o n s ta n t in VII , fils de Léon le fage, dit Porphyro-
gcnetc. Hifioire abrégée de fon regne. Suppl. II. 562; a.
' Conftantin Porphyrogenete proteâeur des fciences. H. 232. b.
C o n s ta n t in V III, fils de Romain le jeune, régna conjointement
avec fon frere Bafile. Etat de l’empire pendant leur
regne. Coniiantin , après la mort de fon frere, fe livre aux
plaifirs, & abandonne le foin du gouvernement. Suppl. II.
562. b. .
C o n s ta n t in IX, fumomitiè Monomaque. Hifioire du regne
de cet empereur. Suppl. IL 562. b.
C o n s ta n t in X , étoit de la famille des Ducas, une des
plus illuftres de l’empire. Il fut élevé au trône de Conftantinople
après l’abdication volontaire d’Ifaac Comraene. Principaux
événemens de fon regne. Suppl. U. 563. a.
C o n s ta n t in X I , dernier empereur de Conftantinople,
étoit fils de Manuel Paléologue, & fuccéda à Jean, fon frere
aîné. Tableau de fon regne. Prife de Conftantinople par les
Turcs. Mort de l’empereur. Suppl. II. 563. b.
Ç o n s ta n t in -F a u lc o n , ( Hift. de Siam) hifioire étonnante
de cet homme né dans l’iile de Céphalonie , fils d’un
cabaretier. Suites d’aventures par lefquellcs il devient premier
miniftre du roi de Siam. Il gouverne cet empire avec gloire.
Difgrace affreufe dans laquelle il tombe après la mort du
roi. Sa fin malheureufe. Suppl. II. 564. b. Deftinée dé fa
femme & de foii fils. Caraâere de Conftantin-Faulcon. Ibid.
*65. a. __
CONSTANTINE , ( Hift. rom. ) fille aînée de Tibere &
d’Anaftafie , fut donnée en npriage à Maurice, le jour même 3u’il fut élu empereur. Eloge de cette princeffe. Fin tragique
e Maurice , de l’impératrice & de fes enfâns. Suppl. II.
5 ^CONSTANTINOPLE, ( Giog. Comm. ) pourquoi on l’appelle
la nouvelle Rome. Prife de Conftantinople par les Turcs
en 1453. Du commerce qu’y font les nations chrétiennes.
Comment s’y fait la vente des efclaves. III. 50. a.
CONSTANTINOPLE. Cette ville devenue le fiege de l’empire
, voyei l’article Conflantin. Prife de Conftantinople par
les Turcs. Suppl. H. 5 <$3. b. Ses mofquées, établifiemens de
charité dans cette ville. XVI. 758. a. Ancienne églife & aujourd’hui
mofquée de fainte-Sophie dans Conftantinople. V.
422. a , b. XV. 362. b. Peinture en mofaïque de la galerie
de fainte-Sophie. X. 749. b, Bafilique des faints apôtres.
II. 117. b. Imprimerie. VIÏI. 6 24. «. Elévation que peuvent
avoir les maifons de Conftantinople. X. <19- b.
Fauxbourg de cette ville , appellé Tophana. XVI. 417.
a , b. Bâtiment où l’çn peint les toiles de coton. XVII.
371. b. Halles appellées be^eftins. II. 220. a. Bibliothèques
anciennes de Conftantinople. .231. b. 232. b. Belle citerne
dans cette ville. III. 487. a. Hans dé Conftantinople. VIII.
36. a. Hippodrome. VIII. 215. b. Bâtiment ou l’on vend lei
drogues oc les toiles. 446. b. Place nommée atmeidan, Suppl.
I. 670. a. bagne. 744. b. Lieu qui fut appellé exocionium.
Suppl. ü . 916. a. Ecueils du détroit de Conftantinople. XV.
742. a. Patriarchat de cette ville. XII. 175. a , b. Son gouverneur
turc. II. 536. a. De tout tems elle avoit pris le
croifiant pour fymbole. IV. 508. b. Etabliffement de fon
commerce. III. 692. b. L’inoculation établie dans cette ville.
VIII. 755. b. Conciles qui y ont été célébrés. XIII. 715. b.
HL 808. a , b. 809. a. Symbole du concile de Conftantinople.
XV. 727. b. Enfans élevés dans cette ville aux dépens du
C O N
roi de France. II. 240. b. Tribut que prient les chrétiens de
Conftantinople. III. 185. a.
CONSTANTINOPOLITAINE, époque. Son rapport avec
la période julienne. IX. 56. ¿.XII. 361. a. ^ ^
CONSTANTIUS » empereur, fait tourmenter plufieurs
perfonnes à l’occafion des billets qui avoientété laiffés dans le
temple de Befa. XI. 536. a.
CONSTELLATION , ( Aflron. ) cartes céleftes inventée«
par les aftronomes, dans lefquelles ils ont partagé le firmament
en plufieurs conftellations. Raifon de cette divifion"
La divifion des cieux en conftellations paroît être aulfi ancienne
que l’aftronomie même. Dans toutes les planetes, on
doit voir de la même maniéré le ciel étoilé. Divifion du^iel
par les aftronomes en trois parties principales ; le régions
boréale & auilrale , & le zodiaque. IV. 59. b. Conftellations
reconnues par les anciens au nombre de 48. Les aftronomes
modernes en ont frit de nouvelles. Comment les étoiles font
diftinguées dans ces conftellations. Ibid. 60. a. Des fables des
poètes fur l’origine des conftellations. Réformation frite à
leurs noms par quelques modernes. Nouvel ordre de conftellations
, fait par Weigelius. Les plus favans aftronomes
n’ont jamais approuvé ces innovations. Ibid. b.
Conflellation. Obfervations de dix mille étoiles dans Fhé-
mifphere auftral, par M. de la Caille. Suppl. II. 365. a. Énumération
des quatorze conftellations formées de ces étoiles.
Lettres données par cet aftronome à chacune de ces étoiles
vifiblesà la vuefimple. Diminution de la conflellation formée
par Halley , fous le nom de chêne de Charles II. Ibid. b.
Autres conftellations formées par les modernes. Maniéré
de connoitre les conftellations les unes par les autres. Ibid.
366.
Conflellations. Cartes qui rident à les connoître. Suppl. IL
253. a , b. Différentes maniérés dont les conftellations font
**ipc difpof*é"*e' s d*a nBs le s cartesm. Ikbi d. b. Alig nemens o¡b¡f¡e¡rHvés entre
quelques étoiles, par lefquels on peut connoître les conftellations.
890. b. Méthode pour reconnoitre les conftellations
fans les cartes. 893. b. Leur divifion en trois parties. III. 442.
a. La divifion des étoiles en conftellations eu au moins auffi
ancienne que le livre de Job. VI. 62. a. Nouvelles conftellations
'des étoiles informes. Ibid. Du nombre des étoiles qui
forment chaque conflellation. 64. b. Etoiles nouvelles obfer-
vées dans quelques conftellations. 62. b. 63. a. Etoiles qui
ont difparu.- Celles dont la lumière varie. 63. a. Voyez
ÉTOILES.
CONSTELLÉES , figures t voyez T a lism an . Baudriers
éonftellés. U. 162. b.
CONSTERNATION, dernier degré de la frayeur. On y
eft jetté par l’attente ou la nouvelle de quelque grand malheur.
IV. 60. b.
■ CONSTIPATION, ( Médec. ) caufes de cette difpofition.
IV. 60. b. Quels font les tempéramens les plus fujets à cette
incommodité. Elle peut être regardée comme un iymptôme
de l’affeétion mélancolique & ae l’hyftérique. Le mouvement
des voitures & du cheval y difpofe. La conftipation
n’eft pas toujours maladive. Il faut diftinguer la conftipation
habituelle ou faine , de la conftipation contre nature ou
maladive , qu’on appelle cchauffement. Premiers accidens par
lefquels elle devient incommodité. Remedes ordinaires à
employer. Ibid. 61. a. Ceux qui tranfpirent abondamment,
ont le ventre fec , & ceux à qui le ventre coule abondamment
tranfpirent peu ; cependant oa ne peut réparer une de
ces excrétions par l'autre. 11 ne faut pas confondre la conftipation
avec la fuppreffion de l’excrétion inteftinale , fymptôme
prefque toujours fâcheux. Ibid. b. Voye{ Sécheresse d u
VENTRE.
Conftipation. Ses différentes caufes. IV. 771. <*• Conftipation
par échauffement. III. 3 5.«é. Celle des femmes enceintes.
VII. 963. a , b. Celle des femmes en couche. VL 480. a. Con-.
ftipation caufée par l’ufage du lait. IX. 205. b.
CONSTITUANT, {Jurifpr.) divers fens de ce mot. IV.
61. b.
Conftituant. Celui qui s’obligeoit par forme de conftitut.
Rapport & différence entre la ndéjumon & le conftitut. Principes
que l’on fuivoit dans l’ancien droit romain par rapport à
cette forme d’obligation.XVII. 764. b. 763. a.
CONSTITUER. Sens grammatical de ce mot. Son ufage
en jurifprudence. Conftituer en dot. Conllituer une rente.
Conftituer une fervitude fur fon bien. Conftituer procureur
ad lites. Conftituerprocureur ad negotia. IV. 61. b.
Conftituer,. f e , XVII. 765. b.
CONSTITUT , ( Jurifpr. ) efpece de contrat chez les Romains.
IV. 61. b. Voyei C o n s t itu a n t . Conftitut parmi nous ,
eft tout autre chofe que chez les Romains. Ce que nous entendons
par-là. Aftes dans lefquels cette claufe intervient.
Quoique l’on joigne ordinairement les termes de conftitut oc
g i m , à ne font pas fynonymes. Deux effers que produit
cette claufe. Conditions iequifes pour que la poffeffion crnle
foit tranférée par le moyen de h claufe de conjhrur & d
précaire, On appofe quelquefois cette claufe dans les contrats
C O N
de c o n te n t io n de rentes à prix d’argent | mais cet« claufe a
peu d’effets. l t X V IL 764. b.
CO^STiT^lON . {Jurifpr-) Conftitution de dot. IV. 6*. *
Conftitutions ecclsjiajtiqu . j ^ l’êglife » les con-
i1ei le§s oec usméniqmuessÊ foMnt ËfÊ “Ê ns iBurmBuBo S -ggé n&esle.s eo»r dfoanit- 111iv-
CON 391
ÜÜË Conftüuti■o ns jd-u, punup»e«r . IiV y.. 771 .8«.t Ujj b. Conftitutionsappellées
txtravagMUrj..VI.337. • ,
Conftitutions parltcuUtrct.1V- 6a. é.
Conftitutions de Catalogne. XVIL 765
Conftitution de procureur. IV. 02. p.
Conftitution de nouveau procureur. IV. 3 •
708.4. . . e relativement i ■PSHMiftSiâist
Im P B B 597> ¿faifu.emen.de rentes conflituêes.
f c i n“ ue s|ft toe!SDu c o ^ e L é&eurs.
Ibid. b. L’aifemblée d’élefhon prefque toujours difîeree.
Etats dt l’mpirt. I. ColUgt dts cltiltws. Corps de l enip re,
./•. __ rlaffes 1 les éleéleurs, les princes, les villes
impériales. Du tems où les électeurs fe font attribué le pn-
vileee d’élire l’empereur. Cette efpece dufurpation neut
u n fn t fixé que pir la bulle d’or publiée par l’empereur
Charles IV. Somment le nombre desè\u&<tuK .q u i avo.
été fixé à fept, fut augmenté jufquà neuf. Ibid. 64.
peu-à-peu.Ses grands domaines. Comment la juftice eft rendue
dans les états. Religion de l’éleâour. Branches de cette maifon«
Berlin, féjour de réle&eur.
De l’èlefleur Palatin. Sa religion.. Celle de l’éleâorat. Grands -
hommes qui ont appartenu à cette branche de la maifon palatine.
Dt m m * Maytnc,. Sa dignité d aK!“^ancelmr. Son
chapitre. Il nomme un vice-chancelter qui réftde à Vienne.
Pourquoi la ville de Mayence n’a plus étévüle impériale.
Prenuer archevêque de Mayence déclaré éleveur. De qui
l’archevêque reçoit l’inveftiture pour le temporel. Ses charges
& pouvoirs. Ibid. b. Lieu de fa réfidence. WÈSm
De l’éle fleur de Trêves. Archi-chancelier pour les Gaules. Son
chapitre. Ses privilèges. Villes qu’il poffede. Premier archevêque
Voyei P a la t in .
De i’élebeur de Hannovre. Zele de cette maifon pour les
intérêts de la maifon d’Autriche. Son origine. Gomment elle
s’eft diftinguée dans l’empire. Ibid. b.^ George I , deuxième
éleéleur d l Hannovré, parvénu au trône d Angleterre , &c.
Autres titres & charges héréditaires, qu on nomme thargts
dt témoin poffédés par les eleéleurs. La pbip.t: de ces
offices tiennent quelque chofe de 1 ancienne dombihcitè des
feigneurs qui étoient auprès des empereurs de l i ra“ de
Charlemagne. Pourquoi l’on quaMe ces chatges des éleaeurs
du titre A'arMnbanctlltr , archt4 chan[on , &c. Ibid. 67. a.
Comment les élefteurs font remplacés, lorfqu ils ne peuvent
affilier aux cérémonies impériales. A qui appartient le vicariat -
de l’empire. Pouvoirs attachés à « m ÿ Prétennons mu.
de Treves déclaré élefteur.
Dt l'archtviqut dt Colognt. Sa rèfidence. Son àjW" * ■ ®
cil archi-chancelier pour l ’Italie. Les prmees
de la maifon de Bavière font en poflelfion de cet électorat ,
auquel fouvent on a joint fur la meme tète, d antres évêchés
de conféquence. Ibid. 65. a. .
•Du roi de Bohême. Dans les premiers tems ce royaume
n’avoit que le titre de duché. La maifon d Autriche le poffede
aujourd’hui. Du duché de Siléfie. Du comté de Luface. Du
marquifat de Moravie. Les droits dû roi de Bohême dans
l’empire augmentés depuis 1708. 1 e r •
De l'èlàfleur de Saxe. Tems où la maifon de Saxe tut in
veftie du duché électoral. Jean Frédéric mis au ban de
l’empire par Charles-Quint, la dignité éleéloraletiomiée à
fon coufin le prince Maurice. Religion reçue dans réleétorat.
Celle de l'électeur. Privilèges de ce prince. Etats qu’il poffede
comme éleéleur. Ibid. b. -
De l'èlefleur de Bavière. Depuis quel tems la braqche cadette
de la maifon palatine poffede l’éledorat. Ancienneté de cette
maifon. Elle a produit des rois & des empereurs. Comment
la branche aînée, ou Rodolphine de Bavicre , fut privée du
droit alternatif qu’elle avoit à l’éledorat avec la branche cadette
, ou Guillelmine. Grands hommes que ces deux branches
ont produits. lbid. 66.~a.
De l’èlefleur de Brandebourg. Cette maifon, quoiqu ancienne,
n’eft parvenue au point de grandeur où nous la yoyons, que
à cette dignité de la part de léleaeur Palatrn & de
''- IL Des princes dt l'empire, divifês en ecdèfaltiques & en
féculiers , de même que les éleélems. Dètads fur chacun
d’eux. Ibid. 67. b. L’archevêque de Saltxbourg ; Bamberg,
premier évêque de l’empire ; l'évêque de Wutxboutg , duc
de Franconie. Cérémonie ridicule quil faut fouffrtr nour
entrer dans fon chapitre. L’évêque de Worms : celm de Spire.
L’évêque d’Augsbourg : celui de Confiance. L évêque de
Paderhom. Ibid. 68. a. L’évêque de Hildesheim. Lévegue
de Ratisbonne. L’évêque d’Ofiiabruk. L évêque de Monfter.
Ceux d’Aichftet & de Strasbourg. Celui de Ltege. Ibid. b.
Les évêques de Frifinghe & de Paflau dans le cercle de Bavière.
Ceux de Bêle , de Coire, de Trente , de Bnxen.
L’évêque de Lubeck. Autres princmautês eecléfiaflignes qiu
font am ourd’hui fécularifées, oc poifédées par divers é eéteurs
& autres princes de l'empire. Etats qui, quoique qualifiés de
princes de l’empire, n'ont plus ni voix m fèance. Il faut
compter , parmi les princes ccdrfiaftiques , le grand-maître
de l'ordre teutonique , le grand-prieur de Malthe. Labbè
de Fulde. Ibid. 69. a. Autres abbés de 1 empire. Les autres
»rélats , auffi bien que les abbeffes , repréfentés par leurs
députés, n’ont qu’une voix unis enfemble. Les princes féculiers
n’ont féance qu’après les eccléfiaftiques. Quels ils
font. Les comtes immédiats de l’empire divnés en quatre
daS l*. Des villes impériales. Elles fe divifent enN deux bancs ;
celui du Rhin & celui de Souabe. Toutes n’ont pas le même
crédit. Obfervations fur la voix de ces villes.
Des cercles de l ’empire. Outre les dietes ou affemblées générales,
il s’en tient encore de particulières danî; les cercles.
Ce que font ces cercles. Comment ils ont été établis. Chaque
cercle a fes directeurs & un colonel. Leurs fondons,
taxe impofée aux états de chaoue cercle. Enumération des
cercles & des états que chacun d eux connent. Ibid. f Cercle
d’Autriche. Celui de Bavière. Celui de Souabe. Celui de Franconie.
Celui de haute-Saxe. Ibid.no. ^ Celin de baffe-Saxe. Celui
de WeftphaÜe. Le cercle éleftoral & du bas-Rhin. Celui du
haut-Rhin. Ibid. b. Le cercle de Bourgogne eft aujourd hm tni
i ^ 'Z ^ d t ° ' 2 pùt. EUes fe divifent en- deux claffes: les
loix qui regardent les états du corps germanique en général;
celles qui regardent les affaires des particuliers.
ïnt le s anaircs u o pa» uv»u»w. ;
e d’o r, qui eft la première des loix générales
liée en 1336 par Charles IV. But de cette lou
mi y ont été Faites.
q j-j 1 .s 11 _ J l. __1 —A 1 . n .nm m rp nPC
» . la bullé c. I
de l’empire, publiée e
Contraventions qui y oui cici«iva. . . _ ,
a0. Des. capitulations impériales : leur origine. Nature de
cette loi. Ibid. b. ... r
a”. Troifieme lo t, celle de la prix publique , connue fora
le nom de paix profane, civUt ou publique. Son ongrne. Son
renouvellement par Maximilien 1, 6rc. . g,
4". Quatrième loi , appellée pats, reUgicufe. Origine «
but de cette convention, qui fe fit à Paffau en X51 • ,
d” évêeliés de Metz , T o îl & Verdun, à Henn Ï I , ro. de
FT “ cinqoieme lo i, le traité de Weftphalie en 1648 , par
lequel on rétablit la liberté du corps ^germantque «id. b.
Autres traités par lefquels cette liberté a depuis été confit
6°4 Les dernieres loix font les recès de l’empire.
On n’a pas parlé ici de plufieurs loix anciennes, parce
qu’elles fervent moins pour le droit public de 1 empire , que
Dour fon hiftoire. ■ t .
Obfervations fur la fécondé clajfe des loix germaniques,
celles qui regardent les affaires des particuliers.
Peines impofées aux membres de l empire. A qui appartient le
droit de condamner au ban de l’empire. Deux exemples notables
de ce ban. Ibid. 72. a. De la dépofition de 1 empereur.
Exemples dans la perfonne d’Adolfe de Naffau en 129» , «
d?n«t celle de ’Wenceflas, fils de Charles IV.