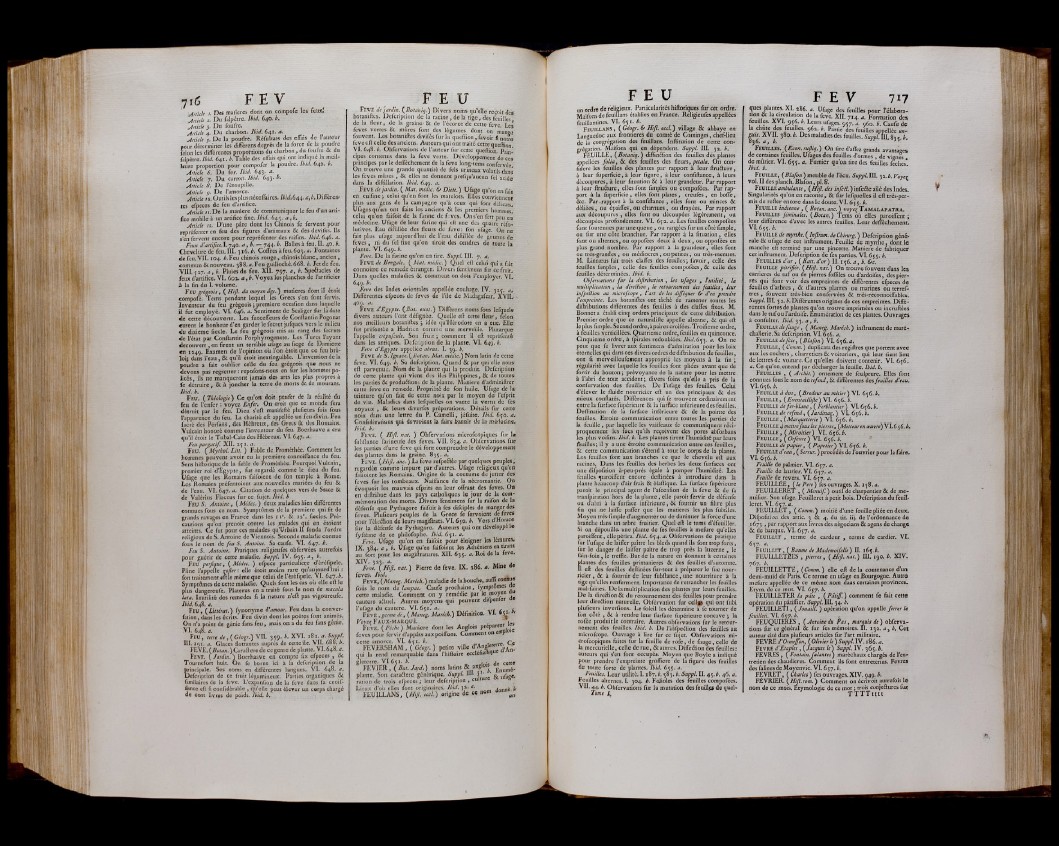
7i6 F E V
' ¡Article /. Des matières dont on compofc les fcltti
Article 2. Du falpétrc. Ibid. 640. b.
Article 3. Du foufre.
Article 4. Du charbon. Ibid. 6 4 1 . a-
Article k. D e la poudre. Réfultats des e/Tais de 1 auteur
pour déterminer les différons degrés de la force de la poudre
félon les différentes proportions du charbon, du foufre oc du
falpétre. Ibid. 641. é. Table des effais qui ont maiqûe Ja mcib-
leure proportion pour compofcr la poudre. Ibid. 642. 0»
Article 6. Du fer. Ibid. 643. a.
Article 7. Du carrort. Ibid. 6 4 3. b.
Article 8. De rétoupille.
Article 9 . De l’amorce. _ . .
Article 10. Outils les plus néccflaircs. Ibid.644. a,b. Différcn*
tes efpeces de feu d’artifice.
Article 11. D e la maniéré de communiquer le feu d’un artifice
mobile à un artifice fixe. Ibid. 64s. a ,b .
Article 12. D’une pâte dont les Chinois fe fervent pour
représenter en feu des figures d’animaux 8c des devifes. Ils
s’en fervent encore pour repréfenter des raifins. Ibid. 646. a.
Feux d’artifice.\. 740. a t b .— 744. b. Balles à feu. II. 40. b.
Chevelure de feu. III. 316. b. Coffres à feu. 6 o x .a . Fontaines
de feu.VII. 104. ¿.Feu chinois rouge, chinois blanc, ancien,
commun 8c nouveau. 388.4. Feu euilloché.668. b. Jet de feu.
VIII. 527. a , b. Pluies de feu. X ll. 797. a t b. Spectacles de
feux d artifice. V I. 602. a ,b . V o y e z les planche» de l’artificier
à la fin du I. volume.
F eu grégeois t ( Hifl. du moyen âg e.) matières dont il écoit
compofo. Teins pendant lequel les Grecs s’en font fer vis.
Inventeur du feu grégeois jjjremicrc occafion dans laquelle
il fut employé. V L 646. a. Sentiment de Scaligcr fur la date
de cette découverte. Les fucceffcurs de Confiantin Pogonat
eurent le bonheur d’en garder le fccrct jufqucs vers le milieu
du dixième ficcle. Le feu grégeois mis au rang des fccrets
de l’état par ConAantin Porphÿrogcnetc. Les Turcs l’ayant
découvert, en firent un terrible ufage au ficge de Damicttc
en 1249. Examen de l’opinion où l’on étoit que ce feu brû-
loi{ dans l'eau, 8c qu’il étoit inextinguible. L invention de la
poudre a fait oublier celle du feu grégeois que nous ne
devons pas regretter : repofons-nous en fur les hommes policés,
ils ne manqueront jamais des arts les plus propres à
le détruire, 8c à joncher la terre de morts oc de mourans.
Ibid. b. , „
F eu. ( Théologie ) Ce qu’on doit penfer de fa réalité du
feu de l’enfer : vo yez Enfer. On croit que ce monde fera
détruit par le feu. Dieu s’cA manifcAé plufieurs fois fous
l ’apparence du feu. La charité cA appcllée un feu divin. Fou
facré des Pcrfans, des Hébreux, des Grecs 8c des Romains.
.Vulcain honoré comme l’inventeur du feu. Boerhaave a cru
qu’il étoit le Tubal-Cain des Hébreux. VI. 647. a.
Feu purgatif. XII. 251 .a .
F eu. ( Mythol. Lut. ) Fable de Prométhéc. Comment les
hommes peuvent avoir eu la première connoiflance du feu.
Sens hiAoriquc de la fable de Prométhée. Pourquoi V ulcain,
premier roi d’E gypte, fut regardé comme le dieu du feu.
Ufâge que les Romains faifoicnt de fon temple à Rome.
Les Romains préfentoient aux nouvelles mariées du feu 8c
de l’eau. VI. 647. a. Citation de quelques vers de Stacc 8c
de Valérius Fkccus fur ce fujet. Ibid. b.
F eu S . Antoine, ( Médec. ) deux .maladies bien différentes
connues fous c e nom. Symptômes de la première qui fit de
grands ravages en France dans les xi*. 8c 12*. Aeclcs. Précautions
qu on prenoit contre les malades qui en étoient
atteints. Ce fut pour ces malades qu’Urbain II fonda l’ordre
religieux de S. Antoine de Viennois. Seconde maladie connue
fous le nom de feu S . Antoine. Sa caufe. V I. 647. b.
Feu S . Antoine. Pratiques religieufes obfcrvécs autrefois
pour guérir de cette maladie. Suppl. IV. 693. a , b.
F eu perfiqucy ( Midec. ) cfpccc particulière d’éréfipelc.
Pline l’appelle zofier : elle étoit moins rare qu’aujourd’hui :
fon traitement eu le même que celui de l’éréfipelc. V l. 647. é.
Symptômes de cette maladie. Quels font les cas où elle eA le
plus dangereufo. Platcrus en a traité fous le nom de macula
lata. Inutilité des remedes A la nature n’cA pas vigoureufe.
Ibid. 648. a. _ t ,
F e u , (L itté ra l.) fynonyme A'amour. Feu dans la convcr-
fation, dans les écrits. Feu divin dont les poetps font animés.
On n’a point de génie fans feu , mais on a du fou fans génie.
‘ .VI. 648,.a .
F e u , terre de y (Géogr.) V IL 3<9. b. XVI. 18 1 .y . %>/>/.
HI. 191. a. Glaces Bottantes auprès de cette île. VII. 688. b.
FEVE. (Botan. )Caraélere de ce genre de plante. V I. 648. a.
Fe v e . ( Jardin. ) Boerhaave en compte ftx efpeces , 8c
Tournefort huit. On fo borne ici à la defeription de la
principale. Ses noms en différentes langues. VI. 648. a,
Defeription de ce fruit légumineux. Parties organiques 8c
fimilaircs de la feve. L’cxpanfion de la feve dans fa croif-
foncc eA fi confidérable , qu’elle peut élever un corps chargé
de cent livres de poids. Ibid, b,
F E U
F f.v e de jardin. (B ota niq.) Divers noms qu’elle reçoit de»
botaniAcs. Defeription de la racine, de la tig e , des fouilles
de la fleur, de la graine-8c de l’écorce de cette fove. Les
feves vertes 8c mûres font des légumes dont on mange
fonvent. Les botaniAcs divifés fur la queftion , favoir fi notre
feve cA celle des anciens. Auteurs qui ont traité cette qucAion.
V I. 648.b . Obforvations de l’auteur fur cette qucAion. Principes
contenus dans la feve verte. Développement de ces
principes par le dciTéchcmcnt de la feve long-rems confervée
On trouve une grande quantité de fols urineux volatils dan9
les feves mûres , 8c elles ne donnent prefqu’aucun fol ÉÉfiS
dans la diAillation. Ibid. 649. a.
F e v e de jardin. ( Mat. médic. fi* Dicte.) Ufage qn’011 en fait
en cuifinc ; celui qu’en font les matelots. Elles conviennent
plus aux gens de la campagne qu’à ceux qui font délicats,
Ufagcs qu’en ont faits les anciens 8c les premiers hommes,
celui qu'on faifoit de la farine de feves. On s’en fort peu en
médecine. Ufitgc de leur farine qui eA une des quatre réfo-
lutivcs. Eau diAillée des fleurs de fove : fon ufage. On ne
fait plus ufage aujourd’hui de l’eau diAillée de gouttes de
fev es , ni du fol fixe qu’on tiroir des cendres de toute la
plante. V I. 649. b.
Feve. De la farine qu’on en tire. Suppl. III. 7. a.
F e v e de Bengale. ( Mat. médic. ) Quel cA celui qui a fait
connoitrc ce remede étranger. Divers fentimens fur ce fruit.
Dans quelles maladies 8c comment on dois l’employer. VI,
¿ 49- %
Fcve des Indes orientales appcllée couhage. IV. 32 e, ai
Différentes efpeces de feves dé l’île de Madagafcar. X V 1L -
4° 9- a-
F e v e S Egypte. (B o t . exot. ) Différons noms fous lefaucto
divers auteurs l’ont défignée. Quelle eA cette Aeur, félon
nos meilleurs botaniAcs ; idée qu’Hérodote c-n a eue. Elle
fut préfentée a Hadrien comme une merveille. Plutarque
l’appelle crepufcule. Son fruit ; comment il eA repréfonté
dans les antiques. Defeription de la plante. V L 649. b.
Feve d’Egypte appcllée abrus. I, 39. b.
F e v e de S . Ignace. (B o ta n . Mat. médic.) Nom latin de cette
fove. VI. 649. b. Sa defeription. Quand 8c par qui elle nous-
eA parvenue. Nom de la plante qui la produit. Defeription
de cette plante qui vient des iles Philippines, 8c de toutes-
les parties 8c produélions de la plante. Maniéré d’adminiArer
cette feve en remede. Propriété de fon huile. Ufage de la-
teinture qu’on fait de cette noix par le moyen de l’cfprit
de vin. Maladies dans lefquelles on vante la vertu de fc*
noyaux , 8c leurs diverfes préparations, Détails fur cette
noix dans une lettre du P. Camclli, jéfuite. Ibid. 650. e,
Confidérations qui devroient la faire bannir de la médecine,
Ibid. é,
F ev e . ( H iß . nat. ) Obforvations microfoöpiqucs fur la
fubAancc fa ri neu fc des feves. VII. 834. a. Observations fuv
les parties d’une fove qui font comprendre le développement
des plantes dans la graine. 835. a.
F e v e . ( I l i f l . anc. ) La feve rcfpeétéc par quelques peuples,
regardée comme impure par d’autres. Ufage religieux qu’ert
failoicnt les Romains. Origine de la coutume de jetter des
feves fur les tombeaux. Naifl'ance de la nécromantie. On
évoquoit les mauvais cfprits 011 leur offrant des feves. On
en aiAribue dans les pays catholiques le jour de la commémoration
des morts. Divers fentimens fur la raifon de la
défenfo que Pythagore faifoit à fes difciples de manger des
feves. Plufieurs peuples de la Grcce fc forvoient de fove»
pour i’éleéHon de leurs magifirats. V I. 650. b. Vers d’Horace
fur la défenfo de Pythagore. Auteurs qui ont développé le
fyfiêmc de ce philofophc. Ibid. 631. a.
Feve. Ufage qu’on en faifoit pour éloigner les lémures,
IX. 284. a , b. Ufage qu’en faifoicnt les Athéniens en tirant
au fort pour les magistratures. XII. 63 5. a. Roi de la fove,
XIV . 32). 4. V. .
Feve. ( Hifl. nat. ) Pierre de fove. IX. 286. a . Mme d»
feves. Ibid, ,
F e v i , (Maneg. Maréch.) maladie de la bouche, auiu connu*
fous le nom de lampat, Caufe prochaine, fymptômes de
cette maladie. Comment on y remédie par le moyen
cautcre aétuel. Autres moyens qui peuvent difpenfcr
l’ufage du cautère. VI. 651. a. . ,
F e v e , germe de y ( Maneg. Maréch.) Définition. VI. *5 ' *
Voyez FAUX-MARQUè. Y . J , , s.
F e v e . (P ê c h e ) Manière dont les AngloiS préparent .
feves pour fervir d’appâts aux poiffons. Comment on etny
cette amorce. VI. 631. b, ç »
FEVERSHAM, ( Géogr. ) petite ville d’Angfejerra
qui la rend remarquable dans l’hiAoire eccléfiaïùq
glctcrre. V I 631. b. , . j . cett*
FEVIER , ( Bot. Ja/dA noms latins1 &H 0 Enuiné-
plante. Son carailerc t tn tn q a c . Suppl. I IM
ration de trois cfocccs ; leur defeription, cu
Lieux d’où elles font originaires. Ibid. la . S , ni ÿ
ILU IL L AN S , {H iß . m l . ) origine de te nom do ^
F E U F E V 7x7
un ordre de religieux. Particularités hiAoriques fur cet ordre.
Maifons de fouillans établies en France. Religieufes appellécs
feuillantines. V I. 6 ç i. b.
F e u i l l a n s , (Géogr. b Hifl. eccl.) village 8c abbaye en
Languedoc aux frontières du comté de Cominges, chef-lieu
de la congrégation des fouillans. InAitution de cette congrégation.
Maifons qui en dépendent. Suppl. III. 32. b.
FEUILLE, (B o ta n iq .) diAinélion des feuilles dés plantes
appellécs fo lia y 8c des feuilles des Acurs, petala. On con-
fiacre les feuilles des plantes par rapport à leur Aruéturc,
à leur fuperficie, à leur figure, à leur confiAance, à leurs
découpures, à leur fituation 8c à leur grandeur. Par rapport
à leur Aruäurc, elles font Amples ou compofées. Par rapport
à la fuperficie, elles font plates, crcufos, en bofie,
8cc. Par .rapport à la confiAance, elles font ou minces 8c
déliées, ou épaiffes, ou charnues, ou drapées. Par rapport
aux découpures, elles font ou découpées légèrement, ou
découpées profondément. V L 652. a. Les fouilles conmofocs
font foutcnucs par une queue, ou rangées fur un côté Ample,
ou fur une côte bran ch ne. Par rapport à la fituation, elles
font ou alternes, ou oppofées deux à deux, ou oppofées en
plus grand nombre. Par rapport à la grandeur, elles font
ou trés-grandes, ou médiocres, ou petites, ou trés-mcnucs.
M. Linnæus fait trois elaffes des feuilles; favoir, celle des
feuilles Amples, celle des fouilles compofécs,8c celle des
feuilles déterminées. Ibid. b.
Obfervations fu r la diflribution , les ufages , lu t ilité , la
multiplication, la direflion, U retournement des feuilUs, Uur
infpeilion au microfcope , l ’art de les difféquer b d en prendre
l ’empreinte. Les botaniAes ont tâché de ramener toutes les
diAributions différentes des feuilles à des elaffes fixes. M.
Bonnet a établi cinq ordres principaux de cette difiribution.
Premier ordre que ce naturaUAe appelle alterne, 8c qui eA
le plus Ample. Second ordre, à paires croifécs. Troificmc ordre,
a feuilles vcrticillées. Quatrième ordre, fouilles en quinconce.
Cinquième ordre, à fpirales redoublées. Ibid.653. a. On ne
peut que fo livrer aux fentimens d’admiration pour les loix
éternelles qui dans ces divers ordres de diAribution de feuilles,
ont fi merveillcufoment approprié les moyens à la fin ;
régularité avec laquelle les feuilles font pliées avant que de
fortir du bouton ; prévoyance de la nature pour les mettre.
à l’abri de tout accident ; divers foins qu’elle a pris de la
conforvation des fouilles. De l’ufage des fouilles. Celui
d’élever le Auide nourricier cA un des principaux 8c des
mieux conAatés. Différences qui fo trouvent ordinairement
entre la furfacc fupéricure 8c la furfecc inférieure des fouilles.
DeAination de la furface inférieure 8c de la pointe des
fouilles.. Etroite communication entre toutes les parties de
la feuille, par laquelle les vaiffeaux fo communiquent réciproquement
les Aies qu’ils reçoivent des pores abforbans
les plus voifins. Ibid. b. Les plantes tirent l'humidité par leurs
fouilles ; il y a une étroite communication entre ces feuilles,
8c cette communication s’étend à tout le corps de la plante.
Les feuilles font aux branches ce que le chevelu eA aux
racines. Dans les fouilles des herbes les deux furfaccs ont
une difpofition à-peu-prés égale à pomper l’humidité. Les
feuilles «paroiffent encore de Ai nées à introduire dans la
plante beaucoup d’air frais 8c élaAique. La furfacc fupéricure
paroit le principal agent de l’afccnfion de la fove 8c de fa
tranfoiration hors de la plante, elle paroit forvir de défenfo
ou d’abri à la furface inférieure, 8c fournir un filtre plus
fin qui ne laiffe paffer que les matières les plus fubtilcs.
Moyen trés-fimple d’augmenter ou de diminuer la force d’une
branche dans un arbre fruitier. Quel eA le tcms d’éfoùiller.
Si on dépouille, une plante de fes feuilles à mefure qu’elles
paroiffent, clic périra. Ibid. 654. a. Obforvations de pratique
fur l’ufagc de laiAcr paitre les bleds quand ils font trop forts,
fur le danger de laiffer paître de trop prés la luzerne , le
fain-foin, le trelHe. But tic la nature en donnant à certaines
Ïlantes des fouilles printanières 8c des feuilles d'automne.
1 eA des feuilles dcAinécs fur-tout à préparer le fuc nourricier
, 8c à fournir de leur fubAance, une nourriture à la
tige qu’elles renferment. Importance de retrancher les fouilles
mal-laines. De la multiplication des plantes par leurs fouilles.
D e la 'dii-cétion 8c du retournement des fouilles pour prendre
leur direélion naturelle. Obforvation fur ce llp qui ont fubi
plufieurs inverfions. Le folcil les détermine à fo tourner de
fon côté , 8c à rendre leur furface fupérieurc concave ; la
rofée produit le contraire. Autres obforvations fur le retournement
des fouilles. Ibid. b. D e l’infpcétion des feuilles au
microfcope. Ouvrage à lire fur ce fujet. Obforvations mi-
crofeopiques faites lur la feuille de rofe, de fauge, celle de
la mcrcuriellc, celle de rue, 8cautres. Diffcélion des fouilles:
auteurs qui s’en font occupés. Moyen que Boyle a indiqué
pour prendre l’empreinte groffierc de la figure des fouilles
de toute forte de plantes. Ibid. 655. a.
Feuilles. Leur utilité. 1. 187. b. 583. b. Suppl. II. 43. b. 46. a.
Feuilles alternes. I. 304. b. Folioles des fouilles compofées.
VII. 44. b. Obfervations fur la mutation des fouUlci de quel-
Tomt A
<¡«5 BUniet. XL ,8 6 . a. Ufage des feuillet pour l’élabora-
? ° " it YOT H d, c la fcvc- x n - 7M. . . Formation dea
feuilles. XVI. 956. b. Leurs ufages. 9S7. e. ,j( o . é. Caufe de
■ ÿ f / i t 5 ^ . / . Partie des feuilles appelléc m -
guis. XVII. 380. b. Des maladies des fouilles. S u p p l.i iL fa t b
836. a , b. rr
F euilles. (E con.rufliq.) On tire d’affez grands avantages
de certaines feuilles. Ufages des fouilles d’ormes , de vienes
de mûrier. VI. 655. a. Fumier qu’on tire des feuilles foches*.
Ibid. b.
F e u il l e , (Bla fon ) meuble de l’écu. Suppl. III. 32.b. Vover
vol. II des planch. Blafon, pl. 8.
_ F e u i l l e ambulante, (H ifl. des injefl. ) infoâe ailé des Indes.
Singularités qu’on en raconte, 8c fur lefquelles il cA trés-per-
mis de rcAcr encore dans le doute. V I. 6 5 ç. b.
F eu ille indienne , ( Botan, a nc.) voyeç T a m a l a p a t r a .
F euilles féminales. (B o ta n .) Tcms où elles paroiffent;
leur différence d’avec les autres feuilles. Leur defféchement.
VI. 655. b.
F e u i l l e de myrthe. ( Inflrum. de Chirurg. ) Defeription générale
8c ufage de cet inArumcnt. Feuille de myrthe, dont le
manche clt terminé par une pincettc. Maniere de fabriquer
cet infiniment. Defeription de fos parties. VI. 6< <. b.
F euille s d ’o r , ( B a u .d ’o r ) II. 136. a , b. b c .
F euille pétrifiée. (H iß . nat.) On trouve fouvent dans les
carrières de tuf ou de pierres foAiles ou d’ardoifos, des pierres
qui font voir des empreintes de différentes efpeces de
fouilles d’arbres , 8c d’autres plantes ou marines ou terref-
tres , fouvent trés-bicn confervées 8c trés-reconnoiffablet.
Suppl. I1L 32. b. Difi'érentcs origines de ces empreintes. Différentes
fortes de plantes qu’on trouve imprimées ou incruAées
dans le tuf ou l’ardoifo. Enumération de ces plantes. Ouvrages
à confulter. Ibid. 33. a , b.
FEUiLUt.de fauge, ( Maneg. Maréch.) inArument de maré-
challcrie. Sa defeription. VI. 656. a.
F eu il le dcfcicy ( Blafon ) VI. 6ç6. a.
F eu il le , ( Comm. ) duplicata des rcgiAres que portent avec
eux les cochers, charretiers 8c voiturters, qui leur tient lieu
de lettres de voiture. Ce qu’elles doivent contenir. V I. 656.
a. Ce qu’on, entend par décharger la feuille. Ibid. b.
F euille s , ( Archit. ) ornement de fculpture. Elles font
connues fous le nom de refend, 8c différentes des feuilles d'eau.
VI. 656. b.
F e u i l l e à dos y (Brodeur au métier) VI. 636. b.
F eu il l e , ( Eventaillifte) V I. 636. b.
F euille de fer-blanc y (Ferblantier) VI. 656. b.
F euille de refend y (Jardinaa.) VI. 656. b.
F e u i l l e , (Marquetterie) V I. 636. b.
F euille 4 mettre fous Us pierres, (Metteuren oeuvre) V L 656.^«
F e u i l l e , (Miro itier ) VI. 6<¡6.b.
F e u i l l e , (Or fèvre) VI. 636. b.
FEUILLE de papier, ( Papetier) VI. 636. b.
F euille d'eau, (Serrur. ) procédés de l’ouvrier pour la faire.
VI. 636. b.
Feuille de palmier. VI. 637. a.
Feuille de laurier. V I. 637. a.
Feuille de revers. V I. 637. a.
FEUILLÉE, (U Pere ) fos ouvrages. X . 138. a.
FEUILLERET , ( Menuif.) outil de charpentier 8c de me-
nuifier. Son ufage. Fcuillcrct à petit bois. Defeription du fouil-
lerct. VI. 637. a.
FEUILLET, ( Comm.) moitié d’une feuille pliée en deux.
Difpofition des artic. 3 oc 4. du tit. iij. de l’ordonnance de
.1673 , par rapport aux livres des négocians 8c agens de change
8c de banque. V I . 637. a.
F eu il le t , terme de cardeur , ternie de cardier. VI.
637- a.
F e u i l l e t , (Baume de Mademoifelle) II. 163. é.
FEUILLETÉES , pierres, (H i f i , n a t.) III. 190. b. XIV.
767. b.
FEUILLETTE, ( Comm. ) elle eA de la contenance d’un
demi-muid de Paris. Ce terme en ufage en Bourgogne. Autro
mefure appelléc de ce même nom clans certaines provinces.
Etym. de ce mot. VI. 657. b.
FEUILLETER la pâte , (P â t if f.) comment fo fait cette
opération du pâtifficr. Suppl. III. 34. b.
FEUILLETI, ( Jouaill. ) opération qu’on appelle ferrer U
fcuilleti. VI. 657* b.
s d e ) obfo rva -
FEUQUIEIIES , (Antoinedu p a s , marquis d
tions fur ce général 8c fur fos mémoires. II. 132 ’. a , b. Cet
auteur cité dans plufieurs articles fur l’art militaire.
FEVRE d’Onneffon. ( Olivier U ) Suppl. IV . 186. a.
FEVRE d’E taples, (Jacques U ) Suppl. IV . 363. b.
FEVRES, ( Fontain. Calantes) maréchaux chargés de l’entretien
des chaudières. Comment Us font entretenus. Fevres
des falinc9 de M oycnvic. V I. 637. b.
FEVRET, (CharUs) fos ouvrages.XIV. 949. é.
FÉVRIER. (H ifl . rom. ) Comment on écrivoit autrefois le
nom de ce mois. Etymologie de ce mot ; trois conjeéturcs fiuc
T T T T t t u