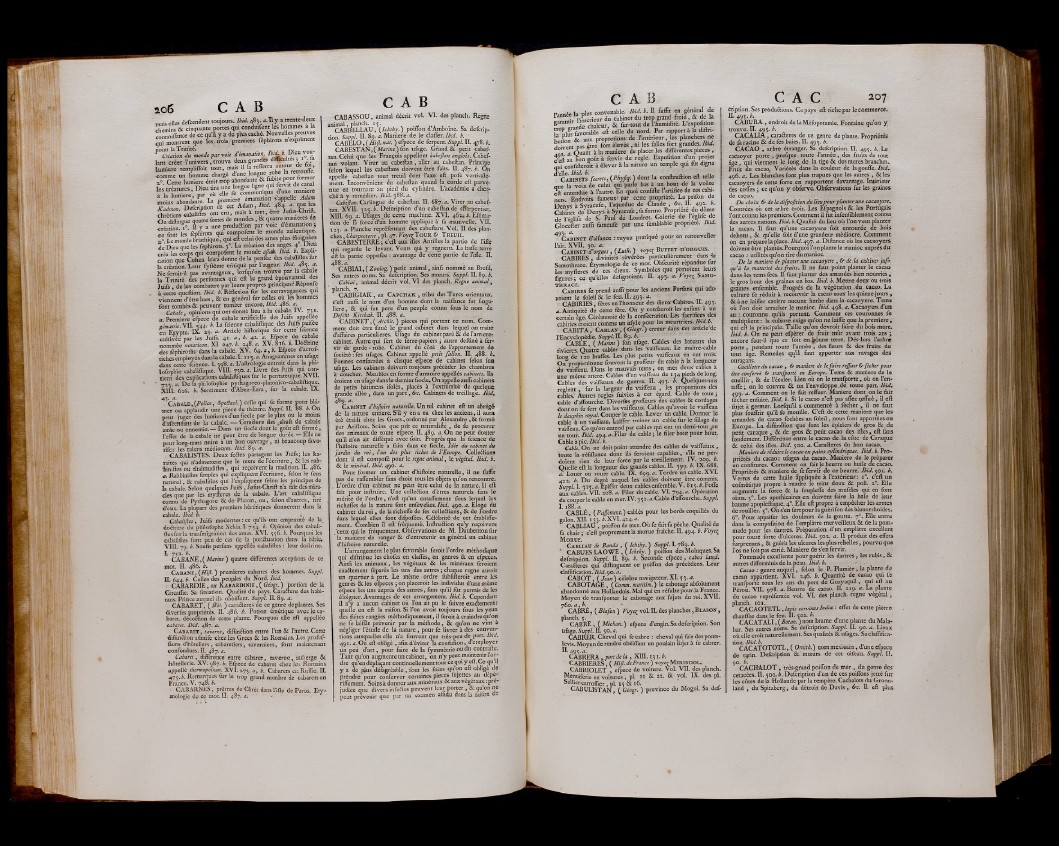
2 0 ß CAB CAB
mais elles drfcenJcnt toujours, Ibid. 483. u. 11 y a trente-deux
Chemins & cinquante portes qui condutfent les hommes à la
S ü de ce qu'il y a de plus caché. Nouvelles preuves
g S S que les., trois premiers féphirots n'expnmeut
lP°C/*!ih lX t u n d c par voie d'imotwo.
lant créer l’univers .trouva d e u x grandes difficultés, 1 . a
'lumiererempliiToit ’tout, mais U UreiTerra au,
comme un homme chargé B f c iM H f i « P p E
.-° Cette lumière étoit trop abondante & iubne pour îormer
les' créatures? D?eu tira une longue ligne ,m fervtt de canal
à la luTcre. par où elle fe communiqua d'une manière
a la dumier , p oremiere émanation s’appelle Adam
I S i S É à t f i l ié Te. Adam, Md. les
chrétiens cabalifles ont cru, mais à tort, être Jefus-Ghnft.
On S g u e quatre fortes de mondes, & quatre manteres de
■création i°. Ii y » «ne produftion ■création, i / . piaer mvo0ined ed éamzialenuattiiqoune ,
créoles co^ q u^ com p o^ n t lç monde a J Â / « ï. £ Explication
que Cohen Irira donne de la penfée des cabaliftes fur
canon vioaen irira uuimc us a» —
la création.„„A-,»:,.,. Tciir-Leur fyftême foftôme eritiaué critiqué par t>ar l’auteur:laqjeur: Ibid. 485.403. #•
a .
li e feroit-il pas avantageux, lorfqu’on trouvé par la cabale
la Trinité des perfonnes qui eft le grand épouvantail des
Juifs de les combattre par leurs propres principes? Kèponie
. à cette queftion. Ibid. b. Réflexion fur les extravagances qui
viennent d’être lues, & en général fur celles où lés hommes
font tombés & peuvent tomber encore. Ibid. 486. a.
. Cabale, rainions qui ont donné lieu à la cabale.1V. mm
à. Première efpece de cabale artificielle des Juifc appellée
.¿mairie VIL 544. b. La fcience cabaliftique des Juifs puifée
en Egypte. IX. 29. *. Article lùftorique fur cette fcience
cultivée par les Juifs. 4i. - , § b j | * E f i^ d jra ta le
nommée noraricon. XI s47-M f e XV. 8i6.4. Do&me
<les féphirorhs dans la cabale. XV. 64. a , b. Efpece dacrof-
•tiches employés dans la cabale. 1. 115. a. Anagrammes en ufage
dans cette fcience. 1. 398. a. L’aftrologie entroit dans la phi-
lofophie cabaliftique. VIII. 730.41. Livre des Juife quicon-
rient des explications.cabaliftiques fur le pentateuque. XV11.
• 72.3. a. De la philofophie py thagoreo-platomco-cabaliftique.
5011. 626. b. Sentiment d’Aben-Ezra, fur la cabale. IX.
^Cabale,.(Po/w*, Speflacl.) celle qui fe forme pour blâmer
ou appiaudir une piece de théâtre. Suppl. IL 88. b. On
peut juger des lumières d’un fiede par le plus ou le moins
d’afeendant de la cabale. — Cara&ere des .chefs de cabale
amie ou ennemie. — Dans un fiecle dont le goût eft formé,
l’effet de la cabale ne peut être de longue durée.— Elle ne
peut long-tems nuire à un bon ouvrage, ni beaucoup fevo-
rifer les talens médiocres. Ibid. 89. a.
CABALISTES. Deux feftes partagent les Juifs; les ka-
raïtes qui n’admettent que le texte de l’écriture, 8c les rab-
Biniftes ou thalmudiftes, qui reçoivent la tradition. IL 486.
a. Rabbiniftes Amples qui expliquent l’écriture, félon le fens
naturel, & cabaliftes qui ¡’expliquent félon les principes de
3a cabale. Selon quelques Juifs, Jefus-Chrift n’a fait des miracles
que par les myiteres de la cabale. L’art cabaliftique
connu de Pythagore & de Platon, ou, félon d’autres, tiré
d’eux. La plupart des premiers hérétiques donnèrent dans la
cabale. Ibid. b. < *•
Cabaliftes, Juifs modernes : ce qu’ils ont emprunté de la.
doârinc du philofophe Xekia.I. 754. b. Opinion des cabaliftes
fur la tranfmigration des ames. XVI. 5 36. b. Pourquoi les
cabaliftes font peu de cas de la ponâuation dans la bible.
Vin. 79. b. Soufis perfans appelles cabaliftes : leur do&rine.
L 732. b.
■ CABANE, ( Marine ) quatre différentes acceptions de ce
mot. II. 486. b.
C a b a n e , (Hift. ) premières cabanes des honjmes. Suppl.
H. 644. b. Celles des peuples du Nord. Ibid.
■ CABARDIE, ou K a b a rd in ie , ( Géogr. ) portion de la
Circaflie. Sa fituation. Qualité du pays. Caraétere des habi-
tans. Prince auquel ils obéiffent. Suppl. II. 89. a.
CABARET, ( Bât. ) caraôeres de ce genre déplantés. Ses
diverfes propriétés. IL 486. b. Potion émérique avec le cabaret.
dècoétion de cette plante. Pourquoi elle eft appellée
Cabaret. Ibid. 487. a.
C a b a r e t , taverne, diftinétion entre l’uii & l’autre. Cette
diftinélion admife chez les Grecs 6c les Romains. Les profef-
fions d’hôteliers, cabaretiers, taverniers, font maintenant
confondues. II. 487. a.
Cabaret, différence entre cabaret, taverne, auberge 8c
hôtellerie. XV. 987. b. Efpece de cabaret chez les Romains
appelle thermopolium. XVI. 273. a, b. Cabarets en Ruffie. II.
473.6. Remarques fur le trop grand-nombre de cabaretsen
France. V. 748. 6.
• CABARNES, prêtres de Cêrès dans rifle de Paros. Etymologie
de ce mot. II. 48 y. a. "
CARASSOU, animal décrit vol. VI. des plànch. Regne
animal, planch. 13 •
CABBELLAU, (Ichthy.) poiffon d’Amboine. Sa defcription.
Suppl. II. 89. a. Maniéré: de le claifer.Ibid. b.
CABELO, (Hift.nat.) efpece de feroent.Suppl. II. 478.6.
CAB EST AN, (Marine.) fon ufage. Grand & petit cabef-
tan. Celui que les François appellent cabeftan anglois. Cabeftan
volant. Virer au cabeftan, aller au cabeftan. Principe
félon lequel les cabeftans doivent être faits. II. 487. 6. On
appelle cabeftan tout treuil dont l’axe eft pofé verticalement.
Inconvénient du cabeftan quand la. corde eft parvç-
nüe eii tournant au pied du cylindre. L’académie a cherché
à y remédier. Ibid. 388. a.
Cabeftan. Carlingue de cabeftan. II. 687. a. Virer au cabeftan.
XVIL 325. 6. Defcription d’un cabeftan de clfarpéntiet;.
XHI. 69. a. Ulâges^de cette machine. XVI. 462* 6. Eftima-
tion de là force d’un homme appliqué à fa manivelle. VIL
123. a. Planche repréfentant des cabeftans. Vol. EL des planches
, Charpenterie, pl. 47- ^jyr? T o u r & T r e u i l .
CABESTERRE ; c’eft aux illes Antilles la partie de l’ifle
qui regarde le levant. Vents qui y régnent. La baffe terre
eft la partie oppofée : avantage de cette partie de l’ifle. IL
488. a. -
CABLAI, ( Zoolog. ) petit animal, ainfi nommé au BrefiL
Ses autres noms. Sa defcription. Ses moeurs. Suppl. II. 89.6.
Cabiai, animal décrit vol. V I des planch. Regne animal
’ planch. 7.
CABIGIAK, ou C a p c h a k , tribu des Turcs orientaux,
c’eft aufli le nom d’un homme dont la naiffance fut fingu*
liere, & qui fut pere d’un peuple connu fous le nom de
Defcht Kitchak. II. 488. a.
CABINET, ( Archit. ) pièces qui portent ce nom. Comment
doit être fitué le grand cabinet dans lequel on traite
d’affaires particulières. Ulage du cabinet paré & de l’arriere-
cabinet. Autre qui fert de ferre-papiers ; autre deftiné à fer-
vir'de garde-robe. Cabinet du côté de l’appartement de
fociété : fes ufages. Cabinet appellé petit fallon. II. 488. 6.
Formes confacrées à chaque eipece de cabinet félon fon
ufage. Les cabinets doivent toujours précéder les chambres
à coucher. Meubles en forme d’armoire appellés cabinets. Ils
étoient en ufage dans le dernier iiecle. On appelle aufli cabinèts
de petits bâtimens ifolés, placés à l'extrémité de quelque
grande allée, dans un parc, &c. Cabinets de treillage. Ibid,
489'. a.
C a b in e t d’hiftoire naturelle. Un tel cabinet eft un abrégé
de la nature entiere. S’il ÿ en a eu chez les anciens, il aura
été établi chez les Grecs, ordonné par Alexandre ,8c formé
par Ariftote. Soins que prit ce nàturalifté , de fe procurer
des animaux de toute efpece. IL 489. a. On ne peut douter
qu’il n’en ait difféqué avec foin. Progrès que la fcience de
l’hiftoire naturelle a faits dans ce fiecle. Idée du cabinet du
jardin du roi, l’un des plus riches de l ’Europe. Collections
dont il eft compofé pour le regne animal, le végétal. Ibid. b.
& le minéral. Ibid. 490. a.
Pour former un cabinet d’hiftoire naturelle, il ne fuflît
pas de raffembler fans choix tous les objets qu’on rencontre.
L’ordre d’un cabinet ne peut être celui de la nature. U eft
fait pour inftruire. Une collection d’étres naturels fans le
mérite de l’ordre, n’eft qu’un entaffement fous lequel les
richeffes de la nature font enfevelies. Ibid. 490. a. Eloge du
cabinet du ro i, de laricheffe de fes colleCtions, & de 1 ordre
dans lequel elles font difpofées. Célébrité de cet établiffe-
ment. Combien il eft fréquenté. InftruCtion qu’y reçoivent
‘ceux qui le fréquentent. Obfervations de M. Daubenton fur
là maniéré de ranger & d’entretenir en général un cabinet
d’hiftoire naturelle.
L’arrangement le plus favorable feroit l’ordre méthodique
qui diftribue les chofes en claffes, en genres 8c en efpeces.
Ainfi les animaux, les végétaux & les minéraux feroient
éxadement féparés les uns des autres ; chaque regne auroit
un quartier à part. Le même • ordre fubfifteroit entre les
genres 8c les efpeces ; on placerait les-individus d’une même
efpece les uns auprès des autres, fans qu’il fut permis de les
éloigner. Avantages de cet arrangement. Ibid. b. Cependant
il n’y a aucun cabinet où l’on ait pu le fuivre exactement:
quelle en eft la raifon. Si l’on avoit toujours fous les yeux
des fuites rangées méthodiquement, il feroit à craindre qu’on,
ne fe laiflat prévenir par la méthode, & qu’on ne vint à
négliger l’étude de la nature, pour fe livrer à des conventions
auxquelles elle n’a fouvent que très-peu de part. Ibid,
491. a. On eft obligé, afin d’éviter la confufion, d’employer
un peu d’art, pour faire de la fymmétrie ou du contrafte.
Tant qu’on augmente un cabinet, on n’y peut maintenir l’ordre
qu’en déplaçant continuellement tout ce qui y eft. Ce qu il
y a de plus défagréable, font les foins qu’on eft obligé de
prendre pour conferver certaines pièces fujettes au dépé-
riffement. Soins à donner aux minéraux & aux végétaux : préjudice
que divers infeCtes peuvent leur, porter , & qu on no
peut prévenir que par un examen affidu dans la faiton ae
CAB C A C 207
H Ai u «tîfe convenable. Ibid. b. Il fuffit en général de
S Ä intérieur du Cabinet du trop grand froid, & de la
orande chaleur, & fur-tout de 1 humidité. Lexpofmon
U°d1us favorable eft celle du mord. Par rapport à la diftri-
v & aux proportions1, de .l’intérieur, lés planchers ne
j æ a H S g fort élevés, ni les falle* fon grande*. Ibid.
Io ï a Quant à la maniéré de placer les différentes piece*,
S i a i bon goûtà fenrir de regle. Expofition dùin projet
qui confifleroit à élever à la nature un temple qui fût digne
C a b in e ts fccrcts.^Phyfif.} dont la conftmâion eft rej 1 e
nue la voix de celui qui parle bas à un bout de la voûte
¿ft entendue à l’autre. En quoi confifte 1 artifice de ces cabinets.
Endroits fameux, par cette propriété. Lajnfon de
Denys à Syracufe, l’aqueduc de Claude , f/c. n . 4oa. 4,
Cabinet de Denys àSyracufe,fa forme.Propnété Ai dôme
de l’églife de S, Paul dé Londr«. Galerie de l egbfe de
Clocefter aufli fimeufe par une femblablé propriété. Ibid.
C a b i n e t d’aifanoe t tuyau pratiqué pour en reuouveUer
l’air. XVII. 30. ai ,
C a b in e t .d'orgues, {Luth. ) voyrt B u f f e t d o rg u e s .
CABIRES , divinités -révérées parttcukéreiuént dans la
Samothrace. Étymologie de ce mot. Obfcurite répandue fur
les myfteres de tes dieux. Symboles que portoient leurs
figures; ce qu’elles défignoient. II. 493- “■ f & t >AMOTHRACE.
_ ' . n r • J
C a b ir e s fe prend àuffi pour les anciens Perfans qui ado-
raient le foleil& le feu. II: 493- ^ TT
CABIRIES, fêtes en l’honneur des diéux Cabires. II. 493:
a. Antiquité de cette fête. On y confacroit les enfans à un
certain âge. Cérémonie de la confécration.' Les faêrifices des
cabiries étoient comme un afyle pour lés meurtriers: Ibid. b.
CABITA, C a b la n , (Géogr.) erreur dans Cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. D. 89. 6.
CABLE, ( Marine ) fon ufage. Cables des bateaux des
rivières. Quatre cables dans les Vaiffeaux. Le maitre-cable
long de 120 braffes. Les plus petits vaiffeaux en ont trois.
On proportionne fouvent la groffeur du cable a la longueur
du vaifleau. Dans le mauvais tems, on met deux cab es à
une même ancre. Cables d’un vaifleau de i34Pjeds de long.
Cables des vaiffeaux de guerre. II. 493. 6. Quelques-uns
règlent, fur la largeur du vaifleau , les proportions des
cables.' Autres réglés fuivies à cet égard. Cable de toue ;
cable d’affourche. Diverfes grofleurs des cables & cordage*
dont on fe fert dans les vaiffeaux. Cables qu avoit le vaiffeau
le dauphin royal. Couper le cable. Lever un cable. Donner lé
cable à un vaiffeau. Laiffer traîner un cable fur le fillage du
vaiffeau. Ce qu’on entend par cables qui ont un demi-tour #ou
un tour. Ibid. 494. a. Filer du cable ; le filer bout pour bout.
Cable k'pic.Ibid. b.
Cable. On ne doit point attendre des cables de vaiileaux ,
toute la réfiftance dont ils feroient capables, s’ils ne per-
doient rien de leur force par le tortillement. IV. 200. 6.
QùeUè eft la longueur des grands cables. H. 399. 6. 1X .688,
a. Louer ou rouer cable. IX. 699. a. Tordre un cable. XVI.
422. 6. Du degré auquel les cables doivent être commis.
Suppl. I. 3 r3. a.Epiffer deux cables enfemble. V. 815.6. Foffe
aux cables. VII. 208. a. Filer du cable. VI. 794. Opération
de couper le cable en mer. IV. 3 31. a. Cable d’affourche. Suppl.
1 . 188. a. , , , • t j
CÂBLÉ, (Pajjement.) câblés pour les bords coquillés du
galon. XII. 133.6. XVI. 424. a. . \ . . . .
CABLIAU, poiffon de mer. Ou fe fait fa peche. Qualité de
fa chair ; c’eft proprement la morue fraîche. II. 494- 6. V
M o ru e . ; ..
CablïAU de Banda , ( Ichthy. ) Suppl. 1. 789. 6.
* CABUES LAOWE, (Ichthy. ) poiffon des Moluques. ba
defcription. Suppl. II. 89. 6. Seconde efpece, cabos lawft.
Carafteres qui d'iitinguent ce poiffon des précédens. Leur
claflification. Ibid. <jo.a.
CABOT, ( Jean) célébré navigateur. XI. 33. a.
CABOTAGE, ( Comm. maritim.) le cabotage abfolument
abandonné aux Hollandois. Mal qui en réfultepourda France.
Moyen de tranfporter le cabotage aux fujets du roi. XVII.
760. a , 6.
CABRÉ, (Bla fon ) Voyei vol. II. des planches, B la s o n ,
planch. 5.
CABRE, (Méchan.) efpece d’engin. Sa defcription. Son
ufage. Suppl. II. 90. a.
CABRER. Cheval qui fe cabre : cheval qui fait des ponts-
levis. M o y e n de rendre obéiffant un poulain fujet à fe cabrer.
II. 493. a.
CABRERA „ port de la , Xm. 131.6.
CABRIERES, ( Hift. de France ) voyez M e r in d o l.
CABRIOLET , efpece de voiture. Vol. VII. des planch
Menuiferie en voitures, pl. 21 & 22. & vol. IX. des pl
Sellier<arroffier . ul. x* & _
crlption. Ses produétions* Ce pays eft riche par le commerce«
IL 49fc6.
CABURA, endroit de la Mèfopotamie. Fontaine qu on y
tfouve. II* 403.6.
CACALIA, carafteres de ce genre de plante. Propriétés
4e fa racine & de fes baies. II. 493. 6.
CACAO , arbre étranger. Sa defcription. II. 493. h. Le
Cacaoyer porte j :prefque tpute -l’année, des fruits de tout
âge, qui viennent le loiig de la tige & des meres branches.
FrUit du cacao. Variétés dans la couleur de la gouffe. Ibid.
496. a. Les blanches font plus trapues que les autres , &les
cacaoyers de cette forte en rapportent davantage. Intérieur
des coiffes ; ce qu’on y obferve. Obfehrations fur les graines
de cacao.
. Du choix b delà difpofition du lieupour planter une cacaoyere.
Contrées où cet arbre croît. Les Efpagnols & les Portugais
l’ont connu les premiers. Comment il fut infenfiblement connu
des autres nations. Ibid. 6. Qualité du lieu où l’on veut planter
le cacao. 11 faut qu’une cacaoyere foit entourée de bois
debout, & qu’elle foit d’une grandeur médiocre. Comment
on én prépare la place. Ibid. 497. a. Diftance où les cacaoyers,
doivent être plantés. Pourquoi l’on plante le manioc auprès du
cacao : utilités qu’on tire du manioc.
De la maniéré de planter une cacaoyere , 6* de là cuUiv.er ju f *
qu’à la maturité des fruits. U ne faut point planter le cacao
dans.les. tems fecs. Il faut planter des amandes bien noumés ,
le gros bout des graines ert bas. Ibid. b. Mettre deux ou trbis
graines enfemble. Progrès de la végétation^du . cacao. La
culture fe réduit à recouvrir la cacaO-tousTes quinze jours ,
&àn e laiffer croître aucune herbe dans la cacaoyere. Tems
où l’on doit arracher le manioc. Ibid. 498. a. Cacaoyers d'un
an .-. couronne qu’ils portent Comment ces couronnes fe
multiplient.: la culture exige qu’on ne laiffe que la première,
qui eft la principale. Taille qu’on devrait faire du bois mort.
Ibid. b. On ne peut efpérér de fruit mûr avant trois ans ;
encore faut-il que ce foit en tonne terre. Dès-lors l’arbre
porte, pendant toute l’année , des fleurs & des fruits de
tout âge. Remedes qu’il faut apporter aux ravages des
ouragans. ;
Cueillette du cacao , & maniéré de le faire reffuer 6* ficher pour
être confervè 6* tranfvortè en Europe: Tems & manière de le
cueillir, & de l’écaler. lieu où on le tranfjporte, où on l’en-
taffe ; on le couvre 8c on l’enveloppe de toute part. Ibid,
499 .a. Comment on le frit reffuer. Maniéré dont on le frit
fécher enfuite. Ibid. 6. Si le cacao n’eft pas affez r.effué , il eft
• fujet à germer. Lorfqu’il a commencé à féchèr , il ne frut
plus fouffrir qu’il fe mouille. C’eft de cette maniéré que les
amandes de cacao féchées au foleil, nous font apportées en
Europe^-La diftinâion que font les épiciers de gros 8c de
petit caraque , 8c.de gros 8c petit cacao des ifles, eft fans
fondement. Différence entre le cacao de, la côte de Caraque
8c celui des ifles. Ibid. 300. a. Cara&eres du bon cacao.
Maniéré de réduire le cacao en pains cylindriques. Ibid. b. Propriétés
du cacao : ufages du cacao. Maniéré de. le préparer
en confitures. Comment on frit Je beurre ou huile de cacao.
Propriétés 8c maniéré de fe fervir de ce beurre.' Ibid. <01. 6.
Vertus de cette huile Appliquée à l’extérieur: 1°. c eft un
cofmétique propre à rendre le teint doux 8c poli. 20. Elle
augmente la force 8c la foupleffe des mufcles qui en font
oints. 30. Les apothicaires en doivent frire la bafe de leur
baume apoplectique. 4°..Elle eft propre à empêcher les armes
de rouiller. 30. Ons’en fertpour la guérifon des hèmorrhoïdes.
6°. Pour appaifer les douleurs de la goptte. 70. Elle entre
dans la compofirion de l’emplâtre merveilleux 8c de la pommade
pour les dartres. Préparation d’un emplâtre excellent
pour toute forte d’ulceres. Ibid. 302. a. Il produit des effets
lurprenans, 8c guérit les ulcérés les plus rebelles, pourvu que
l’os ne foit pas carié. Maniéré de s’en fervir.
Pommade excellente pour guérir les dartres, les rubis, 8c
autres difformités de la peau. Ibid. b. ' • ■
Cacao : genre auquel, félon le P.;Plumier, la plante^ de
cacao appartient. XVI. 246. 6. Quantité de cacao qui fe
tranfporte tous les ans du port de Guayaquil, oui en an
Pérou. VIL 978. a. Beurre de cacao. II. 219. a. La plante
du cacao repréfentée vol. VI. des planch. regne végétal,
planch. 101. _ ,
CACAOTETL, lapis corvinus India : effet de cette pierre
chauffée dans le feu. U. 30a. 6. •
CAO ATA U , (Botan.) nom brame d une plante du Malabar.
Ses autres noms. Sa defcription. Suppl. IL 90. a. Lieux
où elle croît naturellement. Ses qualités 8c ufages. Sa claflification.
Ibid. b. . . ., -
CACATOTOTL, ( Omith.) nom mexicain, dune efpece
de tarin. Defcription 8c' moeurs de cet oifeau. Suppl. II.
• 90. 6.
CACHALOT , très-grand poiffon de m er, du genre des
cetacées. II. 302.6. Defcription d’un de ces poiffons jetté fur
les côtes de la Hollande par la tempête. Cachalots du Groenland
, du Spitzberg, du détroit de Davis, 6*c. Il eft plus