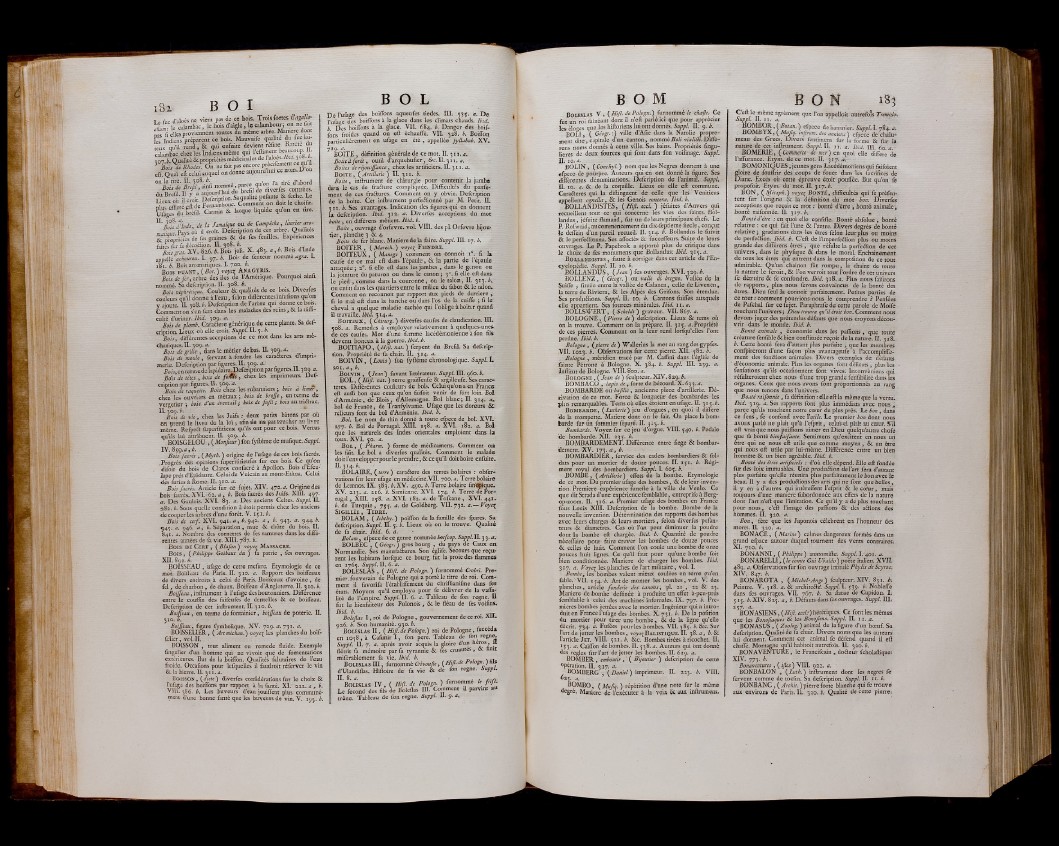
B O I 1 1Ü d’aloès ne vient pas de ce bots. Trots fortes d aguBu-
le calantbàc, le bois d’aigle, le calambour ; on ne fatt
nas fi eUes proviennent- toutes du même arbte. Manière dont
L Indiens préparent ce bois. Mauvatfe qualité du fuc lat-
5 3 S & qui enfuite devient rélino Rareté du
calambac.cjiez les Indiens même qui 1 f
,07. b. Qualité & propriétés médicinales de i * ’.¡i
ÏÏ^ges du bréfd. Carmin & hcque bqmde quon en tire.
a ' i o b 'Â i * , * la Jamaïque ou * Çampêche, Ùuner un-
u Pays où il croit. Defeription de cet arbre. Qualités
impropriétés de fes graines & de fes feudles. Expériences
r.:r,q fa décodion. n . 308. A
Boiseras. XV.-8z6:b. Bois joli. X. 483. a yb. Bois dinde
appeîlè achourou. I. 97. b. Bois de fenteur nomme agra. g
181: b Bois aromatiques. I. 700. b.
Bois puant , ( Bot. ) voyez A n a g yr is . .
Bois de fer, arbre des îles de l’Amérique. Pourquoi ainü
nommé. Sa description. II. 308. b.
Bois, néphrétique. Couleur & qualités de ce bois, Diverfes
couleurs qu’il donne à l’eau, fdon différentes mfufions qu on
y ajoute. II. 308, b. Defeription de l’arbre qui donne ce bois.
Comment on s’en fert dans les maladies des reins, & la difficulté
d’uriner. Ibid. 309. a.
Bois de plomb. Caradere générique .de cette plante. Sa defeription.
i.ieux où elle croit. Suppl. II. 5. A
Bois t différentes acceptons de ce mot dans les arts mé-
chaniques. II. 30.9. a. , , , tt
Bots de grille , dans le métier de bas. 11.309. a.
Bois de moule , fervant à fondre les caraderes d imprimerie.
Defeription par figures. IL 309. *.
Bois, en terme de lapidaire J).efcription par figures.Il. 300 a.
Bo'is de têtes , bois de foMs, chez les imprimeurs. Defeription
par. figures. II. 300. a. .
Bois de raquette. Bois chez les rubanmers ; bois a limer,
chez les ouvriers en métaux 5 bois de broJJ'e, en terme de
vergetier j bois d’un éventail s bois de fufil j bois au trictrac.
1 lots * vie, chez les Juifs : deux petits bâtons par où
on prend le livre de la lo i, afin de ne pas toucher au livre
même. Refpeft fuperflitieux qu’ils ont pour ce bois. Vertus
qu’ils lui attribuent. II. 309. b.
BOISGELOU , (Monfieur) fon fyfteme de mufique. Suppl.
IV. 859.a,b.
Bo is facrés, ( Myth. ) origine de l’ufage de ces bois facrés.
Progrès1 des opinions fuperitirieufes fur ces bois. Ce quon
'difoir du bois de Claros confacré à Apollon. Bois d’Efcu-'
lape près d’Epidaure. Celui de Vulcain au mont-Ethna. Celui
des furies à Borne. IL 31 o.a.
Bots f acres. Article liir ce fujet. XIV. 472.0. Origine des
bois facrés. XVI. 62. a , b. Bois facrés des Juifs. XUI. 497.
d Des Gaulois. XVI. 83. a. Des anciens Celtes. Suppl. II.
282. b. Sous quelle condition il étoit permis chez les anciens
de couper les arbres d’une forêt. V. 151. b.
Bois de cerf. XVI. 941. a , b. 942. a , b. 943. a. 944. b.
t4<j. a. 946. a , b. Séparation, mue & chûte du bois. H.
41. a. Nombre des cornettes de fes ramures dans les différentes
minées de fa vie. XIII. 787. b.
Bois de C erf , ( Blafon ) voyez Massacre.
Bois , ( Philippe Goibaut du ) la patrie , fes ouvrages.
XII. 892. A
BOISSEAU, ufage de cette mefure. Etymologie de ce
mot. Boiffeau de Paris. II. 310. a. Rapport des boiffeaux
de divers endroits, à celui de Paris. Boiiièaux d’avoine , de
fel, de charbon , de chaux. Boiffeau d’Angleterre. II. 310. A
Boijfeau., infiniment à l’ufage des boutonniers. Différence
entre le couffin des faifeufes de dentelles & ce boiffeau.
Defeription de cet infiniment. II. 310. A
Boijfeau , en terme de fontainier, boijfeau de poterie. II.
310. A
Boijfeau, figure fymbolique. XV. 729. <*.731. a.
BOISSELLER, ( Art médian.) voye[ les planches du boif-
felier, vol. II.
BOISSON , tout aliment ou remede fluide. Exemple
fingulier d’un homme qui ne vivoit que de fomentations
extérieures. But de la boiffon. Qualités falutaires de l’eau
froide. Occafions pour lefquelles il faudrait réferver le vin
& la bierre. II. 311. a.
Boisson, {diete) diverfes confidérations fur le choix 8c
l’ufage des boiffons par rappon à la fanté. XI. 222. a , A
VU1. 386. A Les buveurs d’eau jouiffent plus communément
d’une bonne fanté que les buveurs de vin. V . 195. A
BOL De l’ufage des boiffons aqueufes tiedes. DI. <33. a. De
l’ufage des boiffons à la glace dans les climats chauds. Ibid.
A Des boiffons à la glace. VII. 684. b. Danger des boif-
fôns froides quand on eft échauffé. VII. 328. A Boiffon
particulièrement en ufage en é té , appellée Jyllabub. XV,
^ &OITE, définition générale de ce mot. II. 3 n k
Boite â forêt, outil d’arquebufier, &c. II. 311. a. [
Boites de réjquïjfance, chez les artificiers. II. 311. a.
B o it e , ( Artillerie) II. 311. A.
Boite y inftrument de chirurgie pour contenir la jambe
dans le cas de fradure compliquée. Difficultés du panfe-
ment de ces fradures. Comment on y obvie. Defeription
de la boite. Cet inftrument perfedionné par M. Petit. II.
311. A Ses avantages. Indication des figures qui en donnent
la defeription. lbtd. 312. a. Diverfes acceptions du mot
boite y en différens métiers. Ibid. A
Boite y ouvrage d’orfevre. vol. VIII. des pl. Orfevre bijoutier,
planche 3 6c 4.
Boite de fer blanc. Maniéré de la faire. Suppl. III. 17. A -
BOITER, ( Marèch.) voye[ Feindre.
BOITEUX, ( Manege ) comment on connoît i°. fi la
caufè de ce mal eft dans l’épaule, 8c la partie de l’épaule
attaquée ; 20. fi elle eft dans les jambes , dans le genou ou
la jointure du paturon ou dans le canon ; 30. fi elle eft dans
le pied, comme dans la couronne, ou le talon, II. 313. A
ou enfin dans les quartiers entre le milieu du fabot & le talon.
Comment on reconnoit par rapport aux pieds de .derrière ,
fi le mal eft dans la hanche ou dans l’os de la cuiffe ; fi le
cheval a quelque maladie cachée qui l’oblige à boiter quand
il travaille. Ibid. 314. a.
B o it eu x , ( Chirurg.) diverfes caufes de claudication. III.
508. a. Remedes à employer relativement à quelques-unes
de ces caufes. Mot d’une femme lacédémonienne à ion fils
devenu boiteux à la guerre, lbtd. b.
BOITIAPO, {Hiß. nat. ) ferpent du Brcfil. Sa defeription.
Propriété de fa chair, ü . 314. a. ■'
BOIVIN, {Louis) fon fyftème chronologique. Suppl. L
201. a y b.
Boivin , {Jean ) favant littérateur. Suppl. III. 960. A
BOL, fHïft. nat. | terre graiffeufe & argilleufe. Ses caractères.
Différentes couleurs de bols. Celui qu’on a en France
eft aufli bon que ceux qu’on faifoit venir de fort loin. Bol
d’Arménie, deBlois, d’Allemagne. Bol blanc; II. 314. a.
bol de France, de Tranfylvanie. Ufage que les doreurs 8c
relieurs font du bol d’Arménie. Ibid. A
Bol. Le nom de tliin donné à toute efpece de bol. XVT.’
2.77. A Bol de Portugal. XUI. 158. a. XVI. 182. a. Bol
que les naturels des Indes orientales emploient dans la
toux. XVI. 30. a.
Bo l , ( Pharm. ) forme de médicamens. Comment on
les fait. Le bol a diverfes qualités. Comment le malade
doit l’envelopperpour le prendre, & ce qu’il doit boire enfuite.
II. 314. A
BOLAIRE, ( terre ) caradere des terres bolaires : obfer-
vations fur leur ufage en médecine.VII. 700. a. Terre bolaire
de Lemnos. IX. 383. A XV. 490. A Terre bolaire fiftdÇique.
XV. 213. a. 216. A Samicnne. XVI. 174. A Terre de Portugal
, AlII. 158. a. XVI. 182. a. de Tofcane , XVI. 441.
A de Turquie, 735. a. de Goldberg. VU. 732. a.— Voye^
Sig il l é e , T erre.
BOLAM, {Ichthy.) poiffon de la famille des fpares. Sa
defeription. Suppl. IÏ. 5. b. Lieux où on le trouve. Qualité
de fa chair. Ibid.. 6. a.
Bolam y efpece de ce genre nommée botfcop. Suppl. II. 3 3. a.
BOLBEC , ( Géogr.) gros bourg , du pays de Caux en
Normandie. Ses manufactures. Son églife. Secours que reçurent
les habitans lorfque ce bourg fut la proie des flammes
en 1765. Suppl. n . 6. a.
BOLESLAS , ( Hiß. de Pologn. ) furnommé Crobri. Premier,
fouverain de Pologne qui a porté le titre de roi. Comment
il favorifa l’étabUffement du chriftianifme dans fes
états. Moyens qu’il employa pour fe délivrer de la vaffa-
lité de l’empire. Suppl. II. 6. a. Tableau de fon regne. Il
fut le bienfaiteur des Polonois, & le fléau de fes voifins.
Ibid. A . _
Bolejlas I , roi de Pologne, gouvernement de ce roi. A il.
926. b. Son humanité. 930. A
Boleslas II , ( Hiß. de Pologn.) roi de Pologne, fuccéda
en 1058, à Cafimir I , fon pere. Tableau de fon regne.
Suppl. II. 7. a. après avoir acquis la gloire d’un héros, u
flétrit fa mémoire par fa tyrannie & fes cruautés, oc nnit
miférablément fa vie. Ibid. A . . c.
B oleslas III, furnommé Crivoufle, {Hiß-de Pologn. ) fus
d’Ulandiflas. Hiftoire de fa vie & de fon regne. Suppl.
I I Bo lk l a s I V , ( H,fl- de Pologn. ) furnommé le friß.
Le fécond des fils de Boldlas III. Comment il parvint *
trône. Tableau de fon regne. Suppl- 11- 9■ “ •
B O M BON B oleslas V , {Hijl. de Pologn.) furnommé le chaftc. Ce
fut un roi fainéant dont il n’eft parlé ici que pour apprécier
les éloges que .les hiftoriens lui ont donnés. Suppl. IL 9. A
BOLl, ( Géogr. :■) ville d’Afie dans la Natolie proprement
dite, capitale a’un canton , nommé Boit vialiBi. Différens
noms donnés à cette ville. Ses bains. Propriétés fingu-
lieres de deux fources qui font dans fon voifinage. Suppl.
n . 10. a. 7-: •
BOLIN, ( Conchyl. ) nom que les Negres donnent à une
efpece-de pourpre. Auteurs qui en ont donné la figure. Ses
différentes dénominations. Defeription de l’animal. Suppl.
II. 10. a. & de la coquille. Lieux où elle eft commune.
Caraôeres qui la diftinguent de celle que les Vénitiens
appellent ognella, & les Génois roncera. Ibid. A
BOLLANDISTES, ( Hift. eccl. ) jéfuites d’Anvers qui
recueillent tout ce qui concerne les vies des faints. Bol-
landus, jéfuite flamand, fut un de leurs principaux chefs. Le
P. Rofweid, au commencement du dix-feprieme fiecle, conçut
le deffein d’un pareil recueil. II. 314. A Bollandus le fuivit
& le perfectionna. Ses affociés Sc fuccefleurs. Suite de leurs
ouvrages. Le P. Papebrok a apporté plus de critique dans
le choix de fes monumens que Bollandus: Ibid. 31 ç. a.
B ollandistes , faute à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 10. A
BQLjLANDUS, {Jean ) fes ouvrages. XVI. 329. A
BOLLENZ, ( Géogr. ) ou valle di bregno. VaÛée de la
Suifie , fituée entre la vallée de Calanca, celle de Livenen,
la terre de Riviera, & les Alpès des Grifons. Son étendue.
Ses productions. Suppl. II. 10. A Cantons fuiffes auxquels
elle appartient. Ses fources minérales. Ibid. n . a.
BOLLSWERT, ( Scheldt ) graveur. VII. 867. a.
BOLOGNE, ( Pierre de ) defeription. Lieux & tems où
onia trouve. Comment on la prépare. H. 313. a.Propriété
de ces pierres. Comment on la leur rend lorfqu’elles l’ont
perdue. Ibid. A
Bologne , {pierre de ) Wallerius la met au rang des gypfes.
VII. 1023. b. Obfervations fur cette pierre. XII. 382. A
. Bologne , méridien tracé par M. Cafiini dans l’églife de
fainte Pétrone à Bologne. X. 384. A Suppl. DI. 239. a.
Inftitut dé Bologne. VIII. 800. a.
B ologne , ( Jean de ) feulpteur. XIV. 829. A
BOMBÀCQ , lapis de, forte de bézoard. X. 633.a.
BOMBARDE ou bafilic, ancienne piece d’artillerie. Dérivation
de ce mot. Force & longueur des bombardes les
ylus remarquables. Tems où elles étpient en ufage. II. 313.A
B ombard e, {Lutherie) jeu d’orgues, en quoi il différé
•de la trompette. Matière dont on le fait. On place la bombarde
fur un fommier féparé*. II. 313. A
Bombarde. Voyez fur ce jeu d’orgue. VIII. 340. b. Pedale
ide bombarde. XII. 233. A
BOMBARDEMENT. Différence entre fiege & bombardement.
X V. 173. a y b.
BOMBARDIER, fervice des cadets bombardiers & fbl-
dats pour un mortier de douze pouces. II. 131. A Régiment
royal des bombardiers. Suppl. I. 603. A
BOMBE, {Artillerie) effets ae la bombe. Etymologie
de ce mot. Du premier ufage des bombes, & de leur invention.
Première expérience funefie à la ville de Venlo. Ce
que dit Strada d’une expérience femblable, entreprife à Berg-
op-zoom. D. 316. a. Premier ufage des bombes en France
fous Louis XIII. Defeription de la bombe. Bombe de la
nouvelle invention. Détermination des rapports des bombes
avec leurs charges & leurs mortiers, félon diverfes pefan-
teurs & diamètres. Cas où l’on peut diminuer la poudre
dont la bombe eft chargée. Ibid. A Quantité de poudre
néceffairc pour faire crever les bombes de douze pouces
8c celles de huit. Comment l’on coule une bombe de onze
pouces huit lignes. Ce qu’il faut pour qu’une bombe foit
bien conditionnée. Maniéré de charger les bombes. Ibid.
317. a. Voye^ les planches de l’art militaire, vol. I.
■ Bombe y les bombes vident mieux coulées en terre qu’en
fable.'VII. 134.'A Art de monter les bombes, vol. V; des
planches, article fonderie des canons, pl. 21 , 22 & 2^.
Maniéré de bombe deftinée à produire un effet à-peu-pres
femblable à celui des machines infernales. IX. 797. A Premières
bombes jettées avec le mortier; Ingénieur qui a introduit
en France l’ufage des bombes. X;73i. A De la pofition
du morder pour rirer une bombe, & de la ligne qu’elle
décrit. 734. a. Fufées pour les bombes. VII. 385. A&c. Sur
l’art de jetter les bombes, voye{B a l i s t i q u e . II. 38.a, b.8c
l’arride Jet. VID. 321. A &c. Bombes tirées à ricochet. II.
133. a. Caiffon de bombes. II. 338. a. Auteurs qui ont donné
des règles fur l’art de jetter les bombes. II. 619; a.
BOMBER , emboutir , ' ( Bijoutier ) defeription de cette
opération. II. 317. a.
J BOMBERG , {Daniel) imprimeur. II. 223. A VIII.
OMBO, ( Mufiq. ) répétition d’tine note fur le même
degré, Maniéré de l’exécuter à la voix & aux inftrumens.
C eft le_meme agrément que l’on Suppl. II. 11. 1a1. I II appelloit autrefois Trémolo;
efPece bananier. Suppl. I. 784.
BOMBYX, {Mufiq. tnfirum. des anciens) efpece de'chalumeau
des Grecs. Divers fentimens fur la forme & fur là
nature de cet inftrument. Suppl. II. 11. a. Ibid. III. 60. a.
BOMERIE, {Commerce de mer) en quoi elie différé d©
l’aflurance. Etym. de ce mot. II. 317; a.-
BOMONIQUES, jeunes gens Lacédémoniens qui faifoient
gloire de foufirir dès .coups de fouet dans les iacrifices de
Diane. Excès où cettè épreuve étoit pouffée. But qu’on fé
propofoît. Etynu du mot. II. 317. A
BON, ( jyfétapk.) voye{ B on té , difficultés qui fe préfen-
tent firr l’origine & la définition dti mot bon. Diverfes
acceptions que reçoit ce mot : bonté d’être j bonté animale^
bonté raifonnée. IL 317. b. I «
Bonté d être : en quoi elle confifte. Bonté abfblue y bonté
relative : ce qui fait l’une & l’au.tre. Divers degrés de bonté
relative ; gradations dans les êtres felon leur plus ou moins
de perfection. Ibid-, A C’eft de l’imperfeétion plus ou moins
grande des différens êtres , que réfulte la perfection de cet
univers, dans le phyfique & dans le moral. Enchaînement
de tous les êtres qui entrent dans la compofition de ce tout
admirable. Qu’un chaînon fut rompu, la chaîne de toute
la nature le ferait, & l’on verroit tout l’ordre de cet univers
fe détruire & fe confondre. Ibid. 318. a. Plus nous faifirons
de rapports, plus nous ferons convaincus de la bonté des
êtres. Dieu feul la connoît parfaitement. Petites parties de
ce tout : comment pourrions-nous- le comprendre ? Penfées
de Pafchal fur ce lùjet. Paraphrafe de cette parole de Moïfe
touchant l’univers ; Dieu trouva qu’il étoit bon. Comment nous
devons juger des prétendus défauts que nous croyons découvrir
dans le monde. Ibid-. A
Bonté animale , économie dans les paflions, que toute
créature fenfible & bien conftituée reçoit de la nature. II. 318;
A Cette bonté fera d’autant plus parfaite , que les membres
confpireront d’une façon plus avantageufe à l’accompliffe-
ment des fondions animales. Divers exemples de défauts
’ d’économie animale. Plus les organes font délicats, plus les •
fenfations qu’ils occafionncnt font vives; Inconvéniens qui
réfulteroient chez nous d’une trop grande fénfibititè dans les
organes. Ceux que nous avons font proportionnés au rang
que nous tenons dans l’univers.
Bonté raifonnée y fa définition :élle eft la même que la vertus
Ibid. 319. a. Ses rapports font, plus immédiats avec nous ^
parce qu’ils touchent notre coeur de plus près. Le bon, dans
ce fens, fe confond avec Vutile. Le premier bon dont nous
avons parlé ne plaît qu’à l’efprit, celui-ci plaît au coeur. S’il
eft vrai que nous publions aimer en Dieti quelqu’autre chofe
que fa bonté bienfaifante. Sentimens qu’excitent en nous un
être qui né nous eft utile que comme moyen, & un être
qui nous eft utile par lui-même. Différence entre un bien
honnête 8c un bien agréable. Ibid. A
Bonté des êtres artificiels : d’où elle dépend. Elle eft fondée
fur dés loix immuables. Une produdion de l’art fera d’autant
plus parfaite qu’elle réunira plus parfaitement le bon avec lé
beau; Il y a aes produdionsdes arts qui ne font que belles,
il y en a d’autres qui intéreffent l’eiprit 8c le cahir, mais
toujours d’une maniéré fubordonnée aux effets de la nature
dont l’art n’eft que l’imitation. Ce qu’il y à de plus touchant
pour nous, c’eft l’image des pafuons & des adions des
hommes; II. 320.. a.
Bon y fête qtie les Japonois célèbrent en l’honneur des
morts. IL 320. a.
BONACE, ( Marine ) calmes dangereux formés dans un
grand efpace autour duquel tournent des Vents contraires.
XL 710. A
BONANNI, {Philippe) anatomifte. Suppl. I. 401. a.
BONARELLI, ( le comte Gui Ubaldo ) poète italien; XVII.
489. a. Obfervations fur fon ouvrage intitulé Phylis deScyrosi
XIV. 847; A
BONAROTA , {MichelAnge) feulpteur. XIV. 831. A
Peintre. V; 318. a. 8c architedél Suppl. I. 339. A Nobleffé
dans fes ouvrages. VIL 767. A Sa ftatue de Cupidon. L
313. A XIV. 823. a y A Défauts dans fes ouvrages. Suppl. III;
257. <*; . . '
BONASIENS, {Hift. ecclr) hérétiques. Ce font les mêmes
que les Bonofiaques 8c les Bonofiens. Suppl. II. 11. a.
BONASUS, ( Zoolog. ) animal de la figure d’un boeuf. Sa
defeription. Qualité de fa chair. Divers noms que lès auteurs
lui donnent. Comment cet animal fe défend quand il eft
chaffé. Montagne qu’il habitoit autrefois. II. 320. A
BONAVENTURE, le Francifcain , dodeur fcholaftique;
XIV. 773. h.
Bonavcntures , ( ifles ) V lll. 922. a.
BONBALON , {Luth.) inftrument dont les iiegtes fe
fervent comme de toefin. Sa defeription. Suppl. II. 11. A
BONBANC, {Archit.) pierre forte blanche qui fe trouvé
aux environs de Paris. II. 320. A Qualité de cette pierre;