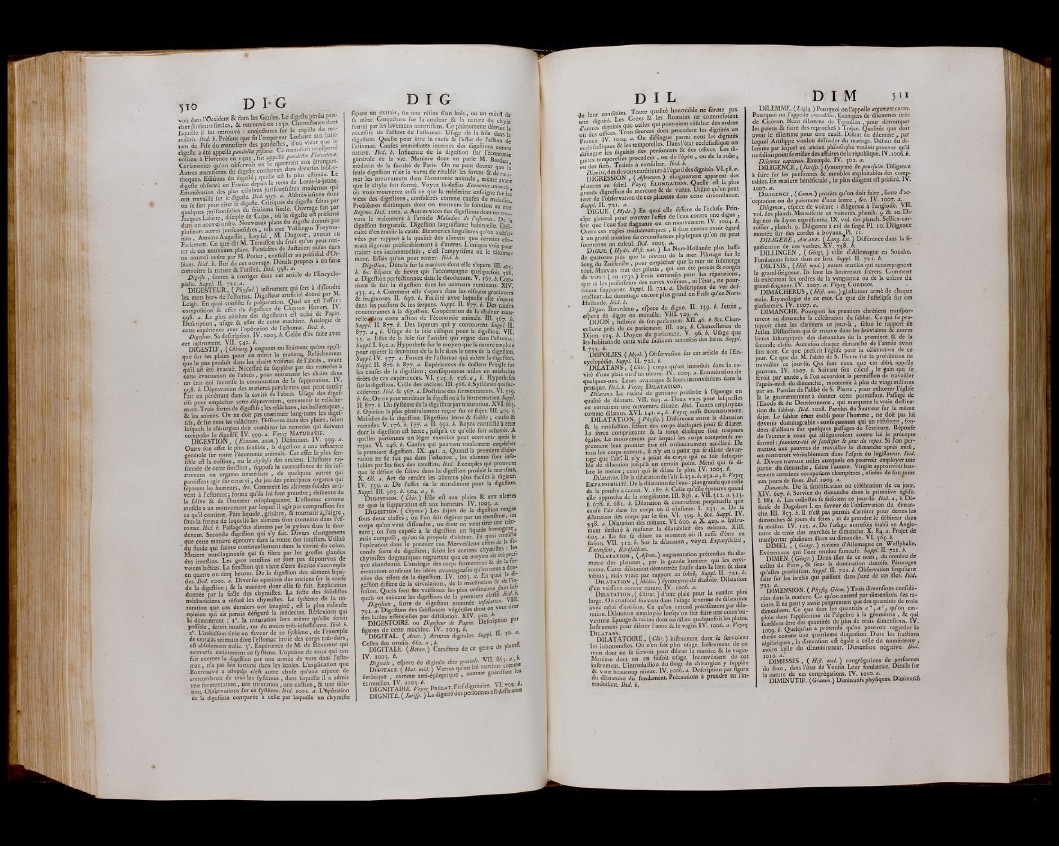
y i ö
voit dans l’Ocddent & dans les Gaules. Le digefte perdu pen
dant plufieurs fiedes, & retrouvé en 1130. Circonflance da
laquelle il fut retrouvé : conjcftures fur le çopttte du ma
jinfcrit. lUd. f. Préfent que fit l'empereur Lothatre m M - k
tans de Pife du manufcpt despandeflcs,
digefte a été appellé pandcilx pifana. Ce manuf P
enfuite à FloSnce eîa 1 505 , fut appellé
Cérémonies qu’on obfervoit en le
Autres manuicrits du digefte çonferv's. eftimée. Le
theques. Editions du digefte; quelle P Louis-le-ieune.
&u Lmine Auguftin, Loyfel , M. Dugone, avocat au
■Parlement. Ce que dit M. Terraffon du fruit qu on peut retirer
de ces nouveaux plans. Pandeâes de Juftinien mifes dans
un nouvel ordre par M. Potier , confeiller an préfidud d Orléans.
Ibid. b. But de cet ouvrage. Détails propres à en tane
connoitrc la nature & 1’urilité* /Aid. 998* M
Digefte, fautes à corriger dans cet article de 1 Encydo-
PÎra c 1S^ E Ù V r ( I™ i'> i-) infiniment qui fert à dilToudrc
les mets hors de l'eftomac. Digcfteur artificiel dohné par M.
Leigh. En quoi confifte fa préparation. Quel en eft l efte,.
compofuion & effet du digcfteur de Clopton Havers IV.
9o8Pu. Le plus célébré des digefteurs eh celui de Eap n
Defcription , ufage & effet de cette machine. Analogie de
cette expérience avec l’opération de 1 ejtomac.Ibid. b.
Digcfteur. Sa defcription. IV. 1003.A. Gelée dos faite avec
cet infiniment. VII. 542. A. . . , : ..
DIGESTIF, (Chirurg.) onguent ou Uniment qu on applique
fur les plaies pour en mûrir la matierq* Relâchement
que le pus produit dans les chairs voifmes de 1 abcès, avant
¿uni ait été évacué. Néceffité de fuppléer par des remedes a
cette évacuation de l’abcès, pour entretenir les chairs dans
un état qui favorife la continuation de la fuppuration. IV.
008. A. Dépravation des matières purulentes que peut cauier
pair eh pénétrant dans la cavité de l’abcès. Ufage des digef-
tifs pour empêcher cette dépravation, entretenir le relâchement.
Trois fortes de digeftifs; les relâchans, les balfamiques,
& les animés. On ne doit pas continuer long-tems les digeftifs,
8e fur-tout les relâchans. Différons états des plaies , félon
lefquels le chirurgien doit combiner les remedes qui doivent
compofer le digeftif. IV. 999. a. Voyez M atu ratif.
DIGESTION, (Econom. anim.) Définition. IV. 999. a.
Outre fon effet le plus fenfible, la digeftion aune influence
générale fur toute l’économie animale. Cet effet le plus fenfible
eft la Coftiori, ou le chylofis des anciens. L’hiftoire rai-
fonnée de cette fonftion, foppofe ht connoiffance de fes mf-
rrumens ou organes immédiats , de quelques autres qui
paroiffent agir fur ceux-ci, du jeu des principaux organes qui
féparent les humeurs, &c. Comment les alimens folides arrivent
à l’eftomacj forme qu’ils lui font prendre; defeente de
la falive 8c de l’humeur oefophagienne. L’eftomac comme
mufcle a un mouvement par lequel il agit par compreffion fur
ce qu’il contient. Pâte liquide, grisâtre, 8c tournant y ’aigre,
fous la forme de laquelle les alimens font contenus dans 1 ef-
tomac. Ibid. b. PaffageMes alimens par le pylore dans le duodénum.
Seconde digeftion oui s’y fait. Divers changemens
que cette matière éprouve dans la route des inteftins. Utilité
* du fluide qui fuinte continuellement dans la cavité du colon.
Matière mucilagineufe qui fe filtre par les groffes glandes
des inteftins. Les gros inteftins ne font pas dépourvus de
veines laâées. La fonction qui vient d’être décrite s accomplit
en quatre,ou cinq heures. De la digeftion des alimens liquides.
Ibid. 1000. a. Diverfes opinions des anciens fur la caule
de la digeftion; 8c la maniéré dont elle fe fait. Explication
donnée par la feûe des chymiftes. La fefle des fohdiftcs
mécbaniciens a réfuté les chymiftes. Le fyftême de la trituration
que ces derniers ont imaginé , eft la plus ridicule
opinion qui ait jamais défiguré la médecine. Réflexions qui
le démontrent ; t°. la trituration lors même qu elle ferait
poffible, feroit inutile, ou du moins très-infumfante. Ibid. b.
. a°. L’induélion tirée en faveur de ce fyftême, de 1 exemple
de certains animaux dont l’eftomac broie des corps tres-durs,
eft abfolument nulle. 30. Expérience de M. de Réaumur qui
renverfe entièrement ce fyliême. L’opinion de ceux qui ont
fait exercer la digeftion par une armée de vers dans l’efto-
mac, n’a pas fait fortune dans les écoles. L’explication que
Boerhaave a adoptée n’eft autre chofe qu’une efpece de
concordance de tous les fyftêmcs, dans laquelle il a admis
une fermentation, une trituration, une coâion, 8c une dilution.
Obfervations fur ce fyftême. Ibid. 1001. a. L'ftpération
de la digeftion comparée à celle par laquelle un chymifte
fépare tin extrait, bu une rêfine d’un bois, ou un métal de1
fa mine. Conjecture fur la couleur 8c la nature du chyle
fourni par les lavemens nourriffans. Ce phénomène détruit la
nécéifité de l’aftion de l’eftomac. Ufage de la bile dans la
digeftion. Quelle peut être la caufe 8c l’effet de l’aélion de
l’eftomac. Caufes immédiates internes des digeftions contre
nature. Ibid. b. Influence de la digeftion fur l’économie
générale de la vie. Maniéré dont en parle M. Bordcu
médecin de la faculté de Paris. On ne peut douter quC
feule digeftion n’ait la vertu de rétablir les forces 8c de ranimer
les mouvemens dans l’économie animale, même avant
que le chyle foit formé. Voyez là-deffus Économie animale
où vous trouverez auffi ce que la médecine enfeigne fur 1«
vices des digeftions, confidcrés comme caufes de maladies
Problèmes diététiques dont on trouvera la folution au mot
Régime. Ibid. 1002. a. Autres vices des digeftions dont 'on trouvera
le traitement à l’article Maladies de l'eftomac. De la
digeftion fongueufe. Digeftion languiffante habituelle. Difficulté
d’en établir la caufe. Bizarreries fmgulieres qu’on a obfcr-
vées par rapport à la qualité des^ alimens que certains cfto-
macs digerent préférablement à d’autres.^ L’unique voie pour
traiter ces incommodités, c’eft l’empyrifme ou le tâtonnement.
Effais qu’on peut tenter. Ibid. b.
Digeftion. Détails fur la maniéré dont elle s’opère. III. 405.
b. &c. Efpece de fievre qui l’accompagoe quelquefois. 360*.
a. Digeftion perfectionnée dans le duodénum. V . 167. b. Comment
fe fait la digeftion dans les animaux ruminans. XIV.
435. a , b. Comment elle s’opère dans les oifegux granivores
8c frugivores. II. 690. b. Facilité avec laquelle elle s’opère
dans les poiffons 8c les ferpens. Suppl: II. 877. b. Des caufes
concourantes à la digeftion. Coopération de la chaleur natu-
relle£jans cette aélion de l’économie animale. IIJ. 367. b.
Suppl. II. 877. b. Des liqueurs qui y concourent. Suppl. II.
877. a , b. Ufage de la bile eiftique pour la digeftion. VII.
33. a. Effet de Ta bile fur l’acidité qui regne dans l’eftomac.
Suppl. 1. 892. a. Hypothefe fur le moyen que la nature emploie
pour opérer la fecrétion de la bile dans le tems de la digeftion.
Suppl. IV. 577. a. Forces de l’eftomac qui aident la digeftibn.
Suppl. II. 876. b. 877. a. Expériences du doéteur Pringle fur
les caufes de la digeftion ; conféquences utiles en médecine
tirées de ces expériences. VI. 523. b. 526.1, b. Hypothefes
fur la digeftion. Celle des anciens. III. 566. b. Syftêmes quifuc-
cédèrent. Ibid. 8c 567. a. Doilrine des fermentateurs. Vl. 519.
b. bc. On ne peut attribuer la digeftion à la fermentation. Suppl.
II. 877. b. Du fyftême de la digeftion par triniration. XVI. 005.
b. Opinion la plus généralement reçue fur ce fujet. III. 405. b. ’
Maladies de la digeftion. Digeftion lente 8c foible ; caufes &
remedes. V. 176. b. 177. a. II. 392. b. Repos confeillé à ceux
dont la digeftion eft lente, jufqu’à ce qu’elle foit achevée. A
quelles personnes un léger exercice peut convenir après le
repas, v l. 246. b. Caufes qui peuvent totalement empêcher
la première digeftion. IX. 491. a) Quand la première élaboration
ne fe fait pas dans l’eftomac , les alimens font info-
lubles par les fucs des inteftins. Ibid. Exemples qui prouvent
que le défaut de falive dans la digeftion produit le marafme.
X. 68. a. Art de rendre les alimens plus faciles à digérer.
IV, m« a. De l’effet de la méridienne pour la digeftion.
Suppl. III. 903. b. 904. a , b. n ’
D ig e s t io n . ( Chir. ) Elle eft aux plaies 8c aux ulcérés
ce que la fuppuration eft aux humeurs. IV. 1003. a.
D ig e s t io n . ( Chymie ) Les fujets de la digeftion ranges
fous deux claffes ; ou l’on fait digérer par un menftrue, un
lliau vwmj.-.- y 1 — g g wv 1
l’opération dans le premier cas. Merveilleux effets u
conde forte de digeftion, félon les anciens chymutes .
chymiftes dogmatiques regrettent que ce moyen ait hé pr
que abandonné. L’analogie des corps fermentans Sc de »
mentation confirme les idées avantageufes qu’on nous a
nées des effets de la digeftion. IV. 1003. a- En quoi a -
eeftion diffère de la circulation, de la macération oc
fufion. Quels font tes vaiffeaux les plus ordinaires dan . .
quels on exécute les digeftions de la première dalle. y • .*
Digeftion y forte de digeftion nommée infolation. •
791. a. Digeftion des fubftances végétales dont on veu
des huiles effehtielles par diftillation. XIV. 920. b.
DIGESTOIRE ou Digcfteur de Papin. Defcription p«
figures de cette machine. IV. 1003. b. . lT tQ üt
DIGITAL. ( Anat. ) Artères digitales. Suppl. 11. 1
Celles des orteils. 662. a 9b. niant#.
DIGITALE. (Botan.) Caraftere de ce genre de P»nt
IV. 1003. b. . • » VIT RAi a.b.
Digitale , efpece de digitale dite gratiole. vil. 3*
D ig i t a l e . {Mat. mtd\ Vertus quon lui at , . ~ t les
émétique , comme anti-epileptique , corn g
écrouelles. IV. 1003. b. v i <702. b.
DIGNITAIRE. V eft différente
DIGNITÉ. ( Jurifp. y u dignité des perfonnes dit dht
D I L D I M 5 1 1
, , Toute qualité honorable ne forme pas
ff- f g recs & les Romains ne connoiffoient
P?c t'f'ÎLéités que oelles qui pouvoient réfulter (les ordres
allîes offices. Trois fources dont proeedent les dignités en
on des tnnt.c ^ Qn dlfling„ e parm; nous les digmtes
LTétoffiques & les temporelles. Dans l'état eeeléfiaffique on
diftingue les dignités d à perfonnaK & des offces Les di-
nîiitéf temporelles procèdent, ou de l'épée , ou de la robe,
OU des fiefs. Traités à confulter. Ibid. b.
Dignité, des de voirs extérieurs à 1 égard des dignités. VI. 58. a.
DIGRESSION , ( Aftronom. ) éteignement apparent des
a ne tes au foleil. Voye^ É lo n g a t io n . Quelle eft la plus
¿rande diereflion de .mercure 8c de vénus. Ütihté qu on peut
tirer de l’obfervation de ces planetes dans cette circonftance.
^^IGUE7 ( Hydr. ) En quoi elle diffère de l’éclufe. Principe
général pour trouver l’effet de l’eau contre une digue ,
foit que l’eau foit ftagnahte ou en mouvement. IV. 1004. b.
Outre ces réglés mathématiques , il faut encore avoir égard
à un grand nombre decirconftancesphyfiques quon ne peut
foumettre au calcul. Ibid. 1005. a. , . —
D igu e . ( Hydr. Hift. nat.) La Nort-Hollande plus baffe
de quatorze piés que le niveau de la mer. Pilotage fait le
long du Ziiiderfée, pour empêcher que le mer ne fubmerge
tout. Mauvais état des pilotis , qui ont été percés & ratgéç.
de vers • ( en 173a ) Frais iramenfes pour les réparations,
que ni les poffeffeurs des terres, voifmei1, ni létal:, ne pourraient
(importer. Suppl. 11. 711.-■ Defcripnon du ver def-
mifteur. L dommage encore plus grand en Frife qu en Nort-
Hollande. Ibid. b. t .a»
Digue. Batardeau, efpece de digue. II. 139. b. Jettee
efpece de digue ou muraille. V1IL 529. a.
DIJON ; hiftoire de fon parlement. XII. 46. b. 8cc. Chancellerie
près de ce parlement. III. 109. b. Chancelleries de
Dijon. 115. b. Doyen du parlement. V. 96. ¿.Ufage que
tes habitans de cette ville faifoient autrefois des bains. Suppl.
1 DllPOLlES. ( Myth. ) Obfervation fur cet article de l’En-
cydopédie. Suppl. II. 721. b. . . . 1
DILATANS, (Chir.) corps qu’on introduit dans la cavité
d’une plaie ou d’un ulcere. IV. 1005. a. Enumération de
quelques-uns. Leurs avantages 8c leurs inconvéniens dans la
pratique. Ibid.b. Voye^ D i la t a t io n .
Dilatans. La racine de gentiane préférée à 1 éponge en
qualité de dilatant. VII. 6oya. Deux vues pour lefcjueUes
on entretient une ouverture dilatée. Ibid. Tentes employées
comme dilatans. XVI. 141.a , A. » I auffi B ou rd on n e t.
DILATATION. ( Phyfiq. ) Différence entre la dilatation
& la raréfaction. Effort des corps élaftiques pour fe dilater.
La force comprimante 8c la force élaiuque font toujours
égales. Le mouvement par lequel les corps comprimés reprennent
leur premier état eft ordinairement accéléré. Ue
tous les corps connus, il n’y en a point qui fe dilate davantage
que l’airr II n’y a point de corps qui ne foit fufeepu-
ble de dilatation jufqu’à un certain point. Métal qui le dilate
le moins ; celui qui fe dilate le plus. IV. 1005. b.
Dilatation. De la dilatation de l’air. 1. 231. b. 232 .a,b. Voyez
Exp an s ib ilité . De la dilatation de l’eau : plus grande que celle
de la poudre à canon. V. 187. b. CeUe qu’elle éprouve quand
elle approche dé la congélation. III. 836. a. VU. 3,12. a. 313.
I 678. b. 681. b. Dilatation 8c contraction perpétuelle que
caufe l’air dans les corps où il s’infinue. I. 233. a. De la
dilatation dés corps par le feu. VI. 599. b^.etc. Suppl. IY .
938. a. Dilatation des métaux. VI. 600. a. X. 429. a. Imtru-
ment deftiné à mefurer la dilatabilité des métaux. XUl.
6o<. a. Le fer fe dilate au moment ou il ceffe d être en
fofion. VII. 312. A. Sur la dilatation, voyez Expanftbiltté ,
Extcnfion, RaréfaSion. .. , . . .
D i la t a t io n , (AJlron.) augmentation prétendue nu diamètre
des planetes , par la grande lumière qui les environne.
Cette dilatation démontrée fauffe dans la lune 8c dans
Vénus ; mais vraie par rapport au foleil. ftuPP‘ - i ..7 ax:
D i la t a t io n , {Médec.) fvnonymede diaftole. Dilatation
d'un vaiffeau contre nature. lV. 1006. a.
‘ D i l a t a t i o n , ( Chirur.) d’une plaie pour la rendre plus
large. On confond fouvent dans l’ufage le terme de dilatation
avec celui d’incifion. Ce qu’on entend précifément par dilatation.
Dilatation employée lorfqu’on fait faire une contr*ou-
verture. Eponge 8c racine dont on dilate quelquefois les plaies.
Inftrumens’pour dilater l’anus 8cle vagin. I v . 1006. a. Voyc{
D i la t a n s . v „ H
DILATATOIRE, ( Chir. ) infiniment dont fe fervoient
les lithotomiftes. On n’en fait plus ufage. Inftrument de ce
nom dont on fe fervoit pour dilater la matrice 6c le vagin*
Maniéré dont on en faifoit ufage. Inconvénient de cet
infiniment. Lintroduftion du doigt du chirurgien y fupplèe
&• u«,._m, IV. 1006. a. Defcnpuon par figure
DILEMME. (Logiq. ) Pourquoi on l’appelle argument cornu.
Pourquoi on l’appelle crocodilus. Exemples de dilemmes tirés
de .Cicéron. Beau dilemme de Tertulien , pour détromper
les païens 8c faire des reproches à Trajan. Qualités que doit
avoir le dilemme pour être exaft. Défaut du dilemme , par
lequel Ariftippe vouloit diffuader du mariage. Défaut du dilemme
par lequel un ancien philofophe vouloit prouver qu’il
ne falloit point fe mêler des affaires de la république. IV. 1006. A.
Dilemme captieux. Exemple. IV. 502. a.
DILIGENCE, (Jurifp.) fynonyme depourfuite. Diligence
à faire fur les perfonnes 8c meubles exploitables des comptables.
En matière bénéficiale, le plus diligent eft préféré. IV.
1007. a. j»
D ilig e n c e , ^ Comm.) protêts qu on doit faire, faute d acceptation
ou de paiement d’une lettre , &c. IV. 1007. a.
Diligence, efpece de voiture : diligence à l’anglOifc. VII.
vol. des planch. Menuiferie en voitures, planch. | 8c 10. Diligence
de Lyon repréfentée. IX. vol. des planch. Selticr-car-
roffier, planch. 9. Diligence à ctil de finge. Pl. 10. Diligence
montée fur des cordes à boyaux.^Pl. ix.
DÍLIGEREy Amare. (Long. lat. ) Différence dans la fr-
gnification de ces 'verbes. XV. 758. A.
DILLINGEN , ( Géogr, ) ville d’Allemagne en Souabe.
Fondations faites dans ce lieu. Suppl. II. 721. A.
DILTSIS , (Hift- mod.) muets mutilés qui accompagnent
le grand-feigneur. Ils font les bourreaux fecrets. Comment
ils exécutent les ordres de la vengeance ou de la colere du
grand-feigneur. IV. 1007. a. Voye1 CORDON.
DÍMACHERUS, (Hift. anc.) gladiateur armé de chaque
main. Etymologie de ce mot. Ce que dit Juftelipfe fur ces
gladiateurs. IV. 1007. a. .
DIMANCHE. Pourquoi les premiers chrétiens tranfpor-
terent au dimanche la célébration du fabbat. Ce qui fe pra-
tiquoit chez les chrétiens ce jour-là , félon le rapport de
Juft’m. Diflinition qui fe trouve dans les bréviaires oc autres
livres lithurgiques des dimanches de la première 8c de la
fécondé clafie. Autrefois chaque dimanche de l’année avoit
fon nom. Ce que preferit l’églife pour la célébration de ce
jour. Ce que dit M. l’abbé de S. Pierre fur la prohibition de
travailler ce jour-là. Qui font ceux que cet abbé appelle
• pauvres. IV. 1007. A. Suivant fon calcul, le gain qui fe.
feroit par année, fi l’on accordoit la permiffion de travailler
l’apirès-midi du dimanche, monteroit à plus de vingt millions
par an. Paroles de l’abbé de S. Pierre, pour exhorter l’églife
8c le gouvernement à donner cette permiffion. Paffagc de
l’Exode 8c du Deutéronome , qui marquent la vraie deftina-
tion du fabbat. Ibid. 1008. Paroles du Sauveur fur le même
fujet. Le fabbat étant établi pour l’homme, ne doit pas lui
devenir dommageable : confequences qui en réfultent, fondées
d’ailleurs for quelques paffages de l’écriture. Réponfe
de l’auteur à ceux qui allégueraient contre lui le précepte
formel : fouviens-toi de fanSifier le jour du repos. Si l’on per-
mettoit aux pauvres de travailler le dimanche après midi,
en rentrerait véritablement dans l’efprit du légiflateur. Ibid.
A. Divers travaux utiles auxquels on pourrait employer une
partie dû dimanche, félon fauteur. Virgileapprouvoirhau-
tement certaines occupations champêtres, ufitées de fon rems
aux jours de fêtes. Ibid. 1009. a.
Dimanche. De la fanftification ou célébrauon de ce jour.
XIV. 607. A. Service du dimanche dans la primitive églife.
I. 881. A. Les coljeâes fe faifoient ce jour-là. Ibid. a, b. Dé-
fénfe de Dagobert I. en faveur de l’obfervation du dimanche.
III. 853. A. Il n’eft pas permis d’arrêter pour dettes les
dimanches ¿jours de fêtes , ni de prendre le débiteur dans
fa maifon. IV. 121. a. De l’ufage autrefois établi en Angleterre
de tenir des marchés le dimanche. X. 84. a. Projet de
tranfporter plufieurs fêtes au dimanche. VI. 565. A.
D1MEL , (Géogr.) rivière d’Allemagne en Weltphalie,
Evéncmens qui l’ont rendue fameufe. Suppl. II. 721. A.
D1MEN. ( Géogr. ) Deux ifles de ce nom, du nombre de
celles de Faro, & fou« la domination danoife. Pâturages
qu’elles produifent. Suppl. II. 7«* b- Obfervation finguliere
faite fur les brebis qui paiffent dans J une de ces ifles. Ibid.
DIMENSION. ( Phyfiq. Gèom. ) Trois dimenfions confidé-
rées dans la matière. Ce qu’on entend par dimenfions des racines
11 ne peut y avoir proprement que des quantités^de trois
dimenfions. Ce que font les quantités * ,a * , quon emploie
dans l’application de 1 algebre à la géométrie , 8c qm
femblent être des quantités de plus de trois dimenfions. IV.
100q. A. Quelqu’un a prétendu qu’on pourrait regarder la
durée comme une quatrième dimenfion. Dans les fraftions
algébriques, la dimenfion eft égale à celle du numérateur,
moins 'celle du dénominateur. Dimenfion négative. Ibid.
10DIMÉSSES, ( Hift. eccl. ) congrégations de perfonnes
du fexe , dans l’état de Venife. Leur fondatrice. Détails for
la nature de ces congrégations. IV. 1010. a. . ■
DIMINUTIF. (Gramm.) Diminutifs phyfiques. Diminutifs