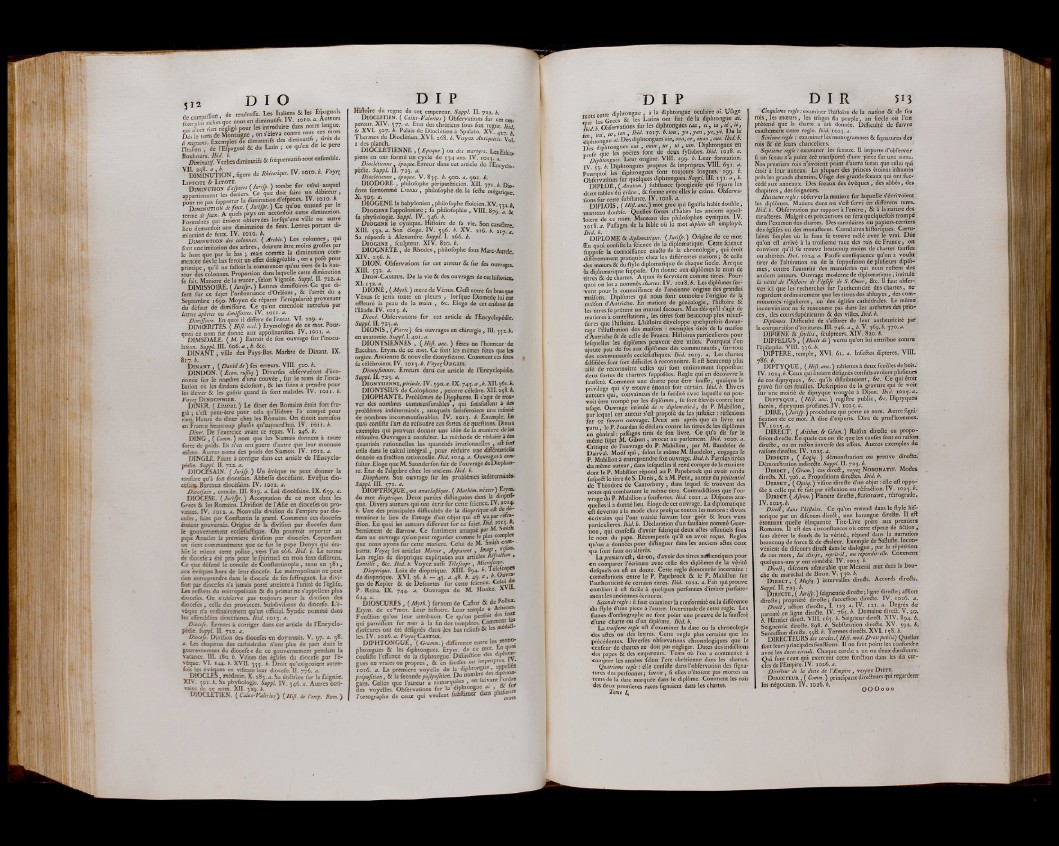
f é D I O
¿ i f d W m t ì f e l v f w J o ! Ì Ìu ? cb «
' Jvnr rien neelieé pour les introduire dans notre langue.
on s-éleve contre tous ces; rno«
/i Exemples de d.mmunfe des dimtnunfi , nrés de
nralfen , de l’Efoagnol & du Lattn ; ce qucn dit le pere
B° É W « ÿ V « t e diminutifs Stiréquentatif. toutenfemblc.
V DIMINUTION, figure de Rhluriqu*. IV. toio. i. Voyi^
% « < « • ) cd“Â S el
appartiennent les deniers. Ce que don faire un délnBnr ,
nour ne nas (importer la diminution:dcfpeccs. IV. ioto. i.
DiminutioS ( Ao/pr.) Ce qu’on entend par le
terme d / s . A quels pays on accordo« cette diminunon.
Formalités qui éroient oblervces lorfquune ville ou autre
lieu demando« une diminution de feux. Lettres portant diminution
de feux. IV. 1010. bs _ •
D im in u t i o n des colonnes. ( Architi) Les colonnes, qui
font une imitation des arbres, doivent être moins grottes par
le haut que par le bas ; mais comme la diminution commencée
dès le bas feroit un effet défcgréable, on a pofé pour
principe, qu’il ne falloir la commencer qu’au tiers de la hauteur
des colonnes. Proportion dans laquelle cette diminution
fc fait. Maniere de la tracer, félon Vignole. Suppl. II. 7l î -f-
DIM1SSOIRE. ( Jurifpr. ) Lettres dimifloires. Ce que di-
ferit fur ce fujet l’ordonnance d’Orléans, 8c 1 arrêt du 4
Septembre 1690. Moyen de réparer l’irrégularité provenant
du défaut de dimiffoire. Ce qu’on emendo« autrefois par
lettres apôtres ou dimijfoires. IV. to n . a.
Dimiffoire. En quoi il diffère de Yexeat. VI. 229. a.
DIMCERITES. ( Hift. eccl.) Etymologie de ce mot. Pourquoi
ce nom fut donné aux appolinariltes. IV. to u . a.
DIMSDALE. (Ai. ) Extrait de fon ouvrage fur 1 inoculation.
SuppL IIL 606. a y b. Sic.
DINANT, ville des Pays-Bas. Marbre de Dînant IX.
817. b.
D î n a n t , {Davidde) fes erreurs. VIII. 320. b.
DINDON. ( Econ. ruîliq. ) Dhrerfes obfervations d’économie
fur le nombre d’une couvée, fur le tems de l’incubation
où les dindons éclofent*, 8c les foins à prendre pour
les élever & les guérir quand ils font malades. IV. 1011. b.
Voyer D in d o n n ie b .
DINER. ( Littéral. ) Le dîner des Romains étoit fort frugal
; c’eft peut-être pour cela qüTftdore l’a compté pour
rien. Heure du dîner chez les Romains. On diffôit autrefois
en France beaucoup plutôt qu’aujourd’hui. IV. 101 x. b.
Dîner. De l’exercice avant ce repas. VL 246. b.
DING, ( Comm. ) nom que les Siamois donnent â toute
forte de poids. Ils n’en ont guère d’autre que leur monnoie
même. Autres noms des poids des Siamois. IV. tota. a.
DINGLE. Faute a corriger dans cet article de l'Encyclopédie.
Suppl. IL 712. a.
donner la
ue dio-
DIOCÉSAIN. ( Jurijp. ) Un évéoue ne peut dot
tonfare qu'à fon diocéfain. Abbeffe diocéfàine. Evé^i
céùis^ Barcata diocéfâins. IV. 1012. a.
Diocéfain, concile. IIL 819. a. Loi diocéùine. IX. 659. a.
DIOCESE. { Jurifpr/) Acceptation de ce mot chez les
Grecs 8c les Romains. Divifion de l’Afie en diocefés ou provinces.
IV. X012. a. Nouvelle divifion de l’empire par dio-
ccfes , fats par Confiantin le grand. Comment ces diocefes
étoiem gouvernés. Orióne de la divifion par diocefés dans
le gouvernement eccléfiaftiquc. On pourrait reporter au
pape Anaclet la premiere divifion par diocefes. Cependant
on tient communément que ce fut le pape Denys qui établit
le mieux cette pedice, vers l’an 206. Jbid. p. Le ternie
de <£ocefé a été pris pour le fpirituel en trois fens différer».
Ce que défend le concile de Conftantinoole, tenu en 381,
aux évêques hors de leur diocefé. Le métropolitain ne peut
tien entreprendre dans ie diocefé de fes fuffragans. La divi-
fion par diocefés n’a jamais porté atteinte à l’unité de l’églife.
Les refforts du métropolitain & du primat ne s*appellent plus
diocefés. On n’obferve pas toujours pour la divifion des
diocefés , celle des provinces. Subdivisons du diocefc. L’é-
vêque n’a ordinairement qu’un official. Syndic nommé dans
les affémblées diocéfâîncs. /¿¿/. 1013. ir.
Diocefe. Erreurs à corriger dans cet article de l’Encyclopédie,
Snppl. IL 722. a.
Diocefe. Divifion des diocefés en doyennés. V. 97. a. 98.
a. Les chapitres des cathédrales n’ont plus de part dans lé
gouvernement du diocefé < de ce gouvernement pendant la
vacance, 11L 180. b. Vifites des églifes du diocefé „par l’é-
vêque. VL 144. b. XVIL 333. b. Droit qu’exigcoicnt autrefois
les évêques en vifhant leur diocefé. II. 776. a.
DIO CLES » médecin. X. 283. a. Sa doôrine fur la faignée.
XIV. 501. é. Sa phyfiologic, Suppl. IV. 346. <r. Autres écrivains
de ce nom. XIL 319, b.
DIOCLETÏEN. {Casus-Valerius) {Hift. de l'emp. Rom.)
D I P
Hiftoire du regne de cet empereur. Suppl. II. 722. b.
D i o c l e t i e n . ( Caïus-Valerius ) Obfervations fur cet empereur.
XIV. 577. a. Etat des chrétiens fous fon règne. Ibid
6* XVI. 507. b. Palais de Dioctétien à Spalato. XvT417. y
Thermes de Dioclétien. XVI. 268. b. Voyez Antiquités. Vol*
x dcsplanch.
_ DIOCLÉTIENNE , ( Epoque ) ou des martyrs. Les Ethiopiens
en ont formé un cycle de 534 ans. IV. 1013. a.
Dioclétienne, époque. Erreur dans cet article de P Encyclopédie.
Suppl. II. 723. a.
Dioclétienne, époque. V. 835. b. 900. a. 901. b.
DIODORE , philofophe péripatéticicn. XII. 371. b. Dio-
dore furnommé Cronus, philofophe de. la feéte mégariquc.
X-, 305. a.
DIOGENE le babylonien, philofophe floïcicn. XV. 332. L
D i o g e n e l’appoloniatc ; fa philofophic, VIII. 879. a. fit
fa phyfiologic. Suppl. IV. 346. b.
D i o g e n e le cynique. Hiftoire de fa vie. Son caradere.
XIII. 532. a. Son éloge. IV. <96. b. XV. 2x6. b. 217.
Sa réponfe à Alexandre. Suppl. L 266. b.
D i o g e n e , fculpteur. XIV. 820. b.
DIOGNETE, de Rhodes, philofophe fous Marc-Auréle
XIV. 256. b.
DION. Obfervations fur cet auteur & fur fes ouvrages.
XIII. 532. *. 6
D io n -C a s s iu s . De la vie 8c des ouvrages de cet hiftorien.
XI. 132. a.
DlONÉ, ( Myth. ) mere de Vénus. Ocft entre fes bras que
Vénus fe jetta toute en pleurs , lorfque Diomcdç lui eut
effleuré la peau de la main , &c. Eloge de cet endroit dt
l’Iliade. IV. 1013. b.
Dioné. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie^
Suppl. II. 723.a.
DIONIS, {Pierre) fes ouvrages en chirurgie, III. 332. b.
en anatomie. Suppl. 1. 401. a.
DIONYSIENNES , {Hift. anc. ) fêtes en l’honneur* de
Bacchus. Etym. de ce mot. Ce font les mêmes fêtes que les
orgies. Ancienne 8c nouvelle dionyficnne. Comment ces fetes
fe célébroient. IV. 1013. b. Voye[ O r g i e s .
Dionyfienncs. Erreurs dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. 11. 723. a.
DIONYSIENNE,période. IV. <90. a. IX. 743. a , b. XIL 361.k
DIONYSIUS de Colophone, peintre célébré. XIL 238. L
DIOPHANTE. Problèmes de Diophante. Il s’agit de trouver
des nombres commenfurables*, qui fatisfaffent i des
problèmes indéterminés , auxquels fâtisferoient une infinité
de nombres incommenfurablcs. IV. 1013. b. Exemple. En
quoi confifle l’art de réfoudre ces fortes de queftions. Divers
exemples qui peuvent donner une idée de la maniéré de les
réfoudre. Ouvrages à confultcr. La méthode de réduire â des
quantités rationnelles les quantités irrationnelles , eftfort
utile dans le calcul intégral, pour réduire une différentielle
donnée en fraétion rationnelle. Jbid. 1014.0. Ouvrages à coo-
fulter.Eloge que M. Saunderfon fait de l’ouvrage dcDiophan-
te. Etat de l’algebre chez les anciens. Ibid. b.
Diophante. Son ouvrage fur les problèmes indéterminés.
Suppl. IIL 571- a.
DIOPTRIQUE, ou anaclaftique. { Mathém. mixtes) Etym*
du mot dioptrique. Deux parties diflinguées dans la dioptn-
que. Divers auteurs qui ont écrit fur cette fcience. IV. 1014.
b. Une des principales difficultés de la dioptrique eft dnàb-
terminer le lieu de l’image d’un objet qui eft vu par r° ri/
âion. En quoi les auteurs différent fur ce fujet. ibid. roi3. o.
Sentiment de Barrow, Ce femiment attaqué par M. bmttit
dans un ouvrage qu’on peut regarder comme le plus complet
que nous ayons fur cette matière. Celui de M- Smith cota- .
battu. Voyez les articles Miroir , Apparent , Image, vqton.
Les redes de dioptrique expliquées aux articles RéfraBion ,
Lentille, 8cc. Ibid. b. Voyez auffi Têlefcope , Mterofeope.
Dioptrique. Loix de dioptrique. XIIL 894. b. Télefcopes
de dioptrique. XVI. a6. b. — 43. a. 48. b. 49. a t LOn***"
ges de Kepler » uc licp ic r 8occ odce Dc /ecfciaurnte»s fîuurr cceetntet fcience. Celui ^.
. Reità. IX. 744. a. Ouvrages de M. Hooke. X
6"èlOSCURES, (Myth.) furnom de Caftor & d e ¡M “ ’
Etym. de c e9mot. Leur hiftoire. Leur temple à Athmi
Fonction qu’on leur attribuoir. Ce qu’on penfo« «es 3ui paroifîcnt fur mer à la fin des tempêtes. Commeor
iofcures ont été défignés dans -les bas reliefs 8c les rtxnior
les. IV. 1016. a. Voyez C a s t o r .
DIPHTONGUE, ( différence entre les mon»:
phtongues 8c les diphtongues. Etym. de ce mot. En qwi
confite l’cflencc de la diphtongue. Diftinâion des djph
eues en vraies ou propres, 8c en faufles ou impropres. •
roi6. La première voyelle de la diphtongue, jjPP'
pripôfition, 8c la fécondé pojlpojiiion. Du nombre es ? . . .
Celles que l’auieur ÎVemarquÉes , en fmvarn ¡ordre
des voyelles. Obfervations fur la diphtongu e
l’orto^phe de ceux qui veulent fubfUtucr dans p l u ^
D I P D I R 5 1 3
mots cette diphtongue , à la diphtongue oculaire or. Ufage
les Grecs 8c les Latins ont fait de la diphtongue ai.
$ 1 1 O b fe r v a t io n s fur les diphtongues mu , m , m
ien ' feu, io, ion , Jbid. 1017. é. m«, y* ,y<w, De la
dinlitoneuc oi. Des diphtongues oin, ouat oe, ouan, oue: Ibid. b.
n U diohtoneues oui , ouin , ue, ui % uin. Diphtongues en
o f c que les poètes font de deux fyllabes. Jbid. 1018. a.
Diphtongues. Leur origine. VIII. 199. b. Leur formation.
IV. 53. b. Diphtongues propres 8c impropres. VIII. 631. a.
Pourquoi les diphtongues font toujours longues. 199. b.
Obfervations fur quelques diphtongues. Suppl. III. iy .a ,b .
DIPLOÉ, ( Anatom.) fubftancc fpongieufe qui fèpare les
deux tables du Crâne, 8c forme avec elles le crâne. Obfcrva-
îionsfurcette fubftance.IV. 1018.a. ,,
DIPLOIS, ( Hift.anc.) mot grec qui figmfie habit double,
■manteau double. Quelles fortes d’habits les anciens appel-
loicnt de ce nom. Manteau des philofophes cyniques. IV.
IOi8. a. Paffagcs de la bible où le mot diplois eft employé.
Jbid. b. ■ I ' , r _ ; _ . . ï
DIPLOME 8c diplomatique. { Jurifp.) Origine de cemor.
En quoi confiftela fcience de la diplomatique. Cette fcience
fuppofe la connoiffance exafte de la chronologie, qui étoit
dincremmcnt pratiquée chez les différentes nations ; 8c celle
des moeurs 8c du ftyle diplomatique de chaque fiecle. Art que
la diplomatique fuppofe. On donne aux diplômes le nom de
titres 8c de chartes. A quoi ils fbrvoicnt comme titres. Pourquoi
on les a nommés chartes. IV. 10x8. b. Les diplômes fer-
-vent pour la connoiffance de l’ancienne origine des grandes
maifons. Diplômes qui nous font connoître l’origine de la.
maifon d’Autriche. En matière de généalogie, l’hiftoire 8c
les titres fe prêtent un mutuel fecours. Mais dés qu’il s’agit de
matières à contcftations, les titres font beaucoup plus nécef-
faircs que l’hiftoire. L’hiftoire développe quelquefois davantage
l’muftration des maifons : exemples tirés de la maifon
d’Autriche 8c de celle de France. Hiftoires particulières pour
lefquclles les diplômes peuvent être utiles. Pourquoi l’on
¿ajoute peu de foi aux diplômes des communautés, fur-tout
des communautés cccléfiaftiques. Ibid. 1019. a. Les chartes
falfifiécs font fort difficiles à reconnoître. Il eft beaucoup plus
aifé de reconnoître celles qui font entièrement fuppoiécs: |
deux fortes de Chartres fuppofées. Réglé qui en découvre la
fauffeté. Comment une charte peut être fauffe, quoique le
privilège qui s’y trouve énonce foit certain. Ibid. b. Divers
auteurs qui, convaincus de la facilité avec laquelle on pou-
voit être trompé par les diplômes, fc font élevés contre leur
ufage. Ouvrage intitulé de re diplomaticâ, du P. Mabillon ,
par lequel cet auteur s’êffpropbfê de les juftificr : réflexions
fur ce favant ouvrage. Deux ans après que ce livre eut
paru, le P. Jourdan fe déclara contre les titres 8c les diplômes
en général : paffagcs tirés de fon livre. Ce qu’a dit fur le
même fujet M. Gibcrt, avocat au parlement. Ibid. 1020. a.
Critique de l’ouvrage du P. Mabillon, par M. Baudelot de
Dairval. Motif qui, félon le même M. Baudelot, engagea le
P. Mabillon à entreprendre fon ouvrage. Ibid. b. Paroles tirées
du même auteur, dans lcfquelles il rend compte de la maniéré
dont le P. Mabillon répond au P. Papebroek qui avoir rendu
fufpeft le titre de S. Denis, 8c à M. Petit, auteur du pénitentiel
de Théodore de Cantorbery, dans lequel fe trouvent des
notes qui combattent le même titre. Contradictions que l’ouvrage
du P. Mabillon a fouffertes. Ibid. 1021. a. Difputcs auxquelles
il a donné lieu. Éloge de cet ouvrage. La diplomatique
eft devenue à la mode chez prefquc toutes les nations : divers
écrivains qui l’ont traitée iuivant leur goût 8c leurs vues
particulières. Ibid. b. Déclaration d’un fauTlaire nommé Gucr-
non, qui confcffa d’avoir fabriqué deux aftes cffenticls fous
le nom du pape. Récompenfe qu’il en avoit reçue. Réglés
qu’on a données pour diftinguer dans les anciens aftes ceux
qui font faux ou altérés.
La première eft, dit-on, d’avoir des titres authentiques pour
ien comparer l’écriture avec celle des diplômes de la vérité
defquels on eft en doute. Cette règle démontrée incertaine :
contcftations entre le P. Papebroek 8c le P. Mabillon fur
l ’authenticité de certains titres. Ibid. 1022. a. Fait qui prouve
combien il eft facile à quelques perfonnes d’imiter parfaitement
les anciennes écritures.
Seconde réglé : il faut examiner la conformité ou la différence
du ftyle d’une piece à- l’autre. Incertitude de cette réglé. Les
fautes d’orthographe ne font point une preuve de la fauffeté
d’une charte ou d’un diplôme. Ibid. b.
La troifieme réglé eft d examiner la date ou la chronologie
des ailes ou des lettres. Cette règle plus certaine que Tes
précédentes. Diverfes obfervations chronologiques que le
ccnfcur de chartes ne doit pas négliger. Dates des indiélions
des papes 8c des empereurs. Tems où l’on a commencé à
compter les années félon l’cre chrétienne dans les chartes.
Quatrième réglé : elle confifte dans l’obfcrvation des figna-
turcs des perfonnes; favoir, fi elles n’étoient pas mortes au
tems de la date marquée dans le diplôme. Comment les rois
des deux premières races fignolent dans les chartes.
Tome /,
Cinauieme réglé : examiner l’hiftoire de la nation Sc de fes
rois, les moeurs, les ufages du peuple, au fiede où l’on
prétend que la charte a été donnée. Difficulté de fuivre
cxailement cette règle. Ibid. 1023.a.
Sixième réglé : examiner lés'monogrammes 8c fignatures des
rois 8c de leurs chanceliers.
Septième réglé ; examiner les fceaux. Il importe d’obferver
fi un fccau n a point été tranfporté d’une piccc fur une autre.
Nos premiers rois n’avoient point d’autre fccau que celui qui
étoit à leur anneau. La plupart des princes étoicnt inhumés
près les grands chemins. Ufage des grands fceaux qui ont fuc-
cédéaux anneaux. Des fceaux des évêques, des abbés, des
chapitres, des feigneurs.
Huitième règle : obfcrver la matière fur laquelle s’écrivoient
les diplômes. Matière dont on s’eft fervi en différens tems.
Ibid. b. Obfervation par rapport à l’encre, 8c à la nature des
caraéleres. Malgré ces précautions on fera quelquefois trompé
dans l’examen des chartes. Des cartulaires ou papiers-terriers
des églifes ou des monafteres. Cartulaires hiftoriques. Cartu-
lâires fimples où le faux fe trouve mêlé avec le vrai. Dès
qu’on eft arrivé à la troifieme race des rois de France, on
Convient qu’il fc trouve beaucoup moins de chartes fauffes.
ou altérées. Jbid. 1024. a. Fauffe conféqucncc qu’on a voulu
tirer de l’altération ou de la fuppofiuon de plufieurs diplômes,
contre l’autorité des manulcrits qui nous reftent des
anciens auteurs. Ouvrage moderne de diplomatique, intitulé
la vérité de l’hiftoire de Téglife de S. Orner y 8cc. Il faut obfer-
ver ici que les recherches lur l’authenticité des chartes, ne
regardent ordinairement que les titres des abbayes, des communautés
régulières, ou des églifes cathédrales. Le même.
inconvénient ne fe rencontre pas dans les archives des princes
, des cours fupéricures 8c des villes. Ibid. b.
Diplômes. Difficulté de s’affurer de leur authenticité par
la comparaifon d’écritures. III. 746. a , b. V. 369. b. 370. a.
DIPCENE & fcyllis, fculptcurs. XIV. 820. b.
DIPPEL1US, {Huile de) vertu qu’on lui atttribue contre
l’épilcpfic. VIII. 336. b.
DIPTERE, temple, XVI. 61. a. Infcftes diptères. VIIL
786. b.
DIPTYQUE, ( Hift. anc. ) tablettes à deux feuilles de bois.’
IV. 1024. b. Ceux qui étoicnt défignés confuls avoient plufieur*
de ces diptyques, 6*c. qu’ils dinribuoient, 6>c. Ce qui étoit
gravé fur ces feuilles. Dcfcription de la gravure qui fe voit
lur une moitié de diptyque trouyée à Dijon. Ibid. 1023. a.
D i p t y q u e , ( Hift. anc. ) regiftre public, 6*c. Diptyques
facrcs , diptyques profanes. IV. 1023. a.
DIRE, {Jurifp.) procédure qui porte ce nom. Autre figni-
fication de ce mot. A dire d’experts. Dire de prud’hommes.
IV. 102<.a.
DIRECT. (Arithm. & Gèom.) Raifon dircélc ou propo-
fition direéle. En quels cas on dit que les caufes font en raifon
direAe, ou en raifon inverfe des effets. Autres exemples de
raifons dircétes. IV. 102s. a.
D i r e c t e , ( Logiq. ) démonftration ou preuve directe.'
■ Démonftration indirecte. Suppl. II. 723. b.
D i r e c t , {Gram.) casdirca, voye{ N o m in a t i f . Modes
direéts. XI. 306. a. Propofitions direâes. Jbid. b.
D i r e c t , ( Optiq. ) vifion direfte d’un objet : elle eft oppo-
féc à celle qui fe fait par réflexion ou réfraction. IV. 1023. é.
D i r e c t . {Aftron.) Planete dircae,ftationaire, rétrograde.
IV. 1023. b. ,
Direfly dans l ’hiftoire. Ce qu’on entend dans le ftyle historique
par un difeours direft, une harangue direde. Il eft
étonnant quelle éloquence Tite-Live prête aux premiers
Romains. Il eft des circonftances où cette efpece de fiction ,
fans altérer le fonds de la vérité, répand dans la narration
beaucoup de force & de chaleur. Exemple de Sallufte. Incon-,
vénient du difeours direâ dans le dialogue, par la répétition
de ces mots, lui dis-je, reprit-il, me répondit-elle. Comment
quelques-uns y ont rémédié. IV. 1023. b.
Direfly difeours admirable que Mezerai met dans la nou-
chc du maréchal de Biron. V . 330. b.
D i r e c t , ( Mufiq. ) intervalles directs. Accords directs.
D i r e c t e ,3( jurifp. ) feigneurie direâe ; ligné direéle ; aétion
direéle; propriété direéle; fucceflion direéle- IV. 1026. a.
Direfl, aétion dircélc, f. 122 IV. tai. a. Degrés de
parenté en ligne dircélc. IV 763./. Domaine d.reét V. 20.
b Héritier direét. VIII. 163. b. Seigneur dircét. XIV. 894. b.
Seigneurie direéle. 898. b. Subflitution direéle. XV. 392. b.
Succcflion direéle. 398. b. Termes direéls. XVI. 138. b.
DIRECTEURS des cercles.{Hift mod. Droit public) Quelles
font leurs principales fonétions. Il ne faut point les confondre
avec les auces circuit. Chaque cercle a un ou deux direéleurs.
Qui font ceux qui exercent cette fonétion dans les dix cercles
de l’Empire. IV. 102 6. a.
Direfleur de la dicte de l ’Empire, voyez D ie t e .
D i r e c t e u r , ( Comm.) principaux dircéteurs qui regardent
les négociai». IV. 1026. b. ^ ^
0 O O O 0 0 0