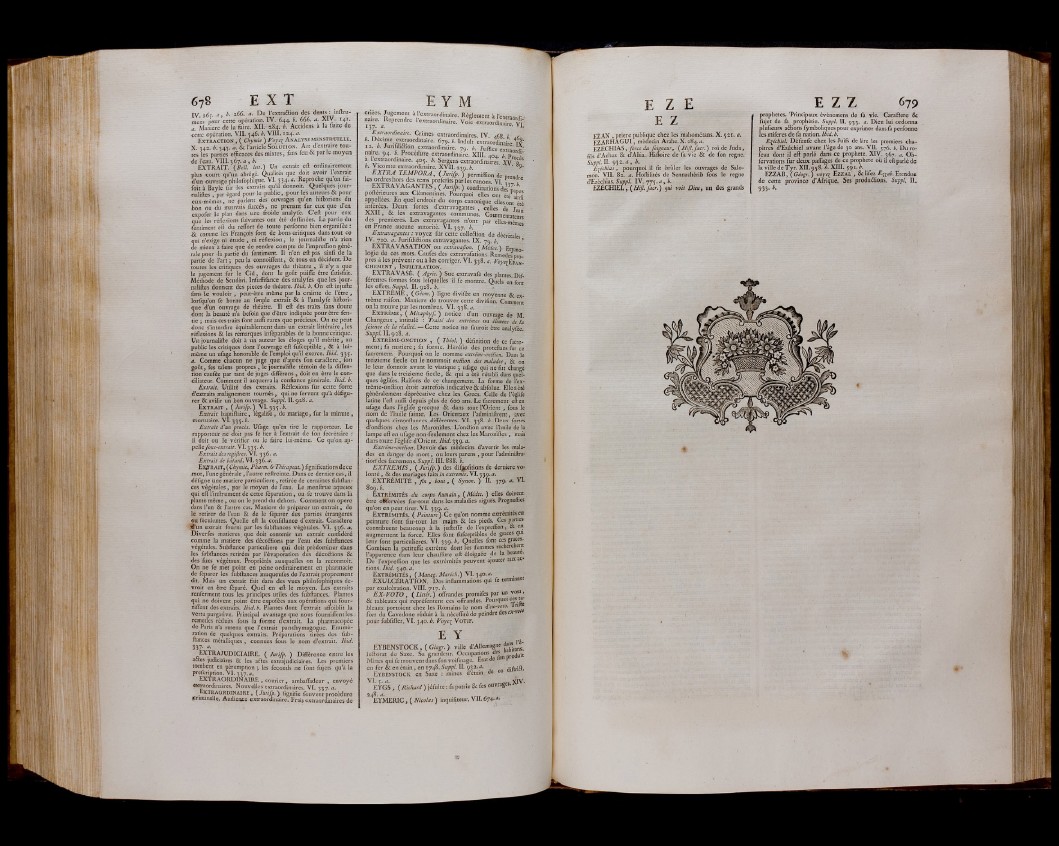
6 7 8 E X T
IV. î 6<. a » b. 266. a. De l’extraûlon des dents : inftru-
jnens pour’cette opération. IV. 644. b. 666. a. XIV. 141.
a. Manière de la faire. XII. 284. b. Accidens à la fuite de
cette opération. VII. 546. b. VIII. 124. a.
E x t r a c t i o n , ( Cnymie ) Voyc% A n a l y s e m e n s t r u e l l e .
X. 342. b. 343. a. 8c l’article S o l u t i o n . Art d’extraire toutes
les parties efficaces des mixtes, fans feu 8c parle moyen
de l’eau. VIII. 367. a , b. .
EXTRAIT. ( Bell, lett.) Un extrait eft ordinairement
plus court qu’un abrégé. Qualités que doit avoir ^extrait
d’un ouvrage philofophique. VI. 334' a- Reproche quon fat-
foit à Bayle fur les extraits qu’il donnoit. Quelques jour-
•naliftes , par égard pour le public, pour les auteurs & pour
eux-mêmes, ne parlent des ouvrages qu’en hiftoriens du
bon ou du mauvais /uccès, ne prenant fur eux que d’en
expofer le plan dans une froide analyfe. C’eft pour eux
que les réflexions fuivantes ont été deftinées. La partie du
•fentiment eft du refTort de toute perfonne bien organifée :
8c comme les François font de bons critiques dans tout ce
qui n’exige ni étude , ni réflexion, le journalifte n’a rien
de mieux à faire que de rendre compte ae Timpreffion générale
pour dk partie du fentiment. Il n’en eft pas ainfi de la
partie de l’art ; peu la connoiffent, 8c tous en décident. De
toutes les critiques des ouvrages du théâtre , il n’y a que
le jugement fur le Cid, dont le goût puifle être fatisrait.
Méthode de Scudéri. Infuffifance des analyfes que. les jour-
naliftes donnent des pièces de théâtre. Ibid. b. On eft injufte
fans le vouloir , peut-être même par la crainte de l’être,
lorfqu’on fe borne au fimple extrait & à l’analyfe hiftori-
que d’un ouvrage de théâtre. Il eft des traits fans doute
dont la beauté n’a befoin que d’être indiquée pour être fende
; mais ces traits font auffi rares que précieux. On ne peut
donc s’interdire équitablement dans un extrait littéraire, les
réflexions 8c les remarques inféparables de la bonne critique.
Un journalifte doit à un auteur les éloges qu’il mérite, au
public les critiques dont l’ouvrage eft fufceptible, 8c à lui-
même un ufage honorable de l’emploi qu’il exerce. Ibid. 333.
a. Comme chacun ne juge que d’après fon caraélere, fon
goût, fes talens propres , le journalifte témoin de la diffen-
tion caufée par tant de juges différens , doit en être le conciliateur.
Comment il acquerra la confiance générale. Ibid. b.
Entrait. Utilité des extraits. Réflexions fur cette forte
d'extraits malignement tournés, qui ne fervent qu’à défigurer
8c avilir un bon ouvrage. Suppl. IL 928. a.
Ex t r a i t , ( Jurifp.) V I .333.b.
Extrait baptiftaire, légalité , de mariage, fur la minute,
mortuaire. VI. 333.b.
Extrait d’un procès. Ufage qu’en tire le rapporteur. Le
•rapporteur ne doit pas fe fier à l’extrait de fon fccrétaire :
il doit ou le vérifier ou le faire lui-même. Ce qu’on appelle
fous-extrait. VI. 333. b.
Extrait des regiflres. VI. 336. a.
Extrait de batard. V-1. 33 6. a.
E x t r a i t , ( Chymie, Pharm. &• Thirapeut. ) fignifications de ce
■mot, l’une générale, l’autre reftreinte. Dans ce dernier cas, il
défigne une maticre particulière, retirée de certaines fubftan-
ces végétales, par le moyen de l’eau. Le menftrue aqueux
qui eft l’inftrument de cette féparation, ou fe trouve dans la
plante même, ou on le prend du dehors. Comment on opere
dans l’un 8c l’autre cas. Maniéré de préparer un extrait, de
le retirer de l’eau 8c de le féparer des parties étrangères
ou féculentes. Quelle eft la confiftance d extrait. Caraaere
JO’un extrait fourni par les fubftances végétales. VI. 336. a.
Diverfes matières. que doit contenir un extrait confidéré
comme la matière des décoâions par l’eau des fubftances
végétales. Subftance particulière qui doit prédominer dans
les fubftances retirées par l’évaporation des décodions 8c
des fucs végétaux. Propriétés auxquelles on la reconnoît.
On ne fe met point en peine ordinairement en pharmacie
de féparer les fubftances muqueufes de l’extrait proprement
dit. Mais un extrait fait dans des vues philofophiqufcs devrait
en être féparé. Quel en eft le moyen. Les extraits
renferment tous les principes utiles des fubftances. Plantes
qui ne doivent point être expofées aux opérations qui four-
niflent des extraits. Ibid. b. Plantes dont 1 extrait affaiblit la
vertu purgative. Principal avantage que nous fourniflent les
remedes réduits fous la forme crextrait. La pharmacopée
de-Paris n’a retenu que l’extrait panchymagogue. Enumération
de quelques extraits. Préparations tirées des fub-
ftanccs métalliques, connues fous le nom d’extrait. Ibid.
337- a.
EXTRA JUDICIAIRE. ( Jurifp. ) Différence entre les
actes judiciaires 8c les aftes extrajudiciaires. Les premiers
tombent en péremption ; les féconds ne font fujets qu’à la
prefeription. VI. 3 37. a.
EXTRAORDINAIRE, courier, ambafladeur , envoyé
extraordinaires. Nouvelles extraordinaires. VI. 337. a.
E x t r a o r d i n a i r e , (Jurifp.) lignifie fouventprocédure
rnnuncllc. Audience extraordinaire. Frais extraordinaires de
E Y M
criées. Jugement à l’extraordinaire. Règlement b l'ennonr -
I u. P lei‘,ra°rdina"°- Voie extraordinaire. v£
Extraordinaire. Crimes extraordinaires. IV. .68 i
1*. g Jurifdiâionextraordinaire. 79. b. Juffice extra«Ji
naire. 94. b. Procédure extraordinaire. XIII. 404 A p i *
.a 1 extraordinaire. 403. b. Sergens extraordinaires. XV ?
b. Vicomte extraordinaire. XVII. 239. b. ”9*
EXTRA TEMPORA y | Jurifp. ) permiflion de prendre
i É » ! des tems preferits par les canons. VI , , 11 .
EXTOAVAGANTES, ( Jurifp. ) conftitutions des
pofténeures aux Clémentines. Pourquoi elles ont été ainf
appellées. En quel endroit du corps canonique elles ont éti
inférées. Deux fortes d’extravagantes , celles de Jean
X X I I , 8c les extravagantes communes. Commentateurs
des premières. Les extravagantes n’ont par elles-mêmes
en France aucune autorité. VI. 337. b.
Extravagantes : voyez für cette colleâion de décrétais
IV. 720. a. Jurifdiâions extravagantes. IX. 70. b. *
EXTRAVASATION ou extravafion. (Médec.) Etymologie
de ces mots. Caufes des extravafations. Remedes propres
a les prévenir ou à les corriger. VI. 338. a. JWrBranchement
, In f ilt r a t io n . v
EXTRAVASÉ. ( Agric. ) Suc extravafé des plantes. Différentes
formes fous iefquelles il fe montre. Quels en font
les effets. Suppl. II. 928. b.
EXTRÊME, ( Géom.| ligne divifée en moyenne 8c extrême
raifon. Maniéré de trouver cette divifion. Comment
onia trouve par les nombres. VI. 338. a.
E x t r ê m e , ( Métaphyf. ) notice ; d’un ouvrage de M.
Changcux, intitulé : Traité des extrêmes ou élémens de la
fcience de la réalité. — Cette notice ne fauroit être analyse.
Suppl. II. 928. a.
E x t r ê m e -o n c t i o n , ( Théol. ) définition de ce facre-
ment; fa matière j fa forme. Héréfie des proteftans fur ce
facrementx Pourquoi on le nomme extrême-onilion. Dans le
treizième fiecle on le nommoit onilion des malades 8c on
le leur donnoit avant le viatique ; ufage qui ne fut changé
que dans le treizième fiecle, oc. qui a été rétabli dans quelques
églifes. Raifons de ce changement. La forme de l’ex-
tréme-onâion étoit autrefois indicative 8c abfolue. Elle a été
généralement déprécative chez les Grecs. Celle de l’églife
latine l’eft auffi depuis plus de 600 ans. Le facremcnt eften
ufage dans l’églife grecque 8c dans tout l’Orient, fous le
nom de l’huile fainte. Les Orientaux l’adminiftrent, avec
quelques circonftances différentes. VI. 338. b. Deux fortes
d’onêtions chez les Maroniftes. L’onâion avec l’huile de la
lampe eft en ufage non-feulement chez les Maroniftes , mais
dans toute l’églifa d’Orient. Ibid. 339. a.
Extrême-onilion. Devoir des médecins d’avertir les malades
en danger de mort, ou leurs parens , pour l’adminiftra*
' tiorf des facreinens. Suppl. III. 888. b.
EXTREMIS, ( Jurifp. ) des diij£>fitions de derniore volonté
, 8c des mariages faits/n extremis. VI. 339.a.
EXTRÉMITÉ , fin , bout, ( Synon. ) II. 379; *. VI.
800. b.
E x t r é m i t é s du corps humain, (Médec. ) elles doivent
être oÉervécs fur-tout dans les maladies aiguës. Prognoftics
qu’on en peut tirer. VI. 339. a.
E x t r é m i t é s . ( Peinture ) Ce qu’on nomme extrémités, en
peinture font fur-tout les mains 8c les pieds. Ces parties
contribuent beaucoup à la juftefle de l’expreffion, & en
augmentent la force. Elles font fufceptibles de grâces qui
leur font particulières. VI. 339. b. Quelles font ces 8r*ces'
Combien la petitefle extrême dont les femmes rechercnen
l’apparence dans leur chauflure eft éloignée de la beaut .
De l’expreffion que les extrémités peuvent ajouter aux a -
tions. Ibid. 340. a.
E x t r é m i t é s , (Maneg. Marêch.) V I .340.a.
EXULCÉRATION. Des inflammations qui fe terminent
par exulcération. VIII. 717. b.
EX-VOTO, ( L'utér. ) offrandes promifes par un voeu,
8c tableaux qui repréfentent ces offrandes. Pourquoi ces *
bleaux portoient chez les Romains le nom d’ex-voto. 1 r*
fort du Cavedone réduit à la néccffité de peindre des ex-v
pour fubfifter. VI. 340. b. Voyc{ V o t i f .
E Y
EYBENSTOCK, ( Géogr. ) ville d’Allemagne• cdwan»s l’éleâorat
de Saxe. Sa grandeur. Occupations des r0(juit
Mines qui fe trouvent dans fon voifinage. Etat de Y
en fer 8c en étain, en 1748. Suppl. II. 932\a‘ . ' diftriâ.
E y b e n s t o c i c en Saxe : mines d étain
* E Î l 3S S ( Richard ) jéfuitc : fa patrie & fes ouvrages. XIV-
248.
EYMERIC , ( Nicolas ) inquifiteur, VII. 674-•'•
E Z E E Z Z 679
E Z
EZAN , prière publique chez les mahométans. X. 321. a.
EZARHAGUI, médecin Arabe. X. 284.a.
EZECHIAS, force du feieneur, ( Hifl. facr. ) roi de Juda ,
fils d’Achaz 8c d’Abia. Hiftoire de fa vie 8c de fon regne.
Suppl. H-9î 2‘ a > b.
¿¡¿chias, pourquoi-il fit brûler les ouvrages de Salomon.
VII. 82. a. Hoftilités de Sennachérib fous le regne
tFEzéchias. Suppl. IV. 773. a , b.
EZÉCHIEL t (Hifl.facr.) qui voit Dieu, un des grands
prophètes. 'Principaux êvénemens de fa vie. Caraâere 8c
fujet de fa prophétie. Suppl. II. 933. a. Dieu lui ordonna
plufieurs aâions fymboliques pour exprimer dans fa perfonne
les miferes de fa nation. Ibid. b.
Eçéchiel. Défenfe chez les Juifs de lire les premiers chapitres
d’Ezéchiel avant l’âge de 30 ans. VII. 376. b. Du ro-
feau dont il eft parlé dans ce prophète. XIV. 267. a. Obfervations
fur deux partages de ce prophète où il eft parlé de
la ville de Tyr. XII. 038 . b. XIII. 3<)i. b.
EZZAB, ( Géogr. ) voyeç Ez z a l , 8c lifez E^ab. Etendu*
de cette province d’Afrique, Ses produirions, Suppl, IL
933. g