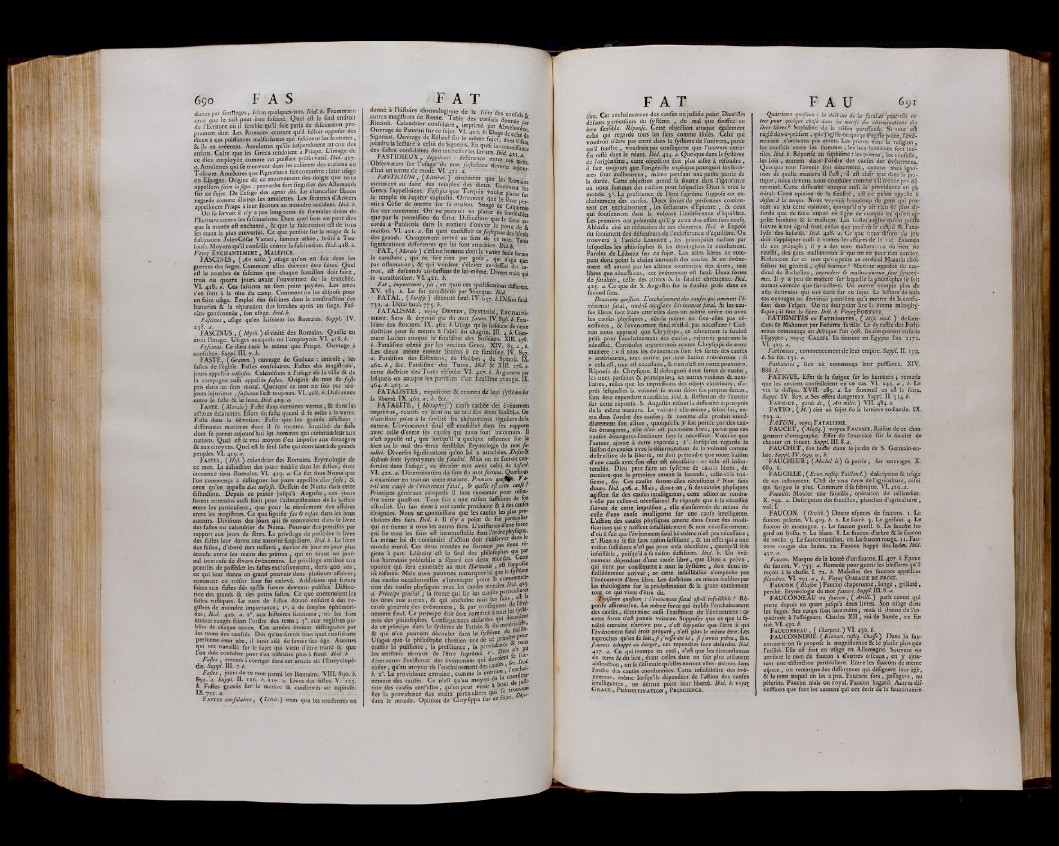
690 F A S
dîmes par forttfeges, félon quelques-uns. Ibid.'b. Frommann
croit que le tatt peut être fafeiné. Quel eft le foui endroit
de l’Ecriture où il fomblc qu’il foit parlé de fafeination proprement
dite. Les Romains crurent qu’il falloir oppofer des
dieux à ces puiifances malfaifantes qui fafeinent les nommes,
& ils en créèrent. Amulettes qu’ils fufpendoicnt au cou des
enfans. Culte que les Grecs rendoient à Priape. L image de
ce dieu employée comme un puiffant préfervattr. lbid. 417.
a. Amulettes qui fe trouvent dans les cabinets des-curieux en
Tofcane. Amulettes que Pignorius a fait connoîtrc «.leur ufage
en Efpagnc. Origine de ce mouvement des doigts que nous
appelions faire la figue : proverbe fort fineulier des Allemands
fur ce fujet. De L’ufage des agnus dei. Le chancelier Bacon
regarde comme illicites les, amulettes. Les femmes d’Anvers
appelaient Priape à leur focoursaw moindre accident, lbid. b.
On fe fer voit il n’y a pas long-tems de formules tirées de
l’Ecriture contre les tafeinations. Dans quel fens on oeuf dire
que le monde eft enchanté,8c que la fafeination eft de tous
les maux le plus univerfel. Ce que penfoit fur la magie & la
fafeination Jules-Céfar Vanini, fameux athée, brûlé à Tou-
louie. Moyens qu’il confeille contre la fafeination. lbid.-4*8. a.
Voye1 E n c h a n t e m e n t , M a l é f i c e .
FASCINES, ( Art milit. ) ufage qu’on en fait dans les
guerres des iieges. Comment elles doivent être faites. Quel
eft le nombre de fafeines que chaque bataillon doit faire ,
trois ou quatre jours avant l’ouverture de > la tranchée.
VI. 4x8. a. Ces fafeines ne font point payées. Les amas
s’en font à la tète du camp. Comment on les difpofe pour
en faire ufage. Emploi des fafeines dans la conftruélion’des
batteries 6c la réparation des breches après un fiege. Faf-
cine goudronnée , fon ufage. lbid. b.
Fafeines, ufage qu’en fliifoient les Romains. SuppLflV.
¿3 8.'a. y
FASCINUS , ( Myth. ).divinité des Romains. Quelle en
¿toit l’image. Ufagcs auxquels on l’emplovoit. VI. 418. b.
Fajcinus. Ce dieu étoit le même que Priape. Ouvrage à
confultcr. SuppLlll. y./é.
FASTE, (Gramm.) ouvrage de Godeau : intitulé , les
faftes de l’églife. Faftes confulaires. Faftes des magiftrats*,
jours appelles néfaflés. Calendriers à l’ufage dé la vifie & de
la campagne auffi appellés fa fies. Origine du mot dcfqfte
pris dans un fens moral. Quoique ce mot ne-foit pas toujours
injurieux t faftueux l’eu toujours. VI. 4*8. ¿.-Dmérence
entre le fafte 8c le luxe. lbid. 41.91 a.
Faste. {Morale) Fafte dans-certaines vertus,•& daWSÎés
ailions éclatantes. Effets du fafte quand il fe mêle k la Vcfttt.
Fafte dans .la dévotion. Fafle que les grands -afFeâeur :
différentes maniérés dont il fe montre. Inutilité' du1 fàftc
dont fe parent aujourd’hui lçs hommes qui commandent aux
nations. Quel eft le vrai moyen d’en impofer aux étrangers
& aux citoyens. Quel eft le feul fafte qui convicnrà de grands
peuples. VI. 419. a.
F a s t e s , ( Hift. ) calendrier des Romains. Etymologie de
ce mot. La diftinélion des ioiirs établie dans les faftes ; ¿toit
inconnue fous Romulus. VI. 419; a. Ce fut fous Numa que
l’on commença à diftinguer. les Jours appellés dits fafii, 8c
ceux qu’on appella dus nefafli. Deffcin de Numa dans cette
diftinâion. Depuis ce prince jufqu’à Augufte, ccs jours
furent entendus auffi bien pour l’aaminiftration de la juftice
entre les particuliers, que pour le. maniement des affaires
entre les magiftrats. Ce quefignifie fasbnefàs dans les bons
auteurs. Divifions des jours qui fe trouvoient dans'le livre
des faftes ou calendrier de Numa. Pouvoir des pontifes par
rapport aux jours de fêtes. Le privilège de poflédér' le livre
des faftes leur donna une autorité finguüere. lbid. b. Le livre
des faftes, d’abord fort relier ré , devint de jour en jour plus
étendu entre les mains des prêtres , qui en firent un journal
immenfe de divers événemens. Le privilège attribué aux
pontifes de polfédcr les faftes exclufivement, dura 400 ans ,
ce qui leur donna un grand pouvoir dans plufieurs affaires ;
comment ce tréfor leur fut enlevé. Additions qui furent
faites aux faftes dés qu’ils furent devenue publics. Diftinc-
tion des grands & des petits faftes. Ce que contenoient les
faftes ruftiques. Le nom de fuftes donne enfuite à des re-
giftres de moindre importance; x". à de fimples éphéméri-
des; lbid. 420. a. 20. aux hiftoires fuccintes, où les faits
étoient rangés félon l’ordre des tems ; 30. aux tegiftres publics
de chaque année. Ces années étoient diftinguées par
les noms des confuls. Dès qu’op favoit fous quel conful une
perfonne étoit née, il étoit aifé de fa voir fon âge. Auteurs
qui ont travaillé fur le fujet qui vient d’étre- traité ÔC que
Ion doit confultcr pour s’en inftruire plus à fond. lbid. b
. ^aflcs » jjvcursà corriger dans cet-article de l’Encyclopédie.
OUppl. 111. J. b.
Faftes, jottrsde ce nom parmi les Romains. VIII. 890. b.
891. a. Suppl. II. 1x6. b.-117. a. Livre des faftes. V. 125.
¿.Faftes graves fur le marbre & confervés au capitole.
IX. 751. a.
F a s t e s confulaires, ( Liitér.) nom que. les modernes on
F A T
autres de Romi^'^blc'des confuu'do^"1^
Ricctoli. Calendrier confit aire , imprimé par Almïi
Ouvrage de Panvini fur ce fuje,. VI.
Stgomus. Ouvrage de Réland fur le même fnicr dont r i.
joindreda ieaure à celui deSigonius. En quoi la conuoin-,
des. faftes confulaires doit inrèrefferlesfavans / W ™ . “
FASTIDIEUX, dégoûtant : différence entre c a fiéX
Obfervation fur Tufage' du mot fupditux devenu
dliiui un terme de moefe. Vf. 421. à. sujour-
FASTICIUM, (¡tttérar.y ornement que'lès
menoient au faite des temples des dieux. GomlnenM
Grecs Pappelloientu Fàfttgia que Tarquin Voulut place,
le temple de Jupiter' Capitolih. Ornement que le ftnat u
mitèCéfar de mettre fur fa maifon, '.Songe de Cabi]
fur cet ornement.'On neipsov©« *»n WsswvjlîiI: /. .91e
l l l s £ ornement qiieVlès Romanis
xicnt les
lacer for
-nat perornement.'
On ne pouvoir eu placér de f em S Z
que paria permiffion du fénat; Diftinétion- que le f¿nat
corda, à-Publicóla dans la maniere d’ouvrir la porte de f
maifon. VI. 421. a. En quoi conftiloit cafaftigiumdzs hôtels
•des grands. Changement arrivé au fens' de ce mot. Trois
lignifications différentes qui lui font attachées. Ibïd.i.
FAT, ( Morale ) c’eft nn homme dont la vanité feule forme
le caraftere , qui ne 'fait rien par goût.', qui n’agit que
par oftcntntion; & qui Voplant s’élever aii-deffus des autres,
eft defeendù au-deffous de Ini-même. Divers trait«
-le caraéiérifenr. VI. .421. b. • - “ nqtu
Fat y impertinent y fû t , en quoi ces qualifications différent.
XV. 383. b. Le fat: çàraélérifé par Séneque. lbid.
FA TA L , ( Jurifp.) débouté fatal. 1V.'657. ¿.Défautfatal.
732. a. Délai'-fatal.-773. b. ,
FATALISME , voye[ D e s t in , D e s t in é e , E n c h a în e m
e n t . Séns & étymol gie du mot fatùrri. IV.'gcjô. b. Fata-
lifme des ftoi'ciens. IX. 462. ¿. Ufage qulls faifoient de cette
doftrine pour fe mettre-à l’abri'du chagrin. III. 4. b. Comment
Lucien attaqué le fatalifme des Stôîçiéns. XUI. ¿78.
¿.-Fatalifmc admis .par lès anciens Grecs. 'XIV. 8t. a , ¿.
-Les dieux même étoient fournis à ce fatalifmc. IV. 897.
a. Fatalisme des EffénienS,' de Hobbes , de Spinofa. IX.
462. ¿ , &c. Fatalifme des Turcs, lbid. 6c XÍII. 276. ^
cette doélrine des Turcs T^furée. VI. 427. b. Argumens par
léfquels; oh auaqtte les jfartîfaris d’un rataltffoe aveugle. M
464. b. 465. a.
FATALISTES, expôfitioff '8c examen de- leur fyftême fur
la liberté. IX. 462. a ,;¿. 8cc., .
FATALITÉ-, ( (ditaphÿp) çaufe cachée 'dés événemens
imprévus,-relatifs au- bion ou ait mal dés' êrreS'fÿnfiblcs.On
n’attribue point à la fatalité 'les phénomènés réguliers delà
nature; L’événement-fatal effeonfidéré dans les rapports
avec celle d’entre fçs chufes qui nous, font* inconnues. Il
n’eft appellé tel, que lorfqtt’il a quelque influence fur le
bien ou le mal des -’êtres lenfrbles. Etymologie 'du mot fa-
talité. Diverfes fignifiçations qu’on lui a attachées. DefiinSc
deftinle font fynonÿmes. de fatalité. Majs on ne fauroit confondre
dans l’ufage, ce dérnier mot avec celiii. de hafari.
VI. 422. a. -Détermination du fens du mot fortuné. Queftioas
à examiner en traitant cette matière. Première quefffi. Yfit
il une caufe de l’événement fatal, 6* quelle eft cette caufe r
Principes généraux auxquels il faut remonter pour réfoudre
cette queftion. Tout fait a une raifon fuffilante de fon
aâualité. Un fait tient à une caufe prochaine 8c à des caufes
éloignées. Nous ne çpnnoiffons que les caufes les plus prochaines
des faits, lbid. b. Il n’y a point de fait particulier
qui ne tienne à tous les autres faits. L’exiftence d une force
•qui lie tous les faits eft inconteftable dans l’ordre phynque.
La même loi de continuité .d’àélion doit s’obferver dans le
monde moral. Ces deux mondes ne forment pas deux r
gions à part. Léibnit? eft le feul des philofophes
ion harmonie préétablie a féparé ces deux mondes.
opinion qui fera examinée au mot Harmonie^, eft foPP°
ici réfutée. Mais nous pouvons remarqucriciquelefyuc®
des caufes ocçaftonnélles n’intercepte point la coaî!^jm1,
tion des caufes phyfiqucs avec les caufes morales./««-.4 r
•a. Principe génital ; la forme qui lie les caufes parucu ^
•les ânes aux autres, 8c qui enchaîne tous les *a,,s* »¿y*,
caufe générale des événemens, 8c par çorifêquent de . ^
nement fatal. Ce principe doit Être co ih tn u u .i tous les Y»
mes des philofopnes.' Conféqucnces abfurdcs qui etc0
de ce principe dans, le fyftême de l’athée,& du
8c qui n’en peuvent découler dans le fyftême j“H * pour
Ufagès que ‘le philofophc chrétien tire de ce prnict^ ‘tQü^
établir la ptliffance , la preféicncc, la providence u
les attributs moraux de l’être fuprênae. Io- çç fuC.
déterminer l’exiftcncc des événemens qui devoien WM0[t
céder, qu’au moyen de l ’enchaînement des
b. 20. La providence entraîne, comme la cr^ t,0fL*COordina-
nement des caufes. Ce n’eft qu’au moyen da ^
tion des caufes entr’elles, qu’on peut venir i ¡Mj -rouvent
fier la providence des m a u x particuliers qui » ¿ y (.
clans le monde. Opinion de Chtyfippe furceitj
F A T F A U 691
tion. Cet enchaînement des caufes ne juftifie point Dieu des
défauts particuliers du fyftême , du mal que.fouffre un
être fenfible. Réponfe. Cette objeéÜon attaque paiement
celui qui regarde tous les faits comme ifolés. Celui qui
voudroit n’être pas entré dans le fyftême de l’univers,- parce
qu’il fouffre , voudroit par conféquent que l’univers entier
fut refté dans le néant, lbid. 424. a. Quoique dans le fyftême
de l’ongénifme, cette objeétion foit plus aifée à réfoudre ,
il faut toujours que l’origénifte explique pourquoi les hommes
font malheureux, même pendant uns petite partie de
la durée. Cette .objeâion prend fa fource dans -'l’ignorance
où nous foipmes des raifons, pour lefquelles Dieu a créé le
monde.,30. La ,prefcience dp Pêtrc fuprême fuppofe cet enchaînement
des.caufes. Deux fortes de perfonnc9 combattent
cet enchaînement , les feflateurs d’Epicure , & ceux
qui foutiennent dans la volonté l’indifférence d’équilibre.
Les premiers ont prétendu qu’ij y avoit des effets, fans 'caufe.
Abbadie cité en réfutation ne ces chimeres. lbid. ¿1 Expofé
du fentiment ;des défenfevtrs dc 1-indiffércnce d’équilibre. On
trouvera a l’article L i b e r t é , les principales raifons par
lefquelles les philofophes & les théologiens le combattent.
Paroles de Léibnitz lùr ce fujet. Les aéles libres ne rompent
donc point la chaîne immenfe des caufes. Si un événement
eft amené par les ailions combinées des ¿êtres, tant
libres que néceffaires, cet événement eft fatal. Deux fortes
de fatalités , celle des athées 6c la fatalité chrétienne, lbid.
425. a. Ce que dit S. Auguftin fur la fatalité prife dans ce
fécond fens.
Deuxième queftion. Venchaînement des caufes qui amènent l'événement
fatal, rend-il nécejfa 'tre. l'événement fatal. Si ïos czu-
fes libres font liées- cntr’elles dans. un même ordre ou avec
les caufes .phyfiques, dès-là même ne font-elles pas né-
celîitées , 8c l’événement fatal n’eft-il . pas néceffaire ? .Cicé-
ron nous apprend que Cbryfippe, en admettant .la fotalité
prife pour renchainement-des caufes, rejettoit pourtant la
néceiüté. Carnêades argumenroit contre Chryftppe de cette
maniéré : «il tous les événemens font les fuites*dès caufes
» antérieures, tout arrive; par,une liaifon très-étroite : fi
» cela eft, tout eft néceffaire, 8c rien n’eft en notre pouvoir».
Réponfe de Chryftppe. U diftinguoit deux fortes de caufes-,
les unes parfaites 8c principales.; les autres vojfines &. auxiliaires
, telles que les imprefftons des objets extérieurs, d’après
lefquelles la volonté ; fe. meut félon fes. propres forces,
fans être cependant nécelfitée. lbid..h. Réflexion de l’auteur
fur cette réponfe. S. Auguftin réfout la .difficulté à-rpeu-prés
delà même maniéré. La volohté elle-même, félon.lui, entre
dans l’ordre des caufes ; :8c . comme elle produit immédiatement
fon aétion, quoiqu’elle ÿ foit.portée par des caufes
étrangères, elle n’en eft .pas-moins libre, parce que ces
caufes étrangères l’inclinent fans la néccffitcr. Voici ce que
l’auteur ajoute à cette réponfe ; x°. lorfqtt’on -regarde la
liaifon des caufes aveç la détermination de la volonté comme
deftruétive de la liberté, dn doit prétendre que toute liaifon
d’une caufe ayeç-fon effet eft néceffaire •: or cela eft infou-
tenable. Dieu peut faire un fyftême de cauics libres, de
maniéré que la première amene la fécondé, celle-ci là troi-
fteme, &c. Ces caufes feront-elles néceffttêes i Non fans
doute. lbid. 42J6. a. Mais, dira-t-on , ft des caufes phyfiques
agiffent fur des caufes intelligentes, cette aélion ne rendra-
t-elle pas celles-ci néceffaires? Je réponds que fi la néceffité
fuivoit de cette impulfion., elle s’enfuivroit de même de
celle d’une caufe intelligente fur une caufe intelligente.
L’aâion des caufes phyfiques amene dans l’ame des modifications
qui y naiffent infailliblement & non néccffairement:
d’où il fuit que l’événement fatal lui-même n’eft pas néceffaire ;
2°. Rien ne fe fitit fans raifon fuffifante, 8c un effet qui a une
raifon fuffifante n’eft pas pour cela néceffaire, quoiau’il foit
infaillible , puifqu’il a fa raifon fuffifante. lbid. ¿ .U n évé-
1 nement dépendant .d’une caufe libre , que Dieu a prévu ,
?ui tient par cooféquent à tout le fyftême , doit donc inailliblement
arriver ; or cette infaillibilité n’empêche pas
l’événement d’être libre. Les doârines es mieux établies par
les théologiens fur la prédeftination 8c la grâce confirment
tout ce qui vient d’être dit.
Troifieme queftion : l ’événement fatal eft-il infaillible ? Réponfe
affirmative. La même force qui établit l’enchaînement
des caufes, détermine auffi l’exifhsnce de l’événement : or
cette force n’eft jamais vaincue. Suppofer que ce que la fatalité
entraîne n’arrive pas, c’eft fuppofer que-l’être à qui
l’événement fatal étoit préparé, n’eft plus le même être. Les
reproches qu’on fè fait,y? j'eujfe été là y f i j ’avois prévu, 8tc.
j'aurois échappé au danger, ces reproches font abfnrdes. lbid.
427. a. Ce qui trompe en ceci, c’eft que les ¿¡rconftances
du tems 8c du lieu, étant celles dont on fait plus aifément
abftraâion, on fe diffimule qu’elles entrent elles * mêmes dans
l’ordre des caufes coordonnées. Cette infaillibilité des événemens,
même lorfqu’ils dépendent de l’aétion des caufes
intelligentes . ne détruit point leur liberté, lbid. b. voye{
G r â c e . , P r é d e s t in a t io n , P r e s c ie n c e .
Quatrième queftion i la do'flrine de la fatalité- ‘peut-elle entrer
pour quelque chofe dans les motifs des déterminations des
êtres libres? Sophifmfe'-de la raifon pareffeüfe. Si ‘tout eft
réglé.dés-à-préient, qde'j’âgiffe ou que je fPagTffe point H
neraerit n’arrivera pas nfôins. Les prières aàhS"ta 'religion,
-les confeils entre les Hommes, les loix liumaincs font inutiles.
lbid. b. Réponfe. au fophifme : les prières^-1 les confeils ,
.les loix , entrent danS-M’drdre des caufes'des événeruens.
Quoique tout l’avenir foit déterminé,, comme ribus .ignorons
de quelle maniere'il ieft^ -il eft.’clat’r qué daris'la pra-
-tique^> nous devons, nous1 conduire comme's’il'h-étéit'pas'déterminé;'
Cette difficulté -'attaquè auffi la' providence en général.
Cette opinion -dê la fatalité , eft ee’ qn’ori appelle /«
deftin à là tutque. Noüs vbyoiiS' beaùcoùp tlc gens qui portent*
au jeu cette opinion ; quoiqu’il n’y ait rid) 'dé plus ab-
ftirdé que de faire entrer en ligne de compte''ce■'(jd’oh, appelle
bonheur 8c le * malheur. Les feules1 règles' qu’on'ptiiffe
fuivre à cet ¿gai*d ‘fontj celles que preferh îe'dalt'iil & fahâ-
lyfe 'des• hafards. lbid. 428. dyCe que 'npùrdiforK'cfu jeu
.¡doit s’appliquer-auffi- à to’dtès les affajrcs-de la'vie.'’ Exàmen
de ces préjugés ; il y a des tems foalheurcux où Jrten ne
réùifif ,• des gens -malhènreux â '-qui onhé peut rien confier.
Réflexions fur ce mot qu’on prête au cardinal Mazarin ch'di-
ftffimt un-général fcft-il-Keiireux ? Maxime oppb'fee du cardinal
de Richelieu, imprudent & malheurçureuxt font fynohÿ-
mes. Il y a peu de matière fuF laquelle la phyôfophie'fe'foit
autant¡oxercée que fur célle-ci. Un auteur compte plus de
160-écrivains qui ont écrirfur ce fujet. La leaùre de tods
ces ouvrages ne fsrvirôit peut-être qu’à mettre de la èôrifü-
fion dans l’cfpxit. On ne aoitpoinr lire la bonne métaphÿ-
ftqùe : il faut la faire. lbM. b. FàyeçFoRTVîT. 1
FATHIMITES ou F a t h é m i t e s , ( ‘Hift. mod. ) defçen-
dans de Mahomet parFathima fit ‘fille. La dyrtaftié des FatHi-
mites Commença en Afrique l’an 908. Ils conquirent êtfftiife
TEgypte , voye\ C a l i f e . -Us ‘finirent en Egypte l’an 1171.
VL 429. a.
Fathimites, commencement de leur empireîSuppl. II. 130.
b. Sa fin. 131. a.
Fathimites , heu -où commença leur pùiffancè. XIV. 888. ¿.
FATIGUE. Effet de la fatigue fur les humeurs ; remede
que les anciens confeilloiènt en ce cas. VI. 245. a y b. Le
vin la difftpe. XVII. 289. a. Le fommeil en eft la fuite*
Suppl. IV1. 807. «.Ses effets dangereux. Suppl. II. 314.b.
F à -t i g u e , garde de, { Art milit. ) VII. 484.a.
-FATIO, ( M.) cité au fujet de la lumière zodiacale. IX.
723. a.
FATUM y voye{ F a t a l i s m e .
FAUCET, \Mufiq.) voyez FAUSSET. Raifon de ce changement
d’ortographe. Effet de l’exercice 'fur la faculté de
chanter en faucet. Suppl. III. 8. a.
FAUCHET, fon bufte dans le jardin de S. Gcrmain-en-
laie. Suppl. I V. 699. a y b.
FAUCHEUR ; ( Michel le) fa patrie , fes ouvrages. X.
689. b.
FAUCILLE, ( Econ. ruftiq. Tailland. ) dèfcription 8c ufage
de cet infiniment. C’eft de tous'ceux de l’agriculture, celai
qui fatigue le plus. Comment il fe fabrique. VI. 429. a.
Faucille. Mouler une faucille, opération du taillandier.
X. 702. a. Dèfcription des faucilles, planches d’agriculture ,
vol. 1.
FAUCON. {Ornith.) Douze efpeces de faucons. 1. Le
faucon pèlerin. VL 429. b. 2. Le facré. 3. Le gérfaut. 4. Le
faucon de montagne, ç. Le faucon gentil. 6. Le faucôn hagard
ou boffu. 7. Le blanc. 8. Le faucon d’arbre 8t le faucon
de roche. 9. Le faucon tunifien. 10. Le faucon rouge. 11. Faucons
rouges des Indes. 12. Faucon huppé des Indfs. lbid.
430. a.
Faucon. Marque de la bonté d’un faucon. II. 407. b. Epave
du faucon. V. 775. a. Remede pour guérir les bleffüres qu’il
reçoit à la chaffe. I. 72. b. Maladies des faucons appellées
filandres. VI. 791.«, b. Poyrç OlSEAUX DE FRÔIE.
F a u c o n . {Élafon ) Faucon chaperonné , longé , grilleté,
perché. Etymologie au mot faucon. Suppl. III. 8.a.
FAUCONNEAU ou faucon, ( Artill. ) petit canon qpi
porte depuis un quart jufqu’à deux livfres. Son ufage dans
les fteges. Ses coups font incertains ; mais il donne de'l’in-
quiétude à l’affiégeant. Charles X I I , roi de Suede, en fût
tué. VI. 430. b.
F a u c o n n e a u , ( Charpent. ) VI. 430. b.
FAUCONNERIE. ( Econom. ruftiq. Chaffe) Dans la fauconnerie
on fe propoie la magnificence 8c lé plaifir plus que
l’utiliré. Elle eft fort en ufage en Allemagne. Souvent on
attribue le nom de faucon à d’autres oifeaux, en y ajoutant
une dirtinélion particulière. ‘Entre les faucons de même
efpece, on remarque des différences qui défignent leur âge,
& le {cms auquel on les a pris. Faucons fors, pàffagers, qu
pèlerins. Faucon niais ou royal. Faucon hagatfd. Autres dtf-
tinétions que font les auteurs qui ont écrit de là fauconnerie.