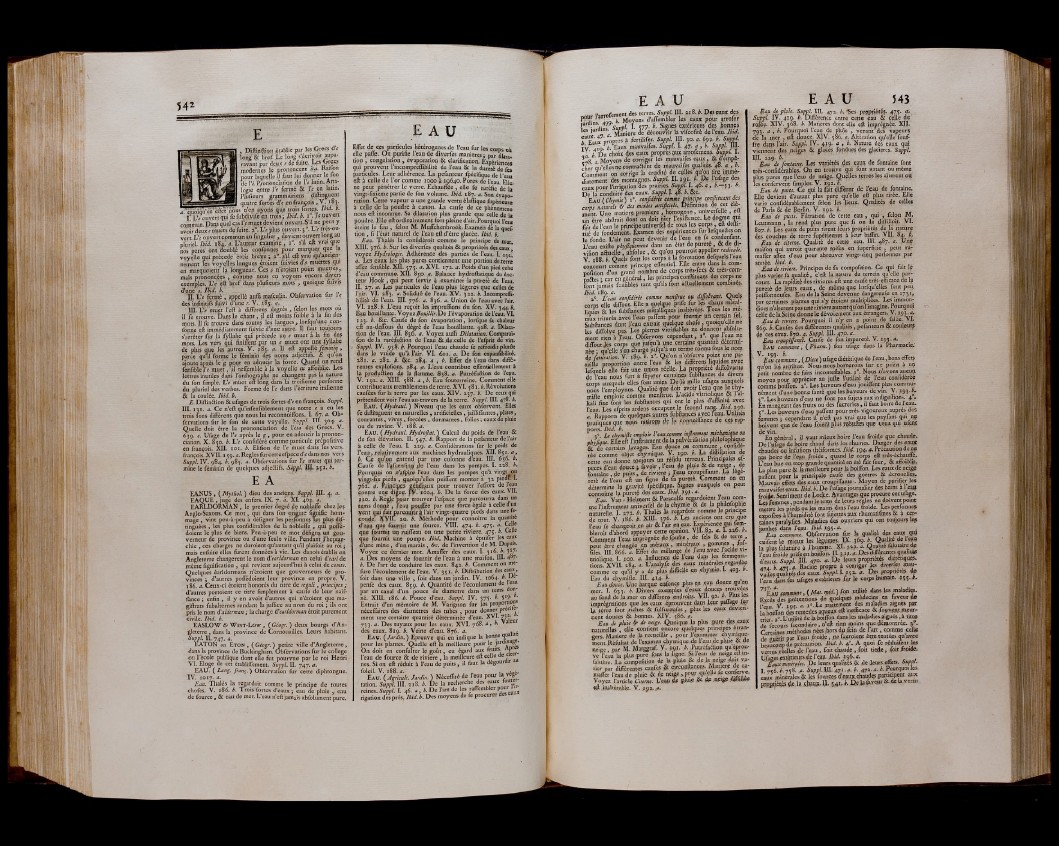
5 4 2
, Diffingiqii ¿fabjic par les G « « ffii
long"® w d |fe long sïcriyçtK ?upa-
ràvant p/ir djSjX 1 dp fuite. Lps Grife?
modernes lç prononcent ife- Railon
pour laquelle ij faut fui dppiVfe K
de u . Pfononçiation de J e fatip. Analogie
entre l'e fariné & f’ffej1 latin.
Plufieurs grammairiens djfffogueot
qu?trè fofoçs aV>nfranc9i5,V. i$î.
^auoïaù’en'cftet pous A M m . quetrois forte?, lbid. b.
1 LVoûyertqui fe fobdiyife en trpisj fbid.ft. i .¿eppverr
commun! DaqS quel c^slVmpetifleyicnt puyçrç.$’Une pseut y
avoir deux« mupts dç fuitp! f°. LVpfe? T O P 30. L f tfo?-ou-
vert. LV ouvert commun au ffpgylfer, çfeyfent ouyeri long au
pluriel. Ilftd. \%a. «.'paitfjspr jexanjine , j°. s’jl fift vfoi que
nos peres ónt doublé les cpqfpnoe? pour ma^quef.^ qife fe
voyelle qui précédé étçijc feeye ; p.0. s’il eff vrai qifancfejn-
neippnt les voyelles lppguçs ÍK>ietn fùiyies ,4V, muettes qui
en màrquoi^nt là longueur. Ces ¡£ n’étgippt pofet qiyçtfe?,
mais prononces , ,comme nous eq yçyoqs encore feyçrs
exemples. L’e <$ bref daps plufieurs pfot? , quoique fuivis
d’un? s. Ibid. b. * J . e „
j}. L’e fermé , apellé aufli m^çplin. .Obfervatipn fof l f
des infmitits fuivi q une r. V. 185; 4.
III. l?e muet fe f tà différent degtès , febn les nwts pu
il te trbùyé.' Dap? le cjiant g jl ( 4 moins foibfe à fe fin des
mots. H fe trouve dans toutes íes fungues , lçrfqu’une fepnfopÿf’efk
feiwtédfefoment iBfif&i ii ^*-ut ^ W “ 1?
s’/rréter fùf ïà fyllabe qpi prlécede pç ç muet à. la no des
mots. Les yers qui finiflént par un e ipuet çnr nnçfylfebe
de plijs que les autres. V . f8s. ¡fe 11 eft apbeüéfífnúiúf,
páj-ce .qu il ferme U féminin ejej npms adjeâifs. E qu on
ajoute après le g jooür en adpucjr li force. Quand on fond
fepfiblefe mifei >f2 folfemble à la yoiÿ.ellé cu ÿffoiblfe. Les
lettres inutifes dans fô ffiograflMtfíe changent pas fe nature
du fon fimplé. LY'mùet eft long dans la troilîeme perfonne
du pluriel des verbes. Forme de l’e dans l’écriture italienne
& la coulée, lbid. b.
E. Diftinétion & ufages de trois fortes d’e en françois. Suppl.
III. 131. a. Ce n’eft qu’infenfiblement que notre e a eu les
trois fons différons que nous lui reconnoiffons. I. 67. a. Ob-
fervations fur le ion de cette voyelle. Suppl. III. 304. a.
Quelle doit être la prononciation de 1'¿ta des Grecs. V.
639. c. Ufage de l’e après le g , pour en adoucir la prononciation.
X. 850. b. LV confidéré comme particule préppfitive
en françois. XII. 101. b. Elifion de IV muet dans les vers.
françois.XVII.tçç./J.ReglesfurcetteefpecedVdansnos vers
Suapl. IV. 984. b. 985. a. Obferyations fur Yç muet qui termine
le féminin de quelques adjeélifs. Suppl. 111. 251. b.
E A
ÉANUS , ( Mythol. ) dieu des anciens. Syppf. jQI. a.
EAQUE, juee des enfers. IX. 7. a. XI. 462. a.
EARLDORMAN , le premier degré dç noblcffe chez
Anglo-Saxons. Ce mot, qui dans fon- origine lignifie hommage
, vint peu-à-peu à aéftgner les personnes Tes plus çlif-
tinguées, les plus confidérables de la fiobleffe f qui pçffé-
doient le plus de biens. Pcu-à-peu ce mot .défign^ un gouverneur
de province ou d’une feule ville. Pendant J’heptju’-
chie, ces charges ne duroient qu’autant qu’il plaifoit au roi j
mais enfuite elles furent données à vie. Les danois établis en
Angleterre changèrent le nom d'earldorman en celui d'earl de
même fignification , qui revient aujourd’hui à celui de comte.
Quelques éarldormans n’étoient que gouverneurs de provinces
; d’autres, poffédoient leur province en propre. V,
186. a. Ceux-ci étoient honorés du titre de reguli, principes ¡
d’autres portoient ce titre ftmplement à caufe de leur naif-
fance ; enfin , il y en avoit' d’autres qui n’étoient que ma-
gifirats fubalternes rendant la juftice au nom du roi ; ils ont
pris le nom d'aider man ¡ la charge d’earldorman étoit purement
civile. Ibid. b.
EASLOW 6* West-Low , (Géogr. ) deux bourgs d’Angleterre
, dans la province de Cornouailles. Leurs nabitans.
. Suppl. II. 747. a.
EATON ou Eton , (Géogr.) petite ville d’Angleterre
dans la province de Buckineham. Obfervations fur le collegi
•ou l'école publique dont eue fut pourvue par le roi Henri
VI. Eloge de cet établiffement. Suppl. II. 747. a.
EAU7 ( Lang. franç. ) Obfcrvation fur cette diphtongue.
IV. 1017. a.
Eau. Thalès la regardoit comme le principe de toutes
-chofes. V. 186. b. Trois fortes d’eaux ; eau de pluie ,, eau
de fource, & eau de mer. L’eau n’eft jamais abfolument pure.
E A U
Effet de ces particules hétérogènes de l’eau fur les corps où
elle paflp. Qn purifie 1 eau d,C dlv^rfes manier.es j par fikra-
tjop , copgelarion, évaporation èç clarification! Expériences
qui jprpuyent 1 incomprefiibilité de l’eau & la duretiè de fes
particules. Leur atjhéren.ce. La pefapteur fpécifique de l ’eau
eft ^ cpllp de l’or comme iooo à 10640. Pores de l’eau. Elle,
ne peut pénétrer l,e yerre. Echauffée , elle fe raréfie de la
vingt-fixicme partie de fon volume. Ibid. 187. a. Son éyapo-
ration. Cette vapeur a une grande vertu élaftique fupérieure
à celle de la poudre à canon. La caufe de ce phénomène
nous eft inconnue. Sa dilatation plus grande que celle de la
poudre. Elle eft ordinairement fort pleine d’air .Pourquoi l’eau
éteint le feu , félon M. Muffchenbroek. Examen de laquef-
tion t fi l’étàt naturel de l’eau eft d’être glacée. Ibid. b.
Eau. Thalès la confiaétoit comme le principe de tout.
XIII. 370. b. Sur les diverfes qualités & propriétés des eaux
voyez Hydrologie. Adhérence des parties de l’eau. L 132.
a. Les eaux fes plus pures contiennent une portion de.terre
affez fenfiblç. XII. 575. a. XVI. 172. a. Poids d’un pied cube
d’eau commune. XII. 8<o. 4. Balance hydeoftatique du docteur
Hook t qui peut ieryir k examiner la pureté de l’eau.
II. 27. a. Les particules de l’eau plus légères que celles de
l’rir. VI. 293. a. Solidité de l’eau. XV. 322. b. Incomprefli-
bilité de Peau. III. 776. a. 836. a. Union de l’eau avec l’air.
VI. 128. b. L’eau reçoit les jmpreifions du ion. XV. 344. b.
Eau bouillante. Voyez Poufllir.De l’évaporation de l’eau. VI.
^23. b. 8cc. Caufe de fon évaporation, lorfque fa chaleur
eft au-de/foUS du çfegré de l’eau houillante. 928. a. Dilata*
tion de l’eau. IJI. 836. a. Voyez aufii Dilatation. Comparai*
fen de la foréfa^iou de l’eau & de .celle de l’eferit de vin.
Suppl. IV. 938. b. Pourquoi l’eau chaude iè refroidit plutôt
dans fe vuidc qu’à l’air. VI. 601. a. De fon expanubilité.
281. a. 282. b. &c. 284. a , b. Effet de l’eau dans, différentes
cxnlofions. 284. a. L’eau contribue effendellement à
la prqdunion de la fiamme. 838..a. Putréfaâion de l’e?u.
V. 192. a. XIII. ç88.. a , b. Eau fouterreine. Comment elle
contribue aux tremblemens de terre. XVI. 581. ¿.Révolutions
caufées fur la terre par les eaux. XIV. 237. b. De ceux qui
prétendent voir l’eau au-travers de la terre. Suppl. III. 478. b.
Eau. ( Hydraul. ) Niveau que les eaux obfervent. .’Elles
fe distinguent en naturelles, artificielles, iailliffantes, pliâtes,
courantes, vives, forcées, 'dormantes, folles ; eaux dis pluie
ou de ravine. V. 188. a.
Eau. (Hydraul. Hydrofiat.) Calcul du'poids de l’eau &
de fon élévation. II. 547. b. Rapport de la pefanteur de l’air
à celle de l’eau. I. 229. a. Confidérations fur le poids de
l’eau, folatjvemcm aux machines hydrauliques. XII. 8çi. <*»
b. Ce qu’on entend par une colonne deau. III. 656. b.
Caufe de rqfçenfio^'fie l’eau dans les pompes. I. 228. b.
Pourquoi on n^fpirel’eau dans les pompes qu’à vingtou
yjpgtrfix pieds , quoiqu’elles puiffent monter à 32 piedlrl.
762. 4. yrfecipes généraux pour trouver l’effort de l’eau
contre uqjç digue, py. 1004. b. De la force des eaux. VIL
ffO. b. Règle p i r trouver l’efpace que parcourra dans un
tepis donné ', Jfeaq poufiec par une force égale à celle d’un
yent qui fait parcqüxir à l’air vingt-quatre pieds dans une féconde.
XY“ - 2Q. b. Méthode pour connoître la quantité
d’c?q qué fournit une fource. VIII. 474. b. 473. a. Celle
qiie fourni^ ûq ruiffeau ou une petite riviere. 473. b. Celle 3ue fournit une pompe. Ibid. Machine à épuifer les eaux
’qne mine, d’un marais, &c. de l’invention de M. Dupuis.
Voyez ce dernier mot. Amaffer des eaux. I. 316. b. 3*7-
a. Des moyens de fournir de l’eau à une maifon. lu. 4^7•
b. De l’art de conduire les eaux. 842. b. Comment on me-
fure l’écoulement de l’eau. V. 331. b. Diftribution des caH^’
foit dans une ville , foit dans un jardin. IV. 1064.
penfe des eaux. 839. b. Quantité de l’écoulement de leau
par un canal d’un pouce de diametre dans un tems donné.
XIII. 186. b. Pouce d’eau. Suppl. IV. J73. b. 31?- *
Extrait d’un mémoire de M. Varignon fur les proportions
néceffaires des diamètres des tubes , pour donner préci (
ment une certaine quantité déterminée d’eau. XVI. 732- *
K i n M tuvanv nniir îlM An.733. a. Des tuyaux pour les eauixv . YXVVTI. 768. aa ., bb.. Valeur
des eaux. 819. b. Veine d’eau. 876. a.
Eau. (Jardin.) Épreuve qui en indique la bonne qu
pour les plantes. Quelle eft la meilleure pour le îar
On doit en confulter fe goût, eu égard aux fruits.
l’eaduu dUGe fAol/UuArWcWe &UG dUGe r1IiVv1iGeIrGe ,y Ilad mIHeGillwle.ud*r*e -e^ c®“ e JÎj 1 a«UH
nés. Si on eft réduit à l’eau de puits, il faut la dégour
foleil. V. 188. a. I . „ u .
Eau. (Apkvli. Jardin.) Néceflité de 1 eau poux la vege
tation. Suppl. 111. ai8. i. De la recherche des eaux foi.ter
relues. Suppl. t 4«. t. De l’art de les raffembler pot r
rlgatlon des prés. lUd. b. Des moyens de fe procurer des eau
E A U
jardins. 499- , j | Signies bxtérieyrÿ d«5 ¿onnçs
les jar • J ? ¿¿coùvrir la vifeofité de l’eau .Ibid.
fE a 'u x p r é p te S à Suppl. 111. g i # « S u p k
IV a 10 . é. Eaux mauyaifes. Suppl. I. 47- 4 » | m Ê P i *
o b Du choix (jes eaux propres ?ux aj-rofemen?. L
"a Moyens de corriger lé5 mguvaifes e^ux, Çt d Çtnpê-
cher au’elTesnçpontraften.t de M l W à S S * , # ? f«
Comment on Rrrige }a crydité de c^es qu çy tire immé-
dlatement des montagnes. Suppl. IL jo.l. k. D ç v »
eaux pour llrrigadon des W f W K B a i . P --Î3- »•
De la xondtiite des eaux. SuppI.J. 48.
' EÀV IChymit) 1“. eontldirfç çonune principe çopfliluant des
caris natureU 6r de, mixies arfljtçiels. Pi&ution de cet élément
Une matière nremigrç . ^çmogene, umyerfeUe , plt
un être abftrait doyt pn dpif nier l’epffençe. Le dognie crui
fait de l’eau le prfecipe univerfel de toys fes eprps, eit delb-
tué de fondement. Examen des expériences fur fefquelles on
le fende. L’air ne peut devenfe de leay en fe cpydeufent.
L’eau exifte phyfiquement dans un état de pureté, & d e
vlfion aituclle . gbfoluç, 6c qy’pn poyrrpit: «ppeUer radicale.
V 188 b. Ôyèis feut les corps à fe feryiaupn defquels l eau
concourt cOmme principe e«entie|. F-Uc en.rç dans la top.-
pofuion d’un grand nombre de corps très-fec? & très-çom-
paâes car en général, lesprincjpesçonïtiiyqiîs <fes eprps ne
ippt jamais fenfibles tant qu’ils fpnt a^yçtie«nÇi?‘ ^wmés.
a® ^ l ’eau confidèrie comme menftrue ojt diffolvçnt. Quel?
corps elle djffput. Elle a qyelqye prife fer lç$ cfeux métalliques
& les fubftgnces jnéfalliqiie? inaltéré^?. Jpus fes méta
u x triturés savec Veau paflent pour fourrnr pn ceffein le».
Subftances .dont j’eau extrai,t quelque phofe , quoiqutjle ne
fes diffolye pas- Les pierre* vitrifiables ne donneçr abloly-
ment riçn à l’eau, pbfervons cependant, x*. que 1 egp n^e
diffoutîes corps qu,Ç jufqu’à VRe certaine quantité déterminée
; qu’elle /pn charge jufqu’à un .terme ffpnnu fous fe nom
dcfamraüpn. V7 1§9. b. 2°. Qy’on n’obferye pomtune pareille
proportion entre l’eau dp fes d.ifférens liquides avec
ielquels elle feU une union répRe. feà propriété
de l’eau nous fert à fepaier certaine? fubifences de fever?
corps auxquels elfes font unifs. Dç-jà ¡oylle ufege? auxquels
nous l’employons. QuaUté que doit avoir leau que le çhy-
nüfte emploie M i menftrne. L acide yitriolique lai-
kali fixe font les fubftanccs qui ont fe pl^s d ave?
l’eau. Lès efprits atdens occupent fe fécond rapg. Jbid. 190.
a. Rapports de qyelqyes ftutres f o r c e s ayec leay.Utfetés
pratiques que ypys retyop^ pÇ fe .epffopiffauee dç ce? rapports.
Ibid. b. . . ■
-9 chymifle emploie l (au cçmme tnltrumtnt micMnimu ou
vhyliauc. EUeeft l’inftruroent de la pulvèrifatipn phUofopluque
& dc certains fevages. JEau ÿu çe au commune, cçyÇdé-
rée comme objçt çhymique. Y- t$P- & La difeUation de
cette eau donne tpujours un rKldU terreujt. Principales ef-
peces d’eau douce -, fevpir, l'eau d? pluie 6ç de neige , de
fontaine, ,de puits, de rivfere 3 l>ay cfoupiffante. La légé-
reté de l’eâu eft un ligne de fa purçté. Comment on ey
détermine fe gravité lpécifiqyp. Signes auxquels on peut
connoître fe pufofe des eaux. ¡bij. a.
' Eau. Van.- Helmont Paracelfe regardoient leau comme
rinftriiment:«niverfel defe chymfe & dç la philofopfee
- naturelle I. ¿72. b. Thalès la fogardoit comme le prmcipe
de tput. V. 186. h S B 376- A Les anciens ont cry que
l’eau fe changeons .air $c l’ftir ey çay. Expérience .qui fem-
bleroit d’abord appuyer cette opinion. VII. .?2. a. L 2^6. b.
Comment l'çay imprégnée defpufre, de fels 6c de terrp ,
peut être .changée çp v b m » , gommes , iol-
Sles. III. ¿66. a. Effet du mêfenge de ) eau yvçc Ji acide yi-
triolique. I. ¿op. a. Influence de leay daos l.es fermçnra-
tions XVII. 284. 4. L analyfe fes eaux .unnéfoles regardé?
comme ce qy’il y a dp plys Rifffcjlè en iChym1!?* *• 4P3* •
Eau du chymifte. ,IU. .414. b. , ,
Eau .dpucç. Une -barque enfonce pUisçn .eay douce qu en
mer I. ^33. b. Divem exempfes dfe?^ >feu^/VPpyê.c.s
yy fond fe la ;mc.r en d'ifferens pndfoits. Vil- 9P- f-Plus les
imprégnations qye fes eayx éprouvent tfens feyr pauage lyr
fe xprtp font /fehçs & fulfurculcs, plus fes eaux deviennent
douces & hpnnes. X,ly. 386. a.
Eau de pluu & éfe neige. Quoique la pliK :pyfo <fes eaux
naturelles , elfe contient encore quelques principes étrangers*
Manierp de fe.focnpitlfe » poyr ¿’examiner çhymiquement
Rêfultat de l’examen cbymique dp l’eau de plyve 6c de
nelgç , par M. Matggraf. % M f. $!>8ÇWv
c l ’eau la dus.pure.ftm la ,hgne. S> Ieau de neige eft tn-
fàluhre. U cotnpofuion dp la pluie & jUU-fUfP Ü f W
rftr par déférentes eanfts fSt f ®-
wafief l’eau de pluie & de neige, f tm m p b ft
Voyçz l'ardclc Cil/mt- VsaU i f f i “ le & & ■<WUfee
çff inaltérable. V. JÇ}!,.,a.
)]
è
E A U 543
gau de pluie. Suppl. III. 472. b. *Ses propriétés. ^7.3. a.
Suppl. IY. 419. b. Différçncp entre cette çau f i cçjle de
ro/eç. XIV. 368. b. ^Matières dpnt elle eft imprégnée. XII.
703. a , b. Pourquoi l’eau de Pluie , venant des vapeurs
de fe mer » Oh feucc- XIV. 586. a. ^Itération qy’cÙe' fouf*
fre daps j ’air. Suppl. IV. 4^9 . a , b. Nature des eaux qui
viennent fes neige? fe glaces fondue? des gfeeferes. Suppl,
lit. 229. b.'
Eau dfi fontaine. Les variété? fe? «30? de fontaine font
très-c’onfidéfobfe?.. .On en tropye qui font autant ou même
âys pures que l’eaii f e neigp. Quçlles tprres lff a|terent ou
es confervent fimples. V. w î .X -
Eau de puits. Ce qui 1a feit ÿiffèrer de leay de fontaine.
Elle devient d’autant plus pure qu’elle eft plus tirée. Elfe
varie confidérablcment félon les feux. Qualités de eeUw
dp Paris fe dé Berlin. Y* b
Èatide puits.’ Filtration de cette eau, qui , félon M.
Leutmann, la rend plus ¿>yrp que £ on la ^feHîlpTt. y l.
807. b- Lés feux de pyits tirpntfeuis propriété? de la nature
des çouefes fe terre fùpéfeiyrçs à jeur baffm. VII. 84. b.
Eau de citerne. Qualité de cettp eau. III. 487. a. Unf
maifon qui âuroit quarante foifes en fupérficié , peut ra-
maffer effet d’eau pour abreyver yingt-cinq personnes par
année. Ibid. b. m . .
Eau de riviere. Principes de fa compofition. Ce qui fait }p
plus varier fe qualité, c’eft fe nature du terrein quelle parcoure
ta rapimtè des riyieres eft une caufe très-çfiicace de 1?
pureté de feurs eau?, de 'même que lorfqu’çRes font pey
poiffonneufes! Eau de fe Seine devenue daneerçufo en 1731,
par certaines plfetes qui s’y étoient miüripfees._ fes immon-
dice? n’alterçpt pas yne riyiere autant qu’on^l’imagine. Pourquoj
¿.elle fe laSeine donne fe dévotement ?yx étrangers. V. 1 9 ^ ,
Êaufte riy‘W- Pourquoi il n’y en a point de falsç. VL
869. b. Caufes des différentes quartés, pefanteurs f i couleur
de ces eauje. 870. 4. Suppl. fil. 470. a.
Eau croupijfante. Çjûfe de fon impureté. V . 193. a.
ÉAV commuât, (Pliarm.) fon ulage dans la Pharmacie:
^ gau commune, (Dicte) ufage diététique de l’eau ,bons effets
qu’on fui afeibue. Nous nous fernçron? fur ce point à uy
périt nombre de feits inconteftabl«. i°- Nous n’avons aucuy
moyen pour Apprécier au jufte l’utUité fe l’eau confidéréç comme feiffon. 20. Les buveurs d’eau jouiffent plus communément
d’une bonne fantê que les puveurs de vin. V. 193.
3°! fe s buveur? ffeau ne font pas fujets aux indigeftions. 4 .
Én mangeant des fruits ou des iucreries, il faut boire de 1 eau.
3°. Les ïyveyrs d’çay paffent pour très-vigoureux ayprès des
femmes ; cependant il n’eft pas vrai que les payfans qui nç
boivent qyç de ÎfeAU foieqt plus fobpifes qwÇ ceyx qui ufent
fevin. , ,
En géyéral, .il yaut mieux boye 1 eau froide qye chaude.
De image de boire içnâùd dans les rhumes. Danger des eau*
chaude? 00 infoûo#? théiformes. Ib'uf. 194. a. Précaution de np
pas boire dpT’fen.fr.oife, quand fe corps eft très-éçh?uffé.
Ueau îi
b.Ùe en trop grande quantité en été fait fuer, f i affoibljr,
f e pfes pure f i fe meilienre pour fe feiffon. Les eaux de neige
paffent pour la principale caufe dés goëtres f i écroueile?.
Mauvais effets ffes eau* feoupiffànfo'- Moye.“ de ppriffer les
mauvaifes eaux. Ibid. b, De fufage jpjur^ie* de? bains ,à f e »
froide. Sentiment de Locfe. Avantages que procure cet ufage.
Lés femme? » pcucfentfe tem?. fe feurs réglés nedoivent poinf
mettre les pied? pu .fes m^11* dans l’epu froide. Les perfonne?
expôfées à l’hmpiditê font fujefes.nu* rhumatifmes 8c à ,c&r
taincs paralyfies. Maladies de? ojiy.riers qui oyt foujour? le?
jambes day? f» u . IM .193. a.
1 Eau comiifftne. Qbfery?ûon for fe qualité dçs eau* qui
cuifent fe fflfeu* fes iégowes. PC. 369. b. Qualité de l.e?n
la pfo? falutaifo à f . homme- XÏ. 22?.^. Qu?!‘fe fçlumve dç
l’eau froide ptife.çn feûff°n- il- 3 ï f - f - Pes différentes qiialifep
474. b. 473.4. Racine propre à cpr/igpr fes fiverfe? ffi» -
vaifes qualités des eaux. Suppl. f . 1 3 *. 4. Pê« RT.opnéfes dê
l’eau'dans fes nfages extérieur? forfe corps humain. 433.^.
m commune, (MV- V Ü ) f°P fe*
Excès des jwéfoRÔons de quelques médecins ep feveur .de
îeku V iQKe a. x°. Le p im e n t de? maladies aiguës par
la boiffon desremedes *gueu* çff in.e®caçç &foyv#AtJfeur-
trier 2°.L’iitfoté de feboiffon djm? les a^fediesaiguës,à uxxg
de fécour?» focpndaire, n’# fien mPlOf quedé»on;rée- A*
Certaines mèfoodes nées ¡fers dofofe de ¿.art, comme celfe
1 de guérir par 'l’eau froid? » J1? Îforpfeat ¿g-e foutées qù’avec
beaucoup de précaution. Ibid. b- 4°- A quoi fe réfeifent feî
vertus réelles de j’i^u, foit qfeudç, foit tiede, foit froide.
Uiaftes^xtérie.iys.de l’^O- ftiV. 196-
' Eaux nùncrçdts. De leiys qualités f i d? feurs effets. Suppl.
I. 7? 6! ¿. 738. fi. Suppl. III. 471.4- b. 472. a- b. Pourquoi les
eaux minérales f i les fource? d’e?WÇ.chaud«? paruopent aux
pr.op^ét^ de la ,<&»*. 0 . L JQç la ¿yeur fi.de la verni