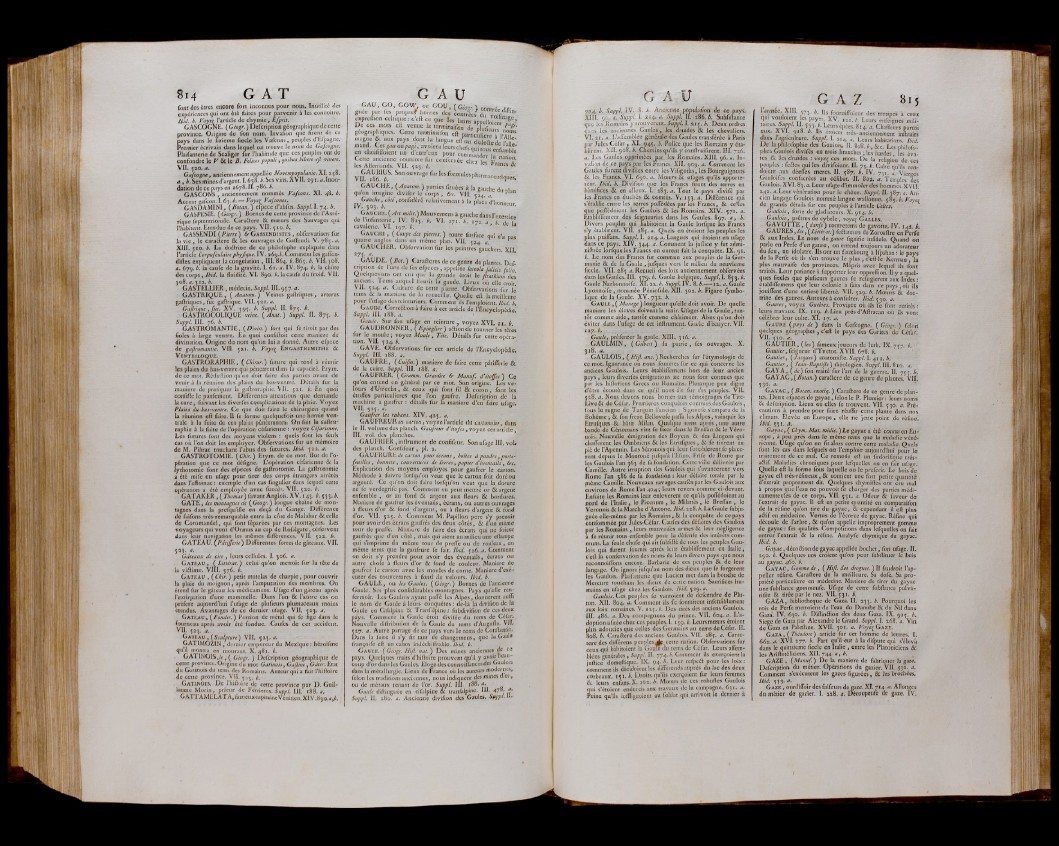
G A T G A U
font des êtres encore fort inconnus pour nous. Inutilité Je*
expérience* qui ont été faites pour parvenir k les connoitrc.
IhU. b. Fpyer l'article de chymie, EJ'prit.
GASCOGNE. ( Giogr. ) Defcription géographique de cette
province. Origine de fon nom. Invafion que firent de ce
pays dans le ftxiemc ficcle les Vafcons, peuples d’Efpagne.
Premier écrivain dans lequel on trouve le nom de Gajcogne.
Plaifantcric de Scaliger fur l'habitude que ces peuples ont de
confondre le V 8c le D . M m populi, quibus bibere efl vivere.
VII. ( io . a.
Gafcogne, anciennement appcllcc Novcmpopulanic. X I, 258.
a , b. Ses mines d’argent. I. (il 8. b. Scs vins. X VII. aqt.n.Inon-
dation de ce pays en 1 6 7 S .i l. 786. b. n -
G A S C O N S , anciennement nomme» Vafcons. XI. 40. b.
Accent gafeon. L ù y b .— Voycr Vajconct.
GA.SDAMINI, ( Bot an. ) cfpcce d'abfus. Suppl. I. 74. b.
GASPESIE. ( Giogr. ) Bornes de cette province de l’Amérique
feptcntrionale, Caraétere 6c moeurs de# Sauvage* qui
l'habitent. Etendue de ce pays. V i l . ç 10. b,
GASSENDI ( Pierre ) & G a ssen d js te s , obfcrvations fur
la vie , le caraétere 8c les ouvrages de Gafîendi. V. 785. a.
XIII. 510. b. La doélrine de ce philofophe expliquée dans
l'article Corpufculairc phyftque. IV. 269.1*. Comment les gaften-
diftes expliquent la congélation, III. 864, b. 865. b. V it, 208.
d. 679. é. la caufe de la gravité. 1. 6 t. a. IV. 874. b. la chiite
des corps , Ibid. la fluidité. V I. 890, b. la caufe du froid. VII.
308. a. 312. A.
G A ST E L L 1E R , médecin.Suppl. III. 957. a.
G A S T R IQ U E , ( Anatom. ) Veines gaflriques, artères
gaflriques| fuc gaftrique. VII. 521. a.
Gaflriquc. fuc. X V . <95. b. Suppl. II. 875. b.
G A STROCO LIQ UE veine. ( Anat. ) Suppl. II. 875. b.
Suppl. III. 76. b.
C/ASTROMANTIE, ( Divin. ) fort qui fe droit par des
fioles k large ventre. En quoi confifloit cette maniéré de
divination. Origine du nom qu’on lui a donné. Autre cfpcce
de gaflromantie. V IL 521. b. Voyc[ En g a st ium ith e ÖC
V entriloque.
GASTRÖRAPH1E , ( Chirur. ) future qui tend k réunir
les plaies du bas-ventre qui pénètrent dans fa capacité. Etym.
de ce mot. Réduélion qu on doit faire des partie* avant de
venir ii lu réunion des plaies du bas-ventre. Détails fur la
maniéré de pratiquer la gaflroraphie. V il. 721. b. En quoi
conftflc Je panfement. Différentes attentions que demande
la cure, fut vaut les diverfes complications de la plaie. V o y e z
Plaies du bas-ventre. Ce que doit faire le chirurgien quand
la réunion eft faite. Il fe forme quelquefois une hernie ventrale
h la fuite de ces plaie* pénétrante». On fait la caftro-
raphic k la fuite de l'opération céfaricnne : vo yez Cilarienne.
Le» futures font des moyens violens : quel# font les feuls
cas où l’on doit le* employer. Obfcrvations fur un mémoire
de M. Pibrac touchant l’abus des futures. Ibid. 5 22. a.
G A STROTOM IE. (C h ir .) Etym. de c e mot. But de l’opération
que ce mot défigne. L’opération céfaricnne 6c la
lythotomtc font des cfpcce# de gaftrotomie. La gaflrotomie
a été mife en ufage pour tirer des corps étrangers arrêtés
dans l’cftomac : exemple d'un cas fingulier dans lequel cette
opération a été em plo yée avec fuccêr. VII. 522. b.
G A T A K E R , ( Thomas) favant Angloi». X V . 143. b. 533.b.
G A T E , les montagnes de (G iog r .) longue chaîne de montagnes
dans la prefqu'iflc en aeça du Gange. Différence
de faifons trés-remarquable entre la côte de Malabar 6c celle
de Coromandel, qui font féparées par ces montagnes. Les
voyageurs qui vont d’Ormus au cap de Rofalgarc, obfervent
dan* leur navigation les mêmes différence». VII. 522. b,
G A TE AU . (Pâtijferie) Différente» fortes de gâteaux. VII.
Gâteaux de c ire , leurs cellules. I. 306. a.
G a t e a u , (L it té ra l.) celui qu’on mettoit fur la tête de
la viétime. VIII. 376. u.
G a t e a u , ( Chir. ) petit matelas de charpie, pour couvrir
la plaie du moignon, après l’amputation de» membres. On
étend fur le gâteau le» médicamcns. Ufage d’un gâteau après
l'extirpation d'une mammclle. Dans l’un 6c l’autre cas on
préféré aujourd'hui i’ufage de pluficurs plumaccaux moins
étendus. Avantages de ce dernier ufage. VII. 323. a.
G ateau , (Fonder .) Portion de métal qui fe fige dans le
fourneau après avoir été fondue. Caufcs de cet accident.
VII. 323. a.
G ATEAU. (Sculpture) VII. 323 .a .
GATIMÔaIN / dernier empereur du Mexique : héroïfinc
q»’j l montra en mourant. X. 481. b.
GATINOIS,/«, | Giogr. ) Defcription géographique de
cette province. Origine du mot Gatinois, Gaßine. Gâter. Etat
du Gatinois du tenu des Romains. Auteur qui a fait l'hiftoire
de cette province. VU. y.
G at in ois . D e l’hiftoire de cette province par D. Guillaume
Morin, prieur de Ferneres. Suppl. 111, 188. a.
GATTAMELATA, famcuxcapitaine Vénitien. X IV .830.*,é.
G A U , G O , C O W . ou G O U , ( Giovr \
guèc par fc» propre.? Iioinra de» c o n ir é c i duTn-fi
exprcflion ccliique; c’eft ce que le» latins aniicll,v s ° ’
De ce. mot» efl venue g
géographiques. Cette terminalfbn eft particulière ï ï K
magne & aux paya dont la langue ell|iS dialeflede
mand. Ces gau ou pagt, avotent leurs chef* k«î . , v- . f*
en choififloicnt un d’enir'eux pour commandé lî® "!
Cette ancienne cou.nrne fut c o k c r v ie c h e i t a F " “ " T
le» Allemand». VU. m . b. Ies F™ « &
\ U AM >lÎ S' ^on 0" vr''gc i"llr les iormulc» pharmaceutique».
GAUCHI», (yi/iatom.) partie» fituée» 1 la eauche d.. S
l’on imagine divllér le co rp i, <kc. VII. « î l™ 1
<|U
Gauche .clW.coufldérè relativement S la place d’honneur
IV. 303,
G a u c iic . ( ,* / m l i l.) Mouvcmen» k gauche dan» l’exercice
de 1 infanterie, IV. 813. b. V I. 171. b. 172 a /, ,1« 1
cavalerie. VI. 197. b. 7 ’ % dc h
G a u c h e , ( Coupe des pierres. ) toute fu r fk c qui n’a nas
quatre angles dans un même pian. VII, 324. a.
GAUCHER. Obfcrvation fur les peintres gauchers. XII.
¿A U D E . ( B o t . ) Caraétere* de ce genre dc plantes. Dcfcnprjon
de l’une de fes cfpcce», appclléc luteola faltcis folio
Quelque* un1* ont cru que la grande étoit le flrathium des
ancien" lems auquel fleurit la gaude. Lieux où elle croit.
VII. 324. a. Culture dc cette plante. Obfcrvations fur le
teins oc la manlcrc dc la recueillir. Quelle eft la meilleure
pour I ufageI des rciniurier». Comment ils l’emploient. MU; b.
Gxuui:. C'orrcihon k faire k cet article dc 1 Encyclopédie,
Suppl. III. 188. a. i
Gaude. Sur fon ufage en teinture, voyez XVI. n . b
G AUD RO N N ER , ( Epinglirr ) aéliondc tourner les têtes
fur le moule; v o y e z M o u le , Tête. Détails fur cette opération.
VII. 324. b.
G A V E . Obfcrvations fur c e t article de l'Encyclopédie.
Suppl. III. 188. 7 1
G AU FR E , (C u ifin .) manière dc faire cette pâtiflerie 8c
de la cuire. Suppl. III. 188. a.
GAUFRER. (Gramm. Gravâte & M a n u f d'étoffes) C e
qu’on entend en général par cc mot. Son origine. Les velours
d’Utrecht, 6c ceux qui font fil 6c co ton , font les
étoffe» particulières que l’on gaufre. Defcription dc la
machine il gaufrer ; détails fur la manière d’en faire ufacc.
V II. 3 « . aT 6
Gaufrer les rubans. XIV . 423. a.
GAUFREUR en carton, v o y e z l’article dit cartonnier, dans
le II. volume des planch. Gaufrcur d ’itofes, voyez cet article
III. vol. des planches;
GAUFR!ER,inftrumcnt dc confifeur. Son ufage 111, voL
des planch. Confifeur, pl. 2.
GAUFRURE de carton pour écrans, boites â poudre, portefeuilles
, bonnets, couvertures de livres, papier d’éventails, €>c.
Explication des moyens employés pour gaufrer le carton.
Méthode â fuivre lorfqu’on veut que le carton foit doré ou
argenté. Ce qu’on doit faire lorfqu’on veut que la dorure
ne fe verdegrife pas. Comment on peut mettre or 6c argent
cnfcmhlc , or au fond 6c argent aux fleur* 6c bordures.
Manière dc gaufrer le»éventails, écrans, ou autres ouvrages
h fleur» d’or 6c fond d'argent, ou à fleurs d’argent 6c fond
d'or. VII. <23. b. Comment M. Papillon pere s’y prenoit
pour avoir (les.écrans gaufré» des deux côtés, 6c d un môme
tour dc prefte. Manière de faire des écrans qui ne foient
gaufré* que d'un cô té , mai» qui aient au milieu une eftampe
qui s'imprime du même tour de prefte ou de rouleau, en
même teins que la gaufrurc fe fait, Ibid. <26. a. Comment
on doit s'y prendre pour avoir des éventails, écran» ou
autre choie ii fleurs d'or 6c fond dc couleur. Maniéré do
gaufrer le carton avec les moule* de corne. Manière d’exécuter
des couverture» il fond de velours. Ibid. b.
G A U L E , ou les Gaules. (G io g r .) Bornes de l’ancienne
Gaule. Ses plu» conftdérahle» montagnes. Pays qu'elle ren-
fernioit. Le» Gaulois ayant paftê les Alpes, donnèrent aufti
le nom dc Gaule it leurs conquêtes : dc-lâ la dlvifion de la
Gaule en Cifalpinc 6c Tranfalpinc; fnbdivifion dc ces deux
pays. Comment la Gaule étoit divtfée du rems de Céfar.
Nouvelle diftrihuiion de la Gaule du tems d’Augufte. VIL
327. a. Autre partage dc ce pays vers le tems dc Conftaniin-
Dans la fuite il s’y fit tant de chnngcntcns, que la Gaula
françoife cft un canos indéchiffrable, Ibid. b.
G a u le . ( Giogr. U ifl. nat. ) Des mines anciennes de ce
pays, Quelque» traits d'hiftoirc prouvent qu'il y avoit ^beaucoup
d'or dan» le# Gaules. Eloge des connoiflancesdes Gaulois
dan* la métallurgie. Lieux de France où le» auteurs modernes,
félon le# tradition» ancienne», nous indiquent des mines cl or,
ou de métaux tenant de l'or. Suppl. III. 188. a.
Gaule (liftinguée en cifalpinc 6c tranfalpiue- HL .47“ ,' .a/
Suppl. II. 280. a. Ancienne divifion des Gaules. Spppi> ».
G A U
774. b. Suppl, I V. 8. b. Ancienne population dc cc pays.
XJli. 9 0 . a. Suppl. 1. 214. a. Suppl. II. 286. b. Stibfiftancc
que le» Romains y trouvèrent, Suppl. I, 213. b. Deux ordres
dans le# anciennes Gaules, les druides 6c les chevaliers.
VI. 21. a. I.’aflemblée générale des Gaules transférée h Paris
par Jules Céfar , XI. 043, b. Police que les Romains y établirent.
XII. 908. b. Chemins qu’ils y conftruiftrcnt. IIÏ. 726.
//. I.cs Gaule»; .opprimées par. les Romains. XIII. 96. a. In-
vafion dc ce pays par les Franc», XII. 909, a. Comment les
Gaules furent (fivifées entre les Vifigoths, les Bourguignons
6c les Francs. VI. 690. a. Moeur# oc ufages qu’ils apportc-
I eut. Ibid. b. Divifion que les Francs firent des terre* en
bénéfices 6c en alleux. I. 283. a. Tout le pays divifé par
ies Francs en duchés 6c comtés. V . 133. a. Différence qui
s’établit entre les terres poftédées par les Francs, 6c celles
que poftédoient les Gaulois 6c les Romains. XIV. 371. a.
Etabhftcmcm des feigneuries dans les Gaules. 807. a , b.
Divers peuples qui habitoicnt la Gaule lorfquc les Francs
s’y établirent. VII. 283. a. Quels en étoient les peuples les
plus puiftâns. Suppl. 1. 214. a. Langues qui étoient en ufage
dans cc pav». XIV. 344. a. Comment la jufticc y fut admi-
niftréc lorfquelcs Francs en curent fait la conquête. IX. 91.
b. Le nom des Francs fut commun aux peuples dc la Germanie
6c dc la Gaule , jufquc* vers le milieu du neuvième
ficdc. VII. 283 a. Recueil des loix anciennement obfervées
dan» les Gaules. III. 379. b. Gaule bclgiquc. Suppl. I. 833. b.
Gaule Narbonnoifc. XI. 22. b. Suppl. IV. 8. b.— 12. a. Gaule
Lyonnoifc, nommée Péninfnle. XII. 302. b. Figure fymbo-
II que dc la Gaule. X V . 732. b.
G a u l e , ( Manège) longueur qu’elle doit avoir. Dc quelle
manière les élèves doivent la tenir. Ufagc4 dc la Gaule, tantôt
comme aide, tantôt comme châtiment. Abus qu’on doit
éviter dans l’ufage dc cet infiniment. Gaule d’écuycr. VII.
227. b,
Gaule, préfenter la enulc. XIII. 316. a.
G AULM IN , ( Gilbert ) fa patrie , fes ouvrages. X .
318. a.
G A U LO IS , ( Uifl. anc, ) Recherches fur l’étymologie dc
ce mot. Ignorance ou nous fommes fur ce qui concerne les
anciens Gaulois. Leurs ¿tabli/Tcincn» hors de leur ancien
pays , leurs diverfes émigrations ne nous fout connues que
par les hiftoriens Grecs ou Romains. Pluturquc peu digne
d’être écouté dans ce qu’il nous dit fur deu peuples. v lL
<28. a. Nous devons nous borner aux témoignages dcTitc-
Livc 6c de Céfar. Premières conquêtes connues des Gaulois,
fous le regne dc Tarquin l’ancien : Sigovefc s'empara dc la
Bohême ; 8c fon frere Bellovcfc pafta les A lpes, vainquit les
Etrufqucs 8c bâtit Milan. Quelque tems après, une autre
bande de Cénomans vint fe fixer dans le Brcftan 8c le Véro-
uo)!;. Nouvelle émigration des Boycns 8c des Lingons qui
chaftcrent les Ombriens 8c les Etrufqucs, 8c fe tinrent au
pié de l’Apennin. Les Sénonois qui leur fuccéderent fe placèrent
depuis le Monroné jufqu’â l’Eftno. Prifc de Rome par
les Gaulois l’an 363 dc fa fondation. Cette ville délivrée par
Camille. Autre irruption des Gaulois qui s’avancèrent vers
Rome l’an 386 de fa fondation : leur défaite totale par le
même Camille. Nouveaux ravages caufés par les Gaulois aux
environs dc Rome l’an 404 ; leurs revers comme ci-devant.
Enfuitc les Romains leur enlevèrent cc qu’ils poffédoient au
nord de l’Italie, le Piccnum, le Milanès, le Brcftan , le
Vcronois 6c la Marche d’Anconc. Ibid. 228. b. La Gaule fubjliguée
elle-même par les Romains, 6c la conquête dc ce pays
confommée par Julcs-Céfar. Caufcs des défaites des Gaulois
par les Romains, leurs mauvaifes armes lie leur négligence
a fc réunir tous cnfcmblc pour la défenfe des intérêts communs.
La feule chofc qui ait fubftfté dc tous les peuples Gaulois
qui furent fournis après leur établiftcmcnt en Italie,
c ’eft la confcrvation des noms dc leur» divers pays que nous
rcconnoiftons encore. Barbarie dc ces peuples 6c dc leur
langage. On ignore jufqu’au nom des dieux que fe forgèrent
les Gaulois. Plaifantcric que Lucien met dans la bouche dc
Mercuro touchant les dieux de cette nation. Sacrifices humains
en ufage chez les Gaulois. Ibid. 329. a.
Gaulois. Ces peuples fc vantoient dc defeendre de Plu-
ton. XII. 804. a. Comment il» fe fournirent infcfiftblcment
aux loix romaines. V. 123. b. Des cités des anciens Gaulois.
III. 486. a. Des compagnons du prince. VII. 604. a. L’adoption
ufttée chez ces peuples. 1.13p. b. Leurs moeurs étoient
plus adoucies que celles des Germains au tems de Céfar. II.
808. b. Caraétere des anciens Gaulois. VII. 283. a. Caractère
des différens peuples B p . cette nation. Obfcrvations fur
ceux qui habitoicnt la Gaule du tems dc Céfar. Leurs aftem-
blécs générales, Suppl. II. 774- A Comment Us exerçoiem la
jufticc domoftique. IX. 94- 1 Leur refpcét pour les loix :
comment ils décidoient les différends auprès du lac des deux
corbeaux. 13 1 .E Droit» qu’ils cxcrçolcnt fur leurs femmes
8c leurs cnfans.X. 10a. b. Moeurs de ces robuftes Gaulois
qui s’étoient endurcis aux travaux dc la campagne. 63 t. a.
Peine qu’ils tuffligeoicflt au foldat qui arrivou le dernier à
G A Z
I armée. X lll. tyy. lia fournilîbicm des troupes à ceux
qu. voulotem es payer XV. m . i . [,curs enfeigne» mill-
ta.res. Siwpl. II 593. i . Leurs ¿pie». 8.4. a. thaffeur» parmi
eux. XVI. 918. i. H» ¿toicnt très-anciennement inÜruits
dan» lamcnlture. Suppt. I « Leurs habitation». Ibid.
D e la jmiloloplne des Gaulois. 11. 808. b , &c. Le» phllofo-
phes ßauloi» divifè» en trou branche» ; le» bardes le* èva-
tts Si le» druide» : »oyej cc» mots. Dc la religion de ce»
peuples : feile» qui le» divlfoient. II. 75. b. Culte qu’ils ren-
doient aux déeffcs mercs. II. 387. b. IV. 731, n. Vierges
O'àulôiféÿ confacrécs au célibat. II. 80a. a. Temples des
Gaulois, XVI. 83.<j. Leur ufage d’immoler des hommes. XVII.
242. /».Leur vénération pour le chêne. Suppl. II, 287. a. Ancien
langage Gaulois'nommé langue wallonne. 383» b, Voycr
de grands détails fur ces peuples k l’article Celtes.
Gaulois, forte de gladiateurs. X. 914. b.
Gaulois, prêtres dc cybele, voyeç Galles.
G A V O T T E , (dan/c) contrctems dc gavotte. IV. 142. b.
GAURE S, le s t (Littirat.-) fcélatcurs dc Zoroaftre en Pcrfe
8c aux Indes. L e nom dc gaure ftgniftc infidèle. Quand on
parle en Pcrfe d’un gaurc, on entend toujours un adorateur
du feu , un idolâtre. Ils ont un fatixbourg à Ifpahnn : le pays
dc la Perfc où ils s’en trouve le plus, c’cft le Kerman, la
plus mauvaife des provinces. Mépris avec lequel ils font
traités. Leur patience h fupporter leur oppreftion. Il y a quelques
ficelés que pluficurs gaurcs fe réfugièrent aux Indes:
ctablificmcns que leur colonie a faits dans ce pays, où ils
jouiffent d’une entière liberté. VII. 329. b. Moeurs 8c doctrine
des gaures. Auteurs â confultcr. Ibid. 330. a.
Gaures, voyez Guébres. Province où ils fc font retirés :
leurs travaux. IX. x 10. b. Lieu prés d’Aftracan où ils vont
célébrer leur culte. XL 17. a.
Gauke (p ay s d e ) dans la Gafcogne. (G é o g r .) félon
quelques géographes, c’cft le pays des Garnes de Céfar.
VII. 330. a.
G AUT IER , ( le s ) fameux joueurs de luth. IX. 737. b.
Gautier ,fci£ncur d’Yvctot. XVII. 678. b,
Gautier, (Jacques) anatomifte. Suppl. I. 4 1 1. b.
Gautier, f Jean-Baptifle ) théologien. Suppl, III. 810, a.
G A Y A , ( de) fon traité fur l’art dc la guerre. II. 733. b.
G A Y A C , (B o t a n . ) caraétere de cc genre de plantes. VII.
330. 0.
G a y a c , ( Botan. txotiq. ) Caraétere de cc genre dc plantes.
Deux cfpcccs dc gay ac, félon le P. Plumier : leurs noms
8c defcription. Lieux où elles fc trouvent. VII. 330. a. Précautions
k prendre pour faire réuffir cette plante dans nos
climats. Elevée en Europe, clic ne jette point de rêfine.
Ibid. 331. a .’
Gayac, ( Chym. Mat. midic. ) L e gayac a été connu en Europe
, à peu prés da ni. le même tems que la maladie vénérienne.
Ufàgc qu’on en fit alors contre cette maladie. Q u e ls
fout les cas dans Icfqucls on l’emploie aujourd’hui pour le
traitement de c e mal. Ce remede eft un fudorifique rrès-
aétif. Maladies chroniques pour lcfqucllcs on en fait ufage.
Quelle cft la forme fous laquelle on le preferir. L e bois de
gayac eft trés-réftneux, 8c contient une fort petite quantité ,
d’extrait proprement dit. Quelques chymiftcs ont cru mal
k propos que l’eau ne pouvoit fc charger des parties médi-
camcnteufcs dc ce corps. VII. 331. a. Odeur oc faveur de
l’extrait de gayac. Il eft en petite quantité en comparaifon
de la réfine qu’on tire du gayac, 6c cependant il cft plus
aétif en médecine. Vertus de l’écorcc dc gayac. Réfinc qui
découle dc l’arbre, 6c qu’on am)ellc improprement gomme
dc gayac : fes qualités. Comportions dans lcfqucllcs on fait
entrer l’extrait 6c la réftne. Analyfc chymique du gayac.
Ibid. b.
. Gayac , décoétion dc gayac appellée h o c h e t , fon ufage. II.
290. b. Quelques- uns croient qu’on petit fubftituer le buis
au gayac. 460. b.
G a y a c , Gomme d t , ( Hiß . des drogues.) Il Faudrait l’ap-
pcllcr réftne. Caraétere de la meilleure, oa (lofe. Sa propriété
particulière en médecine. Manière dc tirer du gayac
une fumtancc goinmeufe. Ufage de cette fubftancc pulvé-
riféc 8c tirée par le nez. VII. 331. b.
G A Z A , bibliothèque de Gaza. II. 233. b. Pourquoi les
rois de Perfc mettoient dc l’eau du Danube 6c du Nil dans
Gaza. IV. 630. b. Diftinétion des deux Gaza. IX. 913. b.
Siège de Gaza par Alexandre le Grand. Suppl. I. 268. a. Vin
de Gaza en Palcftine. XVII. 301. a. Voycç G a ze .
G aza , ( Théodore ) article fur cet homme de lettres. I.
M i . a. XVl. 277. b. Part qu’il eut à la difputc qui s’éleva
dans le quinzième ftecle en Italie , entre les Platoniciens 8c
les Ariftotélicicns. XII. 744. a , b.
GAZE , ( Manuf. ) De la manière dc fabriquer la gaze.
Defcription du métier. Opérations du gazier. VII. 33a. a.
Comment s exécutent les gazes figurées, 8c les brochées.
Ibid. 333. a.
G aze , ourdlffoir des faifeurs de gaze. XI. 714. a. Allonges
du métier de gazier. I. 228. a. uécou p eufe de gaze. IV.