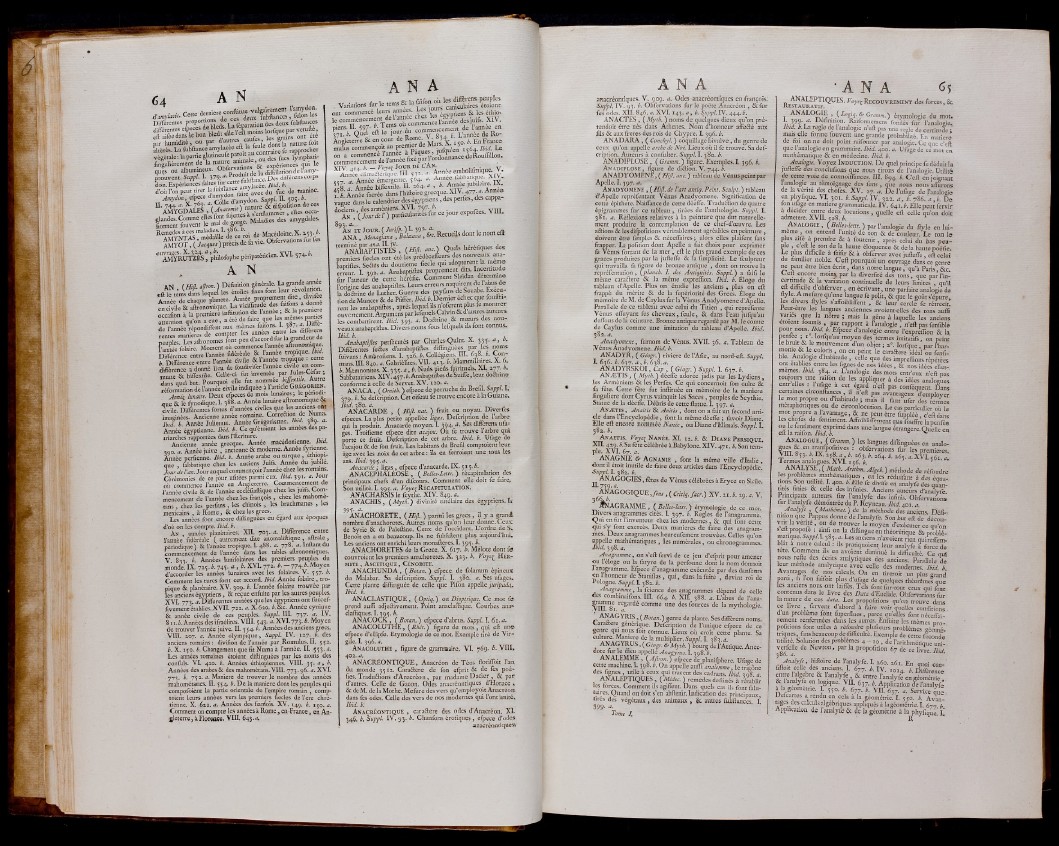
6 4 A N
1 1 1 Cette
Différentes propertiom de ces fubftai.ccs
différentes lorfque par venite,
eft ailée dans le bon bled, eueleltmoms y on( été
par humidité, ou par f ? dont ,a nature foit
altérés. La fubftance amylacée eft la fede mmt her
végétale : la partie glunneufe parott au con iy,„phatifinluliérement
de la Æ f f & expériences qui le
ques ou de la diftillatîon de l’amyprouvent.
Suppl. I. 379- a‘ - A,hûmce. Des diflerens corps
. don. Expériences faites for ce^ ^^ |a cé e i Ibid.b..è^...
d’où l’on peut drer l a / u M l j u i c i d fuc de manioc.
Amydon, efpece ^amydon ;Z Suppl. II. <0,.*•
II. 744. e. X. 769. a. ^ difpohtion de ces
A m y g d a l e s , « 8 ^ > M 8 g a S , eues «caglattdes.
Comme elles^om uiet e £s des amygdales.
Sonnent fouvent le mal “ e gorgemkÊtÊIÊÊÊÊM
° lAÌ\ÌYRLTLiés, philofophc pêripaténcien. XVI. 174- *>
A N
AN ( Hift n/îron. ) Définition générale. La grande année
eft le tems dans lequel les étoiles fixes font leur révolution
ânemfou\u’o rammtee, a élé de | S ^ É É f
de l ' a n n é e d k è r e n s
n eu r ie s^Æ on om e s font peu d’accord fur la grandeur de
Pannée folaire. Moment où commence l’année agronomique.
Difforence entre l’année fidéréale & l’année tropique. Ibid
b Différence entre l’année civile & l’année tropique . cette
différence a donné lieu de foudivifer l’année civde «n commune
& biffextile. Celle-ci fut inventée par Jules-Céfar,
dans quel but. Pourquoi elle fin nommée t i f a l i . Autre
réformation de l’année civile indiquée a 1 aritele G régorien. SB lunaire. Deux efpecesde mois lunaires; le pénodu
nue & le fynodique.I. 388. a. Annee lunaire agronomique &
civile. Différentes fortes d'années civdes
imaginées. Ancienne année romaine. Correftion de Numa.
Ibid. b. Année Julienne. Année Grégorienne. Ibid. 3Ï9. a.
Année égyptienne. Ibid. b. Ce qu’étoient les années despa-
triarches rapportées dans l’Écriture.
Ancienne année grecque. Année macédonienne. ibid.
«co. a. Année juive , ancienne & moderne. Année fynenne.
Année perfienne. Ibid. b. Année arabe ou turque , éthiopi-
que , labbatique chez les anciens Juifs. Année du jubilé.
Jour de Van. Jour auquel commençoit l’année chez les romains.
Cérémonies de ce jour ufitées parmi eme Ibid. 391. a. Jour
où commence l’année en Angleterre. Commencement de
l ’année civile & de l’année eccléfiaûique chez les juifs. Commencement
de l’année chez les françois , chez les mahomé-
tans, chez les perfans, les chinois , les brachmanes , les
mexicains , à Rome, & chez les grecs. _
Les années font encore diftinguées eu égard aux époques
<l’où on les compte. Ibid. b. _
An , années planétaires. XIL 703. a. Différence entre
l’année fidéréale ( autrement dite anomaliftique , mtrale ,
périodique) 8c l’année tropique. 1. 488. a. 778. a. Inftantdu
commencement de l’année dans les tables ailronomiques.
V 833. b. Années lunifolaires des premiers peuples du
monde. IX. 725. i . 745- “ , b- XVI. 772. b. — 774-4.Moyen
d’accorder les années lunaires avec les folaires. V. 557. b.
Comment les turcs font cet accord. Ibid. Année folaire^, tropique
& planétaire. XV. 309. b. L’année folaire trouvée par
les anciens égyptiens, & reçue enfuite par les autres peuples.
XVI 773. a. Différentes années que les égyptiens ont fuccef-
fivement établies. XVII. 722. a. X.620. b.8cc. Année cynique
& année civile de ces peuples. Suppl. 111. 737. a. IV,
8ii.ii. Années des ifraélites. VÛI. 343. 4. XVI. 773.*. Moyen
de. trouver l’année juive. II. 5 54. b. Années des anciens grecs.
VÌI!. 207. a. Année olympique, Suppl. IV. 127. b. des
anciens romains: divifion de l’anuée par.Romulus.II. 552.
b. X. 150. b. Changement que fit Numa à Tannée. IL 553. 4.
Les années romaines étoient diftinguées par les noms des
confuls. VI. 420. b. Années éthiopiennes. VIII. 35. a , b.
Années des arabes & des mahométans. VIII. 773.96. a. XVI.
• 773. b. 752. a. Maniere de trouver le nombre des années
niahométanes. II. 554. b. De la maniere dont les peuples qui
compofoiént la partie orientale de l’empire romain , comp*-
toient leurs années vers les premiers üedes de l’ere chrétienne.
X. 621. a. Années des fiamois. XV. 149. b. 150. a.
Comment on compte les années à Rome, en France, en Angleterre,
à Florence. VIII. 643.4.
A N A
H w S i l lB KËftSBï §S8 ont commencé leurs W | - ! égyptiens & les éthiot
e d e s j m f s . XIV
3 7g4. Q ue l eft le Ke-
BSEroi f f iHHPIi „ 7 Année émergente. 564. «■
vague dans le calendrier des égyptiens, des perfes, des cappadociens
. des arméniens. X V I . 797" • . v t i t
An , ( Jour de t ) particularités fur ce jour expolêes. V I IL
893. 4.,.
t£r AN A BA P T ISTE S , ( Hifl■ une.) Quels hérétiques des
premiers fiecles ont été les prédéceffeurs des nouveaux ana-
,1,, 4An7Îpme fiecle qui adoptèrent la même
fur l’auteur de cette uww*v. ......— . , ,, , ,
l’origine des anabaptiftes. Leurs erreurs naquirent de 1 abus de
la doftrine de Luther. Guerre des payfans de Souabe. Exécution
de Muncer & de Pfiffer. Ibid. b.Dernier échec que fouffri-
rent les anabaptiftes, après lequel Us n oferent plus le montrer
ouvertement. Argumens par lefquels Calvin & d autres auteurs
les combattirent. Ibid. 393. a. DoSniie & moeurs des nouveaux
anabaptiftes. Divers noms fous lefquels ds font connus.
Anabaptiftes perfécutés par Charles-Quinr. X. 335. a , 4.
Différentes feftes d’anabaptiftes diftinguees n?®15
fuivans: Ambrofiens. I. 326. b. Collégiens. III. 638. b. L.on-
mans. UI. 840. 4. GabriéUtes. VH. 413-, A Mammillaires. X. 6.
b. Memnonites. X . 333.4, b. Nuds pieds fpirituels. XI. 277. b.
Sabbatairiens. XIV. 457. ¿.Anabaptiftes deSuiffe,leur domine
conforme à celle de Servet. XV. 120. a. • , T,
A N A C A , ( Omïth. ) efpece de perruche du Rreiil. Suppl. I.
379. b. Sa defeription. Cet oifeau fe trouve encore à la Guiane.
Ihl'ANACARDE , ( Hifl. nat. ) fruit ou noyau. Diverfes
efpeces. La plus petite appellée ligas. Defeription de 1 arrue
qui la produit. Anacarde moyen. I. 394* a‘ ^es differens ufa-
ges. Troifieme efpece dite acajou. Ou fe trouve 1 arbre qui
porte ce fruit. Defeription de cet arbre. Ibid. b. Ufage de
l’acajou & de ion fruit. Les kabitans du Brefil comptoient leur
âge avec les noix de cet arbre : ils en ferroient une tous les
ans. ibid:395.4.
Anacarde ; ligas, efpece d’anacarde. IX. 31 ç. b.
ANACEPHALÉOSE , ( Btües-Lettr. ) récapitulation des
principaux chefs d’un difeours. Comment elle doit fe faire..
Son utilité. 1. 395. a. Voyez R é c a p i tu la t io n .
ANACHARSIS le fcytlie. XIV. '849.4. .
ANACHIS, ( Myth. ) divinité tutélaire des égyptiens. L‘
395. a.
ANACHORETE, (Hifl. ) parmi les grecs , il y a grand
nombre d’anachoretes. Autres noms qu’on leur donne. Ceux
de Syrie & de Paleftine. Ceux de l’occident. L’ordre, de S»
Benoît en a eu beaucoup. Ils ne fubfiftent plus aujourd’hui.
Les anciens ont enrichi leurs monafteres.I. 395 .b.
ANACHORETES de la Grece, X. 617. b. Mélote dont fe
couvroient les premiers anachorètes. X. 323. b. Voyez Her-
mite , A scé tiq ue , C én obite.
ANACHUNDA , ( Botan. ) efpece de folanum épineux
du Malabar. Sa defeription. Suppl. I. 380. a. Ses ufages.
Cette plante diftinguée de celle que Pifon appelle juripad
Ibid. b.
ANACLASTIQUE, ( Optiq. ) ou Dioptriquc. Ce mot fe
prend auffi adjeâivement. Point anaclaftique. Courbes ana*
daftiques. 1 . 395. b.
ANACOCK , ( Botan. ) efpece d’abrus. Suppl. I. 61.4.
ANACOLUTHE, (Rhét.') figure de mots, qui eft une
efpece d’ellipfe. Etymologie de ce mot. Exemple tiré de Virgile.
I. 396.4.
A n a co lu th e , figure de grammaire. VI. 769. b. VIII,
402.4.
ANACRÉONTIQUE, Anacréon de Téos floriffoit l’an,
du monde 3512. Caraétere de fon efprit & de fes poé-
fies. Traduéhons d’Anacréon, par madame Dacier , & pat*
d’autres. Celle de Gacon. Odes anacréontiques > d’Horace ,
& de M. de la Mothe. Mefure des vers qu’employoit Anacréon
dans fes odes. Celle des vers de nos modernes qui Tont imité,
Ibid. b'.
A n a c r éo n t iq u e , carafrere des odes d’Anacréon. XL
346. b. Suppl. IV. 93. b. Chanfons érotiques , efpece d’odes
anacréontique^'
A N A
anacréontiques. V . 909. 4. Odes anacréontiques en françois.’
Suppl. IV. 93. b. Obfervations fur le poète Anacréon , &fur
fes odes. XIÏ. 846. a. XVI. 143. a , b. Suppl. IV. 444. b.
ANACTES, {Myth. ) noms de quelques dieux qu’on pré-
tendoit être nés dans Athènes. Nom d’honneur affe&é aux
fils & aux freres des rois de Chypre. I. 396. b.
ANADARA , ( Conchyl. ) coquillage bivalve, du genre de
ceux qu’on appelle arche de Noé. Lieux où il fe trouve. Sa defeription.
Auteurs à confiilter. Suppl. I. 380. b.
ANADIPLOSE , ( Gramm. ) figure. Exemples. I. 396. b.
A n a d ip l o s e , figure de diélion. V. 744. é.
ANADYOMENE, ( Hifl. anc. | tableau de Vénus peint par
Apelle. 1. 397. 4.
ANADYOMENE , ( Hifl. de l'art antiq. Peint. Sculpt. ) tableau
<TApelle repréfentant Vénus Anadyomene. Signification de
cette épithete. Naiffance de cette déeffe. Traduéuon de quatre
épigrammes fur ce tableau , tirées de l’anthologie. Suppl. I.
381. 4. Réflexions relatives à la peinture que dut naturellement
produire la contemplation de ce chef-d’oeuvre. Les
afrions &lesdifpofitions véritablement agréables en peinture,
doivent être fimples & néceffaires ; alors elles plaifent fans
frapper. La pofition dont Apelle a fait choix pour exprimer
fa Vénus forçant de la mer, eft le plus grand exemple de ces
grâces produites par la jufteffe & la fimplicité. Le fculpteur
qui' travailla fa figure de bronze antique , dont on trouve la
repréfentation, Çplanch. I. des Antiquités. SuppL ) a faifi le
même caraélere & la même exprefiion. Ibid. b. Éloge du
tableau d’Apelle. Plus on étudie les anciens , plus on eft
frappé du mérite & de la fupériorité des Grecs. Éloge du
mémoire de M. de Caylus fur la Vénus Anadyomene d’Apelle.
Parallele de ce tableau avec celui du Titien , qui repréfente
Vénus effuyant fes cheveux, feule, & dans l’eau jufqu’au
defïous de la ceinture. Bronze antique regardé par M. le comte
de Caylus comme une imitadon du tableau d’Apelle. Ibid.
382.4.
Anadyomene, fur nom de Vénus. XVII. 36. a. Tableau de
iVénus Anadyomene. Ibid. b.
ANADY Îl, ( Géogr.j riviere de l’Afie, au nord-eft. Suppl.
I. 636. b. 637. 4 , b. 638.4.
ÀNADYRSKOI, Cap , ( Géogr. | Suppl. I. 637. b.
ANÆTIS| ( Myth.) déeffe adorée jadis par les Lydiens,
les Arméniens & les Perfes. Ce qui concernoit fon culte &
fa fête. Cette fête fut inftituée en mémoire de la maniéré
fmguliere dont Cyrus vainquit les Saces , peuples de Scythie.
Statue de la déeffe. Débris de cette ftatue. I. 397. a.
A næ t is , Anaïtis & Anitis , dont on a fait un fécond arri-
cle dans l’Encyclopédie, font la même déeffe ; favoir Diane.
Elle eft encore nommée Nanée, ou Diane d’Elimaïs. Suppl. I.
382. b.
A n a e t i s . V ?yez N an é e . XI. 12. b. 8c D ia n e P e r s iq u e .
XII. 419. é.Sa fête célébrée àBabylone. XIV. 4 7 1 . b. Son temple.
XVI. 67. 4.
AN A G N IE & A g n a n ie , font la même v ille d’I ta lie ,
dont il étoit inutile de frire deux articles dans l’Encyclopédie.
Suppl. I. 382. b.
^ ÄNAGOGIES, fêtes de Vénus célébrées à Eryce en Sicile.
ANÀGOGIQUE ,fins I ( Crhlq.facr.) XV. 21.1. 29. a. V.
36(^b. - - - ^ '
æ N AGRAMME , ( Belles-lettr. ) étymologie de ce mot.
Divers anagrammes cités. I. 397. b. Réglés de l’anagramme.
Qui en fut l’inventeur chez les modernes, 8c qui font ceux
qui s’y font exercés. Deux maniérés de faire des anagrammes.
Deux anagrammes heureufement trouvées. Celles qu’on
appelle mathématiques , les numérales, ou chronogrammes.
Ibid. 398.4.
Anagramme, .on s’eft fervi de ce jeu d’efprit pour amener
ou l’éloge ou la fatyre de la perfonne dont le nom donnoit
1 anagramme. Efpece d’anagramme exécutée par des danfeurs
en 1 honneur de Staniflas , qui, dans la fuite , devint roi de
Pologne. Suppl. I. 382. b.
Anagramme, la fcience des anagrammes dépend de celle
des combinaifons. DL 664. b. XIL 388. 4. L’abus de l’ana-
| j | : r c gardé comme une des fources de la mythologie.
ANAGYRIS, {Botan.) genre de plante. Ses différensnoms.
Caractère générique. Defeription de Tunique efpece de ce
genre qui nous foit connue. Lieux où croît cette plante. Sa
euhure. Mamere de la multiplier. Suppl. I. 383.4.
ANAGYRUS, ( Géogr. & Myth. ) bourg de l’Attique. Anecdote
fur le dieu appellé Anagyrus. 1. 398. b.
ANALEMME , (Aftron. ) efjjece de planifphere. Ufage de
cette machine. 1. 398. b. On appelle auffi analemme, le trigône
des lignes , utile a ceux qui tracent des cadrans. Ibid. 208 a
ANALEPTIQUES, {Médec. ) remedes deffinés à rétablir
les forces. Comment ik agiffent. Dans quels cas ils font falu-
taîres. Quand on doit s’en abftenir.Indication des principaux,
tirés des végétaux, des animaux , & autres fuhftances I
399-
Tome l , ..............
R e s t a u r a t ^ ^ ^ ’ ^7 ^ R e c o u vr em en t des forces, 8c
ANALOGIE , (Logiq. & Gramm.) étymologie du mot.
i r l 9î ' , a' Rajfonnemens fondés fit? l’analogie.
Ibii. b La réglé de 1 analogie n’eft pas une tcgje de certitude ;
mats elle forme fouvent une grande probabilité. En matière
de foi on ne doit point raifonner par analogie. Ce que c’eft
que l’analogie en grammaire. Ibid. 400. a. Ufage de ce mot en
mathématique & en médecine. Ibid. b.
Analogie. Voyez In d u c t io n . De quel principe fe déduit la
juftefle des conclufions que nous tirons de l’analogie. Utilité
de cette voie de connoiflânees. III. 894. b. C ’eft en joignant
l’analogie au témoignage des fens, que nous nous aflurons
de la vérité des chofes. XV. 27. a. De l ’ufage de l’analogie
en phyfique. VI. 301. b.Suppl. IV. 322. a , b .786.'a,b. De
fon ufage en matière grammaticale. IV. 641. b. Elle peut fervir
a décider entre deux locutions , quelle eft ceUe qu’on doit
admettre. XVII. 5 *81 b.
A n a lo g i e , ( Belles-lettc. ) par l’analogie du ftyle en lui—
meme on entend l unité de ton & de couleur. Le ton le
plus aifé a prendre & à foutenir, après celui du bas pen-
ple , c e ll le ton de la haute éloquence & delà hautepoéfie.
Le plus diffiede à faifir & a obferver avec jufteffe, eft celui
du familier noble: C’eft pourquoi un ouvrage dans ce genre
ne peut être bien écrit, dans notre langue, qu’à Paris, &c.
C eft enccn-e moin^ par la diverfité des tons, que par l’in-
c™ ï e, & la vanation continuelle de leurs limites , qu’il
elt difhcde d obfeiyer, en écrivant, une parfiiite analogie de
ftyle. A mefure qu une langue fe polit, & que le goût s’épure,
les divers ftyles s’affoibüffent , & leur cerclé fe rétrécit!
Peut-etre les langues anciennes avoient-elles des tons auffi
variés que la nôtre ; mais la gêne a laquelle les anciens;
étoient fournis par rapport à Panalogie , n’eft pas fenfiblé
pour nous. Ibid. b. Efpece d analogie entre l ’expreflion & la
F , ■ ’a1 ,- lorf9uau ®9ÿ§S des termes imitatifs, qg peint
le bruit & le mouvement d’un objet ; 2”. lorfque, par /harmonie
& le colons , on en peint le cataftere idéal ou fenfi-
a I v S‘e hajutude , celle que des impreffions répétées
ont établies entre les fignes de nos idées, éc nos idées elles-
memes. Ibid. 384 a. L analogie des mots entr’eux n’eft pas
tou,ours une raifon de les appliquer à des idées analogies
entr elles . 1 ufage à cet égard n’eft pas conféquent. Dans
certaines circonftances, .1 n’eft pas avantageux d’employer
le mot propre ou d habitude ; mais il finit ufer des termes
métaphoriques ou de circonlocution. Le cas particulier où le
îü.0t i f r? pra 3 1 « % " e.Peut «tre foppléé, c’eft dans
les chofes de fentiment. Affoibliffement que fouffre lapenfée
eft h V t â ^ I b id S ™ 6 dîmS Une langUC étranSere-QueUe en
A n a l o g u e , ( Gramm.) les langues diftinguées en analo-
gties &xeii tranfpofinves : obfervations fur les premières,
v m . 853. b IX. 258. a b. 263. b. 264. b. 26,. a.XVI. 561. ¿i
Termes analogues. XVI. i j 6. b.
ANALYSE, ( Math. Arithm. Algeb. ) méthode de réfoudre
les problèmes mathématiques, en les réduifant à des équations.
Son utilité. I. 400. b. Elle fe divife en analyfo des quantités
limes & celle des infinies. Anciens auteurs d’andyfc
Principaux auteurs fur l’analyfe des infinis. Obfervations
fur 1 analyfe démontrée du P. Reyneau. Ibid. 401. a.
Analyfe , (Mathimat. ) de la méthode des anciens tié S -
muon que Pappus donne de l’analyfe. Son but eft de décou-
vnr la vénté , ou de trouver le moyen d’exécuter ce qu’on
seft propofé : ainfi on la dilhngue en théorétique 8b problématique.
Suppl. 1. 385. u. Les anciens n’avoient rien quireffem-
. ù notre calcul : ils pranquoient leur analyfe à force de .
tete. Comment ils en avoient diminué la difficulté. Ce ma
nous relte des écrits analytiques des anciens. Parallèle de
leur méthode analytique avec celle des modernes. Ibid b
Avantages de nos calculs. On en tireroit un plus grand"
parti, (1 I on Éufolt plus d’ufage de quelques théorème que
les anciens nous ont biffés. Tels font fur-tout ceux qui font
contenus dans le livre des Data d’Eudide. Obfervations fur
la nature de ces data. Les propofirions qu'on trouve dans
ce livre , fervent d’abord à frire voir quelles conditions,
d un problème font fuperfiues, parce qu'elles font néceflai-
rement renfermées dans les autres. Enfuite les mêmes pro-
pofitions font utiles à ré foudre plufieurs problèmes géométriques,
fans beaucoup de difficulté. Exemple de cette fécondé
utilité. Solution des problèmes 4 - 1 0 , de l’arithmétique uni-
verfelle de Newton, par la propofition 67 de ce livre Ibid
386. 4.
AmUyfe ,• hiftoire de l’analyfe. I. 260.161. En quoi con- '
fiftoit celle des anciens I. 677. b. IV. 10.4. ¿.différence
mitre 1 algèbre & 1 analyfe & entre l’analyfe en géométrie ,
& 1 analyfe en logique. VII. 637. b. Application Se l’analyfo '
à la géométrie. I. 5,5.0, b. 677. b. VI1. 637. | Service que.
Defcartes a rendu en cela à la géométrie. I. 550. b. Avan-
tages des calculs algébriques appliqués à la géométrie. I. 677 b
Application de l’analyie- 8c de la géométrie à la phyfique,' L