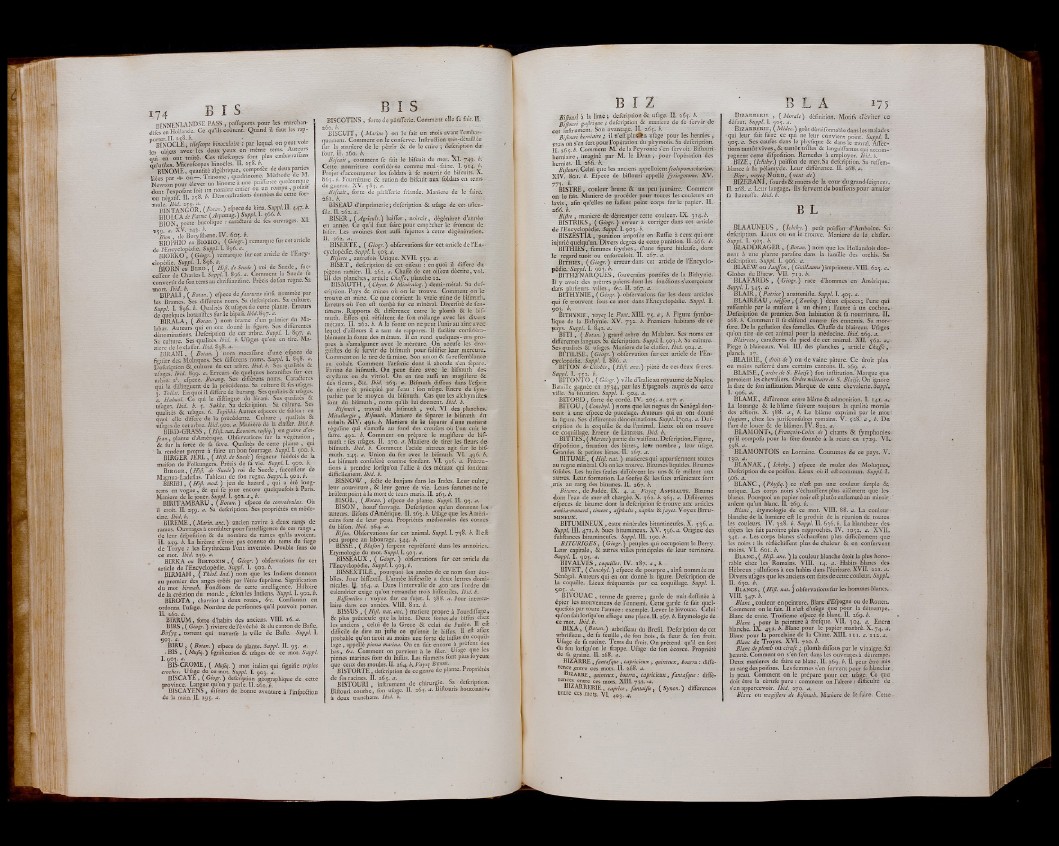
174 BIS BINNENLANDSE PASS , paffeports pour les marchan-
dife en Hollande. Ce qu’ils coûtent. Quand il faut les rapporter.
II. b. * ,
BINOCLE, têlefcope binoculaire : par lequel on peut voir
les objets avec-les deux yeux en même tems. Auteurs
qui en ont traité. Ces tèlefcopes font plus embarraffans
au’unies. Microfcopes binocles. II. 258. b.
BINOME , quantité algébrique, compofée de deux parties
liées par ■+■ óu—. Trinôme, quadrinome. Methode de M.
Newton pour élever un binôme à une puiflance
dont l’expofant foit un nombre entier ou un rompu, pofinf
ou négatif. II. j p É Démonflrauons données de cette for-
TOIB IN T A n S S r , {Botan. > efpece de kina. Suppl. II. 447-b-
BIOLCA de Parme (Arpentag.| Suppl. I. 566. b.
g ION , poete bucolique : caractère de les ouvrages, a i .
3>o a, Xv. 143*
Bion , de Botyllhene. IV. 605. g
BIOPHIO ou B io b io , ( Géogr. ) remarque fur cet article
¿e l’Encyclopédie. Suppl. 1. 896. a.
BIORKO , {Géogr.) remarque fur cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. I. 896. a.
BIORN ou Bero , ( Hiß. de Suede ) roi de Suede, fuc-
ceffeur de Charles I. Suppl. g 896. a. Comment la Suede fe
convertit de fon tems au chriftianifme. Précis de fon regne. Sa
mort. Ibid. b. .
BIP A LI, ( Botan. ) efpece de faururus amfi nommee par
les Brames. Ses différens noms. Sa defeription. Sa culture.
Suppl. I. 896. b. Qualités 8t ufages de cette plante. Erreurs
de quelques botaniftes fur le bipali. Ibid. 897. a.
BIRALA, ( Botan. ) nom brame d’un palmier du Malabar.
Auteurs qui en ont donné la figure. Ses différentes
dénominations. Defeription de cet arbre. Suppl. I. 897. a.
Sa culture. Ses qualités. Ibid. b. Ufages qu’on en tire. Maniere
de le claffer. Ibid. 898. a. .
BIRANI, i Botan. ) ' nom macaffare d’une efpece de
figuier des Moiuques. Ses différens noms. Suppl. I. 898. a.
Defeription &.culture de cet arbre. Ibid. b. Scs qualités 8c
ufages. Ibid. 899. a. Erreurs de quelques botaniftes fur cet
arbre: 2e. efpece. Burang. Ses différens noms. Carafteres
qui la diftinguent de la précédente. Sa culture & fes ufages.
3. TolLit. En quoi il différé de burang. Ses qualités & ufages.
4. Hahuol. I Ce qui le diftingue du birani. Ses qualités &
. ufages. Ibid. b. I l Sakka. Sa defeription. Sa culture. Ses
qualités & ufages. 6. Topikki. Autres efpeces de fakka : en
quoi elle différé de la précédente. Culture , qualités &
ufages de cet arbre. Ibid. 900. a. Maniere de la claffer. Ibid. b.
BIRD-GRASS , (Hift. nat. Économ.ruftiq.) ou graine d’oi-
feau, plante d’Amérique. Obfervations fur la végétation ,
& fur la force de fa feve. Qualités de cette plante , qui
la rendent propre à faire un bon fourrage. Suppl. I. 900. b.
BIRGER JERL, {Hiß. de Suede) feigneur fuédois de la
maifon de Folkungers. Précis de fa vie. Suppl. I. 900.. b.
Bir g e r , {Hiß. de’Suede) roi de Suede, fucceffeur de
Magnua-Ladeilas. Tableau de fon regne. Suppl. I. 901. b.
BIRIBI, ( Hiß. mod. ) jeu de hazard , qui a été long-
tems en vogue, & qui fe joue encore quelquefois à Paris.
Maniere de le jouer. Suppl. 1. 902. a , b.
BIRITAMBARU , ( Botan. ) efpece de convolvulus. Ou
il croit. II. 259. a. Sa defeription.- Ses propriétés en médecine.
Ibid. b. v
BIREME, {Marin, anc.) ancien navire à deux rangs de
rames. Ouvrages à confulter pour l’intelligence de ces rangs ,
de leur difpofition & du nombre de rames qu’ils avoient.
II. 259. b. La birême n’étoit pas connue du tems du liege
de Troye : les Erythrèens l’ont inventée. Double fens de
ce mot. Ibid. 259. a.
BIRKA ou Birtoxin , ( Géogr. ) obfervations fur cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. I. 902. b.
BIRMAH, ( Théol. Ind. ) nom que les Indiens donnent
au premier des anges créés par l’être fuprême. Signification
du mot bïrmah. Fondions de cette intelligence. Hifloire
de la création du monde, félon les Indiens. Suppl. I. 902. b.
BIROTA , charriot à deux rôties, &c. Conftantin en
ordonna l’ufage. Nombre de perfonnes qu’il pouvoit porter.
IL 260. a.
B1RRUM, forte d’habits des anciens. VIII. 16. a.
BIRS, I Géogr. I riviere de l’évêché & du canton de Balle,
Birfyg, torrent qui traverfe la ville de Balle. Suppl. I.
W m ß { Botan. ) efpece de plante. Suppl. II. 93. a.
.BIS , (Mufiq.) lignification & ufages de ce mot. Suppl.
L'903. a.
BIS-CROME, ( Mufiq. ) mot italien qui fignifie triples
croches. Ufage de ce mot. Suppl. I. 903. a.
BISCAYE, {Géogr.) defeription géographique de cette
province. Langue qu’on y parle. II. 260. b.
BÏSCAYENS, difeurs de bonne aventure à l’infpedion
de la main. IL 295. a.
B I S
BISCOTINS , forte de pâdfferie. Gomment clic fe fait. II.
260. b. . .. v ;
BISCUIT, ( Marine ) on le fait un rfiois avant 1 embarquement.
Comment on le conferve. Inftru&ion très-détaillée
fur la maniéré de le pétrir & de le cuire ; defeription du
four. II. 260. b. .
Bifeuit, comment fe fait le bifeuit de mer. XI. 749- I l
Cette, nourriture confidérêe comme mal-faine. I. 914. b.
Projet d’accoutpmer les foldats à fe nourrir de bifeuits. X.
863. b. Fourniture Sc ration de bifeuit aux foldats en tems-
de guerre. XV. 583. a.
Bifeuit t forte .de pâtifferie friande. Maniéré de le faire.
261. b.
BISEAU d’imprimerie; defeription & ufage de cet-uften-
. file. II. 262. a.
BISER , {Agricult.) baiffer, noircir, dégénérer d’année
çn année. Ce qu’il faut faire pour empêcher le froment de
bilèr. Les avoines font auûi fujettes a cette dégénération.
II. 262. a.
BISERTE, {Géogr.) obfervations fur cet article de l’En--
cyclopédîe. Suppl.I. 903.a.
Biferte , autrefois Utique. XVII. 339. a.
BISET, defeription de cet oifeau : en quoi il diffère du ■
>igeon ramier. II. 262. a. Chaffe de cet oifeau décrite, vol.
II des planches, article Chajfe, planche 12.
BISMUTH , {Chym. & Minéralog.) demi-métal. Sa defeription.
Pays & mines où on le trouve. Comment on le
trouve en mine. Ce que contient la vraie mine de bifmuth.
Erreurs où l’on eft tombé fur ce minéral. Diverfitè de fen-
timens. Rapports & différence entre le plomb & le bifmuth.
Effets qui réfultent de fon mélange avec lés divers
métaux. IL 262. b. A la fonte on ne peut l’unir au zinc avec
lequel d’ailleurs il a tant de rapports. Il facilite confidéra-
blement la fonte des métaux. Il en rend quelques - uns propres
à s’amalgamer avec le mercure. On accufe les dro-
guiftes de fe fervir de bifmuth pour falfifier leur mercure.
Comment on le tire de famine. Son union & fa reffemblance
au cobalt. Comment l’arfenic dont il abonde s’en fépare.
Farine de bifmuth. On .peut faire avec le. bifmuth des
cryftaux ou du vitriol. On en tire auffi un magiftere &
des fleurs, &c. Ibid. 263. a. Bifmuth diffous dans l’efpric
de nitre & précipité par l’eau : fon ufage. Encre de fym-
pathie par le moyen du bifmuth. Cas que les alchymiftes-
font du bifmuth , noms qu’ils lui donnent. Ibid. b.
Bifmuth , travail du bifmuth , vol. VI des planches.'
Métallurgie , Bifmuth. Maniéré de féparer le bifmuth du
cobalt. XlV. 491. b. Maniéré de le léparer d’une matière
réguline qui s’amaffe au fond des creufets où l’on cuit le
faire. 492. b. Comment on préparé le magiftere de bifmuth
: les ufages. II. 270. a. Maniéré de tirer les fleurs de
bifmuth. Ibid. b. Comment l’acide nitreux agit fur le bifmuth.
245. a. Union du fer avec le bifmuth. VI. 496. b.
Le bifmuth confidéré comme fondant. VI. 916. a. Précautions
à prendre lorfqu’on l’allie à des métaux qui fondent,
difficilement. Ibid. b.
BISNOW , fefte de banjans dans les Indes. Leur culte,‘
leur nourriture, & leur genre de vie. Leurs femmes ne fe
brûlent point à la mort de leurs maris. II. 263. b. .
BISOL, (Botan. ) efpece de .plante. Suppl. II. 93. a.
BISON, boeuf fauvage. Defeription qu’en donnent les ;
auteurs. Bifons d’Amérique. II. 263. b. Ufage que les Américains
font de leur peau. Propriétés médicinales des cornes'
du bifon. Ibid. 264. à. • > ■
Bifon. Obfervations fur cet animal. Suppl. I. 758. b. Il eft
peu propre au labourage. 344. b.
BISSE , ( Blafon) ferpent repréfenté dans les. armoiries.
Etymologie du mot. Suppl. 1. 903. a.
BISSÉAUX, ( Géogr. ) obfervations fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. \. 903. b.
BIoSEaTILE , pourquoi les années de ce nom font éta-:
blies. Jour biffextil. L’année biffextile a deux lettres domi- -
ni cales. JJ. 264. a. Dans l’intervalle de 400 ans l’ordre du
calendrier exige qu’on retranche trois biffextiles. Ibid. b.
Bïffextiles : voyez fur ce fujet. I. 388. a. Jour intercalaire
dans ces années. VIII. 812. b.
. BISSUS , (Hift. nat.anc.) matière propre à l’ourdiffage,
& plus précieufe que la laine. Deux fortes «de biffus chez
les anciens , celui de la Grece & celui de Judée. 11 eft
difficile de dire au jufte ce qu’étoit le biffus. Il eft affez
probable qu*on tiroit au moins une forte de biffus du coquillage
, appcllé p'tnna marina. On en fait encore a préfent des
bas, &c. Comment on parvient à le filer. Ufage que les
pinnes marines font du biffus. Les filamens font plus foyeux
que ceux des moules. II. 264. b. Voye£ Bysse.
BISTORTE, defeription de ce genre de plante. Propriétés
de fes racines. H. 263. a. , . _ , . . *
BISTOURI, infiniment de chirurgie. Sa defeription.
Biftouri courbe, fon ufage. II. 263. a- Bdtouns boutonnes*
à deux tranchans. Ibid. b.
B I Z
Biftouri à la lime ; defeription & ufage. II. 263. b.
Biftouri gajlrique ; defeription & maniéré de fe fervir de
cet infiniment. Son avantage. II. 263. b.
Biftouri herniaire ; il n’eft pluafen ufage pour les heriliés *
mais on s’en fert pour l’opération du phymofis. Sa defeription.
II. 263. Comment M. de la Peyronie s’en fervoit. Biftouriherniaire,
imaginé par M.-le Dran, pour l’opération des
hernies. II. 266. b.
Biftouri. Celui que les anciens appelloient fcolopomacharion.
XIV. 801. b. Efpece de biftouri appellé fyringotome. XV.
B i s t r e , couleur brune & un peu jaunâtre. Comment
on le fait. Maniéré de procéder pour toutes les couleurs en
lavis, afin qu’elles ne faffent point corps furie papier. II.
266. b.
Biftre, maniéré de détremper cette couleur. IX. 314. b.
BISTRIKS, ( Géogr. ) erreur à corriger dans cet article-
de l’Encyclopédie. Suppl. I. 903. b.
BISZÉSTIA, punition impofée en Ruflie à ceux qui ont
injurié quélqu’un. Divers degrés de cette punition. II. 266. b.
BITHIES, femmes fcythes,-d’une figure hideufe, dont
le regard tuoit ou enforceloit. II. 267. a.
B ithïes, {Qéogr.) erreur dans.cet article de l’Encyclopédie.'
Suppl I. 003 . b.
BITHj NARQUES, fouverains pontifes de la Bithynie.
Il y avoit des prêtres païens dont-les fonéüons s’exerçoient
dans plufieurs villes , &c. II. 267. a.
BITHYNIE, (Géogr. ). obfervations fur les deux articles
qui fe trouvent fous ce mot dans l’Encyclopédie. Suppl. I.
Bithynie , voyei le Pont. Xül. 73. a , b. Figure fymbo- •
îique de la Bithynie. XV. 732. b. Premiers habitans de ce:
pays. Suppl. I. 842. a.
B IT I, {Botan.) grand arbre du Malabar. Ses noms en
différentes langues. Sa defeription. Suppl. I. 903. b. Sa culture.
Ses qualités & ufages. Maniéré de le claffer. Ibid. 904. a.
B1TILISE, {Géogr.) obfervation fur cet article.de l’En--
cyclopédie. Suppl. 1. 886. a.
BITON & Clcobis, {Hift. anc.) piétc de ces deux freres.
Suppl. I. 332. b.
BITONtO , ( Géogr. ) ville d’Italie au royaume de Naples.
Bataille gagnée en 1734, par les Efpagnols. auprès de cette
ville. Sa fituation. Suppl. I. 904. a.
BITORD, forte de. corde. IV. 203. a. 217. a.
BITOU, ( Conchyl. ) noms que les negres du Sénégal don-'
nent à une efpece de pucelage. Auteurs qui en ont donné
la figure. Ses différentes dénominations. Sapp/.I.*904. <1. Defeription
de la coquille 8c de l’animal. Lieux où on trouve
ce coquillage. Erreur de Linnæus. Ibid. b.
BITTES, |Marine) partie du vaiffeau. Defeription. Figure,
difpofition , fituation aes bittes, leRr nombre , leur ufage.
Grandes 8c petites bittes. EL 267. a.
BITUME, ( Hift. nat. | matières qui appartiennent toutes
au regne minéral. Où on les trouve. Bitumes liquides. Bitumes
folides. Les huiles feules diffolvent les uns 8c fe mêlent aux
autres. Leur, formation. Le foufre 8c lesfucs arfénicaux font
.mis au rang des bitumes. II. 267. b.
Bitume, de Judée. IX. 4. a. Voyej A sphalte. Bitume
dont l’eau de mer eft chargée. X. 362. b. 363. a. Différentes
efpeces de bitume dont la defeription fe trouve aüx articles
ambia-monard, ciment, afphalte, naphte 8cjayet. Voyez BITUMINEUX.
BITUMINEUX , eaux minérales bitumineufes. X. 336. a.
Suppl. III. 471. b. Sucs bitumineux. XV. 396. a. Origine des
fubftances bitumineufes. Suppl. III. 190. b.
BITURIGES, ( Géogr. ) peuples qui occupoient le Berry.
Leur capitale, & autres villes principales de leur territoire.
Suppl: I. 903. a.
BIVALVES, coquilles. IV. 187. a y b. .
BIVET, ( Conchyl. ) efpece de pourpre , ainfi nommée au
Sénégal. Auteurs qui en ont donné la figure. Defeription de
la coquille. .Lieux fréquentés par ce coquillage. Suppl. I.
903. a.
BIVOUAC , terme de guerre; garde de-nuit deftinée a
épier les mouvemens de l’ennemi. Cette garde fe fait quel- •
quefois par toute l’armée : exemple. Lever le bivouac. Celui '
qu’on fait lorfqu’on affiege une place. II. 267. b. Etymologie de
ce mot. Ibid. b.
BIXA, {Botan. ) arbriffeau du Brefil. Defeription de cet
arbriffeau , de fa feuille, de fon bois, fa fleur 8c fon fruit.
Ufage de fa racine. Tems du fruit. On prétend qu’il en fort
du feu lorfqu’on le frappe. Ufage de ion écorce. Propriété
de fa graine. II. 268. a.
BIZARRE, fantafque, capricieux , quinteux, bourru : différence
jîntre ces mots. II. 268. a.
Bizarre , quinteux , bourru, capricieux , fantafque : diffé-
■bÜI AC« tre ces mots- XIII. 722. *a.
BIZARRERIE caprice, fantaifie. {Synon.) différences
fernre ces mots. VI. 403. a.
B L A 175
B i z a r r e r i e , {Morale) définition. Motifs d’éviter ce
défaut. Suppl. I. 903. a.
Biza rrerie, {Médec.) goût déraifonnablc dans les malades
•qui leur fait faire ce qui ne leur convient point. Suppl. L
903. a. Ses caufes dans le phyfique 8c dans le moral. Affections
tantôt vives, 8c tantôt trilles 8c languiffantes qui accom- •
pasnent cette dilpofition. Remedes à employer. Ibid. b.
BIZE, |Ichthy.) poiffon de mer. Sa defeription. Sa reffem-,
blance à la pélamyde. Leur différence. II. 268. a.
Biçe, voyez N o r d , (vent de)
BIZEBANi, fourds & muets de la cour du grand-feigneur.
II. 268. ¿. Leur langage.-Ils fervent de bouffons pour amufer
fa haùteffe. Ibid. b.
B L
BLAAUNEUS , | Ichthy. ) petit poiffon d’Amboine. Sa '
defeription.. Lieux où on le trouve. Maniéré de le, claffer.
Suppl. I. 903. b.
BLADDRAGER, (Botan. ) nom que les Hollandois donnent
à une plante parafite dans la famille des orchis. - Sa
defeription. Suppl. I. 906. a.
BLAEW ou Janjfon., ( Guillaume ) imprimeur.- VIII. 623. -a.'
Globes de Blaew. VII. 711. b.
' BLAFARDS , (Géogr.) race d’hommes en Amérique:
Suppl. I. 343. a.
BLAlK, (Patrice) anatomifte. Suppl.X. 403. a.
BLAIREAU, taijfon, (Zoolog. ) deux efpeces; l’une qui
reffemble par le mufeau a un chien ; l’autre à un cochon. :
Defeription du premier. Son habitation & I l nourriture. II.
268. b. Comment il fe défend contre les ennemis. Sa mor--
fure. De la geftation des femelles. Chaffe du blaireau. Ufages
qu’on tire de cet. animal pour la médecine. Ibid. 269. a. ■
Blaireau, cara&eres du pied de cet animal. XII. 362. a.>
Piege à blaireaux. Vol. III. des planches , article Chaffe, •
planch. 17.
B LAI RIE, (droit de) ou de vaine pâture. Ce droit plus
où moins refferré dans certains cantons. II. 269. a.
BLAISE, ( ordre de S. Blaife) fon inftitution. Marque que
p.ortoient les chevaliers. Ordre militaire de S. Blaife. On ignore
la date de fon inftitution. Marque de cette chevalerie. Suppl.
I. 006. a.
BLAME, différence entre blâme 8c admonition. I. 141. a.-
La louange 8c le blâme fuivent toujours la qualité morale
des aftions. X. 388. a t b. Le blâme exprimé par le mot '-
elogium, chez les jurifconfultes romains. V. 328. a , b. De
l’art de louer 8c de blâmer. IV. 822. a.
BLAMONT», (François-Coliri de) chants 8c fymphonies.
qu’il compofa pour la fête donnée a la reine en 1729. VI»-
398. a.
BLAMONTOIS en Lorraine. Coutumes de ce pays. V.
130. a.
BLANAK, I Ichthy. ) efpece de mulet des Moluques, ’
Defeription de ce poiuoii. Lieux où il eft commun. Suppl. I.
906. a.
BLANC, (Phyfiq.) ce n’eft pas une couleur fimple &
unique. Les corps noirs s’échauffent plus aifément que les
blancs. Pourquoi un papier noir eft plutôt enflammé au miroir -
ardent qu’un blanc, il. 269. b.
Blanc, étymologie de ce mot. VIII. 88. a. La couleur •
blanche de la lumière eft le produit de la réunion de toutes
les couleurs. IV. 328; b. Suppl. II. 636. b. La blancheur des-
objets les fait paraître plus rapprochés. IV. 1032. a. XVII.
341. a. Les corps blancs s’échauffent plus difficilement que-
les noirs : ils rêfléchiffent plus de chaleur 8c en confervent
moins. VI. 601. b.
Blanc , ( Hiß. anc. ) la couleur blanche étoit la plus hono- -
râble chez les Romains. VIII. 14. a. Habits blancs des
Hébreux : allufions à ces habits dans l’écriture. XVII. 221. a.
Divers ufages que les anciens ont faits de cette couleur. Suppl.
II. 630. b.
Blancs , (Hiß. nat. ) obfervations fur les hommes blancs..
Vni. 347. b.
Blanc , couleur en peinture. Blanc d’Efpagne ou de Rouen.
Comment on le fait. Il n’eft d’ufage que pour la détrempe.
Blanc de craie. Troifieme efpece ae blanc. H. 269. b.
Blanc , pour la peinture à frefque. VII. 304. a. Encro
blanche. IX. 43 â. b. Blanc pour le papier marbré. X..74. a.
Blanc pour la porcelaine de la Chine. XIII. m . a. 112. a.
Blanc de Troyes. XVI. 720. b.
Blanc de plomb ou cérufe ; plomb diffous par le vinaigre. S i
beauté. Comment on s’en fert dans les ouvrages à détrempe.
Deux maniérés de faire ce blanc. II. 269. b. fi peut être mis
au rang des poifons. Les femmes s’en fervent pour fe blanchir,
la peau. Comment on le prépare pour cet uïagei Ce que
doit être la cérufe pure : comment on l’altere: oifficulté de
s’en appercevoir. Ibid. 270. a.
Blanc ou magiftere de bifmuth. Maniéré, de le faire. Cette -