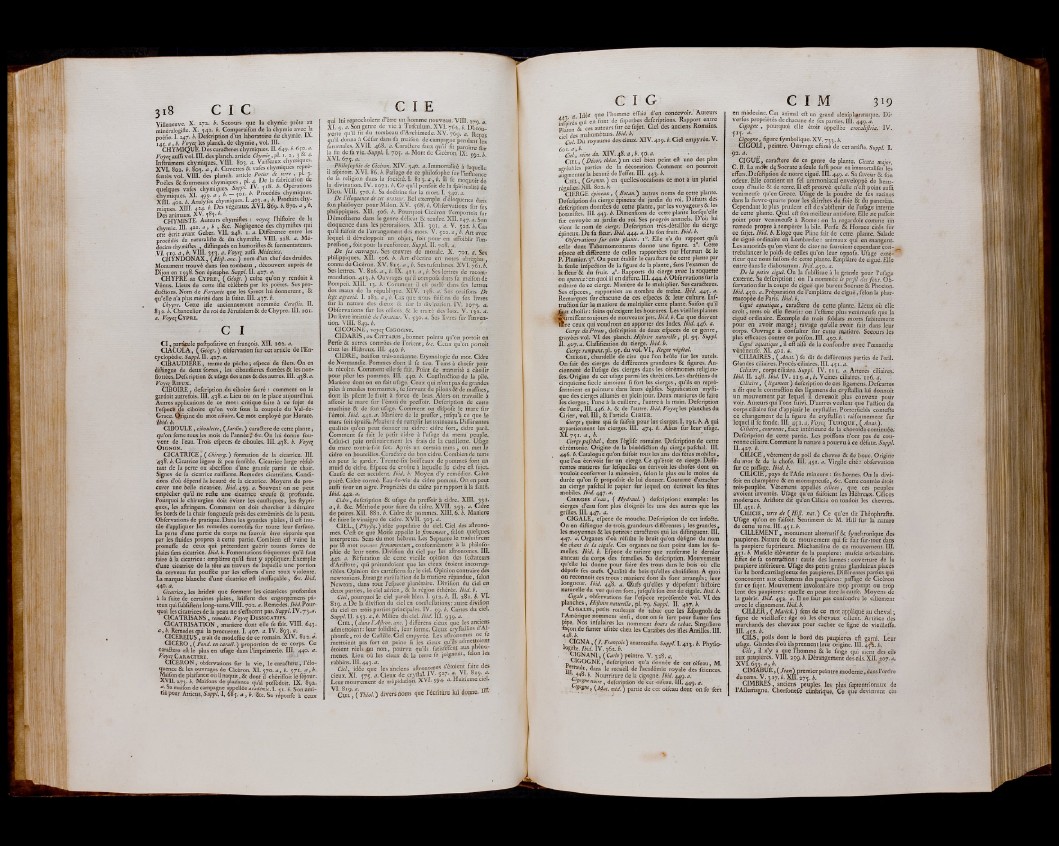
3 i 8 C I C
Villeneuve. X. 272. b. Secours que la chymie prête au
minéralogifte. X. 54a. b. Comparai fon de la chymie avec la
poéfie. I .247* b. Description d’un laboratoire de chymie. IX.
143*a> b. Voyezles planch.de chymie, vol. III.
CHYMIQUE. Des caraéteres chymiques. II. 649. b. 6ço. a.
Voyez aufli vol. III. des planch. article Çhymie, pl. 1. 2, 3 & 4*
Inftrumens chymiques. VIII. 803. a. Vaiffeaux chymiques.
XVI. 802. b. 803. a , b. Cuvettes & vafes chymiques repré-
fentés vol. VIU. des planch. article Potier deterre , pl. 2.
Poêles & fourneaux chymiques, pl. 4- De fabneatio _
quelques vafes chymiques. Suffi. Iv lS 'S - f
chymiques. XL 499. a , H t . !<><• *• Procédés chymiques.
Xm. 402. b. Analyfcs chymiques. I. '¡MMU* P f^ “*“ cl,X‘
miques. xm. 424. i. Des yégéiaux. XVI. 869. é. 870. 4 , t.
Des animaux. XV. j8ç.^. . . ,
C H Y M I S T E . Auteurs chymiftes : 1 hiftoire de la
chymie III. 421. a, b , 8cc. Négligence des chymiftes qui
ont écrit avant Geber. VII. 248. 1. a. Différence entre les
procédés du naturalifte & du chymifte. VIU. 228. «, Médecins
chymiftes , diftingués en humoriftes & fermentateurs.
VJ. «9. a , b. VIU. 353. a. Voye{ aufli Médecins.
CHYNDONAX, (Hift. anc. ) nom d’un chef des druides.
Monument trouvé dans fon tombeau , découvert auprès de
Dijon en 1598. Son épitaphe. Suppl. U. 427. a.
CHYPRE ou C y p r e , ( Géoêr. ) culte qu’on y rendoit à
Vénus, lieux de cette iflé célébrés par les poëtes. Ses pro-
duélions. Nom de Fortunée que les Grecs lui donnèrent, &
qu’elle n’a plus mérité dans la fuite. UI. 437. b.
Chypre. Cette ifle anciennement nommée Ceràftis. IL
$32. b. Chancelier du roi de Jérufalem & de Chypre. 111. xoi.
a. Voyt{ C y p r e .
C I
C I , particule poftpofitive en françois. XII. 102. a.
CIACOLA, IGéogr.) obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 427. a.
CIBAUDIERE, terme de pêche ; efpece de filets. On en
diftingue de deux fortes» les cibaudicres flottées & lesnon-
flottées. Defcription 8c ufage des unes & des autres. lU. 438. a.
VoyézKiEVX.
CIBOIRE, defcription .du ciboire facré : comment on le
gardoit autrefois. III. 438. a. Lieu où on le place aujourd’hui.
Autres applications de ce mot : critique faite à ce fujet de
l’efpeéfe de ciboire qu’on voit fous la coupole du Val-de-
Gracc. Qrigine du mot ciboire. Ce mot employé par Horace.
ïbid.b.
CIBOULE, ciboulette, (Jardin.) caraétere de cette plante »
qu’on feme tous les mois de l’année f &c. On lui donne fou-
vent de l’eau. Trois efpeces de ciboules. 1U. 438. b. Voyeç
O ig n o n .
CICATRICE ,* ( Chirurg. ) formation de la cicatrice. IU.
■438. b. Cicatrice légère 8cpeu fenflble. Cicatrice large réful-
tant de la perte ou abceflion d’une grande partie de chair.
Signes de la cicatrice naiffante. Reme des cicatrifans. Conditions
d’où dépend la beauté de la cicatrice. Moyens de procurer
une belle cicatrice. Ibid. 439. a. Souvent on ne peut
empêcher qu’il ne refte une cicatrice creufe 8c profonde.
Pourquoi le chirurgien doit éviter les cauftiques, les ftypti-
ques, les aftringens. Comment on doit chercher à détruire
les bords de la chair fongueufe près des extrémités de la peau.
Obfervations de pratique. Dans les grandes plaies, il eu inutile
d’appliquer les remedes corrofifs fur toute leur furface.
La perte d’une partie du corps ne fauroit être réparée que
par les fluides propres à cette partie. Combien eft vaine la
promeffe de ceux qui prétendent guérir toutes fortes de
plaies fans cicatrice. Ibid. b. Fomentations fréquentes qu’il faut
faire à la cicatrice : emplâtre qu’il faut y appliquer/Exemple
d’une cicatrice de la tête au travers de laquelle une portion
du cerveau fut pouffée par les efforts d’une toux violente.
La marque blanche d’une cicatrice eft ineffaçable, &c. Ibid.
440. a.
Cicatrice, les bride» que forment les cicatrices profondes
à la fuite de certaines plaies, laiffent des engorgemens pâteux
qui fubftftent long-tems.VlII. 702. a. Remedes. Ibid. Pourquoi
les cicatrices de la peau ne s’effacent pas. Suppl. IV. 73.a.
CICATRISANS, remedes. Voyez D e s s ic à t if s .
CICATRISATION, maniere dont elle fe fait. VIII. .643.
ety b. Remedes qui la procurent. I. 407. a. IV. 892. a.
CICEREIUS, trait de modeftie de ce romain. XlV. 812. a.
CICÉRO, ( Fond, en carabi. ) proportion de ce corps. Ce
caraâere eft le plus en ufage dans l’imprimerie. III. 44°* a-
Voyeç C a r a c t è r e .
CICERON, obfervations fur la vie, le caraâere, l’éloquence
8c les ouvrages de Cicéron. XI. 570. at b. 371. a,b.
Maifon de plaifance où il naquit, 8c dont U chériffoit le féjour.
c 73-*- Maifons de plaifance qù’il poffédoit. IX. 892.
ï»a maifon de campagne appellèe académie.I. ci. b. Son ami-
tic pour Atdcus, Suppl, -I, 6% a , b. 8cc. Sa réponfe à ceux
C I E
qui lui reprochoient d’être un homme nouveau. VIÎI. 279. a.
XI. 9. a. Son genre de vie à Tufculum. XVI. 7^1. b. Découverte
qu’il fit du tombeau d’Archimede. XV. 769. a. Repas
qu’il donna à Céfar dans fa maifon de campagne pendant les
faturnales. XVII. 468. a. Caraélcre faux qu’il fit paroitre fur
Ja fin de fa vie. Suppl, I. 705. a. Mort de Cicéron. IX. ||ɧ¡,
XVI. 675. a.
Philofophie de Cicéron. XIV^ 340. a. Immortalité à laquelle
il afpiroit. XVI. 86. b. Pafl'age de ce philofophe fur l’influence
de la religion dans la fociété.I. 813. a , b. Il fe moquoit de
la divination. IV. 1071. b. Ce qu’il penfoit de la fpiritualité de
Dieu. VIII. 570. b. Sa do&rine fur la mort. I. 340. a.
De l'éloquence de cet orateur. Bel exemple d’éloquence dans
fon plaidoyer pour Milon. XV. 568. b. Obfervations fur fes
philippiqucs. XII. <06. b. Pourquoi Cicéron l’emportoit fur
Démofthene dans le genre délicat 8c tendre. XII. 147. a. Son
éloquence dans lesperoraifons. XII. 391. a. V. 522. ¿.Cas
qu’il faifoit de l'arrangement des mots. V. 522. a, b. Art avec
lequel il développoit un objet, foit pour en affoiblir 11m-
preflion, foit pour la renforcer. Suppl. II. 708. a.
De fes ouvrages. Ses oeuvres de morale. X. 701. a. Ses
philippiques. XII. 306. b. Art d’écrire en notes abrégées,
connu de Cicéron. XV. 813. a , b. Ses tufculanes. XVI. 761. ¿.
Ses lettres. V. 816.-4, b. lA. 41-1. Ses lettres de recommandation.
413. b. Ouvrages qu’il compofa dans fa maifon de
Pompeii. XIII. 13. b. Comment il eft parlé dans fes lettres
des maux rie la république. XIV. 138. a. Ses oraifons De
lege agrariâ. I. 182. a, b. Cas que nous fàifons de fes livres
fur la nature des dieux 8c fur la divination. IV. 1073. a.
Obfervations fur les officesv 8c le traité des loix. V. 132. à.
Du livre intitulé de l'orateur. V. <30. a. Ses livres fur l’invention.
VIII. 849. b.
CICOGNe , voyc{ Cigogne.
CIDARiS, ou C it t a r is , bonnet pointu qu’on portoit eh
Perfe 8c autres contrées de l’orient, &c. Ceux qu'on portoit
chez les Hébreux. III. 440. b.
CIDRE, boiffon très-ancienne. Etymologie du mot. Gdre
de Normandie. Pommes dont il fe tire. Tems à choifir pour
la récolte. Comment elle fe fait. Point de maturité à choifir
pour piler les pommes. III. 440. b. Conftruôion de la pile.
Maniéré dont on en fait ufage. Ceux qui n’ont pas de grandes
piles à meules tournantes, fe fervent de pilons 8c de maflùes,
dont ils pilent le fruit à force de bras. Alors on travaille à
afleoir le marc fur l'émoi du preffoir. Defcription de cette
machine 8c de fon ufage. Comment on difpofe le marc fur
l’émoi. Ibid. 441. a. Maniéré de le prefler, jufqu’à ce que le
marc foit épuifé. Manière de remplir les tonneaux. Différentes
qualités qu on peut donner au cidre : cidre fort, cidre paré.
Comment fe tait le petit cidre à l’ufage du menu peuple.
Celui-ci paie ordinairement les frais de la cueillette. Ulagc
du marc tout-à-fait fcc. Après un certain tems, on met le
cidre en bouteilles. Cara&ere du bon cidre. Combien de tems
on peut le garder. Trente-fixboiffcaux de pommes font un
muid de cidre. Efpece de croûte à laquelle le cidre eft fujet.
Caufe de cet accident. Ibid. b. Moyen d’y remédier. Cidre
poiré. Cidre cormé. Eau-de-vie du cidre pommé. On enjpeut
aufli tirer un aigre. Propriétés du cidre par rapport à la famé.
Ibid. 442. a.
Cidre, defcription 8c ufage du preffoir à cidre. XIII. -331.
a, b. 8cc. Méthode pour faire du cidre. XVII. 293. a. Cidre
de poires. XII. 881. b. Cidre de pommes. XIII. 6. b. Maniéré
de. Faire le vinaigre de cidre. XVII. 303. a.
CIEL, ( Phyfiq.) idée populaire du ciel. Ciel des aftrono-
mes. C ’eft ce que Moïfc appelle le firmament, félon quelques
interprètes. Sens du mot hébreu. Les Septante le traduifirent
par le mot üipiwÀ«* firmamentutti, conformément à la philofo-
phie de leur tems. Divifion du ciel par les aftronomcs. IIL
442. a. Réfutation de cette vieille opinion des fcélatcurs
d’Ariftote, qui prétendoient que les cieux étoient incorruptibles.
Opinion des cartéfiens lur le cieL Opinion contraire des
newtoniens. Etrange raréfaftion de la matière répandue, félon
Newton, dans tout l’efpace planétaire. Divifion du ciel en
deux parties, le ciel aérien , oc la région éthérée. Ibid. b.
C/e/, pourquoi le ciel paroît bleu. I. 012. b. II. 281. b-
819. a. De la divifion du ciel en conftcllations : autre divifion
du ciel en trois parties principales. IV. <0. b. Cartes du ciel.
Suppl. II. 253. a, b. Milieu du ciel. Ibid. III. 939. a.
C ie l, ( dans l’j 4(lron. anc. ) différens cieux que les anciens
admettoient: leur lolidité, leur forme. Cic.ux cryftallins d’Ai-
phonfe, roi de Caftille. Ciel empyrée. Les aftronomes ne fe
mettoient pas fort en peine fi les cieux qu’ils admettoient
étoient réels £u non, pourvu qu’ils fatisnffent aux phénomènes.
Lieu où les cieux 8c la terre fe joignent, félon les
rabbins. III. 443. a. ■ . -c . . -
Ciel, idée que les anciens aftronomes s’éroient faite des
cieux. XI. 575. ..Cieux decryiU.IV. 527. . .V I . 819.-2-
Leur mouvement de trépidation1. XVL 594. »• Huiueme cieL
V CÙl , “( tM . ) divers(iotus que l’icritüre lui donne. ®
C I G C I M
Idée que l’homme è ffiié ' d’eit concevoir.’ Auteurs
fnfcirés qui en font de fuperbes defcriptions. Rapport entre
p i mn & ces auteurs fur ce fujet. Ciel des anciens Romams.
ciefdes mahométans. Ibid. b.
Ciel. Du royaume des cieux. X lV. 419. b. Ciel empyrée. V.
Ciel, reine du. XIV. 48. a , b. ÇO. a. •
Cie l, ( Décor, théat.) un ciel bien peint eft une des plus
agréables parties de la décoration. (Jomment on pourroit
augmenter la beauté de l’effet. III. 443- b.
Ciel , ( Gramm. ) en quelles occafions ce mot a un pluriel
régulier. XII. 802. b\ ..........-
CIERGE épineux, (Botan.) autres noms de cette plante.
Defcription du cierge epineux du jardin du roi. Défauts des
defcriptions données de cette plante, par les voyageurs8c les
botaniftes. III. 443. b. Dimenuons de cette plante lorfqu’elle
fut envoyée au jardin du roi. Ses progrès annuels. D’où lui
vient le nom de cierge. Defcription très-détaillée du cierge
épineux. De fa fleur. Ibid. 444. a. De fon fruit. Ibid. b.
Obfervations fur cette plante. \°. Elle n’a du rapport qu a
celle dont Tabernomontanus donne une figure. 20. Cette
efpece eft différente de celles rapportées par Herman 8c le
P. Plumier. 30. On peut établir le caraftere de cette plante par
la feule infpeâion de la figure de la plante, fans 1 examen de
la fleur-8c du fruit. 4°.- Rapports du cierge avec la roquette
ou opuntia i en quoi il en diffère. III. 444* b. Obfervations fur la
culture de ce cierge. Maniéré de le multiplier. Ses caraéleres.
Ses efpeces, rapportées au nombre de treize. Ibid. 443. a.
Remarques fur chacune de ces efpeces 8c leur culture. Inf-
tru&ion fur la maniéré de multiplier cette plante. Saifon qu’il
fut choifir: foins qu’exigent les boutures. Les vieilles plantes
urniffent toujours de nouveaux jets. Ibid. b. Ce que doivent
Ire ceux qui voudront en apporter des Indes. Ibid. 446. a.
Cierge du Pérou, defcription de deux efpeces de ce genre,
«rayées vol. VI des planch. Hiftoire naturelle, pl. 95. Suppl.
II. 427. a. Claflification du cierge. Ibid. b.
Cierge rampant, pl. 93. du vol. V I , Regne^ végétal.
C ie r g e , chandelle de cire que l’on brûle fur les autels.
On fait des cierges de différentes grandeurs 8c figures. Ancienneté
de l’ufage des cierges dans les cérémonies religieu-
fes. Origine de cet ufage parmi les chrétiens. Les chrétiens du
cinquième fiecle aimoient fi fort les cierges, qu’ils en repré-
ientoient en peinture dans leurs églifes. Signification myfti-
que des cierges allumés en plein jour. Deux manières de faire
les cierges ; l’une à la cuillere, l’autre à la main. Defcription
de l’une, III. 446. b. 8c de l’autre. Ibid. Voye^ les planches du
Cirier, vol. QI, 8c l’article C ir ie r .
Cierge, quête qui fe faifoit pour les cierges. 1. 191. b. A qui
appartiennent les cierges. III. 474. b.. Abus fur leur ufage.
XL 751. a , b.
Cierge pafchal, dans l’êglife romaine. Defcription de cette
cérémonie. Origine de la bénédi&ion dp cierge pafchal. III.
446. b. Catalogue qu’on faifoit tous les ans des fêtes mobiles,
que l’on écrivoit fur un cierge. Ce qu’êtoit ce cierge. Différentes
matières fur lefquelles on écrivoit les chofes dont on
vouloit conferver la mémoire, félon le plus ou le moins de
durée qu’on fe propofoit de lui donner. Coutume d’attacher
au cierge pafchal le papier fur lequel on écrivoit les fêtes
mobiles. Ibid. 447. a.
C ie r g e s d'eau, ( Hydraul. ) defcription : exemple : les
cierges d’eau font plus éloignés les uns des autres que les
grilles. III. 447. a.
CIGALE, efpece de mouche. Defcription de cet infefte.
On en diftingue de trois, grandeurs différentes ; les grandes,
les moyennes & les petites : caraéleres qui les diftinguent. III.
447. a. Organes d’où réfulte le bruit qu’on défigne du nom
de chant de la cigale. Ces organes ne font point dans les femelles.
Ibid. b. Efpece de tariere que renferme le dernier
anneau du corps des femelles. Sa defcription. Mouvement
qu’elle lui donne pour faire des trous dans le bois où elle
dépofe fes oeufs. 'Qualité du bois qu’elles choififfent. A quoi
on reconnoît ces trous : maniéré dont ils font arrangés ; leur
longueur. Ibid. 44’8. a. OEufs qu’elles y dépofent : hiftoire
naturelle du ver qui en fort, jufqu’à fon état ae cigale. Ibid. b.
Cigale, obfervations fur l’efpece repréfentée vol. VI des
planches, Hiftoire naturelle, pl. 79. Suppl. II. 427. b.
C ig a l e s , petits rouleaux de tabac que les Efpagnolsde
1 Amérique nomment airifi, dont on fe fert pour fumer fans
Pipe. Nos infulaires les nomment bouts de tabac. Singulière
façon de fumer ufitée chez les Caraïbes des ifles Antilles. III.
448. b.
CIGNA, (/. François) anatomifte. Suppl'. 1. 412. b. Phyfio-
«>gifte. Ibid. IV. 362. b. 3
CIGNANI, (Carlo) peintre. V. 328. a.
GIGOGNE, defcription au’a donnée de cetoifeau, M.
crtauh, dans le recueil de l’académie royale des fciences.
•448. b. Nourriture de la cigogne. Ibid. 449. a.
‘^gne noire, defcription de cet oifeau. III. 449. a.
l&°gnet (Afat, méd.) partie de cet oifeau dont on fe fert
en médecine. Cet animal eft un grand alexipliarmaque. Di-
verfes propriétés de chacune de fes parties. III. 449. a.
Cigogne , pourquoi elle étoit appellèe crotaliflria. IV.
■ft Ç. a.
Cigogne, figure fymbolique. XV. 733. b.
ClGOLI, peintre. Ouvrage eftimé de cet artifte. Suppl. I.
92. a.
, CIGUË, caraftere de ce genre de plante. Cicuta major.
C. B. La mSt dç Soc rate a feule fuffi pour eu immortalifei les
effets.Defcription de notre ciguë. III. 449.a. Sa faveur 6c fon
odeur. Elle contient un fel ammoniacal enveloppé de beaucoup
d’huile 8c de terre. B eft prouvé qu’elle n’eft point aufli
venimeufe qu’en Grece. Ufage de la poudre de les racines
dans la fievre-quarte pour les skirrhes du foie 8c du pancréas.
Cependant le plus prudent eft de s’abftenir de l’ufage interne
dé cette plante. Quel eft fon meilleur antidote. Elle ne paffoit
point pour venimeufe à Rome : on la regardoit comme un
remede propre à tempérer la bile. Perfe & Horace cités fur
ce fujet. Ibid. b. Eloge que Pline fait de cette plante. Salade
de ciguë ordinaire en Lombardic : animaux qui en mangent.
Les autorités qu’on vient de citer ne fauroient cependant çon-^
trebalancer le poids de celles qu’on leur oppofe. Ufage extérieur
que nous faifons de cette plante. Emplâtre de ciguë. Elle
entre dans le diabotanum. Ibid. 430. a.
De la petite ciguë. On la fubfHtue à la grande pour l’ufage
externe. Sa defcription : on l’a nommée Uperfil des fous. Obfervation
fur la coupe de ciguë que burent Socrate 8c Phocion.
Ibid. 430 .a. Préparation de l’emplâtre de ciguë | félon la pharmacopée
de Paris*. Ibid. b.
Ciguë aquatique, caraftere de cette plante. Lieux où elle
croît, tems où die fleurit: on l’eftime plus venimeufe que la
ciguë ordinaire. Exemple de trois foldats morts fubirement
pour en avoir mange ; ravage qu’elle avoit fait dans leur
corps. Ouvrage à consulter fur cette maticre. Secours les
plus efficaces contre ce poifon. III. 450. b.
Cipié aquatique, il eft aifé de la confondre avec l’oenanthe
véneneufe. XI. 401. a.
C 1LIAIRES, ( Anat. ) fe dit de différentes parties de l’oeil.
Glandes ciliaires. Procès ciliaires. III. 431.4.
Cilïaire, corps ciliaire. Suppl. IV. m . a. Arteres ciliaires.
Ibid. II. 248. Ibid. IV. iiç-, a, b. Veines ciliaires. 116. a.
Ciliaire, ( ligament ) defcription de ces ligamens. Defcartes
a dit que la contraétion des ligamens du cryftallin lui donnoit
un mouvement par lequel ü devenoit plus convexe pour
voir. Auteurs qui l’ont luivi. D’autres veulent que l’a&ion du
corps ciliaire foit d’applatir le cryftallin. Porterfields contcfte
ce changement de la figure du cryftallin : raifonnement fur
lequel il fe fonde. III. 43 i . a, Voyc^ T u n iq u e , ( Anat.).
Ciliaire, couronne, face intérieure de la choroïde continuée.'
Defcription de cette partie. Les poiffons n’ont pas de couronne
ciliaire. Comment la nature a pourvu à ce défaut. Suppl.
II. 427. b.
CILICE, vêtement de poil de chevre & de bouc. Origine
du mot 8c de la chofe. III. 451. a. Virgile cité: obfervation
fur ce paffage. Ibid. b.
CILlCIE, pays de l’Afie mineure : fes bornes. On la divi-
foit en champêtre 8c en montagneufe, &c. Cette contrée étoit
trés-peuplée. Vêtemens appcllçs ci lices, que ces peuples
avoient inventés. Ufage qu en faifoient les Hébreux. Cifices
modernes. Ariftote dit qu’en Cilicie on tondoit les chevres.
III.431. b.
C il ic ie , terre de ( Hift. nat.) Ce au’en dit Thèophrafte.
Ufage qu’on en faifoit. Sentiment de M. Hill fur la nature
de cette terre. III. 431. b.
CILLEMENT, monument alternatif 8c fynchronique des
paupières. Nature de ce mouvement qui fc fait fur-tout dans
la paupiere fupérieure. Méchanifme de ce mouvement. III.
431.b. Mufde élévateur de la paupiere: mufcle orbiculaire.
Effet de fa contraétion : caufe des larmes : ouverture de la
paupiere inférieure. Ufage des petits grains glanduleux placés
fur le bord.cartilagineux des paupières. Différentes parties qui
concourent aux cillemens des paupières : paffage ae Cicéron
fur ce fujet. Mouvement involontaire trop prompt ou trop
lent des paupières : quelle en peut être la .caufe. Moyens de
la guérir. Ibid. 432. a. Il ne faut pas confondre le cillement
avec le clignement. Ibid. b.
CILLER, ( Maréch.) fens de ce mot appliqué au cheval j
figne de vieilleffe : âge où les chevaux cillent. Artifice des
marchands des chevaux pour cacher ce figne de vieilleffe.
III.4<2. b.
CILS, poils dont le bord des paupières eft garni. Leur
ufage. Glandes d’où ils prennent leur origine. III. 4$l. b.
Cils, il n’y a que l’homme 8c le finge qui aient des cils
aux paupières. VIII. 239. ¿.Dérangement des cils. XII. 207. a.
X V L 633. a,b. , . .. * /
CIMABUÉ, ( / tan) premier peintre moderne, dans l’ordre
du tems. V. 317, b. XII. 275. b.
CIMBRES, anciens peuples les; plus feptentrionaux de
l’Allemagne. Cherfonëfê çimbrique. Ce que devinrent ces