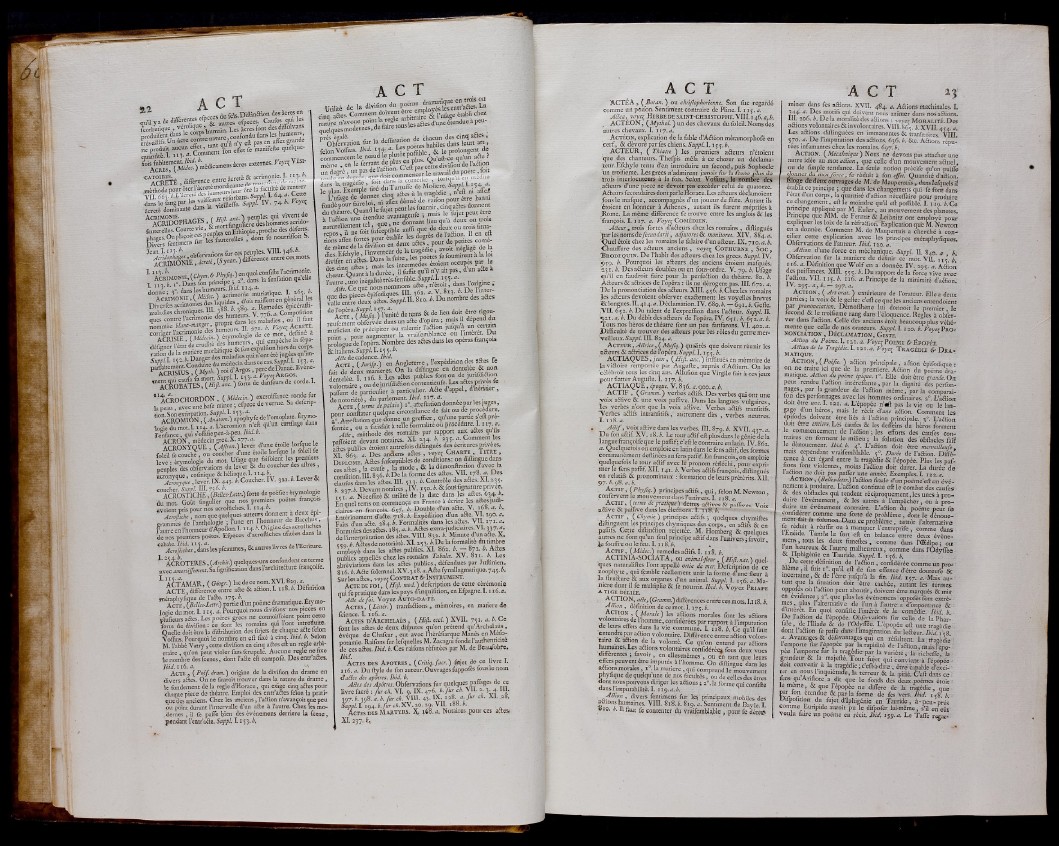
*âs .*«^A^ âCt sTSsSSfi feorbuiique , vé1r0 ‘J ’humain. Les âcres font des diflolvans
produifent Jans le ™ e confondu dans les humeurs,
t ^ a i f e U n ac re to n t r e n a r a r e , | | ^ e îg r a n de
« produit M f ® T o „ effet fe manifefte quelqueÏuannte.
1 . 1 1 y ex,eraes' Biü ° A & , différence 5 j |
« ï ï S " S r ôte la faculté de,
YII. 66 A4g?**r\ :iT—..«■ «AOwHa»
ë 74- f ¿ g
dans le f i ^ g i A g § &
âcretè dominante dans la viem
A c r im o n ie . , dnc. 3 peuples qui vivent de
ACR1DOPHAGES, ( " 0{ tfin 4 re des hommes acndo-
fauterelles. Courte vm, Ethiopie .proche des deferís.
^ “ ^ e n S ' S Æ e r e l l e s fd o n t fe noutnffoit S.
a QACsRtIMeOeNrIE^, (M Mîdgecf-^ ) iaácnhmFoum t t ó ^x Ég I- f^\ - f he-
Diverfes acrimonies des hqu , Remedes ép;céraftiinaladies
chroniques. 111. 3 • •3 9 , CompOfition
qucs contre lacrimóme ¿ “ humeurs, g m g g . - g g g |
nommée blaacimager, Pr0P” - .« , b W y fi A c r e te .
1 S^mologieie ce mor, deltiné à
ACRISIE ■ ÿM m à g * L meUrt qui empêche la fépa-
déíigner 1 état de crudi - « , exPulfion hors du corps.
* ? ACROCHORDON, ( Médecin. ) excroiffance ronde fur
la peaJfavïc «ne bafe mince ; efpece de verrue. Sa defcnp-
“ X à o S N r ( ^ V 4 U y f o de l'omoplate. j ¡ ¡ ïÊËMMM MËÈmm m ïïmdans l ’enfance, qui s’offifie peu-a-peu. Ibid. b.
A C R O N , médecin grec. A. 277. a.
ACRONYQUEI ( Aftron.) lever dune étode lorfque le
foleil fe couche, ou coucher d’une étoile lorfque le foleil fe
leve étymologie du mot. Ufage mie faifoient les premiers
peupies des observations du lever & du coucher des affres ,
* °A CRO S$Cifè Jfeellés-Letir?) forte de poèfte : étymologie
du mot. Goût fingulier que nos premiers poetes françois
avoient pris pour nos acroftiches. 1 . 114. p.
Acroftiche, nom que quelques auteurs donnent à Aeux epi-
grammes de l'anthologie j i’une en
Pautre en l’honneur d’Apollon. 1. 1 r 4. A Onguie des acromches
rie ^ premiers tpoëtes. Efpeces d’acrofliches ufttèes dans la
C^ r o f i c t s ! Ù les pfeaumes, & autres livres de l’Ecriture.
Í ACROTERES, (Archit.) quelques-uns confondent ce terme
avec amortijjement. Sa figniftcation dansl’architetture françoife.
A^'t AMAR . f Gécrr. ) lac de ce nom. XVI. 819. e.
A C T E , différence entre aile & action. 1. 118. é. Définittoa
métaphyfique de l ’atte. 173. é. .
A c t e . CBelles^Lettr) partie d’unpoemedramatique. Etymologie
du mot. L 11 s- a. Pourquoi nous divifons' nos piècesi en
plufteurs attes. Les poëtes grecs ne connoiffotent point cette
forte de divifion: ce font les romains qui [ont introduite.
Quelle doit être la diftrihution des fuiets de chaque aftefejon
Voflius. Pourquoi le nombre en eft fixé à cinq. Ibid. b. belon
M. l’abbé Vatry, cette divifion en cinq a&es eft un regle arbitraire
, qu’on peut violer fans fcrupule. Aucune regle ne fixe
le nombre des fcenes, dont l’afte eft compofé. Des entr’aftes.
'Ibid. 116. a. '-n
A cte | ( Poif. dram.) origine de la divifion du drame en
divers aftés. On ne fauroit trouver dans la nature du drame,
le fondement de la regle d’Horace, qui.exiee cinq aCtes pour
chaque piece de théâtre. Emploi des entr’actes félon la pratique
des anciens. Chez les anciens, l’aftion n’avançoit que peu
ou point durant l’intervalle d’un afte à l’autre. Chez les mo-
.dernes , U fe paffe ljien des événemens derrière la feene,
pendant l’entr’afte, Suppl. 1. 1 53. ||
A C T
Utilité de lu
cinq aftes. Comment doreent être J | P i Ul ^
qmriqufô modmnes )de ^uire tous les ailes d’une étendue a peu
B R i i •* félon Voflius. Ibid. 15 4- a- 5|§ P « -.! a, je prolongent de
même , en le ferraia de plus en pl V de ra a , 0„
l â S C f f ^ d at t ° c o m m e „ S le tra v aU * . poéte.fçm
dans la. tragédie. atïTartuffï'de Molière. SupplX 15 4.u-
le plan. Exemple ure u tragédie , n eft ni affef
i ’ufàge de donner c q^ t o ué<le raifon p0ur être banni
fondé pour f . g | fournir, cinq ailes donnent
du théâtre. Quanti le îiq e p le f„|et peut être
à l’aélion une étendue iivantaguie^, ^ ^ ^
naturellement te l, M M E ff d deux ou trois fitua-
repos ? il nê fou W V ® » ¡ ¡ É l de raffion. u en eft
dons affez fortes pour emb g petites coméde
même de la àvtfion en deux a«es , pour P ¿S ^
p ie f lg p p a s g ii
f a f l e t r d | Du nombre des aftes
^ l l ^ l f l l i i t è detems & d e lieu doit être rigou-
reiifeinent obfervêe dans un aflé d’opéra ; mais 4 dépend du
muficien de précipiter ou ralentir l’aiüon jufqu à un certain
point pour augmenter la vraifemblance ou lhnteret. Du
prologue de l’opéra. Nombre des aftes dans les opéras françois
& italiens. Suppl. 1. 1 5; 5* ^
ASie de cadence. Ibid. „ . . . . ,■ r.
A c te ( Jurifp.) en Angleterre 1 1 expédition des attes le
Êùf l ë deux maniérés. On la diftingue en dentelée _& non
dentelée. I. xxé. ¿.Les aftes publics font ou de uinfdi6hon
volontaire , ou de jurifdiftion contentieufe. Les aftes privés fe
paffent de particuUer à particulier. Afte dappel, dhéritier ,
de notoriété, du parlement. Ibid. 1 17. <u .
A c t e , («mtr J 'pM ls ) t”,afteftation donnée:par les rages,
pour conftater quelque circonftance de fait ou de procédure.
a° Atteftation que donne un greffier, qu une parue s eft pre-
fentée ou a fatisfait à telle formalité ou procédure. 1 . 1 17. a.
Aile, méthode des romains par rapport aux aftes quds
naffoient devant notaires. XI. 134- *• »3 3- ,*• Comment les
aftes publics étoient autrefoisdiflingués
XI 863. <t. Des anciens attes , voytl C h a rTea? UTJ s »
D iplôme. Attes fufcepùbles de conditions: on diftingue dans
ces attes , la caufe , là niode, & la démonftranonjfavcc h
condition. III. 8,36. b. De la forme des attes. VII. 178. u. Des
daufes dans les attes. III. SM- »■ Eonno\e des attes. XI. Z35.
b ivj.b. Devant notaires, IV. 150. é. 8c fousfignamre privée.
i r r . a. Néceffité 8c utilité de la date dans les attes. 634. é.
En quel tems on commença en Franceà écrire les a®e„s l“ d)"
ciaires en françois. 657, b Double d un atte. V . 168. 4. b
Entérinement d’atte. 718. b. Expédition d un atte VI. a9o. a.
Faits d’un atte. 2.84. b. Formalités dans les attes. V i l. 171. u.
Formules des attes. 18 3. a. é. Attes extra-judiciaires. VI. 337-«•
de l’interprétation des attes. VHI. 832. b Minute d un atte. X.
i ,g. b. Attesde notoriété. XI. 253. i.D e la formalité du timbre
employé dans les attes publics. XI 862. b - 872. b. Attes
publics appellés chez les romains Tabula. XV. 811. b. Les
abréviation dans les attes publics, défendues par Juftimen.
816. b. Atte folemnel. XV. 318. u. Atte fynallagmatique. 743. b.
Sur les aftes, voyez C o n t r a t & Instrument. ( (
A cte de f o i , ÇÆjti mod.) defeription de cette cérémonie
qui fe pratique dans les pays d’inquifition, en Efpagne. 1. 1 16. a.
ASle de foi. Voyez A u to -d a -fé.
A c t e s , ( Littér.) tranfaftions , mémoires, en matière de
fcience. 1 . 116. a.
A ctes d’A rchelaüs , (Hift- ceci. ) XVII. 751 .a . b. Ce
font les aftes de deux difputes qu’on prétend qu’Archelaüs ,
évêque de Chafcar S eut avec l héréfiarque Manès en Méfo-
potamie. R^fons fur lefquelles M. Zacagni fonde l’authenticité
de ces aftes. Ibid. b. Ces raifons réfutées par M. de Beaufobre.
Ibid. . ; t
A ctes des A p ô t r e s , ( Critiq.facr. ) fajet de ce livre 1.
116. a. D u ftyle de fon auteur. Ouvrages fuppofés fous le nom
d'aSlcs des apôtres. Ibid. b.
Ailes des Apôtres. Obfervations fur quelques paflages de ce
livre facré : Jur ch. VI. 9. IX. 476. b. fur ch. V II. a. 3^4.111.
397. b. 398. 1 b. fur ch. VIII. 43. IX. 128. ^ fur ch. XI. ¡j8J
Suppl. I. 194. b./ur ch. XV, oo. 29. VII. 188. b.
A c t e s d es M a r t y r s . 3£. 168. a. Notaires ^our ces acte»
XI. 237. k%
A C T
ACTÊA , | Boian. ) ou chriflophorienne. Son fuc regardé
comme un poifon. Sentimient contraire de Pline. 1. 113. a.
A Sie a s voyei H erbe de s a in t -ch r is to ph e . VIII. 146. a3 b.
A C TÉO N , ( Mythol. ) un des chevaux du foleil. Noms des
autres chevaux. I. 117. a.
A ct éo n , explication de la fable d’A&éon métamorphofé en
cerf, & dévore par fcs chiens. Suppl. 1. 155.
ACTEU R, ( Théâtre ) les premiers afteurs n’étoient
que des chanteurs. Theipis mêla à ce choeur un déclama-
'teur.Efchyle tenta d’en introduire un fécond, puis Sophocle
un troifieme. Les grecs n’admirent jamais fur la fccnc ¡>lus de
trois interlocuteurs à la fois. Selon, Voffius, le nombre des
.afteurs d’une piece ne devoir pas excéder celui de quatorze.
Afteurs feconaaires dont parle Horace. Les aôeurs déclamoient
fous le mafque, accompagnés d’un joueur de flûte. Autant ils
étoient en honneur à Athènes, autant ils furent méprifés à
.Rome. La même différence fe trouve entre les anglois & les
‘françois. I. 117. a. Voye^ C omédien.
ASleur, trois fortes d’aéleurs chez les romains , diflingués
par les noms de fccundarii, adjutores & monïtores. XIV. 884. a.
Quel étoit chez les romains le falaire d’un aéteur. IX. 710. a. b.
ChaufTure des a ¿leurs anciens , voye^ C o th u rn e , S o c ,
"Br o d eq u in . De l’habit des a&eurs chez les grecs. Suppl. IV.
.959. b. Pourquoi les aèfeurs des anciens étoient mafgués.
'331. b. Dés afteurs doubles ou en fous-ordre. V . 79. b. Ufage
qu’il en faudroit faire pour la perfection du théâtre. 80. b.
Aéleurs & aCtrices de l’opéra : ils ne" dérogent pas. IH. 672. a.
T)e la prononciation des aéleurs. XIII. 4^6. b. Chez les romains
les aCteurs devoient obferver exactement les voyelles brèves
& longues. II. 414. a. Déclamation. IV. 680. b. — 691. b. Gefte.
,VII. 652. b. Du talent de l’expreflion dans l’aCteur. Suppl. II.
921. a. b. Du débit des aéteurs de l’opéra. IV. 6çi. b. 6<¡2. a. b.
Tous nos héros de théâtre font un peu fanfarons. VI. 402.4z.
Difficulté de trouver des aCteurs pour les rôles du genre merveilleux.
Suppl. III. 824. a.
A ct eu r , ASlrice, (• Mufiq. ) qualités que doivent réunir les
aCteurs & aétrices de l’opéra. Suppl. 1. 15 ç. A
ACTIAQUES, jeux 9 ( Hiß. anc. ) inftitués en mémoire de
la viCtoire remportée par Augufte, auprès d’ACtium." On les
célébroit tous les cinq ans. Allufion que Virgile fait à ces jeux
pour flatter Augufte. I. 117. b.
A C T IAQ U E , époque. V. 836. a. 900. a. b.
ACTIF , ( Gramm. ) verbes attill Des verbes qui ont une
voix attive 8c une voix palfive. Dans les langues vulgaires
les verbes n’ont que la voix attive. Verbes attlfs tranfitifs!
"Verbes attifs intranfttils, autrement dits , verbes neutres.
L 118.U.
AUif, voix attive dansles verbes, m . 879. b. XVII. 437. a.
Du Ion aflif. X V . 18. A Le tour aftif eft plus dans le génie delà
langue françoife que le paffif; c’eft le contraire en latin. IV. 862
a. Quelquefois on emploie en latin dans le fens attif, des formes
communément deftinées au fens paflïf. En françois, on emploie
quelquefois le tour attif avec lë pronom réfléchi, pour exprimer
le fens paffif. XII. 141. A Verbes attifs françois, diflingués
en relatifs 8c pronominaux : formation de leurs prétérits 3ül
97. A 98. a.b.
A c t if , ( Phyßq. ) principes attife, qui, félon M. Newton '
conlervent le mouvement dans l’univers. I. 118 a
A c t i f , (terme de pratique) dettes attive . Voix
aCtive & palfive dans les élections*. Iî "ïi8. b. * ■
. A c t if , ( Chymïe j principes aétifs * quelques chymiftes
diftinguent les principes chymiques des corps, en aCtits & en
paffifs. Cette aiftinCtion rejettee. M. Homberg & quelques
autres ne font qu’un feul principe aClif dans l’univers jfavoir
fouftre ou le feu. 1. 1 1 8. A. |
A c t i f , {Médec.) remedes aClifs. I. 1 18. A
y ACTINIA-SOCl A T A , ou animal-fleur, ( Hifl. nat. ) quelques
naturaliftes l’ont appellé ortie de mer. Defeription de ce
zoophyte, qui femble réellement unir la forme d’une fleur à
la ltrufture & aux organes d’un animal. Suppl. I. 156. a. Maniéré
dont il fe multiplie & fe nourrit. Ibid. A Voyez Priape
a t ig e d e l ié e . '
• ißramml) différences entre ces mots. I.i 18. b.
jMtwn y définition de ce mot. 1. 175. A
1 (Horale ) les attions morales font les aôions
1 homme, confidérées par rapport à l’imputarion
de leurs effets dans la vie commune. I. 118. A Ce qu’il faut
entendre par attion volontaire. Différence entre attion volontaire
8c attion de la volonté. Ce qu’on entend par attions
. A zttions volontaires confidéré^ fous deux vues
différentes j favoir , en elles-mêmes , ou en tant que leurs
effets peuvent être imputés k l’homme. On diftingue dans les
uttions morales, l la matière, qui comprend le mouvement
phyfique de quelqu une de nos facultés, ou de celles des êtres
dont nouspouvohs diriger les attions ; a l la forme quiconfifte
oans 1 xmputabilité. I. 119. a. A
ASlion y divers fentimens fur le^ principaux, mobiles des
actions humaines. VIII. 818. A 81,9. a. Sentiment de Bayle. I.
«iQ. A II faut fe contenter du vraifemblîfole , pour fe déiec»
A C T n
nuner dans fes aCtíons. XVII. 484, a. AClioiis machinales. I.
344. a Des motifs qui doivent nous animer dans nos aCHbns*
III.206. A De la moralité desaûions : voytr M o r a l it é . Des
attions volontaires & involontaires. VIII.'865. b. XVII. 4*4. a\
Les adions diftinguées en immanentes & tranûtoires. VTTL
3.70. a. De l’imputation des aClions. 636. b. &c. Actions réputées
infamantes chez les romains. 697. b.
A c t io n . ( Mécahnique ) Nous ne devons pas attacher une
autre idée au mot aSlion, que celle d’un mouvement aàuel,
ou de fimple tendance. La feule notion précife qu’on puifîe
lÊ P t ? P réduit à fon effet. Quantité d’aClionl
P gH R de deux ouvrages de M. de Maupertuis, dans lefquels il
étabht ce principe ; que dans les change'mens qui fe font dans
1 état d’un corps, la quantité d’aCtion néceiïaire pour produire
ce changement, eft le moindre qu’il eft poflible. I. 119. A Ce
principe appliqué par M. Eu 1e r , au mouvement des planetes.
Principe que MM. de Fermât & Leibnitz ont employé pour
expliquer les loix de la réfraCtionTÈxplication qub M. Newton
en. a donnée. Comment M. de Maupertuis a cherché à con-*
ciher cette explication avec les principes métaphyfiques.
Ublervations de l auteur. Ibid, ï 20. a.
. ASlion d’une force en méchanique. Suppl II. 840. a b:
Obfervation fur la maniere de définir ce inót. VU. ti«;. A
116. «. Définition que W o lf en a donnée. IV. 2.9e. à. AClioii
des puiffances. XIIL 353. A Du rapport de la force vive avec
1 aétion. VII. 113. A 116. «.Principe de la minimité d’aCtion.
IV. 293. «, A *— 297. a.
A c t io n , ( Art orat. ¡ extérieure de l’orateur. Elle a deux
parties ; la voix & le gefte : c’eft ce que les anciens entendoient
par prononciation. Démofthene lui dortnoit le premier le
fécond & le troifieme rang dans l’éloquence. Regles à obferver
dans l’aCtion. Celle des anciens étoit beaucoup plus véhémente
que celle de nos orateurs. Suppl. I. j É | A Voytr Pr o n
o n c ia t io n , D é c l am a t io n , G este.
ASlion du Poème. I. 121. a. Voye^ Poeme & ÉPOPÉE.
ASlion de la Tragédie. I. 121.«. Voyer TRAGÉDIE 6* DRAMATIQUE.
A c t io n , (Poéfie. ) aCtiôn principale, aCtion épifodiquer
on ne traite ici que de la première. ACtion du poeme dramatique.
ASlion du poème épique. i°. Elle doit être grande. On
peut rendre l’aCtion intèreffante, par la -dignité des perfon-
nages, par la grandeur de l’aCtion même, par la comparai-
lon des perfonnages. avec les hommes ordinaires. 20. L’aCtion
doit être une. I. 121. «. L’épopée n’«ft pas la vie ou le lan-
j Ui\ héros, mais le récit d’une aCtion. Comment les "
epifodes doivent être liés à l’aCtion principale. 30. L’aCtion
doit etre entière. Les caufes & les defieins du héros forment
le commencement de l’aétion- les efforts des caufes contraires
en forment le milieu ; la folution des obftacles fai?
le dénouement. Ibid. A 40. L’aCtion doit être merveilleufe,
mais cependant vraifemblable. 30. Durée de l’aCtion. Différence
à cet égard entre la tragédie & l’épopée. Plus les paf-
f°nt violentes, moins l’aCtion doit durer. La durée de
1 action ne doit pas putter une année. Exemples. L 122.«.
A c t io n , {Belles-lettr.)l'aStion finale d’un poëme’eft un événement
à produire. L’aCtion continue eft le combat des eau fes
& des obftacles qui tendent réciproquement,les unes à produire
l’événement, & les autres à l’empêcher, ou à pro-
duire un événement contraire. L’aCtion du poème peut fe
confidérer comme une forte de problème , dont le dénoue-
ment-fait la folution. Dans ce problème, tantôt l ’alternative
I p i S t ' l i , rél* ,r | manquer l’entreprife , comme dans
1 Enéide. Tantôt le fort eft en balance entre deux événemens,
tous les deux funeftes, comme dans l’OEdipe : ou
ï m m m & rautr^ malheureux, comme dans l’ôdyifée
oc 1 iphigéme en Tauride. Suppl. I. 136. A
De cette définition de l’aCtion , confidérée comme un pro-"
blême, il fuit 1 . qu’il eft de fon effence d’être douteufe 8c
meertame , & de 1 être jufqu’à la fin. Ibid. 137. *.• Mais au-
tanf que-la Situation doit être cachée, autant les termes
oppofés ou 1 aCtion peut aboutir, doivent être marqués & mis
en évidence j 20. que plus les événemens oppofés font extrê-
mes plus I alternative de l’un à l ’autre .a d’imporfancô &
dinterêt. En quoi confifte l’intérêt de la comédie. Ibid. b. -
De l’aCtion de l’épopée. Ob/èrvarions fur celle, de laPhar-
í3*6 ’ .¿A 1Iliade & l’Odyllée. L’épopée eft une tragédie i
dont l’attion fe paffe dau2:FimaginatÎ0R du'letteur./êid 1V8
a. Avantages & défavantages qui en réfultent: ES tragédie'
1 emporte fut l'épopée par la rapidité de l'attion. maisrébo-
P Iemporte fur la tragédie-par la variété¡ là richeffe, la
g-andeur & la majefté. Tout fujet qui convient-à l’épopéedoit
convenir a la tragédie ;c'eft-à-dire , êtreiapable & -
ter en nous 1 mqiuétude, la terreur 8c la piné. G'eft dans ce -
lens qu Annote. a dit que le fonds des deux .poèmes étoit:
le même, & que l’épopée ne différé de la tragédie que
? . .n^ue & pat la."forme de fes vers. Ibid. 138. A
Dilpofition du fujet d’Iphigéitie en Tauride , à- peu- près
comme Euripide auroit pu le difpofer lui-même, s’il en eût
voulu fiùre un poè'mc en récit, Ibid, 159. a, Le TafTe regar-î