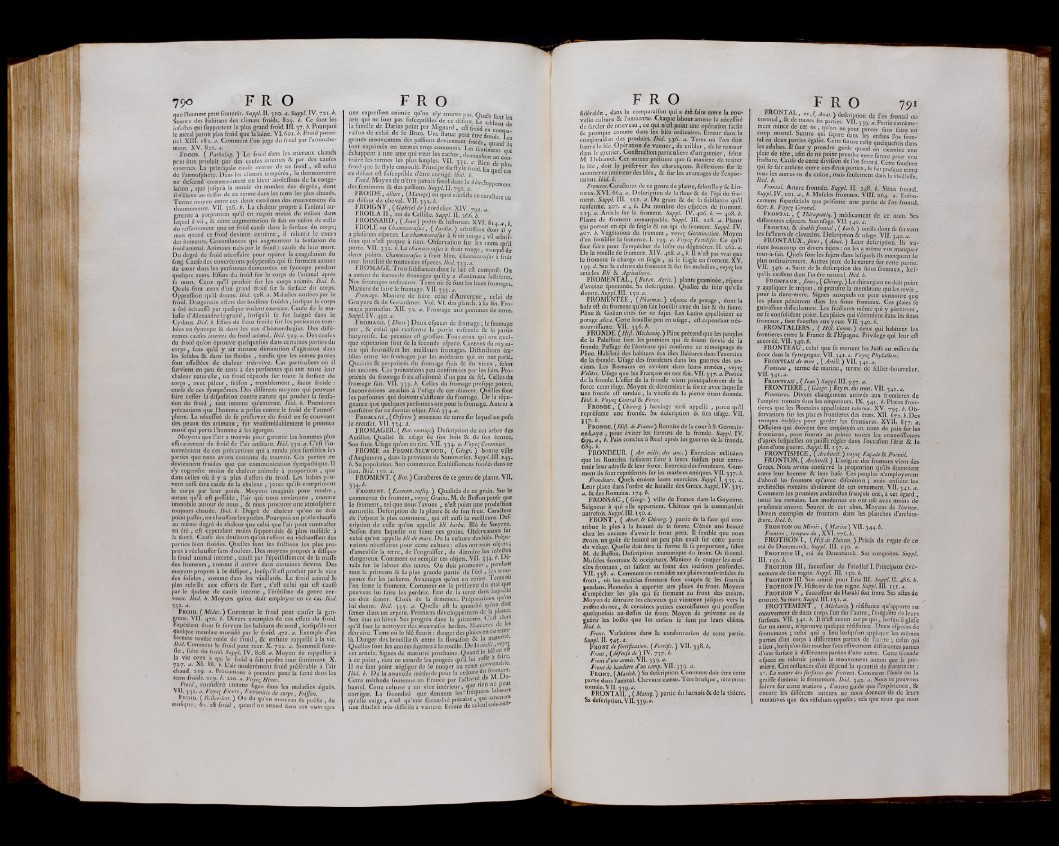
790 F R O F R O
que l'homme peut foutenir. Suppl. II. 310. a. Suppl. IV. 7 1 1 . b.
Stature des habitans des climats froids. 820. b. Ce font les
iiifcélcs qui fupportent le plus grand froid. III. 37. b. Pourquoi
le métal paroît plus froid que la laine. VI. 601. b. Froid potentiel.
XIII. 182. a. Comment l’on juge du froid par l'attouchement.
X V . 821. a.
F r o id . ( Patholog. ) Le froid dans les animaux chauds
peut être produit par des caufcs internes & par des caufcs
externes. La principale caiifc externe de ce froid , cil celui
de l'atmofphcrc. Dans les climats tempérés, le thermomètre
ne defeend communément en hiver au-deflous de la congélation
que jufqu’à la moitié du nombre des degrés, dont
il s’élève au-dcfîus de ce terme dans les tems les plus chauds.
Terme moyen entre ces deux extrêmes des mouvemens du
thermomètre. VII. 326. b. La chaleur propre à l’animal augmente
ii porportion qu’il en reçoit moins du milieu dans
lequel il v i t , 8c cette augmentation fc fait en raifon de celle
du re/ferrement que ce froid caufc dans la furface du corps;
mais quand ce froid devient extrême, il ralentit le cours
des humeurs. Circonftanccs qui augmentent la fenfation du
froid animal. Animaux tués par le froid : caufc de leur mort.
Du degré de froid néceflairc pour opérer la coagulation du
fang. Caufc des concrétions polypeufes qui fe forment autour
du coeur dans lcspcrfonncs demeurées en fyncopc pendant
quelque tems. Effets du froid fur le corps de l’animal après
la mort. Ceux qu’il produit fur les corps animés. Ibid. b.
Quels font ceux d’un grand froid fur la furface du corps.
Oppreflion qu'il donne. Ibid. 328. a. Maladies caufécs par le
froid. Dangereux effets des boiffons froides, Ibrfquc le corps
a été échauffé par quelque violent exercice. Caufc de la maladie
d’A lcxandrc-lcgrand, lorfau’il fc fut baigné dans le
Cydnus. Ibid. b. Effets de l'eau froide fur les perlonncs tombées
en fyncopc & dans les cas d’hémorrhagies. Des différentes
caufcs internes du froid animal. Ibid. 329. a. Des caufcs
du froid qu’on éprouve quelquefois dans certaines parties du
corps, fans qu’il y ait aucune diminution d'agitation dans
les folides & dans les fluides , tandis que les autres parties
font affeélées de chaleur três-vivc. Cas particuliers où il
furvient en peu de tems à des perfonnes qui ont toute leur
chaleur naturelle, un froid répandu fur toute la furface du
corps , avec pâleur, fr'iffon , tremblement, fucur froide :
caufc de ces fymptômes. Des différens moyens qui peuvent
faire ccffcr la difpofition contre nature qui produit la fenfation
du froid , tant interne qu’externe. Ibid. b. Premières
précautions que l’homme a prifes contre le froid de l’atmof-
phcrc. La nécelfité de fc préferver du froid en fc couvrant
des peaux des animaux , fut vraifcmblablemcnt le premier
motif qui porta l'homme à les égorger.
Moyens que l’art a trouvés pour garantir les hommes plus
efficacement du froid de l’air ambiant. Ibid. 330. a. C ’eft l’inconvénient
de ces précautions qui a rendu plus fcnfiblcs les
parties que nous avons coutume de.couvrir. Ces parties ne
deviennent froides que par communication fympathique. Il
s’y engendre moins de chaleur animale à proportion , que
dans celles où il y a plus d’effets du froid. Les habits peuvent
aufTi être caufc de la chaleur , parce qu’ils compriment
le corps par leur poids. Moyens imaginés pour rendre,
autant qu’il cil pofiiblc, l’air qui nous environne , comme
immobile autour de nous , 8c nous procurer une atmofpherc
toujours chaude. Ibid. b. Degré de chaleur qu’on ne doit
point palier, en chauffant les poêles. Pourquoi un poêle chauffé
au même degré de chaleur que celui que l’air peut contrarier
en été , cil cependant moins fupportable & plus nuifiblc à
la fanté. Caufc des douleurs qu’on reifent en réchauffant des
parties bien froides. Quelles font les friélions les plus propres
à réchauffer fans douleur. Des moyens propres a difuper
le froid animal interne, caufé par répaiffiffemcnt de la maffe
des humeurs, comme il arrive dans certaines fièvres. Des
moyens propres à le diffipcr, lorfqu’il cil produit par le vice
des folides, comme dans les vieillards. Le froid animal le
plus rebelle aux efforts de l’art , c’eft celui qui cil caufé
par le fpafmc de caufe interne , l’érétifmc du genre nerveux.
Ibid. b. Moyens qu’on doit employer en c e cas. Ibid.
332. a.
F r o id . ( Médec. ) Comment le froid peut caufcr la gangrené.
V it . 470. b. Divers exemples de ces effets du froid.
Expédient dont fe fervent les habitans du nord, lorfqu’ils ont
quelque membre mortifié par le froid. 471. a. Exemple d’un
*ombê roide de froid , 8c cnfuitc rappellé a la vie.
Ibid. Comment le froid peut tuer. X. 722. a. Sommeil func-
f te , fuite du froid. Suppl. IV. 808. a. Moyen de rappcllcr |
la vie ceux îi qui le froid a fait perdre tout fentiment. X .
727. a. XI. 88. b,, L’air modérément froid préférable il l’air
chaud. 2to. a. 1 récautions ?i prendre pour la fanté dans les
tems froids. 219. b. 220. a. Foyer Hiver.
b'roid, confidéré comme ligne dans les maladies aiguës.
,*■ 332. Voyei Ftevre, Extri,nuit du corps. Fri (Ton.
1 ROID. I Belle,-leu. ) U n dit <|u’un morceau de p o ê f ii, de
manque, (Pc. cil froid , quand on attend dans ces ouvrages
une cxprciTton animée qu’on n’y trouve pas. Ouel« font 1«
art; qui ne font pas fufçcpfibh/dc ce à i L . & "
la Empile de Darius peint par Mignard , cft froid en m l
raifon de celui de le ¡Brune Une ftatuc petit être froid• f
grands mouvemens des pallions deviennent froids ou-Tml u
lotit exprimis en termes trop communs. Les fendmens n •
échappent !i une ame qui veut les cacher, demandent au cnn
traire les termes les plus fimplcs. VII. 351. a . ?
froid que le ftyle cmnoulé. Principe du (lyle froid. En n u c frS
ce défaut cil Itifceptihlc d’étre corrigé. Ibid. b. *
fro id . Moyen de n’être jamais froid dans le dévcloi>nem.„,
des fentimcns & des paflions. Suppl. II. yoai a.
FK O ID E , Mure {Mmegr) en quoi confilk ce caraSere ou
c e défaut du cheval. V I I .332.b .
H lO IG N Y , ( Gabriel d e ) cordclicr. XIV. 702. a.
FRO ILA I I , roi de Caftillc. Suppl. II. 260. b.
FR O IS SA R D , ( J ea n) poète 8c hiftoricn. XVI. 814. a b
FROLE ou Chamacerafus, ( Jardin. ) arbriiTeau dont il’ v
a pluficurs cfpcccs. Le chamotcerafus h fruit rouge ; vil arbrif-
feau qui n’eft propre à rien. Obfcrvation fur les noms qu’il
porte. VII. 332. b. Le chamacerafus h fruit rouge, marqué de
deux points. Chamacerafus h fruit bleu. Chamacerafus à fruit
noir. Inutilité de toutes ces cfpcccs. Ibid. 3 33. <7.
FROMAGE. Trois fubflanccs dont le lait cft compofé. On
a autant de fortes de fromages qu’il y a d’animaux laétifcrcs.
Nos fromages ordinaires. Tems où fc font les bons fromages.
Manière de faire le fromage. VII. 333. a.
Fromage. Manière de faire celui d’A u ve rgn e, celui de
Gruyère & de Gcrardincr. Vol. VI. des planch. à la fin. Fromage
parmefan. XII. 72. a. Fromage aux pommes de terre.
Suppl. iV . 490.4.
F r o m a g e . ( D ie te ) Deux cfpcccs de fromage ; le fromage
pur , 8c celui qui renferme la partie cafécufc 8c la partie
butyreufe. Le premier cft groiïier. Tous ceux qui ont quelque
réputation font de la féconde cfpccc. Cantons du royaume
qui fournifTent les meilleurs fromages. Diftinélions établies
entre les fromages par les médecins qui en ont parlé.
Qualités & propriétés du fromage frais 8c du v ieu x, félon
les anciens. Ces prétentions peu confirmées par les faits. Propriétés
du fromage frais affaifonné d’un peu de fel. Celles du
fromage fait. V II. 333. b. Celles du fromage prcfque pourri.
Inconvénicns attachés à l’ufagc de cet aliment. Quelles font
les perfonnes qui doivent s’abftcnir du fromage. De la répugnance
que quelques perfonnes ont pour le fromage. Auteur à
confultcr fur ce dernier objet. Ibid. 334. a.
F r o m a g e , ( Orfèvre ) morceau de terre fur lequel on pofe
le crcufet. VII. 334. a.
FROMAGER. ( Bot. exotiqJ) Defeription de cet arbre des
Antilles. Qualité 8c ufage de fon bois 8c de fon écorce.
Son fruit. Ufage qu’on en tire. VII. 334. a. Foye{ Cotonnier.
FROME ou F r o m e -Se l w o o d , ( Giogr. ) bonne ville
d’A ngleterre, dans la province de Sommerfet. Suppl. III. 149.
b. Sa population. Son commerce. EtablifTcmcns fondés dans ce
lieu. Ibid. i <0. a.
FROMENT. ( Bot. ) Caraélcrcs de ce genre de plante. VII.
334 -b.
F r o m e n t . ( Econom. rufliq. ) Qualités de c e grain. Sur le
commerce du froment, voye[ Grains. M. de Bnffon penfe que
le froment, tel que nous l’avons , n’eft point une produétion
naturelle. Defeription de la plante 8c de fon fruit. Caraéterc
de l’efpcce la plus commune, qui cft aufii la meilleure. Defeription
de celle qu’on appelle b li barbu. Blé de Smyrnc.
Saifon dans laquelle on fcinc ces grains. Obfcrvations fur
celui qu’on appelle b li de mars. De la culture des blés. Préparations
néccfiaircs pour cette culture : elles ont trois objets ;
d’ameublir la terre, de l’cngraiffcr, de détruire les infectes
dangereux. Comment on remplit ces objets. VII. 334* P®"
tails fur le labour des terres. On doit promener, pendant
tout le primcins 8c la plus grande partie de l’é té , les troupeaux
fur les jachères. Avantages qu’on en retire. Tems ou
l’on feme le froment. Comment on le préferve du mal que
peuvent lui faire les perdrix. Etat de la terre dans laquelle
on doit femer. Choix de la femencc. Préparations qu on
lui donne. Ibid. 335. a. Quelle cft la quantité qu’on doit
femer dans un arpent. Premiers dévcloppcmcns de la niante.
Son état en hiver. Scs progrès dans le primons. C ’eft ^alors
qu’il faut la nettoyer des mauvaifes herbes. Manières de les
détruire. T o n s oii le blé fleurit : danger des pluies en ce temsl.
i. Danger des brouillards entre la floraifon & g /,.niltur“ 1
Quelles font les années fiijettcs ¿1 la rouille. D e la n,e^ *
cet article. Signes de maturité prochaine. Quand leblle ^
à ce point, rien ne retarde les progrès qu’ii lui refte a ■«
Il ne faut point négliger de le couper au tjcms couve •
Ibid. b. De la nouvelle méthode pour la culture du r •
Cette méthode foutenuc en France par l’aélivite de •
hamcl. Cette culture a un vice intérieur, que rien1 n P
corriger. La fécondité que donnent Ics'Héquens
qu’elle ex ig e, n’eft qu’une fécondité précaire , qui a« ,
une ftérilité très-difficile & vaincre, Erreur de calcul très-
F R O
iidérable , dans la comparaifon qui a été faite entre la nouvelle
culture 8c l’ancienne. Chaque labour amene la néccflité
de farder de nouveau, ce qui n’eft point une opération facile
8c prompte comme dans les blés ordinaires. Erreur dans la
comparaifon des produits. Ibid. 33 6. a. Tems où l’on doit
battre le blé. Opération de vanner, de cribler, de le remuer
dans le grenier. Conftruélion particulière d’un grenier, félon
M. Duhamel. Ce t auteur prefume que fa manière de traiter
le b lé , doit le préferver des charcnçons. Réflexions fur le
commerce intérieur des b lés, 8c fur les avantages de l’exportation.
Ibid. b.
Froment. Caraélcrcs de ce genre de plante, félon Ray 8c Lin-
næus. XVI. 664. a. Defeription de la fleur 8c de l’épi du froment.
Suppl. III. 221. a. Du grain 8c de la fubftance qu’il
renferme. 207. a , b. Du nombre des efpeccs de froment.
213. a. Article fur le froment. Suppl. IV. 406. b. — 408. b.
Plante de froment remarquable. Suppl. III. 218. a. Plante
qui portoit un épi de feiglc 8c un épi de froment. Suppl. IV.
407. b. Végétation du troment, voyeç Germination. Moyen
d’en fcrtililcr la femencc. I. 23 j . a. Foyer Fertilifer. C e qu’il
faut faire pour l’empêcher de hifer ou dégénérer. II. 262. a.
D e la rouille de froment. XIV. 408. a , b. f i n’eft pas vrai que
le froment fe change en fcigle, ni le fcigle en froment. X V .
19c. d. Sur la culture du froment 8c fur fes maladies, voye[ les
articles B U 8c Agriculture.
FROM EN TA L , (Botan. A g r ic .) plante graminée, eipecc
d’avoine fpontanéc. Sa defeription. Qualité du foin qu’elle
donne. Suppl. III. x 50. a.
FROM ENTÉ E , ( Pharmac. ) cfpece de potage, dont la
bafe cft du froment qu’on fait bouillir avec du lait 8c du fucrc.
Pline 8c Galicn cités fur ce fujet. Les Latins appclloient ce
potage alica. Cette bouillie peu en ufage, cft cependant très-
nourriflante. VII. 336. b.
FRONDE. ( Hift. Michaniq. ) Pline prétend que les peuples
de la Palcftinc font les premiers qui fc foient fervis de la
fronde. Paflage de l’écriture qui confirme ce témoignage de
Pline. Habileté des habitans des ifles Baléares dans Exercice
de la fronde. Ufage des frondeurs dans les guerres des anciens.
Les Romains en avoient dans leurs armées, voyer
Velites. Ufage que les François en ont fait. VII. 337.4. Portée
de la fronde. L ’eftet de la fronde vient principalement de la
force centrifuge. Moyen de déterminer la force avec laquelle
une fronde cil tendue , la vîtefle de la pierre étant donnée.
Ibid. b. Foye[ Central 8c Force.
F r o n d e , ( Chirurg. ) bandage ainfi appelle , parce qu’il
repréfente une fronde. Sa defeription oc fon ufage. VII.
337- b-
F RONDE. {Hift. de France) Retraite de la cour à S. Germain-
en-Laye , pour éviter les fureurs de la fronde. Suppl. IV.
600. a , b. Paix conclue h Rucl après les guerres de la fronde.
689. b.
FRONDEUR. ( A r t milit. des anc. ) Exercices militaires
que les Romains faifoient faire à leurs foldats pour entretenir
leur adrefle 8c leur force. Exercice des frondeurs. Comment
ils font repréfentés fur les marbres antiques. VII. 337. b.
Frondeurs. Quels étoient leurs exercices. Suppl. I. <3 ç. 4.
Leur place dans l’ordre de bataille des Grecs.Suppl. I v . 31 <j.
a. 8c des Romains. 174. b.
F R O N SA C , ( Giogr. ) ville de France dans la Guyenne.
Seigneur à qui elle appartient. Château qui la commandoit
autrefois. Suppl. III. 150. a.
FRON T , ( Anat. & Chirurg. ) partie de la face qui contribue
le plus à la beauté de fa forme. C ’étoit une beauté
chez les anciens d’avoir le front petit. Il fcmblc que nous
avons un goût de beauté un peu plus cxaél fur cette partie
du vifage. Quelle doit être fa forme 8c fa proportion, félon
M. de Billion. Defeription anatomique du front. Os frontal.
Mufclcs frontaux 8c occipitaux. Manière de couper les muf-
clcs frontaux, en faifant au front des incifions profondes.
VII. 338. a. Comment on remédie aux plaies tranfverfales du
fron t, où les mufclcs frontaux font coupés 8c les fourcils
pendans. Remèdes à apporter aux plaies du front. Moyens
d ’empêcher les plis qui fc forment au front des enfans.
Moyen de détruire les cheveux qui viennent jufqucs vers la
radnc du nez, 8c certaines petites excroilTances qui pouffent
quelquefois au-deflùs du front. Moyen de prévenir ou de
guérir les boffes que les enfans fc font par leurs chûtes.
Ibid. b.
Front. Variations dan» la conformation de cette partie.
Suppl. II. 34Ç. a.
FRONT de fortification. (For tifie.) VII. 338. b.
Front, ( difenje d e ) IV. 737. b.
Front d'une armée. VII. 339* **•
Front de bandiere d'un camp. VII. 339. a.
F r o n t . (Maréch.) Sa defeription. Comment doit être cette
partie dans l’animal. Chevaux camus. T ête bnifque, tête moutonnée.
VII. 339. <2.
F R O N T A IL , ( Mantg. ) partie du harnois 8c de la téticrc.
Sa defeription. V IL 339. a.
F R O ÉÉ
Z ‘nn morral V ” “ ’ Í Peut P ™ » & fi,|re „ „
coup mortel. Suture m f i m j m les enfans l’os frona
en deux parues égales. Cette future refte quelquefois dans
les adultes. Il faut y prendre garde quand on examine une
plate de tête , afin de ne pomt prendre cette future pour une
IraOurc. Caufe de cette divifion de l’os frontal. Cette foudiire
qui fe fait enfuite entre ces deux parties, fc fait prcfque entre
tous les autres os du crâne, mais feulement dans la vicilleflc
Ibid. b.
Frontal. Artere frontale. Suppl. II. 248. b. Sinus frontal.
Suppl. IV . 101. a y b. Mufclcs frontaux. VIII. 264. a. Enfon-
ccmens fuperficicls auc préfente une partie de l’os frontal.
607. b. Voye{ Coronal.
«rtRONTAL » ( Thirapeutiq. ) médicament de ce nom. Scs
différentes cfpcccs. Son ufage. VII. 340. a.
F r o n t a l 8c double fron tal, ( Lu th .) outils dont fc fervent
les faéleurs de clavecins. Defeription 8c ufage. VII. 340. a.
I FR O N T A U X ,f in u s , (A n a t . ) Leur defeription. Ils va rient
beaucoup en divers fujets : on les a même vus manquer
tout-à-fait. Quels font les fujets dans lefquels ils manquent le
plus ordinairement. Autres jeux de la nature fur cette partie.
VII. 340. a. Suite de la defeription des finus frontaux, lorfqu’ils
exiftent dans l’ordre naturel. Ibid. b.
F r o n t a u x , fin u s , | Chirurg. ) Le chirurgien ne doit point
y appliquer le trépan, m prendre la membrane qui les revêt,
pour la dure-mere. Signes auxquels on peut connoitre que
les plaies pénétrent dans les finus frontaux. Ces plaies fè
guériflent difficilement. Les fraélurcs même qui y pénétrent,
ne fc confolidcnt point. Les plaies qui s’étendent dans les finus
frontaux, font funeftes aux yeux. VII. 340. b.
FRONTALIERS , ( Hift- Comm. ) ceux qui habitent les
frontières entre la France oc l’Efpagnc. Privilège qui leur cft
accordé. VII. 340. b.
FRON TEAU , celui que fc mettent les Juifs au milieu du
front dans la fynagogue. V II. 341. <z. Voyc{ Phylaflere.
F r o n t e a u de mire , ( Artill. ) VII. 341.4.
Fronteau , terme de marine, terme de fcllier-bourrelier.'
VII. 341. a.
F r o n t e a u , ( Jean ) Suppl. III. 957. a.
FRON TIER E, ( Giogr. ) Etym. au mot. VII. 341.4.
Frontières. Divers changemcns arrivés aux frontières de
l’empire romain fous les empereurs. IX. 541. b. Places frontières
que les Romains appclloient taberna. X V . 795. b. Ob-
fervations fur les places frontières des états. X ll. 672. ¿ .Des
troupes établies pour garder les frontières. XVII. 857. a.
Officiers qui doivent être employés en . tems de paix lur les
frontières, pour fournir au prince toutes les connoifTances
d’après lefquellcs on puifle régler dans l ’occafion l’état & Je
pland’uneguerre. Suppl. II. 157. a.
FRONTISPICE, ( ArchiteU. ) voyeç Façade 8c Portail. .
FRONTON. ( Architett. ) L ’origine des frontons vient des
Grecs. Nous avons confervé la proportion qu’ils donnoient
entre leur hauteur 8c leur bafe. Ces peuples n’employerenc
d’abord les frontons qu’avec diferétion ; mais > enfuite les
architeéles romains abuferent de cet ornement. VII. 341. 4.
Comment les premiers architeéles François ont, à cet égard,
imité les romains. Les modernes en ont ufé avec moins de
prudence encore. Source de cet abus. Moyens de l’éviter.
Divers exemples de frontons dans les planches d’archite-
élurc. Ibid. b.
FRONTON ou Miroir, (Ma rine ) VII. 344.b.
Fronton , tympan du , X V I. 776. b.
FROTHON I , ( Hift de Danem. ) Précis du règne de ce
roi de Danemarck. Suppl. III. 130. a.
F r o t h o n I I , roi de Danemarck. Ses conquêtes. Suppl.
III. iço. b.
F r o t h o n I I I , fuccefleur de Fricdlcfl. Principaux évé-
ncmens de fon regiic. Suppl. III. 1 ço. b.
F r o t h o n III. Son amitié pour Eric III. Suppl. II. 488. b.
F r o t h o n IV . Hiftoire de ion regne. Suppl. III. 151.4.
F r o t h o n V , fuccefleur de Harald fon frère. Ses aéles de
cruauté. Sa mort. Suppl. III. 131. a.
FROTTEMENT , ( Michaniq. ) réfiftance qu’apporte au
mouvement de deux corps l’un fur l’autre, l’inégalité de leurs
furfaces. VII. 341. b. Il n’eft aucun corps qui, Torfqu’il glifle
fur un autre, n’éprouve quelque réfiftance. Deux cfpcccs de
frottemens ; celui qui a lieu lorfqu’on applique les mêmes
parties d’un corps ;i différentes parties de l’aurru ; celui qui
a lieu , lorfqu’on fait toucher fucccflivcmcnt différentes parties
d’une furface à différentes parties d’une autre. Cette fécondé
cfpccc ne ralentit jamais le mouvement autant que Ja première.
Circonftanccs d’où dépend la quantité du frottement :
i°. La nature des furfaces qui frottent. Comment l’huile ou la
graiffe diminue le frottement. Ibid. 342. a. Nous ne pouvons
luivre fur cette matière , d’autre guide que l’expérience, 8c
encore les différens auteurs ne nous donnent-ils de leurs
tentatives que des réfultats oppofés; tels que ceux que nous