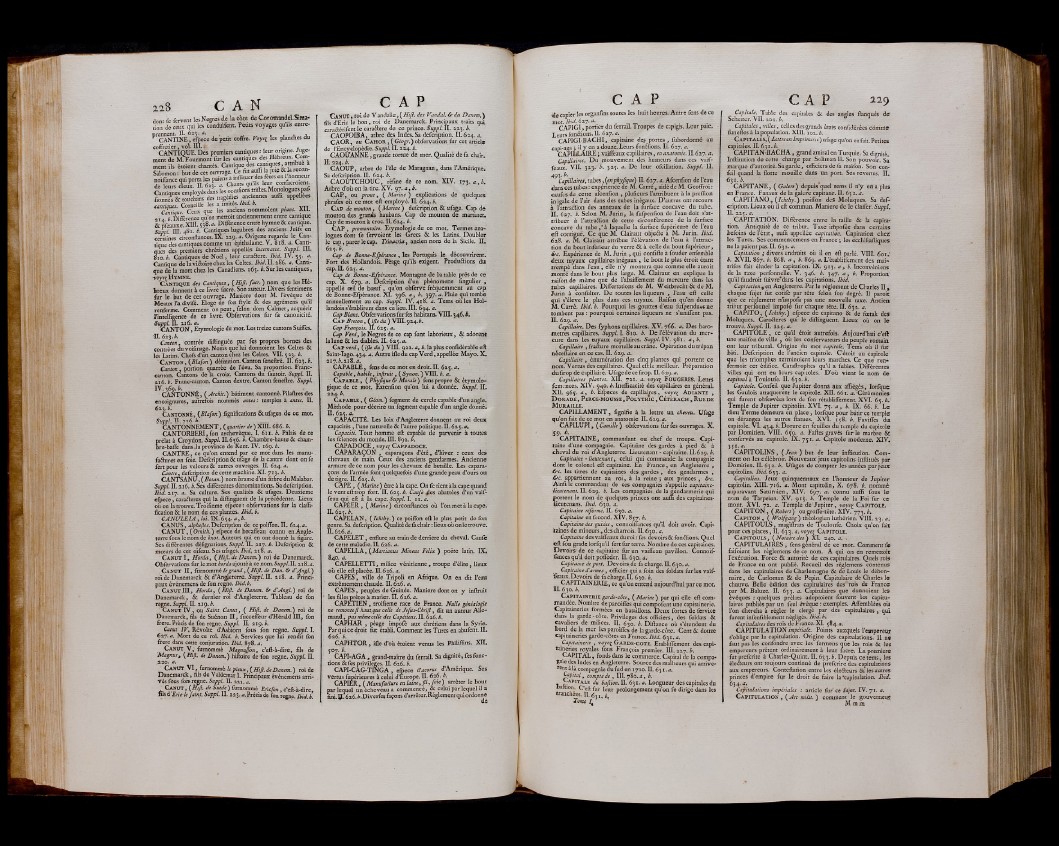
2.28 C A N
dont <e fervent les Nègres de l i côte tle CoromandelSlmi-
tion de ceux qui les conduifent. Petits voyages quüs entre-
PtCANTINE, efcece de petit coffre. Voyti les planches du
coffrctier ,vol. lu . v T a
CANTIQUE. Des premiers canaques : leur origine. Jugement
de M. Fourmont fur leç cantiques des Hébreux. Comment
ils étoient chantés. Cantique des
Salomon : but de cet ouvrage. Ce fin ¡suffi la joie & J»
noiffance qui porta les païens à rnfttner des fîtes en
de leurs dieux. II. 6 ij. *■ W & J & g Ê S â t i È Ê Ê m
C^dqîTes m^îoyés dmis les occafions trilles. Monologues pat
lionnes & touchons des tragédies anciennes aufli appelées
cantiques. Corneille les a mutés. Iota. b.
Cantique Ceux que les anciens nommoient pums. XII.
âï4 3 Différence qu’on mettoit anciennement entre cantique
& pfcàume. XIII. 538. a. Différence entfe hymne 8c cantique.
Suvvl III 481- b■ Cantiques lugubres des anciens Juifs en
certaines circonfiances. IX. M9. n. Origene regarde le: Can-
tique des cantiques, comme un épithalame. V . 818. a. Cantiques
des premiers chrétiens appellés lucemates. Suppl. III.
810. b. Cantiques de Noël, leur caraôere. Ibid. IV. 55. a.
Cantique delaviftoirechezles Celtes. Ibid. II. 286. a. Cantique
de la mort chez les Canadiens. 165. b. Sur les cantiques,
-voyezHymne. ,
C antique des Cantiques, (Hifi.facr.) nom que les Hé-
ireux donnent à ce livre fecré. Son auteur. Divers fentimens
fur le but de cet ouvrage. Maniéré dont M. l’évêque de
Meaux l’a divifé. Eloge de fon ftyle 8c des agrémens qu’il
renferme. Comment on peut, félon dom Calmet, acquérir
l ’intelligence de ce livre. Obfervations fur fa canonicité.
Suppl. fi. a i6. a. 1 _
CANTON, Etymologie du mot. Les treize cantons Sûmes.
IL 623.Î. : . , ,
Canton, contrée diftinguée par fes propres bornes des
contrées du voifinage. Noms que lui donnoient les Celtes 8c
les Latins. Chefs d’un canton chez les Celtes. VII. 523. b.
'C a n t o n , (Blafon) définition.Cantonfeneftré. II. 623.b.
Canton, portion quarrée de l’éeu. Sa proportion. Franc-
canton. Cantons de la croix. Cantons du fautoir. Suppl. H.
a i 6. b. Ftanc-canton. Canton dextre. Canton feneftre. Suppl.
IV. 369. b.
CANTONNÉ, (Archit.) bâtiment cantonné. Pilaftres des
encoignures, autrefois nommés antes: temples à antes. II.
623.3.
C antonné, (Blafon) Lignifications 8cufages de ce mot.
Suppl. II. 216. b.
CANTONNEMENT, ( quartier de) XIII. 686. b.
CANTORBERI,fon archevêque. I. 611. b. Palais de ce
Srélat à Croydon. Suppl. II. 656. b. Chambre-haute 8c cham-
re-baffe dans Ja proyince de Kent. IV. 169. b.
C ANTRE, ce qu’on entend par ce mot dans les manu-.
faâures en foie. Defcription 8c ufage de la cantre dont on fe
fert pour les velours 8c autres ouvrages. II. 624. a.
Cantre, defcription de cette machine. XI. 713 .b.
CANTSANü, ( Botan.) nom brame d’un ârbre du Malabar.
Suppl. H. 216. b. Ses différentes dénominations. Sa defcription.
Ibid. 217. a. Sa culture. Ses qualités 8c ufages. Deuxième
efpcce, carafteres qui la diftinguent de la précédente. Lieux
où on la trouve. Troifieme efpece: obfervations fur la claffi-
fication 8c le nom de ces plantes. Ibid. b.
CANULEIA, loi. IX. 634.4,3.
CANUS, alphefles. Defcription de ce poiffon. II. 624.4.
CANUT, ( Omith. ) efpece de becaffeau connu en Angleterre
fous le nom de knot. Auteurs qui en ont donné la figure.
Ses différentes défignations. Suppl. H. 217. 3. Defcription 8c
moeurs de cet oifeau. Ses ufages. Ibid. 218. a.
C anut I , Horda, (Hiß. de Danem.) roi de Danemarck.
Obfervations furlemot horda ajouté à ce nom.Suppl.il. 218.4.
C anu t II, fumommé le grand, (Hiß. de Dan. & d'Angl. )
roi de Danemarck 8c d’Angleterre. Suppl. H. 218. a. Principaux
événemens de fonregne. Ibid.b.
CANUT III, Horda, (Hiß. de Danem. & d'Angl.) roi de
Danemarck, 8c dernier roi d’Angleterre, Tableau de fon
regne. Suppl. II. 219.3.
C a n u t tV , ou Saint Canut, ( Hiß. de Danem.) roi de
Danemarck, fils de Suénon H, fuccefleur d’Hérald III, fon
frere. Précis de fon regne. Suppl. IL 219.3.
Canut IV, Révolte d’Asbiorn fous fon regne. Suppl. I.
627.4. Mort de ce roi. Ibid. 3. Services que lui rendit fon
frere dans cene conjuration. Ibid. 878.4.
C anut V fu rn om m é Magnujfbn, c’eft-à-dire, fils de
Magnus, (Hiß. de Danem. ) hiuoire de fon regne. Suppl. IL
.220. 4.
CANUT V I . furnouraiè U pimx, (Hiß. diDanm.) roi de
Danemarck, fils de Valdemar I. Principaux événemens arrivés
fous fon regne. Suppl. IL 221. a.
C a n u t , (Hiß. de Suede ) fumommè Ericfon, c’eff-à-dire,
fils à.'Eric le faint. Suppl. H. 223.4. Précis de fon regne. Ibid 3
CAP CANUT, roi de V andalie, ( Hiß. des Vandal. 6* du Danem. )
fils d’Eric le bon, roi de Danemarck. Principaux traits qui
cara&érifent le caraâere de ce prince. Suppl. II. 223.3.
CAOPOIBA, arbre des Indes. Sa defcription. IL 624.4.
CAOR, ou C ah o r , ( Gcogr.) obfervations fur cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. II. 224.3.
CAOüANNE, grande tortue de mer. Qualité de fa chair.
Q. 224. 3.
CAOUP, arbre de l’ifle de Maragnan, dans l’Amérique.
Sa defcription. II. 624.3.
CAOUTCHOUC, réfine de ce nom, XIV. 173. 4 ,3 .
Arbre d’où on la tire. XV. 97.4,3.
CAP, ou proue, (Marine) explications de quelques
phrafes où ce mot eft employé, ü . 624.3.
C a p de mouton, ( Marine ) defcription & ufage. Cap de
mouton des grands haubans. Cap de mouton de martùiet.
Cap de mouton à croc. IL 624. 3.
CAP , promontoire. Etymologie de ce mot. Termes analogues
dont fe fervoient les Grecs 8c les Latins.. Doubler
le cap, parer le cap. Trinacria, ancien nom delà Sicile. IL
625.3.
Cap de Bonne-Efpêrance , les Portugais le découvrirent.
Fort , des Hollandois. Péage qu’ils exigent. Productions du
cap. II. 625.4.
Cap de Bonne-Ejpérance. Montagne de la table près de ce
cap. X. 679. 4. Defcription d’un phénomène fingulier ,
appelle oeil de boeuf, qu’on obferve fréquemment au cap
de Bonne-Efpérance. XL 396. 4 , 3. 397.4. Pluie qui tombe
annuellement au cap. Suppl. IV. 418. a. Teins où les Hollandois
s’établirent dans ce lieu. III. 694. a.
Cap Blanc. Obfervations fur fes habitans. VIII. 346.3.
C a p Breton, (¡(ledu) V IIL924.3.
Cap François. U. 625. a.
Cap Verd, le Negres de ce cap font laborieux, & adorent
la lune & les diables. II. 625.4.
Cap verd ,(ifle du) VIII. 922.4 , 3. la plus confidérable eil
Saint-Iago. 434. a. Autre ifledu cap Verd, appellée Maÿo. X.
2x7.3.218.4.
CAPABLE, fens de ce mot en droit. H. 625.4.
Capable, habile , inßruit, ( Synon. ) VIII. 3. a.
C a pa b l e , (Phyfique& Morale) fens propre & étymologique
de ce mot. Extenfion qu’on lui a donnée. Suppl. U.
224.3.
C apable , ( Géom.) fegment de cercle capable d’un angle.
Méthode pour décrire un fegment capable d un angle donné.
II. 62c. 4.
CAPACITÉ. Les loix d’Angleterre donnent au roi deux
capacités, l’une naturelle 8c l’autre politique, ü . 625. a.
Capacité. Tout homme eff capable de parvenir à toutes
les fciences du monde, m. 892. 3.
CAPADOCE, voyeç_ C appadoce.
CAPARAÇON , caparaçons d’été, d’hiver : ceux des
chevaux de main. Ceux des anciens gendarmes. Ancienne
armure de ce nom pour les chevaux de bataille. Les caparaçons
de l’armée font quelquefois d’une grande peau d’ours ou
de tigre. H. 625.3.
CAPE, (Marine ) être à la cape. On fe tientàla cape quand
le vent eft trop fort. H. 625.3. Caufe des abattées d’un vaif-
feau qui eft à la cape. Suppl. I. x x. a.
CAPÉER, ( Marine ) circonftances où l’on met à la cape.
11.625.3.
CArELAN, (Ichthy.) ce poiffon eft le plus petit de fon
genre. Sa defcription. Qualité de fa chair : lieux où on le trouve.
IL 626.4.
CAPELET, enflure au train de derrière du cheval. Caufe
de cette maladie, ü . 626. a.
CAPELLA, ( M a rù a n u s Mineus Felix ) poëte latin. IX«
840. 4.
CAPELLETTI, milice vénitienne, troupe d’élite, lieux
où elle eft placée. II. 626. a.
CAPES', ville de Tripoli en Afrique. On en dit l’eau
extrêmement chaude. II. 026. a.
CAPES, peuples de Guinée. Maniéré dont on y inftruit
' les filles prêtes à marier, ü. 626. a.
CAPETIEN, troifieme race de France. Nulle généalogie
ne remonteß haut que celle de Jefus-Chrifl, dit un auteur Allemand,
pas mime celle des Capétiens.ïl. 62 6. 3.
CAPHAR , péage impofé aux chrétiens dans la Syrie.
Par qui ce droit fut établi. Comment les Turcs en abufent. II.
626. 3.
CAPHTOR, ifle d’où étoient venus les Philiftins. XIL
507. 3.
CAPI-AGA , grand-maître du ferrail. Sa dignité, fes fonctions
8c fes privilèges. II. 626.3.
CAPI-CAG-TINGA , efpece à'aconis d’Amérique. Ses
vertus fupérieùres à celui d’Europe. II. 626. 3.
CAPIER, ( Manufacture en lam e , f i l , f o i e ) arrêter le bout
par lequel un écheveau a commencé, & celui par lequel il a
fini. D. 626.3.DiYerfe$ façons d’arrêter. Règlement qui ordonne
de
CAP CAP xle capier les organfins toutes les huit heures. Autre fens de ce
mot. Ibid. 627. »
CAPIGI, portier du ferrail. Troupes de capigis. Leur paie.
Leurs fonâions. II. 627. a.
CAPIGI-BACHI, capitaine de? portes, fuberdonné au
capi-aga ; il y en a douze. Leurs fondions. II. 627. a.
CArlIaLAlRE ; vaiffeaux capillaires, en anatomie. II. 627.4.
Capillaires. Du mouvement des humeurs dans ces vaif-
feaux. VII. 323. 3. 325. a. De leur ofcillation. Suppl. II.
4 9 3 .3.
Capillaires, tubes, (enphyfique\ II. 627. a. Afcenfion de l’eau
dans ces tubes : expérience de M. Carré, aidé de M. Geoffroi :
caufes de cette alcenfion, plufieurs l’attribuent à la preflion
inégale de l’air dans des tubes inégaux. D’autres ont recours
à l’attradion des anneaux de la lurface concave du tube.
II. 627. 3. Selon M. Jurin, la fufpenfion de l’eau doit s’attribuer
à l’attradion de cette circonférence de la furface
concave du tube ,* à laquelle la furface fupérieure de l’eau
eft contiguë. Ce que M. Clairaut objede à M. Jurin. Ibid.
628. 4. M. Clairaut attribue l’élévation de l’eau à l’attraction
du bout inférieur du verre 8c à celle du bout fupérieur,
&c. Expérience de M. Jurin, qui confifte à fouder enfemble
deux tuyaux capillaires inégaux, le bout le plus étroit étant
trempé dans l’eau, elle n’y montera que comme elle auroit
monté dans le bout plus large. M. Clairaut en explique la
raifon de même que de l’abaiffement du mercure dans les
tubes capillaires. Differ tâtions de M. Weitbrecht 8c de M.
Jurin à confulter. De toutes les liqueurs , l’eau eft celle
qui s’élève le plus dans ces tuyaux. Raifon qu’en donne
M. Carré. Ibid.b. Pourquoi les gouttes d’eau fulpenduvsne
tombent pas : pourquoi certaines liqueurs ne -.s'unifient pas.
IL 629.4.
Capillaire. Des fyphons capillaires. XV. 766. a. Des baromètres
capillaires. Suppl. I. 810. 3. De l’élévation du mercure
dans les tuyaux capillaires. Suppl. IV. 981. 4 , 3.
Capillaire, fracture mortelle au crâne. Opération du trépan
néceffaire en ce cas. IL 629. a.
Capillaire, énumération des cinq plantes qui portent ce
nom. Vertus des capillaires. Quel eft le meilleur. Préparation
dufirop de capillaire. Ufagedecefirop. U. 629.4.
Capillaires plantes. XII. 7 2 X. a. voyt{ FOUGERES. LeurS
femences. XIV. 940.3. Inefficacité des capillaires en général.
XII. 965. 4 , 3. Efpeces de capillaires, voye^ A d ia n t e ,
D o r a d e , Perce-mousse , P o l y t r i c , C é t é r a c h , R ue de
M u r a i l le .
CAPILLAMENT, fignifie à la lettre un cheveu. Ufage
qu’on fait de ce mot en anatomie II. 629.4.
CAPILUPI, (Camille) obfervations fur fes ouvrages. X.
39. 3.
CAPITAINE, commandant ou chef de troupe. Capitaine
d’une compagnie. Capitaine des gardes à pied & à
cheval du roi d’Angleterre. Lieutenant - capitaine. II. 629.3.
Capitaine - lieutenant, celui qui commande la compagnie
dont le colonel eft capitaine. En France, en Angleterre ,
&c. les titres de capitaines des gardes , des gendarmes ,
£>c. appartiennent au roi, à la reine ; aux princes , &c.
Ainfi le commandant de ces compagnies s’appelle capitaine-
lieutenant. II. 629. 3. Les compagnies.de la gendarmerie qui
portent le nom de quelques princes ont auffi des capitaines-
lieutenans. Ibid. 630. a.
Capitaine réformé. II. 630. a.
Capitaine en fécond. XIV. 857. 3.
Capitaine des guides, connoiuances qu’il doit avoir. Capitaines
de mineurs, des charrois. IL 630. a.
Capitaine des vaiffeaux du roi : fes devoirs & fondions. Quel
eft fon grade lorfqu’il fert fur terre. Nombre de. ces capitaines.
Devoirs- de ce capitaine fur un vaiffeau pavillon. Connoif-
fanecs qu’il doit pofféder. II. 630. a.
Capitaine de port. Devoirs de fa charge. II. 630. a.
, Capitaine darmes, officier qui a foin des foldats furies vaif-
feaux. Devoirs de facharge.il. 630. 3.
CAPITAINERIE, ce qu’on entend aujourd’hui par ce mot.
II. 630.3.
C apitainerie garde-côte, (Marine) par qui elle eft commandée.
Nombre de paroiffes qui compofent une capitainerie.
Capitaineries formées en bataillons. Deux fortes de fervice
dans la garde - côte. Privilèges des officiers, des foldats 8c
cavaliers de milices. II. 630. 3. Diftance où s'étendent du
bord de la mer les paroiffes de la garde-côte. Cent 8c douze
capitaineries garde-côtes en France. Ibid. 631. a.
Capitainerie , voye^ Q arde-cote. Etabliffement des capitaineries
royales fous François premier. III. 227. 3.
CAPITAL, fonds dans le commerce. Capital de la compa-*
gme des Indes en Angleterre. Source des malheurs qui arrive-
re“t âlà compagnie dufud en 1720. II. 63 x. a.
Capital, compte de , III. 780.4,3.
- (V PlTA,LE b*fiion.\l. 631.4. Longueur des capitales du
a tion. C’eft fur leur prolongement qu’on fe dirige dans les
tranchées. II. <5, x 3 r & ^ *
Tome I%
Capttalé. TéAe des capitales 8c des angles flanqués de
Scheiter.VII.201.3.
■ Capitales, villes, celles des grands états confidérées comme
funeftes à la population. XIII. 102.3.
C apitales, (Lettre en Imprimerie) ufage qu’on en fait. Petites
capitales. II. 631.3.
CAPITAN-BACHA, grand amiral en Turquie. Sa dignité.
Inftitution de cette charge par Soliman IL Son pouvoir. Sa
marque d’autorité. Sa garde, officiers de fa maifon. Son con-
feil quand la flotte mouille dans un port. Ses revenus. II.
631.3. ’ fe jSgS
CAPITANE, ( Galere) depuis quel tems il n’y en a plus
en France. Fanaux de la galere capitane. II. 632. a.
CAPITANO, ( Ichthy. ) poiffon des Moluques. Sa defcription.
Lieux où il eft commun. Maniere de le clafier. Suppl.
II. 225. 4.
CAPITATION. Différence entre la taille 6c la capita*
tion. Antiquité de ce tribut. Taxe iifipofée dans certains
befoins del état, auffi. appellée capitation. Capitation ch et
les Turcs. Ses commencemens en France j les eeelefiaftiques
ne la paient pas. H. 63 2. a.
Capitation ; divers endroits où il en eft parlé. VIII. 6oi.’
3. XVII. 867. 3, 868. 4 , 3. 869.4. L’établilfemc nt des maî-
trifes fait éluder la capitation. IX. 913. a , 3. Inconvéniens
de la taxe perfonnelle. V. 346, 3. 347. 4 , 3. Proportion
qu’il faudroit fuivre*dans les capitations. Ibid.
Capitation 9 en Angleterre, Par le règlement de Charles I I ,
chaque fujet fut cotifé par tête félon fon degré. Il paroit
que ce règlement n’impofa pas une nouvelle taxe. Ancien
tribut perlonnel impofé fur chaque tête. II. 632. a.
. CAPITO, (Ichthy.) efpece de capitano 8c de foetak des
Moluques. Cara&eres qui le diftinguent. Lieux où on le
trouve. Suppl. II. I25. a.
CAPITOLE , ce qu’il étoit autrefois. Aujourd’hui c’eft
une maifon de ville , où les confervateurs du peuple romain
ont leur tribunal. Origine du mot capitole. Tems où il fut
bâti. Defcription de l’ancien capitole. C’étoit au capitole
?[ue les triomphes terminoient leurs marches. Ce que ren-
ermoit cet édifice. Cataftrophes qu’il a lubies. Différentes
villes qui ont eu leurs capitules. D'où vient le nom de
capitoui à Touloufe. II. 632. 3.
Capitole. Confeil que Jupiter donna aüx affiégés, lorfque
les (Gaulois attaquèrent le capitole. XII. 661. a. Cérémonies
qui furent obfervées lors de fon rétabliffement. XVI. 65. 3.
Temple de Jupiter capitolili. XVI. 75. 4 , 3 . IX. 66. 3. Le
dieu Terme demeura en place, lorfque pour bâtir ce temple
on dérangea les autres ftatues. XVI. 158, 3. Faviffes du
capitole. VI. 434.3. Dorure en feuilles du temple du capitole
par Domitièn. VIII. 659. a. Faftes gravés fur le marbre 8c
confervés au capitole. ÎX. 751. 4. Capitole moderne. XIV.
351.4.
CAPITOLINS , ( Jeux ) but de leur inffituti&n, Comment
on les célébroit. Nouveaux jeux capitolins inftitués par
Domitien. IL 632. 3. Ufages de compter les années par jeux
capitolins. Ibid. 633. a.
Capitolins. Jeux quinquennaux en l’honneur de Jupiter
capitolin. XIII. 716. a. Mont capitolin, X. 678. 3. nommé
auparavant Saturnien, XIV. 697. a. connu auffi fous le
nom de Tarpeïen. XV. 915. 3. Temple de la Foi fur ce
mont. XVI. 72. 4. Temple de'Jupiter, voyez C a p i t o l i .
CAPITON, ( Robert) ougroffe-tête. XIV. 773.3.
C a pito n , ( Wolfgang) théologien luthérien. VIII. 23. al
CAPITOULS, magiftrats de Touloufe. Choix qu’on fait
pour ces places, II. 633. a. voyez C a pito le.
CAPITOULS , ( Notaire des ) XI. 240. a. .
CAPITULAIRÈS , fens général de ce mot. Comment fe
faifoient les réglemens de ce nom. A qui on en remettoit
l’exécution. Force 8c autorité de ces capitulaires. Quels rois
de France en ont publié. Recueil des réglemens contenus
dans les capitulaires de Charlemagne 8c de Louis le débonnaire
, de Carloman 8c de Pépin. Capitulaire de Charles le
chauve. Belle édition des capitulaires des' rois de France
ar M. Baluze. II. 633. a. Capitulaires que donnoient les
vêques : quelques prélats adoptoient fouvent les capitulaires
publiés par un feul évêque : exemples. Affemblées oii
l’on chercha à régler le clergé par des capitulaires, qui
furent infenfiblement négligés. Ibid. 3.
Capitulaires des rois de France. XI. 584. a.
CAPITULATION impériale. Points auxquels l’empereur
s’oblige par la capitulation. Origine des capitulations. Il ne
faut pas les confondre avec les fermens que les rois 8c les
empereurs prêtent ordinairement à leur iacre, La premiere
fut oreferite à Charles-Quint. II. 633.3. Depuis ce tems, les
éleâeurs ont toujours continué de preferire des capitulations
aux empereurs. Conteftation entre les éleéteurs 8c les autres
princes d’empire fqr le droit de faire la'capitulation. Ibid.
634* É
Capitulations impériales : article fur'ce fujet. IV. 71. 4.
C a pitu la t io n , (Art milit. ) comment le gouvernent
M mm