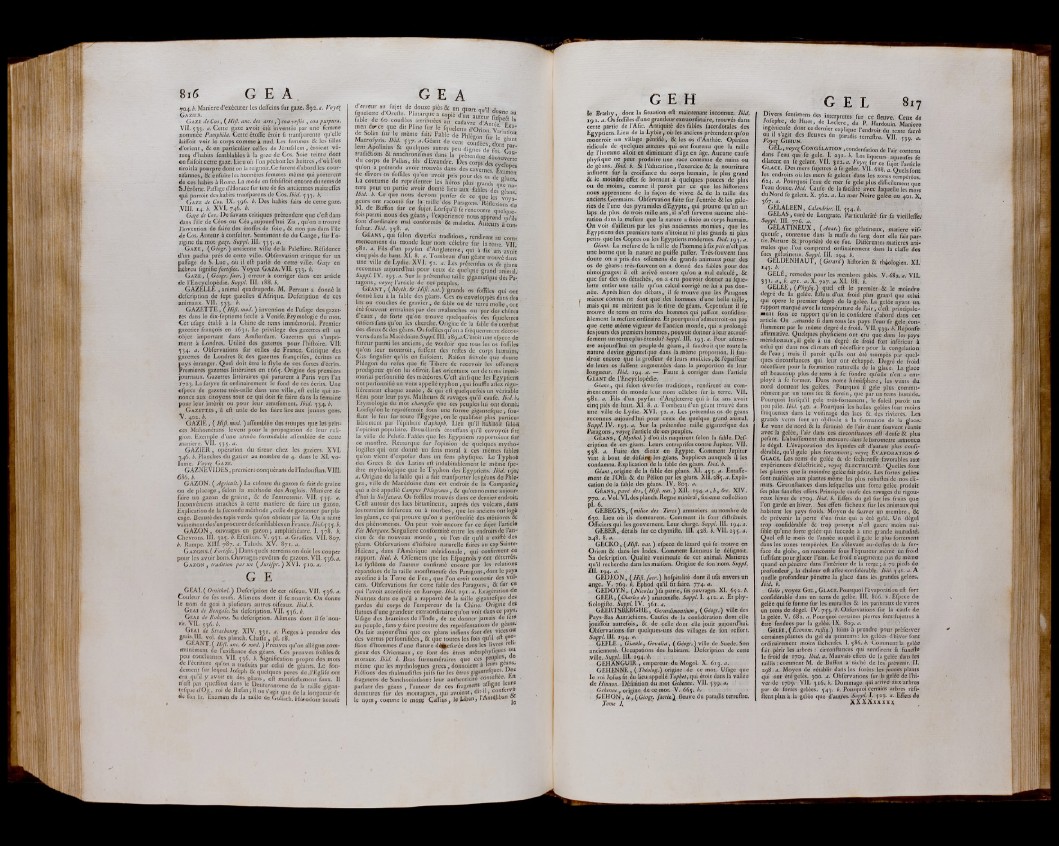
816 G E A G E A
704. b. Manière d'exécuter les defleins fur gaze. 89t . a. Voyty
G a z i e r .
G a z e de C os , (H ift . anc. des arts , ) c o a v e fiis , coa purpura.
VII. 533. a. Cette gaze avoit été inventée par une femme
nommée Patnphila. Cette étoffe étoit fi tranfparcnte qu’elle
laiflbit voir le corps comme à nucl. Les femmes 6c les filles
d’orient, 6c en particulier celles de Jértifalcm, éroient v ê tues
d'habits fcmblablcs à la gnze de Cos. Soie teinte dont
on raifoit cette gaze. Lieu où l’on déchoit les huîtres, d'où l’on
tiroitla pourpre dont on la rcignoit.Cc furent d’abord les cour-
tifaunes, 6c enfuitelcs honnêtes femmes même qui portèrent
de ces habits h Rome. La mode en fubfiAoit encore du temsde
S.Jérôme. Paflàgcd'Horacc fur une de fes anciennes maitreffes
qui portoit desnabits tranfparens de Cos .Ibid. 513, b.
G aze de Cos. IX. 396. b. Des habits faits de cette gaze.
.VIII. 14. b. XVI. 74& 1
Gare de Cos. D e favans critiques prétendent que c’cA dans
dans 1 île de Céos ou C é a , aujourd hui Zia , qu’on a trouvé
l ’invention de faire des étoffes de foie, & non pas dans l’ile
de Cos. Auteur à confulter. Sentiment de du Cange, fur l'o rigine
du mot ea^e. Suppl. 111. «33. a.
Gaze , ( Géogr. ) ancienne ville de la PalcAine. Réfidcncc
d’un pacha prés de cette ville. Obfcrvation critique fur un
tiaffage de S. L u c , où il cfl parlé de cette ville. Ga\e en
lébrcu fignifie fortifiée. V o y e z G a z a . VII, 333. b.
G a z e , ( Geogr. fa e r .) erreur à corriger dans cet article
de l'Encyclopédie. Suppl. III, 188. b.
GAZELLE , animal quadrupède. M. Perraut a donné la
defeription de fept gazelles d Afrique. Defeription de ces
animaux. V IL 533. b.
G A Z E T T E , ( f f i f i . rnod. ) invention de l’ufagc de*gazettes
dans le dix-feptieme ficelé à Venife. Etymologie du mot.
Cet ufage établi h la Chine de tems immémorial. Premier
gazetier françois en 1631. Le privilège des gazettes efl un
objet important dans Amftcrdam. Gazettes qui s’impriment
à Londres. Utilité des gazettes pour l'hiAoire. VIL
334. a. Obfcrvations fur celles de France. Critique des
gazettes de Londres & des gazettes françcifes, écrite* en
Ïiays étranger. Quel doit être le ftyle de ces fortes d’écrits.
Vemicres gazettes littéraires en 1663. Origine des premiers
journaux. Gazettes littéraires qui parurent à Paris vers l’an
Z723. La fatyre fit ordinairement le fond de ces écrits. Une
cfpecc de gazette très-utile dans une v ille , eA celle qui annonce
aux citoyens tout ce qui doit fe faire dans la femaine
pour leur intérêt ou pour leur amufement. Jbid. 334. b.
G azettes , il efl utile de les faire lire aux jeunes tiens.
V . 402. b.
G A Z IE , ( ffifi. mod. ) affemblée des troupes que les princes
Mahoinérans lèvent pour la propagation de leur religion.
Exemple d'une armée formidable affemblée de cette
manière. VII. 33s. a.
G A Z IE I l, opération du tireur chez les gazier*. X V L
Î,4Ô. b. Planches du gazier au nombre de 4. dans le XI. vo-
umc. Poyef G aze.
GAZNë'V ID ES, premiers conqucrans de l’Indouflan. VIII,
686. b.
GAZON . ( Agricult. ") La culture du gazon fe fait dé graine
ou de placage , félon Ja méthode des Anglois. Maniéré de
faire un gazon de graine, 6c de l’entretenir. VII, 333, a.
Inconvémcns attachés à cette manière de faire un gazon.
Explication de la fécondé méthode, celle de gazonner par placage.
Beauté des tapis verds qu'on obtient par l/i. On a tenté
Vainement de s’en procurer de fcmblablcs en France. Ibid.q 3 3. b.
G A Z O N , ouvrages en gazon ; amphithéâtre. I. 378. b.
Chevrons. 111. 3»<. b. Efcalier». V . 931. a. Gradins. V il. 807.
b. Rampe. XIII. 787. a. Taluds. X V . 871. a.
G a zo n s . ( fortifie. ) Dans quels terreins on doit le* couper
pour les avoir bons. Ouvrages revêtus de gazons. VII. 336. a.
G a zo n , tradition par un ( Jurifpr. ) X V L 510. a.
G E
G EM .iO r n itA o l. ) Defeription de cet oifeau. VII. 336. a.
Couleur de fes oeufs. Alimcns dont il fe nourrit. On donne
le nom de geai à pluficurs autres oifeaux. Ibid. b.
Geai de Bengale. Sa defeription. VII. 336, b.
G eai de Boheme. Sa defeription. Alimcns dont il fe *11011-
ru. VU. 336, b.
Gp.ai de Strasbourg. XIV. 331. a. Pièges à prendre des
gcaiUH. vol. des planch. Chafle, pl. 18.
GEANT, ( Hiß. anc. & mod. ) Preuve* qu’on allègue communément
de I exiflencc de* géan». Ces preuve* foibles 6c
peii concluante*. VII. 336, b. Signification propre de* mots
de 1 écriture qu on a traduits par celui de géants. Le fon-
iem em ; fur lequel Jofçph & quelques p e r« d e .l’I g lifc ont
cru qu il y avoir eu t a * » , c ft mauifeftcmenl fauu. Il
ncA pas queftion dan* le Deuteronome de la taille gigan-
te fq u cdO g , roi de IJafan;U n e ijllc dc);i |ongu5 f d e
de fon ht. Examen de la taille dc Golwth. Hérodote Uccufé
d’erreur au fujet de douze piés & un miarr n..’:t 1
fquclettc d’O rcfle. Plutarque a copié d’un ô iiS , Î ? " « au
fa'blc de 60 coudées a.,r?buéc, ^ c a dm c d 'A u ^ 0? '*
incn dirco que dit Pline fur le fquelctie d'Orion V ■ x“‘
de Solin lur le môme fait; Fable dc Phléeon îïirÉ É p i
Macrofyris; Ibid. 537, a. Géant de cent coudée. .u .
lent Ajiolinius & quelques autres peu digues de’
traditions & nnachronifmes dans la nré,endue découd
du corps de Paiias, fila d’Evandre. ¿ e s É l 1 B B
qu on a prétendu avoir trouvés dans des cavernes E*
de divers os foAilcs qu’on avoir pris pour des os :d ï X ?
La coutume de repréfeuter les héros plus grands «.fe n,
VJw P,ci“ .cn Partic avoir don"* lieu aux fables des eé,nV
Ibid. b. Ce que nous devons penfer dc ce que les
e c u r s o n t racnnr/« fu r la ,\...genre ont raconté fur la taille des DP,a..t..a..g..o...n.. s. uR.é, fi lcx.mnÏÏI
M. dc Btiffon fur ce fujet.Lortqu'ilf e S n t r e q T e ïïu t
fois parmi nous desgéans, l’expérience nous apprmd tu,'ils
font d ordinaire mal conformés & malades. Auteurs ù con.
fultcr. Ibid. 338. a.
Gé *N S ,q u t félon dlvcrfes traditions, rendirent au coma
mencemcnt du monde leur nom célèbre fur la terre VII
981. a. Fils d’un payfàn d’Angleterre, qui !i f,x ans'avoir
cinq piés dc haut. XI, 8. ». Tombeau d'un géant trouvé dans
une ville dc Lydie. XVI. 5a. „ . Les prétendus os dc géana
reconnus aujourd'hui pour ceux dc quelque grand animal.
Suppl. IV. 193. a. Sur la prétendue taille gignmcfque des IV
tagons, voye^ l’article dc ces peuples.
G é a n t , (M y th . & I lif l.n a t ,) grands os foililcs qui ont
donné lieu h la fable des géans. Ces ou enveloppés dans dc»
lits ou couches de gravier, dc fable ou dc terre molle, one
été fouvcnt entraînés par des avalanches ou par de* chiite»
d’eaux, dc forte qu’on trouve quelquefois des fquclettc»
entiers fans qu’on les cherche. Origine de la fable du combae
des dieux ¿¿des géans. Osfoflilesqu’on a fréquemment découverts
dans la Macédoinc.5«p/>/. III. ify .a .G 'litoit uncefpecc de
fureur parmi les anciens, de vouloir que tous les o* fofliles
qu’on leur montroit, fuflent des refles dc corps humains;
C is fingulicr qu’ils en faifoient. Raifon frivole que donne
Phlcgon du refus que fit Tibère de recevoir les oflemen»
prodigieux qu’on lui oflroit. Les orientaux ont dc tems immémorial
perfonnifié des météores. C ’cfl ainfi que les Egyptien»
ont perfonnifié un veut appelle typhon, qui (buffle allez régulièrement
chaque année, 6c qui eA quelquefois un véritables
fléau pour leur pays. Malheurs & ravages qu’il caufe. Ibid. />;
Etymologie du mot champfin que ces peuple* lui ont donné;
Lorfqu’on le repréfentoU tous une forme pigantcfque, fou-
flant le feu fur toute l'Egypte, on le qualinoit plus particu-!
fièrement par l’épithcte d ap/toph. Lieu qu’il habitoit felo/x
l’opinion populaire. Brouillards étouffans qu’il envoyoit fins
la ville dc Pehife. Fables que les Egyptiens rapportoient fui
ce monArc. Remarque fur l’opinion de quelques mytho-*
logiAcs qui ont donné un fens moral h ces mêmes fable»
qu on vient d’expofer dans un fens phyfique. Le Typhoé
des Grecs 6c des Latins eA indubitablement le même fpc-,
élrc mythologique que le Typhon des Egyptiens. Ibid. 190;
a. Origine de la fable qui a fait tranfportcr le* géans dc Phi«-
g ra , ville de Macédoine dans cet endroit dc Ta Campame;
qui a été appelle Campus Phlcgrceus, 6c qu'on nomme aujourd’hui
la Solj'atara. O s fofliles trouvés dans c e dernier endroit;
G’eA autour des lacs bitumineux, auprès des volcans, dan»
les terreins ftilfnreux ou 2t tourbe*, que le* anciens ont logé
les géan», ce qui prouve qu’on a perfonnifié des météores oc
de* phénomènes. O n peut voir encore fur ce fujet l’article
P ie Morgane. Singulière conformité entre les endroits de J’an-
cicn 6c du nouveau monde , où l’on dit qu’il a exifié des
géan*. Obfcrvations d’hifloire naturelle faites au cap Sainte-
Hélène, dan* l’Amérique méridionale, qui confirment co
rapport. Ibid, b. Oflemens que les Efpagnols y ont déterrés*
Le fyAéme dc l'auteur confirmé encore par le* relation»
répandues dc la taille monflrueufc des Paragons,dont lepay»
avoifincà la Terre dc F eu , que l’on croit contenir des volcans.
Obfcrvations fur cette fable des Patagons, 6c fur ce
qui i’avoit accréditée en Europe. Ibid. 191. a. Exagération de
Nunnez dans ce qu’il a rapporté de la taille gignutcfquc des
garde* du corps de l’empereur de la Chine. Origine dc»
Aatucs d’une grandeur extraordinaire qu’on voit dans ce pay*«
Ufage des bramines dc l'Inde, de ne donner jamais de füto
au peuple, fans y faire paroitre des repréfentations de géans.
On fait aujourd'hui nue ces géans indiens font des vices oit
des vertus perfonnifices, 6c que toutes les fois qu’il cfl q*'®*
Aion d’hommes d’une Aaturc défccfiiréc dans les livres religieux
des Orientaux, ce font des êtres métaphyfiq,,cs
moraux, Ibid. b. Bras furnuméraires que ces pc«P*c** ®
même que les mythologues grec s, donnoient h '
Fiélions des thalmudiAes juifs fur les êtres giganrcfquc»- e
fragmens de Sanchoniathon : leur authenticité c o n t c i tc c .^
parlant des géan» , l’auteur de ces fragment aflignc
demeures fur des montagnes, qui avoient, dit-il, corne
le nçm f comme le mont Calfiys, le J-iban, lAntejiw ^
G E H
te Bratliy, dont la fituation eA maintenant inconnue. Ibid.
192. a. O s fofliles d’une grandeur extraordinaire, trouvés dans
cette partic dc l’Afic. Antiquité des fables facerdotalcs des
Egyptiens. Lieu de la Lybie, où les anciens prétendent qu’on
montroit un village pétrifié, 6c les os d’Anthéc. Opinion
ridicule de quelques auteurs qui ont foutenu que la taille
de l’homme alloit en diminuant d’âge en âge. Aucune caufe
phyfique ne peut produire une race continue de nains ou
dc géans. Ibid. b. Si l’éducation, l’exercice & la nourriture
influent fur la croiflancc du corps humain, le plus grand
6c le moindre effet fe bornent à quelques pouces de plus
ou de moins, comme il paroît par ce que les hiAonens
nous apprennent dc la façon dc vivre & dc la taille des
anciens Germains. Obfcrvation faite fur l’entrée 6c les galeries
de l’une des pyramides d’Egypte. qui prouve qu’en un
laps de plus dc trois mille ans, il n’eft lurvemi aucune altération
dans la mcfurc que la nature a fixée au corps humain.
On voit d’ailleurs par les plus anciennes momies, que les
Egyptiens des premiers tems n’étoient ni plus grands ni plus
petits que les Coptes ou les Egyptiens modernes. Ibid. 193, a.
Géant. La mciurc dc la taille dc l’homme à fix piés n’eApas
une borne que la nature ne puifle pafler. Trés-fouvent fans
doute on a pris des oflemens dc grands animaux pour des
os de géans : trés-fouvent on a donné des fables pour des
témoignages: il eA arrivé encore qu’on a mal calculé, &
que fur des os détachés, on a cru pouvoir donner au fque-
lctte entier une taille qu’un calcul corrigé ne Jui a pas donnée.
Après bien des débats, il fe trouve que les Patagons
1 mieux connus ne font que des hommes aune belle taille,
’ mais qui ne méritent pas le titre de géans. Cependant il fe
trouve dc tems en tems des hommes qui paflent confidéra*
Elément la mcfurc ordinaire. Et pourquoi n’admettroit-on pas
que cette même vigueur dc Y ancien monde, qui a prolongé
les jours des premiers hommes, pouvoir donner h leur ace roi f-
fe nient un terme plus étendu î Suppl. III. 193.4. Pour admettre
aujourd'hui un peuple dc géans, il faudroit que toute la
nature devint gigantcfquc dans la même proportion. Il fau-
riroit encore que la grofleur de leurs imifclcs, 6c l’épaiffeur
de leurs os fuflent augmentées dans la proportion dc leur
•longueur. Ibid. 194. a. — Faute à corriger dans l’article
G é a n t de l'Encyclopédie.
Géans, qui félon tlivctfes traditions, rendirent au commencement
du monde leur nom célebre fur la terre. V i l .
981. a. Fil* d'un payfau d’Angleterre qui ù fix ans avoit
cinq pié» dc haut. Xl. 8. a. Tombeau d’un géant trouvé dans
une ville de Lydie. XVI. 32. a. Les prétendus os dc géans
reconnus aujourd'hui pour ceux de quelque grand animal.
Suppl. IV. 193. a. Sur la prétendue raille gigantcfquc des
Patagons, voye^ l’article dc «es peuples.
G éans , ( Mythol. ) d’où ils naquirent félon la fable. Defeription
de ces géans. Leurs entreprifes contre Jupiter. VII.
538. a. Fuite des dieux en Egypte. Comment Jupiter
vint h bout de.défaire les géans. Supplices auxquels il les
condamna. Explication de la fable des géans. Ibid. b.
Géant y origine de la fable des eéans- XI. 433. a. Entafle-
rnent de l'OlTa & du Pélion parles géans. X 1Í. 283.a .Explication
de la fable des géans. IV. 803. a.
GÉANS, pavé d c s , (H ifi. nat.) XII. 104. a t b , (/e. XIV.
770. a. Vol. VI. des planch. Règne minéral, fixicmc collection
pl. 6.
G EBEGY S, ( milice des Turcs ) armuriers au nombre de
£30. Lieu où ils demeurent, t Comment ils font diAribués.
Officiers qui les gouvernent. Leur charge. Suppl. III. 194. a.
GEBEK, détails fur ce chymiAe. 111. 428. b. V il. 233. a.
'248, 8. a,
G E C KO , (H ifl. nat. ) cfuccc de lézard qui fe trouve en
Orient 6c dans les Indes. Comment Linnæus le défignoit.
Sa defeription. Qualité venimeufe de cet animal. Matières
qu’il recherche dans les maifons. .Origine de fon nom. Suppl.
«II. 104. a.
GEDE0 N , ( Util. faer. ) hospitalité -dont il ufa envers un
ange. V , 769. b. Ephod qu’il nt faire. 774. a.
G E D O Y N , (N ic o la s ) fa patrie, fes ouvrages. XI. 632. b.
G EER, (Charles d e) anatomiAc. Suppl. I. 412. a. Et phy*
fiologiAc. Suppl. IV . 361. a.
GEERTSBËRGHE, Gerardimontium, ( Géogr. ) ville des
Pays-Bas Autrichiens. Caufes de la confidération dont elle
jouiflou autrefois, 6c de celle dont elle jouit jtujourd’hui.
Obfcrvations-fur quelques-uns des villages de fon reflort.
Suppl. IIL 194. a.
GEFLE , Giautlc, G e valia, ( Géogr. Y ville de Suède. Son
ancienneté. Occupations des habitans. Defeription dc cette
.ville. Suppl. IIL 194- b.
GEHANGU1R , empereur du Mogol. X . 6 13. a.
GEHENNE, ( Théolog. ) .originel dc ce mot. Ufage tjuc
le roi Jofiasfit du Ueu appcllé Tophet, qui étoit dans la vallée
de ! hnnon. Définition (lu mot Géhenne. VII. 339. a.
Géhenne, origine, de ce mot. V . 663. b,
.GEHON ,/<-,( Geogr. 0 0 M fleuve du paradis terre Arc.
J'orne /,
G E L 817
ingéniciifc dont ce dernier explique l’endroit du texte facré
ou d aapt des fleuves du paradis terrcflre. VII. m . e.
"o y et &IHI/N. 1 • •
G L L ,v e y ,{ CoNGÉLATlON, condenfation de l'air contenu
dans 1 eau nui le gelé. I. 131. é. Le. liqueurs aqueufes fe
dilatent en te gelant. VII. 3111 . a. Voy ,, (m « ,.art.,cjc
IxlACE. Des mers fujettes a fe geler. VII. 688. ». Quels font
les endroits où les mers fe gèlent dans les zones tempérées.
624. a. Pourquoi l’eau de mer fe eclc plus difficilement que
1 eau douce. Ibid. Caufe de la facilité avec laquelle les mer»
du Nord fe gèlent. X. 362. a, La nier Noire gelée en 401. X .
367. a.
G EL ALLEN, Calendrier, II, 334. b,
G E LA S, curé dc Longrate. Particularité fur fit vicillcfle;
Suppl. III. 776. a.
G E LA T IN EU X , ( Anat, ) Aie gélatineux, matière vif-
queufe, contenue dans la mafle du fang dont elle fait partie.
Nature 6c propriété dc ce fuc. Différentes matières animales
que l’on comprend ordinairement dans la clafle des
fucs gélatineux. Suppl. 111. 194. b.
G E LD EN H AU t, ( Gérard) hiAoricn 6c théologien. XI. ¡11 m
GELE, remedes pour les membres gelés. V.682.4. VIL
331. a . b . 4 y i . a. X. 727. a. XI. 88. b.
GELEE, (Phyfitj.) quel eA le premier,6c le moindre
degré dc la gelée. Effets d’un froid plus grand que celui
qut opère le premier degré dc la gelée. La gelée ayant un
rapport marqué avec la température dc l’air, c cA principalement
fous ce rapport «li'pn le confidcre d’abord dans cet
article. On ..mande A dans tous les pays l’eau fe gclc con-
Aamment par le même degré dc froid. VII. 3391 b. Réponfe
affirmative. Quelques phynciens ont cru que dans les pays
méridionaux, il gclc à un degré dc froid fort inférieur à
celui qui dans nos climats eA néceflairc pour la congélation
de l’eau ; mais il paroît qu’ils ont été trompés par quelques
circonAanccs qui leur ont échappé. Degré de froid
néceflairc pour la formation naturelle de la glace. La glace
oA beaucoup plus de. tems k fe fondre qu’elle n’en a employé
h fe former. Dans notre hémifphcrc, les vents du
nord donnent les gelées. Pourquoi il gclc plus communément
par un tems fcc 6c fcrcin, que par un tems humide.
Pourquoi lojfqu’il gclc très-fortement, le folcil paroît un
peu pâle. Ibid. 340. a. Pourquoi les belles gelées font moins
fréquentes dans le voifinnge des lacs 8c. des rivicres. Les
grands vents font un obAacle ¿1 la formation de la glace*
Le vent de nord 6c la férénité dc l’air étant fouvcnt réunis
avec la gelée, l’air dans ces circonAanccs eA donfe & plu*
pcfartt. L ’abaiflement du mercure dans le baromètre annonces
le dégel. L’évaporation des liquides eA d’autant plus confi-
dérablc, au’il gclc plus fortement; voyc\ É v a p o r a t io n &
G l a c e . Les tems de gelée 8c dc féchcrcfle favorables aux-
expériences d’éleélricitê, voyeç El e c t r ic it é . 1 Quelles font
les plantes que la moindre gelée fait périr. Les fortes gelée*
font nuifiblcM aux plantes même les plus robuAes de nos climats.
CirconAanccs dans lcfquclles une forte gelée produit
fes plus funcAcs effets. Principale caufe des ravages du rigoureux
hiver, dc X709. Ibid. b. Effets du gel fur les fruits que
l’on garde en hiver. Ses effets fâcheux fur les animaux qui
habitent les pays froids. Moyen dc fauver un membre, 8c
de prévenir la perte d’un fruit qui a été gelé. Un dégel
trop confidétablc 8c trop prompt n’eA guère moins nui*
fible qu’une forte gelée qui fucccuc h une grande humidité*
Quel eA le mois dc l’année auquel il gclc le plus fortement
dans les zones tempérées. En s’élevant au-dc/Tus dc Jit fur-
face du globe, on rcncôntfc fous l’équatcur môme un froid
fuffifam.pour glacer l’eau.. Le froid n’augmente pas de môme
quand on pénétré dans l’intérieur de la ter^c ; â 70. pieds dc
profondeur, la chaleur eA aflczconfidérablic. Ibid. 341. a. A
quelle profondeur pénètre la glace dans les grandes gelées*
Ibid. b.
Gelée, voyez G e l , G l a c e .Pourquoi l’évaporâtion eA fort
confidérablc dans un tems de gelée. III. 866. Efpcce de
gelée qui fe forme fur les murailles 8c les panneaux dc vitre*
en tems de dégel. IV. 7 3 7 .'¿'. Obfcrvations fur la caufe de
la gelée. V. 682. a. Pourquoi certaines pierres font'fujettcs à
être fendues par la gelée. IX. 809. a.
G e lé e , ( Econom. rufliq. ) foins â prendre pour préferver
certaines plantes du gel du .printeins : les gelées d'hiver font
ordinairement moins fâchcufcs. I. 386. b. Comment la gelée
fait périr les arbres : circonAanccs qui rendirent A funefle
le froid de 1709. Ibid. a. Mauvais cficts dc la gelée dans les
taillis .-comment M. dc Buffon a tâché dc les prévenir. IL
298 a. Moyen de rétablir dans les forêts les /etinés plants
qui ont été gelés. 300. a. Obfcrvations fur Jn gelée de l’hi-
vcr dc tyo<f. VII. 316 . b. Dommage qui arrive âiix arbro*
par de fortes gelées. 343. b. Pourquoi ceriaitis arbres réfi*
lient plus à la gelée que d’autres» Suppl. J. 323. a. Effets do
X X X x x x x x