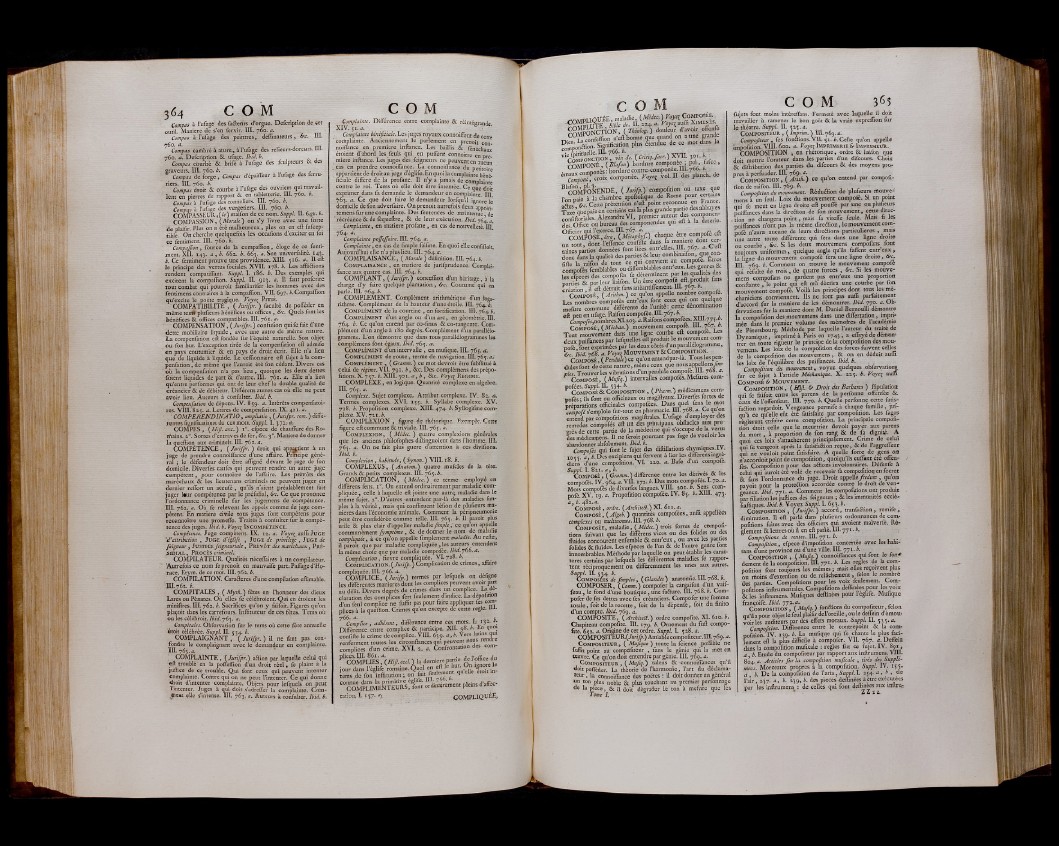
3 6 4 COM Compas à l’ufage des faâenrs d’orgue. Defcriptlon de cet
outil. Maniéré de s’en fervir. III. 760. a. .
Compas à l’ufage des peintres, défiinateurs, fcc. III.
760. a. . - . , m
Compas cambré à aturé, àl’ufage des relieurs-doreurs. 111.
760. a. Defcription 8c iifage. Ibid. b.
Compas courbé 8c brifé à l’ufage des fculpteurs & des
graveurs. III. 760. b. .
Compas de forge, Compas d’épaiffeur a lufage des fer-ru-
riers. 111. 760. b. _
Compas droit & courbe à Mage des ouvriers qm trava.1-
lent en pierres de rapport & en tabletterie, p . 760. b.
s à l’ufage des tonneliers, lu. 760. b.
Compas S l’iifage des vergetiera. UI. 760
COMPASSEÜK,(le) maifon de ce norp. Suppl. 11.642. b.
COMPASSION, (Morale) on s’y livre avec une forte
de plaifir. Plus on a été malheureux, plus on en eft fufcep-
dble. On cherche quelquefois les occafions d’exciter en foi
ce fentiment. III. 760. b.
Comvaffion, fource de la compaflion, éloge de ce fenti-
jnent. Ail. 143. a , b. 662. b. 663. a. Son univerfalité. 143.
b. Ce fentiment prouve une providence. XIII. 516. a. Il eft
le principe des vertus fociales. XVII. 17.8. b. Les affligions
rendent compatiffant. Suppl. I. 186. b. Des exemples qui
excitent la compaflion. Suppl. IL 913. a. Il faut profcrire
tout combat qui pourroit nuniliarifer les hommes avec des
fentimens contraires à la compaflion. VII. 697. b. Compaflion
qu’excite le poëte tragique. VoyerVniE.
COMPATIBILITÉ , ( Jurifpr.) faculté de pofféder en
même ten#plufieurs bénéfices ou offices , fcc. Quels font les
bénéfices 8c offices compatibles. III. 761. a.
COMPENSATION, ( Jurifpr. ) confufion qui fe fait d’une
¡dette mobiliaire liquide , avec une autre de même nature.
La compensation eft fondée fur l’équité naturelle. Son objet
OU' fon but. L’exception tirée de la compenfation eft admife
en pays coutumier 8c en pays de droit écrit. Elle n’a lieu
que de liquide à liquide. Le ceflionnaire eft fujet à la compenfation
, de même que l’auroit été fon cédant. Divers cas
' où la compenfation n’a pas lieu , quoique les deux dettes
foient liquides de part 8c d’autre. III. 761. a. Elle n’a lieu
qu’entre perfonnes qui ont de leur chef la double qualité de
créancier 8c de débiteur. Différens autres cas où elle ne peut
avoir lieu. Auteurs a confulter. Ibid. b.
Compenfation de dépens. IV. 859. a. Intérêts compenfatoi-
rcs. Vin. 825. a. Lettres de compenfation. IX. 421. a.
‘ COMPERENDINATIO, ampliatio, ( Jurifpr. rom. ) différentes
lignifications de ces mots. Suppl. I. 372, a.
COMrES, (Hijl.anc. ) i°. cfpece de chauffure des Ro-
' lhains. 20. Sortes d’entraves de fer, fcc. 30. Maniéré de donner
la queftion aux criminels, ni. 762. a.
COMPÉTENCE, ( Jurifpr. ) dçoit qui appartient à un
juge de prendre connoiflance d’une affaire, rrmeipe général
; le défendeur doit être afligné devant le juge de fon
domicile. Diverfes caufcs qui peuvent rendre un autre juge
compétent, pour connoître de l'affaire. Les prévôts des
maréchaux 8c les lieutenans criminels ne peuvent juger en
dernier reffort un accufé, qu’ils n’aient préalablement fait
juger leur compétence par le préfidial, fcc. Ce que prononce
l’ordonnance criminelle fur les jugejnens de compétence.
III. 762. a. Où fe relevent les appels comme de juge compétent.
En madere civile tous juges font compérens pour
reconnoître une promefle. Traités à confulter fur la compétence
des juges. Ibid. b. Voye{ I n c o m p é t e n c e .
Compétence. Juge compétent. IX. 12. a. Voye[ aufli J u g e
V attribution , JüGE d’égfife , J u g e de privilège , J u g e de
feigneur, JUSTICE feigneuriale, P r é v ô t des maréchaux, P r ê -
S ID IA L , P r o c è s criminel.
COMPILATEUR. Qualités néceffaires à un compilateur.
’Autrefois ce nom fe prenoit en mauvaife part. Paffage d’Ho-
race. Etym. de ce mot. III. 762. b.
COMPILATION. Carafteres d’u
d’une compiladon eftimable.
311762.*.
COMPITALES , ( Myth. ) fêtes en l’honneur des dieux
Lares ou Pénates. Où elles fe célébroient. Qui eh étoient les
miniftres. III. 762. b. Sacrifices qu’on y faifoit. Figures qu’on
plaçoit dans les carrefours. Inftituteur de ces fêtes. Tems où
on les célébrait. Ibid. 763. a.
Compitales. Obfervation fur le tems où cette fête annuelle
‘étoit célébrée. Suppl. II. 534. b.
COMPLAIGNANT , ( Jurifpr. ) il ne faut pas confondre
le complaignant avec le demandeur en complainte.
III. 763. a.
COMPLAINTE, (Jurifpr.') aCtion par laquelle celui qui
eft troublé en la poffeflion d’un droit réel, fe plaint à la
jufttce de ce trouble. Qui font ceux qui peuvent intenter
'complainte. Contre qui on ne peut l’intenter. Ge qui donne
¿toit d’intenter complainte. Objets pour lefquels on peut
l’intenter. Juges à oui doit.s’adreffer la complainte. Coni-
.jPeat elle s'intenie. UI. 763. a. Auteurs à confulter. Ibid. b.
C O M
Complainte. Différence entre complainte 8c réintégrant!*
XIV. 51 .a.
Complainte bénéficiai. Les j uges royaux, connoiflent de cette
complainte. Anciennement le . parlement en prenoit coii-
noiflance en première inftance. Les baillis 8c fénécliaux
étoient d’abora les feuls qui en puflent connoître en nre-
miere inftance. Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun
cas èn prendre connoiflance. La connoiflancé'du petitoire
appartient dé droit au juge d’églife.Enquoila complainte béné-
ficiale différé de la profane. Il n’y a jamais de complainte
contre le roi. Tems où elle doit être intentée. Ce que doit
exprimer dans fa demande le demandeur en complainte. III
763. a. Ce que doit faire le demandeur lorfqu’il ignore lé
domicile de fon adverfaire. On prenoit autrefois deux appoin-
temens fur une complainte. Des fentences de maintenue de
récréahce 8c de féqucftre, 8c de leur exécution. Ibid. 764. a.
Complainte, en matière profane , en cas de nouvelleté. IIL
764. a.
Complainte pojfejfoire. III. 764. a.
Complainte, en cas de fimple faifine. En quoi elle confiftoit.
Aujourd’hui elle n’a plus lieu. III. 764. a.
COMPLAISANCE, ( Morale ) définition, m. 764. b.
C o m p l a i s a n c e , en matière de jurifprudence. Complai-
fance aux quatre cas. UI. 764. b.
COMPLÂNT, (jurifpr.) conçeffion d’un héritage, à la
charge d’y faire quelque plantation, fcct Coutume qui en
parle. III. 764. b.
COMPLEMENT. Complément arithmétique d’un logarithme.
Complément de la hauteur d’une étoile. III. 764. b.
C o m p l é m e n t de la courtine , en fortification. HL 764. b.
C o m p l é m e n t d’un angle ou d’un arc, en géométrie. III.
764. b. Ce qu’on entend par c'o-finus & co-tangentc. Complément
d’un angle à 180 degrés. Complément d’un parallélogramme.
L’on démontre que dans tous parallélogrammes les
complémens font égaux. Ibid. 765. a.
C o m p l é m e n t d’un intervalle , en mufiqué. IÏÏ. 765. a.
C o m p l é m e n t de route, terme de. navigation, n i. 765.«;
C o m p l é m e n t , (Gramm.),ce mot devrait être fubftituéà
celui de régime. VIL 791. b, &c. Des complémens des prépo-
fitions. X. 757. b. XIII. 301. a, b , &c. Voye{ RÉGIME.
COMPLEXE, en logique. Quantité complexe en algèbre.
III. 765. a.
Complexe. Sujet complexe. Attribut complexe. IV. 82. a.
Termes complexes. XVI. 155. b. Syllabe complexe. XV.
718. b. Propofition complexe. XIII. 474. b. Syllogifme complexe.
XV. 721. b.
COMPLEXION , figure de rhétorique. Exemple. Cette
figure eft commune & triviale. III. 765. a.
C o m p l e x i o n , (Médec.) quatre complexions générales
que les anciens philofophes diftinguoient dans l’homme. IU.
765. a. On ne fàit plus guere d’attention à ces divifions.
Ibid. b.
Complexion, habitude, (Synon.) VIII. 18. b.
COMPLEXUS, ( Anatom.j quatre mufcles de la tête.
Grands & petits complexus. IlI. 765. b.
COMPLICATION, ( Médec. ) ce terme, employé en
différens fens. i°. On entend ordinairement par maladie compliquée
, celle à laquelle eft jointe une autre maladie dans le
même fujet. 20. D’autres entendent par-là des maladies Amples
à la vérité, mais qui conftituent léfion de plufieurs maniérés
dans l’économie animale. Comment la péripneumonie
peut être confidérée comme telle. III. 765.; b. Il paroît plus
utile & plus clair d’appeller maladie fimple ce qu’on appelle
communément fymptôme, 8c de donner le nom de maladie
compliquée, à ce qu’on appelle Amplement maladie. Au refte,
il paroît que par maladie compliquée, les auteurs entendent
la même choie que par maladie compofée. Ibid. 766. a.
Complication, fievre compliquée. VI. 728. b.
C o m p l i c a t i o n . (Jurifp. ) Complication de crimes, affaire
compliquée. III. 766. a. , . , . . .
COMPLICE, (Jurifp.) termes par lefquels on défigne
les différentes maniérés dont les complices peuvent avoir part
au délit. Divers degrés de crimes dans un complice. La déclaration
des complices fert feulement d’indice. La dépofinon
d’un feul complice ne fuffit pas pour faire appliquer fes complices
à la queftion. Crimes qu’on excepte de cette réglé, m.
7 Complice, adhérent, différence entre ces mots. 'UfflM h:
Différence entre complice & participe. XII. 98. *. En quoi
confifte le crime de complice. VIII. 639. a, ¿.vers latinsqui
renferment toutes les circonftances qui peuvent nous renare
complices d’un crime. XVI. 2. *. Confrontation des com- S 11m coç o m p u i^ t Êü r s ! S S Æ « p u - H f
tation, I. 1 J7- a. COMPLIQUÉE,
C O COM 3 6 5
fjfef f i f lB Signification plus fendue de ce mot dans la jppjipWf Ki ^ '¿m I COMPONÉ, {Slafin) bordure componée :
1 Jmmnnnès: bordure contre-componée. IIL 766. b.
CmpoS! croü codiponée. vol. II des planch. de
BlrOlJlfoiiENDÈ, ( Jnrifp.y compofition ou taxe que ,
l’on uaie à la chambre apoftolique de Rome pour “ t™ “ ;
ailes Cette prétention n’eit point reconnue en F m »
T » e ’t fté p conliftoriiies^. A“ lex“an™dr“e VcI^. lparPelmMie8rr aa”udte^u r des;coinPf '
des. Office ou bureau des componendes qm eft à la daterte.
Officier aui l’exerce. III. 767. a. A
COMPOSÉ, être, (Mitaphyf.) f chaque être compofe: eft
un tout, dont l’effence conftfte dans ïa maniéré dont certaines
parties données font lices éntr elles. III. 767.^ . ^ :
donc dans la qualité des parties 8c leur eombmaifon, auccon-
fifte k raifon de tout ce qui convient au compofé. Êtres
compoféT iemblables ou difleniblables entr eux. Les genres &
lesXeces des compofts fe détermiWnt par les qnabtes des
parties & par leur liaifon. U n ê t r e compofteft^rodmt fans
création, il eft détruit fans anéantiffement. IU. 767. b.
C o m p o s é , (Arithm.) ce qu’on appelle nombre compofés
Les nombres compofés entr’eux font ceux qui ont quelque
mefure commune différente de l’unité: cette dénommation
eft peu en ufage. Raifon compofée. M. 767. *.
Compofés, nombres.XL203u dz.Raifons compofées. XUI.77Ç-*-
C o m p o s é , ( Méchan. ) mouvement eompofé. UI. 767. b.
Tout mouvement dans une ligne courbe eft corapofé. Les
deux puiffances par lefqueües elt produit le f
pofé, font exprimées par les deux côtés d un parallélogramme,
6‘C. Ibid. 768. a. Voye{ M o u v e m e n t 8c C o m p o s i t i o n .
C o m p o s é i Pendule ) ce qu’on entend par-là. Tous les pendules
font de cette nature, même ceux que nousappellons/m-
vles. Trouver les Vibrations d’un pendule compofe. m. 76». a.
C o m p o s é , (Mufiq.) intervalles compofés.Mefurescom-
pofées.'Sapp/. II. 534- *• ■. . ...
C o m p o s é 8c CûMPOSitiON, (Pharm.) médicamens com-
pofés ; ils font ou officinaux ou magiftraux. Diverfes fortes de
préparadons officinales compofées. Dans quel fens le mot
eompofé s’emploie fur-tout en pharmacie. III. 768. a. Ce qu on
entend par compofttions magiftrales. L ufage d employer des
remedes compofés eft un des principaux obftacles aux progrès
de cette partie dè la médecine qui s’occupe de la vertu
Ses médicamens. Il ne feroit pourtant pas fage de vouloir les
abandonner abfolumeftt. Ibid. b. .
Compofés qui font le fujét des difhllaüons chynuques. IV.
lOtt. à, b. Des excipiens qui fervent à lier les différensîngré-
diens dune compofition.’ VL 220. Bafe d’un eompofé.
^ S o m p o s é 1 *, Vùramm.) différence entre les dérivés 8c les
compofés. IV. 964. a. VII. 172. b. Des mots compofés. 1.70. a.
Mots compofés de diverfes langues. VIII. 201. b. Sens com-
pofé.XV. 19. a. Propofition compofée. IV. 85. b. XIII. 47^.
a,b. 482.ii.
C o m p o s é , ordre. (AtchiteS.) XL oii.«>
C o m p o s é , ( Algeb. ) quantités compofées, aufli appellees
complexes ou multinomes. III. 768. b. r
C o m p o s é e , maladie, (Médec.) trois fortes dé cOmpoli-
tions fuivartt que les différens vices ou des folides ou des
fluides concourent enfemble 8c entr’eux, ou avec les parties
folides 8c fluides. Les efpéces de l’un 8c de l’autre genre font
innombrables. Méthode par laquelle on peut établir les caractères
certains par lefquels les différentes maladies fé rapportent
réciproquement ou différemment les uries aux autres.
Suppl. II. 534. b.
Composées de fimples, ( Glandes) anatomie. III. 708. b.
COMPOSER, (Comm.) compofer la càrgaifon d’un vaif-
feau, le fond d’une boutique, une fafture. 111. 768. é. Com-
■ pofer de fes dettes avec fes créanciers. Compofer une fomme
totale, foit de la recette, foit de la dépenfê, foit du finito
d’un compte. Ibid. 769. a.
COMPOSITE, ( ArchiteSl. ) ordre compoftte. XI. 610.
Chapiteau compoftte. III. 179. b. Ornement du fuft cohipo-
fite. 6 a--— ¿^.—1 t _.o 8 -
umt point au compouteur , tans le génie qui la
euvre. Ce qu’on doit entendre par génie. III. 709. a.
C o m p o s i t e u r , (Mufiq.) talens 8c-connoiffances qu’.
doit poflêder. La théorie de l’harmonie, l’art du déclama-
teur ; la connoiflance des poëtes : il doit donner eu général
an ton plus noble 8c plus touchant au premier perfonnage
-fujets font moins intéreffans. Fermeté avec laquelle il doit
travailler à ramener le bon goût 8c la vraie expreflion fur
le théâtre. SuppL II. <525. <*.
C o m p o s i t e u r , ( Imvrim. ) IU. 769. ¿i
Compofiteur, fes fonctions. Vil. <{1. ¿. Celle qu'on appelle
tmpofition. VIII. 600. a. Im p r im e r i e 6* I m p r im e u r .
COMPOSITION » en rhétorique, ordre 8c liaifon que
doit mettre l’orateur dans. les parties d’un difeours. Choix
& ’ diftribution des parties du difeours 8c des moyens pro,-
pres à perfuader. IIL 769. a. _
C o m p o s i t i o n , (Arith.) ce qu’on entend par compofition
de raifon. III. 769. b. _ ± , » ’ ■
Compofition du mouvement. Réduéhon de plulieuts mouve-
mens a un feul. Loix du mouvement eompofé. Si u.n jpomt
qui fe meut en ligne droite eft pouffé par une ou plufieurs
puiffances dans la direaiôn de fon mouvement, cette direction
ne changera point , mais fa vîteffe feule. Mais fi les
puiffances n’ont pas la même direftion, le mouvement coni-
pofé n’aura aucune de leurs directions particulières , mais
une autre toute différente qui fera dans une ligne droite
ou courbe, fcc. Si les deux mouvemens compofans font
toujours uniformes, quelque angle qu’ils faffent entr’eux,
la ligne du mouvement eompofé fera une ligne droite, fcc.
III. 769. b. Gomment on trouve le mouvement eompofé
qui réfulte de trois, de quatre forces , fcc. Si les mouye-
mens compofans ne gardent pas entr’eux une proportion
confiante, le point qui eft mû décrira une courbe par fon
mouvement eompofé. Voilà les principes dont tous les mé-
chaniciens conviennent. Ils ne font pas aufli parfaitement
d’accord fur la maniéré de les démontrer. Ibid. 770. a. Ob-
fervations fur la maniéré dont M. Daniel Bemoulli démontre
la compofition des mouvemens dans une diflertation, imprimée
dans le premier volume des mémoires de l’académie
de Pètersbourg; Méthode par laquelle l’auteur du traité de
Dynamique, imprimé à Paris en 1743 » a:èflayéde démontrer
en toute rigueur le principe de la cbmpofitiqn des mouvemens.
Les loix de la compofition des forces fuivent celles
de la compofition des mouvemens, 8c on en déduit auifi
les îoix de l’équilibre des puiffances. Ibid. b.
Compofition du mouvement, voyez quelques obferyations
fur ce fujet à l’article Méchanique. X. 225. b. Voycç aufli
C o m p o s é fc M o u v e m e n t . . .
C o m p o s i t i o n , ( üîfi. fc Droit des Barbares ) lhpulatipn
qui fe faifoit entre les parens de la perfonne offenfée 8c
ceux de l’offenfeur. IIL 770. b. Quelle perfonne cette fatis-
faftion regardoit. Vengeance permife à chaque famille, juf-
qu’à ce qu'elle eût été fatisfaite par compofition. Les fages
réglèrent enfuite cette compofition. La principale compofition
étoit celle que le meurtrier devoir payer aux parens
du mort, à proportion de fon rang 8c de fa dignité. A
quoi ces loix s’attachèrent principalement. Crime de celui
qui fe Vengeoit après la fatisfaâion reçue, 8c de l’aggreffeur
qui né vouloit point fâtisfaire. A quelle forte de gens on
n’accordoitpoint de compofition, quoiqu’ils euffent été offen-
fês. Compofition pour des aétions involontaires. Défenfe à
celui qui auroitété volé de recevoir fa compofitioij en fecret
8c fans l ’ordonnance du juge. Droit appelle fredum , qu’on
payoit pour la protection accordée contre le droit de vengeance.
Ibid. 771. a. Comment les composions ont produit
par filiation les juftices des feigneurs ; 8c les immunités ecclé-,
fiaftiques. Ibid. b. Voyez Suppl. jgg 653. b. . •. ‘ t/.
C o m p o s i t i o n j (Jurifpr.) accord, tranlattion, rcmiie,
diminution. Il eft parlé dans plufieurs ordonnances de corn-
pofitions faites avec des officiers aui avoient malverfé. Règlement
8c lettres où il en eft parlé. IIL 771. b.
Compofttions de rentes. IIL 771. b.
Compofition 3 efpece d’impofidon concertée avec les habi-
tans d’une province où d'une ville. III. 771. *• . _ .
C o m p o s i t i o n j ( Mufiq.) connoiffances qui font le ton*
dement de la compofition. UI. 771. b. Les réglés de la.com-
pofition font toujours les mêmes; mais ellesreçoivent plus
ou ihoins d’extenfion ou de relâchement, félon le nombre
des parties. Compofitions pour les voix feulement. Comportions
inftrumentales. Compofitions deftmées pour les voix
8c les inftrumens. Mufiques deitinées pour léglife. Mufique
] (Mufiq.) fonétionsdu compofiteur,félon
qu’ilapour objet le feul plaifir de l’oreille, ou le deffein d’èmou*
voiries auditeurs par des effets moraux. Suppl. II. «$ .« .
Compofition. Différence entre le contrèpoint 8c la com-
nnftrion IV. b. La mufique qui fe. chante le plus faci-
Fement eft la plus difficile à compofer. VIL 767. * Deffein
dans la compofition muficale : règles fur ce fujet. IV. 891,
a b. Etude du compofiteur par rapport aux inftrumens. VIII.
804. a. Articles fur la compofition muficale -, tirés des Supplé