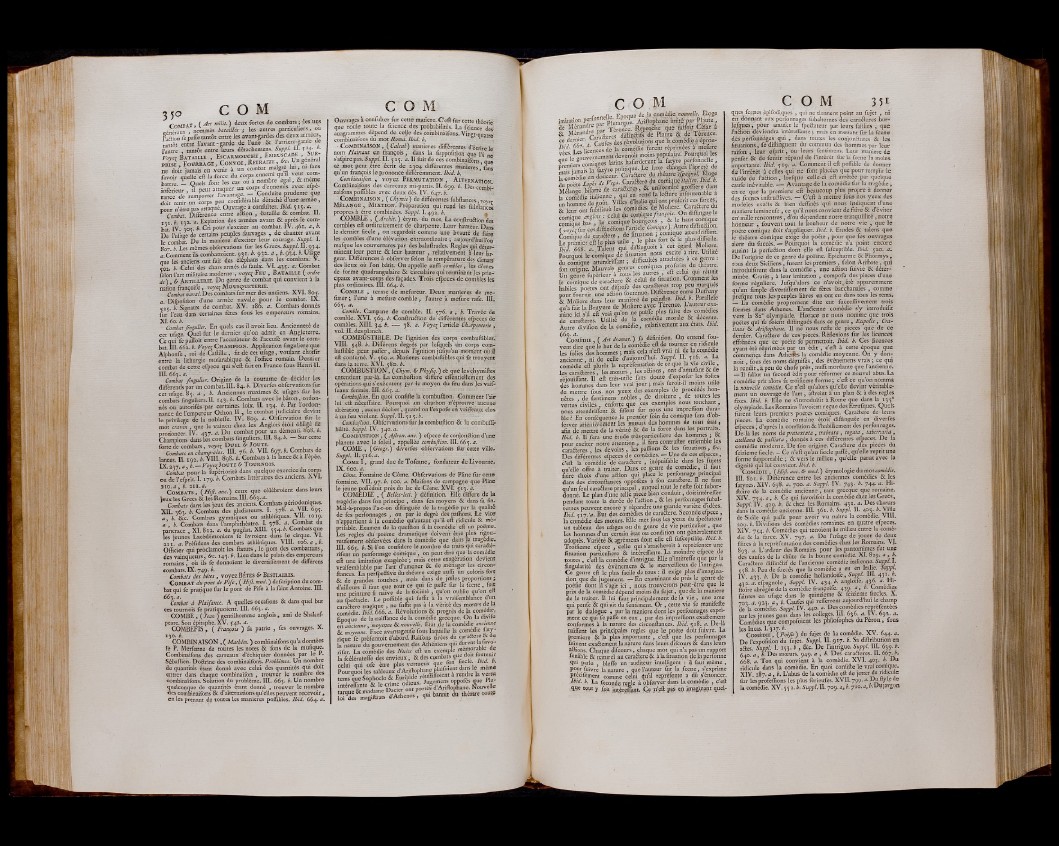
3 5 0 C O M
r , T { Art milit. ) deux fortes de combats ; ?les'uijs
t ¿riux » nommés batailles -; les -autres particuliers , .ou
r-iâion fe paffe tantôt entre les avant-gardes des, deux armées,
cmSt entre l’avant - garde de l’une :& ramereÆarde çte
l’autre , tantôt entre leurs dètachemens. Sitfpl. 11- 5M- »•
Vovt! B a t a i l l e , E s c a rm o u ch e , Embuscade , s u r
* Z l , E o S L a g ï , C o n v o i , R e t r a i te fo Un généra
ne doit jamais en venir à un combat Uialgr , .
favoir quelle- eft la force du corps ennemi qud ve“
battre - Ouels font les cas on à nombre n p l , & meme
inféSnr U peut attaquer un corps d’ennemis avec elpé-
tance de remporter l’nvantage - Conduite prudente que
doit tenir un coq« peu congdérable .détaché d une armÎe,
pour n’étre pas attaqué. Ouvrage é coirfulter. lbtd. 5 « 5-
Combat, Différence entre aftion , bataille oc combat. 11.
x ti b 132. -a. Expiation des armées avant & après le combat
IV 203. b. Cri pour s’exciter au combat. IV. 461. a, b.
De l’ufaee de certains peuples iauvages , de chanter avant
le combat. De la maniéré d’exciter leur courage. W . I.
807. b. Les mêmes obfervations fur les Grecs..Suppl. IL 954.
a. Comment ils combattoienr. 931. b. 932. a , b. 934. b. Ufage
que les anciens orit fait des éléphans dans les combats; V.
e02. b. Celui’des chars armés, de faulx. VI. 435. a. Combat
félon l’art militaire moderne , voyc{ F eu , Ba ta il l e ( ordre
de) 6* A rtillerie. Du genre de combat qui convient à la
nation françoife » voye\ Mousqueterie.
Combat naval. Des combats fur mer des anciens. XVI. 805.
a Difpofition d’une armée navale pour le combat. IX.
<23. b. Signaux de combat. XV. 186. a. .Combats donnés
fur l’eau dans certaines fêtes fous les empereurs romains.
XI. 60; b. . •
Combat fagulier. En quels cas il avoit lieu. Ancienneté de
cet ufage. Quel fut le dernier qu’on admit en Angleterre.
Ce qui fe paffoit entre l’accufateur & l’accufé avant le combat.
III. 662. b. Voyei C h am p io n . Application fingulierë que
Alphonfe , roi deCaitille, fit de cet ufage, voulant chqifir
entre la lithurgie mofarabique & l’office romain. Dernier
combat de cette efpece qui s’eft fait en France fous HennlI.
III. 663. *. .
Combat fingulier. Origine de la coutume de décider les
différends par un combat.111. 84. b. Diverfes obfervations fur
cet ufage. 85. a , b. Anciennes maximes 8e ufages fur les
combats finguliers.il. 143- b- Combats, avec le bâton » ordonnés
ou autorifés-par certaines loix. II. 134. b. Pajr lordon-.
nance de l’empereur O th o n ll, le combat judiciaire devint
le privilège de là nobleffe. IV. 809. a. Obfervation fur le
mot craven, que le vaincu chez les Anglois éto.t obligé: de
prononcer. IV. 437-1 Du c?mh*} W t M S B I I I # '
Champions dans les combats finguhers. III. 84. b. — Sur cette
forte de combats, voye{ D u e l & J°ute. , ,
Combats en champ-clos. IIL 76. b. VII. 697. b. Combats de
lances. IL 192. b. VIII. 898. b. Combats à la lance & à 1 epée.
IX 237 a b. — Foyer Joute & T ournois.
Combat pour la fupériorité dans quelque exercice du corps
ou de l’efprit. I. 179. b. Combats littéraires des anciens. XVI.
’ ' combats^ '( S ï/î. abc.) ceux que célébraient dans leurs
jeux les Grecs fx les Romains. III. 603.A. . . . .
Combats dans les jeux des anciens. Combats pénodomques.
XII. 161. i. Combats des gladiateurs. I. 378. a. VU. 695.
a, b. Sic. Combats gymniques ou athlétiques. VU. loip.
a . b. Combats dans l’amphithéatre. I. 378. a. Combat du
pancrace , XL 812. a. du pugilat. XIII. 554. b. Combats que
les jeunes Lacêdèmoniens fe livroienr dans le cirque. VI.
a n . a. Préfidens des combats athlétiques. VIII. 106.a ,b.
Officier qui proclamoit les ftatuts, le pom des combattans,
des vainqueurs, &c. 143. b. Lieu dans le palais des empereurs
romains , où ils fe donnoient le divertiifement de tüfférens
combats. IX. 749. b. ■ g
Combats des bêtes, voyez Betes g* Bestiaires.
C ombat du pont de Pife, ( ’Hift. mod. ) defeription du combat
qui fe pratique fur le pont de Pife à la faint Antoine. III.
¿63. a.
Combat à Plaifance. A quelles occafions & dans quel but
ces tournois fe pratiquoient. III. 663. a.
COMBE, ( Jean ) gentilhomme anglois, ami de Shakef-
peare. Son épitaphe. XV. 542. a.
COMBEFIS , ( François ) fa patrie , fes ouvrages. X.
130. b . ' - '
COMBINAISON , ( Mathém. ) combinaifons qu’a données
lé P. Merfenne dé toutes les notes 8c fons de la mufique.
Combinaifons des carreaux d’échiquier données par le P.
Sébaitien. Doftrine des combinaifons .Problèmes. Un nombre
de quantités étant donné avec celui des quantités qui doit
entrer dans chaque combinaifon , trouver le nombre des
combinaifons. Solution du problème. Itl. 663. b. Un nombre
quelconque de quantités étant donné , trouver le nomhrç
«es combinaifons & d’akernationsqu’ellespeuvent recevoir ,
en les prenant de toutes les maniérés poffibles. Ibid. 664. a.
C O M
Ouvrages à, confulter fur cette matière. C’eft fur cette théorie
que roule toute la fcience des probabilités. La fcience des
anagrammes dépend de ceUe des combinaifons. Vingt-quatre'
combinaifons du mot Roma. Ibid. b. .
• .Combinaison , ( Calcul) manieres différentes d’écrire le
nom Hainaut en françois ? clans la fuppofitiOn'que l’/i ne
s’aípire.pas. Suppl. II. '515. a. Il'fuit de ces combinaifons que
cé mot petu .être écrit de 2304 différentes manieres * (ans
qu’un françois le .prononcé différemment. Ibid. b. * '
Combinaifon , voyez Permutation , A lternation
Combinaifons des carreaux mi-partis. II. 699. b. Descombi-
naifons poffibles avec deux dés. IV. 647. b.
C ombinaison , ( C/jymie ) de différentes fubilances, voyer
Mélange , M ix t io n . Préparation qui rend les fubftancc®
propres à être combinées. Suppl. 1. 492. b.
COMBLE , ( Arckit. ) étym. du mot. La conftruftion des
combles eft ordinairement de charpente. Leur Hauteur. Dans
le dernier fiècle , on regardoit comme une beauté de faire
les combles d’une élévation extraordinaire ; aujôurd?huiTon
mafque les couvertures par des bahiftrades. Regles qui déterminent
leur pente & leur hauteur , relativement à-leur largeur.
Différences à obferver félon la température des climats"
des lieux où l’on bâtit. On appelle auffi combles',le s dômes
de forme quadrangulaire 8c circulaire qui términênt- jcs prin-
dpaux avant-corps des façades. Trois efpeces de Combles les
plus ordinaires, ili. 664. b.
C omble , terme de mefureur. Deux manieres de me-
furer ; l’une à mefure comble, l’autre à mefure rafe. IIL
665. a.
Comble. Campane de comble. II. 576. a , b. Travée de
comble. XVI. 569. b. Conftruélion de“ différëntès efoeces de
combles. XIII. 34. b. ■— 38. a. Voye^ l’article' Charpenterie ,
vol. II. des planch.
COMBUSTIBLE. De l’ignition dés corps; combatibles.
VIIL 548. b. Différens degrés par lefqueis tin corps com-
buftible peut paffer, depuis l’ignition jùfqu’au m'ônüent où il
eft conium’é. V. 560. a. Matières combùftinles qui fe trouvent
dans la terre. XVI. 580. b.
.COMBUSTION, ( Ckym. fyPhyJùj.) cé que les çbymiftes;
entendent par-là. La combuftion difiere eflentietiement des
opérations qui s’exécutent par-le moyen du feu dans les vaif-
feaux formés. IH. 665. a. '
Combufiiòn. En quoi confifte la combufljon. Comment Pair
lui eû nécpifaire. Pourquoi un charbon n’éprouve aucune
altération , aucun déchet, quand'on l’expofe en vaiffeaux clos
à imfeu violent. Suppl. 11. 315 . b.
Combuftion. Obfervations fur la combuftion & la conibuft;-
btiité. Suppl. IV. 340. a.
Combustion , ( Afiron. anc. ) efpece deconjonétion d’une
planete avec le foleil, appelléé combuftion. III. 665. a.
COME , ( Gcogr. ) diverfes obfervations fur cette ville.
Suppl. 'II; 5x6. a. ‘
C ome 1, grand duc de Tofcane, fondateur de Livourne.
IX. 600. a.
Cóme. Fontaine de Còme. Obfervations de Pline fur cette
fontaine. VII. 97. b. 100. a. Maifons de campagne que Pline
le jeûne poffédoit près du lac deCôme. XVÎ. 313. a.
COMÉDIE , ( Belles-leti. ) définition. Elle différé de la
tragédie dans fon principe , dans fes moyens & dans fa fin.
Mal-à-propos l’a-t-on diftinguée de la tragédie par la qualité
de fes perfonnages | ou par le dçgré dès paffions. Le vice
n’appartient à la comédie Wautant qu’il eft ridicule & mé-
prifable. Examen de la queftioñ fi la comédie’ eft un poème.
Les regles du poème dramatique doivent être plus rigou-
reufement obfervées dans la conièdie que dans la tragédie.
III. 663. b. Si l’on confidere le nombre de traits qui carafté-
rifent un pprfonnage comique . on peut dire que la comédie
eft une imitatiop exagérée ; mais cette exagération devient
vraifemblable par l’art d’amener & de ménager les circon-
ftances. La perfpeâivé du théâtre exige auffi un coloris fort
& de grandes touches , mais dans de jdftes proportions ;
d’ailleurs il faut que tout ce qui fe paffe fur la feene , foit
une peinture fi naïve de la fociété , quon oublie quoni.cft
au fpeâacle. Le poffible qui fuftit à la vraifemblance a un
caractère tragique , ne fuftit pas a la vérité des moeurs de la
comédie. lbÙ.666. a. Révolutions & progrès de la comédie.
Époque de la naiffance de la comédie grecque. On la divile
en ancienne, moyenne & nouvelle. État .de la comédie ancienne
& moyenne. Face avantageufe fous laquelle la comédie foty*
rique fe préfentoit debordi Raifons tirées du carattere oc as
la nature du gouvernement des Athéniens qui durent la tavo-
rifen La comé<jie des Nuées eft un exempte
la fcélératefle des envieux, &desci>mbaB ® Ç “
celui qui lofé êlre plus vertueux i.'
Pourquoi les tablea^ d^ftoph|B|.J.“cm g g ^
tems queSophoclc &. E u r r p . d e • s „ p,u,
.ntéreifante & le, crime o i ¡ ¿ J d.Ari(t ha„ e. flouvellé
;^ d :s&m ^ S s Dd'Arh<: : « ,: pp Ifp m
C O M
de Menandre P Réprobbe que faifoit Çéfar à
& ^ ¿ n a n d g M t e & d^Térence.
ce .dernier- . ■ ^ des j^volutiotis que la comédie a éproii-
- l : Les licences de la cométlie forent r^rimèes a ntefore
Gouvernement devënpit moins pop^ulaure; Pourquoi les
que le gouv . ^ hafarderent la fatyre perfonnclle ,
premiers la^/atvre politique. Le luxe changea î’âpreté de
'1 Ë J Tnnès 'de Vexa. Car'afterè du ço/mque italun. Ibid. b.
î/r1-? S Lifarrè de caraélêrès,' ,& unifprmité geoffière dans
i ü S P l iBfouteqable à
la çomWre > S lÿîmîié qui ont proferit ces farces,
comîaue attifoU : celui W c»ip>q(Ié fiançots. On drftmgre le
comique wç. ? . m àtie'bourgeois , & le haut comique
rv » S r% s 'ik • 1 ’ «...j.Lflnprapio wd 8e fitpuaEtio*n 1; c6om* iq Auuet raettendriffant.
utile , le plus fwt ¿ l e plusdifÉcüe.
Ib il W Ê ffi- Talent qui diftinguoit à cet eg?rd Jloliçre.
Pourquoi le comique .de fituation nous excite a rire. Uohté
du comScte attendant ; difficultés attachées à ce genre* :
fou oïiene. «auvais ««W!» conuques
Un eenrefirpSieur à aqus .JéS »»>¡¥5 > Sg S B 1U1 ÎErSÏ
lé comique Îe caraftere & celui de fituanon. Comment les
habiles poètes W difpoié des caraSeres trop peu .parqués
pmrr fournir une
& Mohere daus leitr mauteré de peindre. lbtd.b. Parallèle
qu’a fait la Bruyere de Moliere avec Téreqce. f. auteur examine
ici s’il eft .vrai qu’on ne puiffe plus faire des comédies
de carafteres. UüUté ,de la çoméiie morale & < “ <*““ •
Autre divifion de la comédie, relativement aux états, lbtd.
Î6?ioMiDiï, (Art dramatl) fa définidou. On euïend fou-
vent dire que le but de la comédie eft de m » ep redicÿe
les folies ie s hommes ; mais cela n’eft vra, ra de la comédie
ancienne, ni de celle d’aujourd hqi. Suppl. II. 310. » l a
comédie .eft plutôt la repréfentatton de ce que la vie civile ,
les carafteres , les moeurs , les aftipus , ont damufant |c de
réjouiflint. Il eft très-utile fans doute dexpofer les folies
des hommes dans leur .vrai jour; irais feroit-d moins utile
de mettre fous, nos yeux des exemples de procédé? honnêtes
, de fendméns nobles, de droiture , de toute? les
vertus civiles , enforte que ces exemples nous touchant,
nous attendriffent .& fiffent fur nous une impretfion durable
? En conséquence le pren^ér foin du comique fera d ob-
forver attentivement les m.oeuxs des hommes de tout état,
¿fin de mettre de la vérité & de la force dans les portraits.
Ibid. ¿. Il'fera une étude pès-particuliere des hommes ; 8c
pour exciter notre attention , il fora contrafter enfemble les
carafteres \ les dèyoirs , les paffions 8c les fituations, (yc.
Des différentes efpeces de comédies. - Une de ces efpeces,
¿’eft la comédie de caraftere , inépuifable dans les fujets
qu’eUe offre à traiter. Dans ce genre de comédie, il fout
faire choix d’uiië aûion qui place le perfonnage principal
dans des circonûapce? oppofées à Con caraftere. 11 ne faut
qu’un feul caraftere'principal, auquel tout le relie fou fobor-
donné. Le plan d’une teUe piece bien conduit, doitmtéreffer
pendant toute la durée de l’aftion , 8c je? perfonnages fubal-
ternes peuvent encore y répandre une grande variété d idées.
Ibid. 317. -a. But des comédies de caraftere. Seconde efpece,
la comédie des moeurs. EUë met fous le? yeux du fpeftateur
un tableau des ufages ou du genre de vie particulier, que
les hommes d’un certain état ou condition ont généralement
adoptés. Variété 8c agrémens dont elle eft fufçeprible. Ibid. b.
Troifieme eipcce , celle qui s’attacheroit a repréfenter une
fituation particulière & iiitéreffante. t a moindre efpece de
toutes, c eft la comédie d’intrigue. Elle n intérefle que par la
iingularité des événemens 8c le merye'dleux de l intrigue.
Ce genre eft le plus facile de tous : il .exige plus d’imagination
que de jugement. — En examinant de près le genre de
poéfie dont il s’agit ici , nous trouverons peut-être que le
prix de la comédie dépend moins du fujet, que de la maniéré
de le traiter. Il lui faut principalement .de la vie , une ame
qui penfe 8c qui ait du fentiment. Or , cette vie fe manifofte
par le dialogue , par la maniéré dont les perfonnages expriment
ce qui fe paffe en eux , par des imprefljons exaftement
conformes à la nature des circonftançes. Ibid. 318. a. De-là
naiffent les principales réglés que le poète doit fuivre. La
première 8c la pfos importante , c’eft que les perfonnages
fuivent exaftement la nature dans leurs difcours & dans leurs
•aftions. Chaque difcours, chaque mot qui n’a pas un rapport
fenfible 8c naturel au caraftere 8c à la fituation de la perionne
qui parle , bleffe un auditeur intelligent : il faut même ,
pour fuivre la nature , que l’auteur for la feene, s’exprime
précifément comme celui qu’il repréfente a dû s’énoncer.
Ibid. b. La fécondé réglé à obferver dans la comédie , c’eft
nilf» fnn» .. • 1 /?■_____ _1.A jm.mnnnt nllhl.
C O M 3 5 1
q^^5 foçp?? ,épifod“i,qnes , qui ne tiennent point au fujet , ni
en donnait aux perfonnages fubalterncs des carafteres bur-
lefoues y pour amufer le fpeftateur par leurs faillies , que
l-’aftion deviendra intéreffante ; mais en mettant fur la feene
dps perfoqnâges qui , dans toutes les conjonftures 8c les
f i tu a t io n s , fe dift'mguent du commun des hommes par leur
raifon , leur elprit, ou leurs fentimens. Leur maniéré de
penfer & de fentir répand de l’intérêt fur la fcçne la moins
importante. Ibid. 319. ^. Comment il eft poffible de donner
dé l’intérpt à celles qui ne font placées que pour remplir le
vuide de l’aftion, lorfque celle-ci eft arrêtée par quelque
caufe inévitable. — Avantage de la comédie fur la tragédie,
en ce que la première eft beaucoup plus propre à donner
de? fcènes inftruftives. — C’eft à mettre fous nos yeux des
modèles exafts 8c bien deffinés qui nous indiquent d’une
njanierelumineufe, ce qu’il nous convient de faire 8c d’éviter
en' mille rencontres, d’ou dépendent notre tranquillité, notre
honneur , fouvent tout le bonheur de notre vie , que le
poète comique doit s’appliquer. Ibid. b. Etudes 8c talens que
le théâtre comique exige du poète , pour que fes ouvrages
aient du fuccès. — Pourquoi la comédie n’a point encore
atteint la perfeftion dont elle eft fufceptible. Ibid. 320: a.
De l’origine de ce genre de poème. Epicharme 8c Phormys ,
tous deux Siciliens, furent les premiers , félon Ariftote, qui
introduifirent dans la comédie , une aftion fuivie 8c déterminée.
Cratés, à leur imitation , compofa des pièces d’une
forme régulière. Jufqu’alors ce n’avoit,été apparemment
qu’un fimple divertiffement de fêtes bacchanales , comme
prefque tous les peuples libres en ont eu dans tous les tems.
— La comédie proprement dite eut fucçeffivement trois
formes :dans Athènes. L’andienne comédie s’y introduilit
vers la 82e olympiade. Horace ne nous nomme que trois
poètes qui fe ioieiit diftingués dans ce genre , Eupolis, Cra-
tinus 8c Ariftophane. 11 ne nous refte ae pièces que de ce
dernier. Caraftere de ces pièces. Réflexions fur les licences
effrénées qiië ce poète fe permettoit. Ibid. b. Ces licences
ayant été réprimées par un édit , c’eft à cette époque que
commença dans Athées la comédie moyenne. On y don-
noit, fous des noms déguifès , des événemens vrais ; ce qui
la rendit, à peu de choie près, auffi mordante que l’ancienne.
— Il fallut un fécond édit pour réformer ce nouvel abus. La
comédie prit alors fa troifieme forme ; c’eft ce qu’on nomma
la nouvelle comédie. Ce n’eft qu’alors qu’elle devint véritablement
un ouvrage de l’art, aftreint à un plan 8c à des réglés
fixes. Ibid. b. Elle ne s’introduifit à Rome que dans la 133e
olympiade. Les Romains l’avoient reçue des Etrufques. Quels
furent leurs premiers poètes comiques. Caraftere de leurs
pièces. La comédie romaine étoit diftinguée en diverfes
efpeces ; d’après la condition 8c l’habillement des perfonnages.
De-là les noms de preetextata , trabeata , togata, tabernaria ,
atellana 8c palliata, donnés à ces différentes efpeces. De là
comédie moderne. De fon origine. Caraftere des pièces du
feizieme fiecle. - Ce n’eft qu’au fiecle paffé, qu’elle reprit une
forme fopportable ; 8c vers le milieu, qu’elle parut avec la
dignité qui lui cpnvient. Ibid. b.
Comédie , (ffift- anc. & mod. ) étymologie du mot comédie.
ni. 801. b. Différence entre les anciennes comédies 8c les
fatyres. XIV. 698. a. 700. a. Suppl. IV. 743. b. 744. a. Hi-
ftoire de la comédie ancienne , tant grecque que romaine.
XIV. 734. a, b. Ce qui favorifoit la comédie chez les Grecs,
Suppl: IV. 429. b. 8c chez les Romains. 431. a. Des choeurs
dans la comédie ancienne, ni. 361. b. Suppl. II. 4° 3\ fc Ville
de Sicile qui paffe pour ¿voir vu naître la comédie. VIII.
209. b. DiVifions des comédies romaines en quatre efpeces.
XIV. 734. b. Comédies qui tenoient le milieu entre la comédie
8c la farce. XV. 797. a. De l’ufage de jouer de deux
flûtes à la repréfentation des comédies Chez les Romains. VI.
893. a. L’ardeur des Romains pour les pantomimes fut une
des caufes de la chûte de la bonne comédiè. XI. 829. a , b.
Caraftere diftinftif de l’ancienne comédie italienne. Suppl. 1.
338. b. Peu de fuccès que la comédie a eu en Italie. Suppl.
IV. 433. b. De la comédie hollandoife, Suppl. III. 431-f-
42 2. a. efpagnole , Suppl. IV. 434- angloife. 436. Hi-
ftoire abrégée de la comédie françoife. 439. a , b. Comédies
faintes en ufage dans lë quinzième 8c feizieme iiecles. X.
702. a. 923.1 1 b. Caufes qui refferrent aujourd hm le champ
de la comédie. Suppl. IV. 440. Des comédies représentées
parles jeunes gens dans les collèges, m. 636. a.. IV. 692. a.
Comédies que compofoient les phUQfophes du Pérou, fous
les Incas. 1. 317. b. .
Comédie, ( Poéfie) du fujet de la comédie. XV. 644. a.
De l’expofition du fujet. Suppl. II. 917. b. Sa diftributioii en
aftes. Suppl. I. 133 .b , 8cc. De l’intrigue. Suppl. III. 639. b.
640. a, b. Des moeurs. 949. a , b. Des carafteres. IL 667. ¿.
668. a. Ton qui conyient à la comédie. XVI. 403. b. Du
ridicule dans la comédie. En quoi confifte le vrai comique.
XIV. 287. a, b. L’abus de la comédie eft de jetter du ridicule
fur les profeffions les plus fèrieufes. XVII. 799. a. Puftylp de
la comédie. XV. 532. ¿; SuppL U. 709. a, b. jio . a, ¿.Dujargon