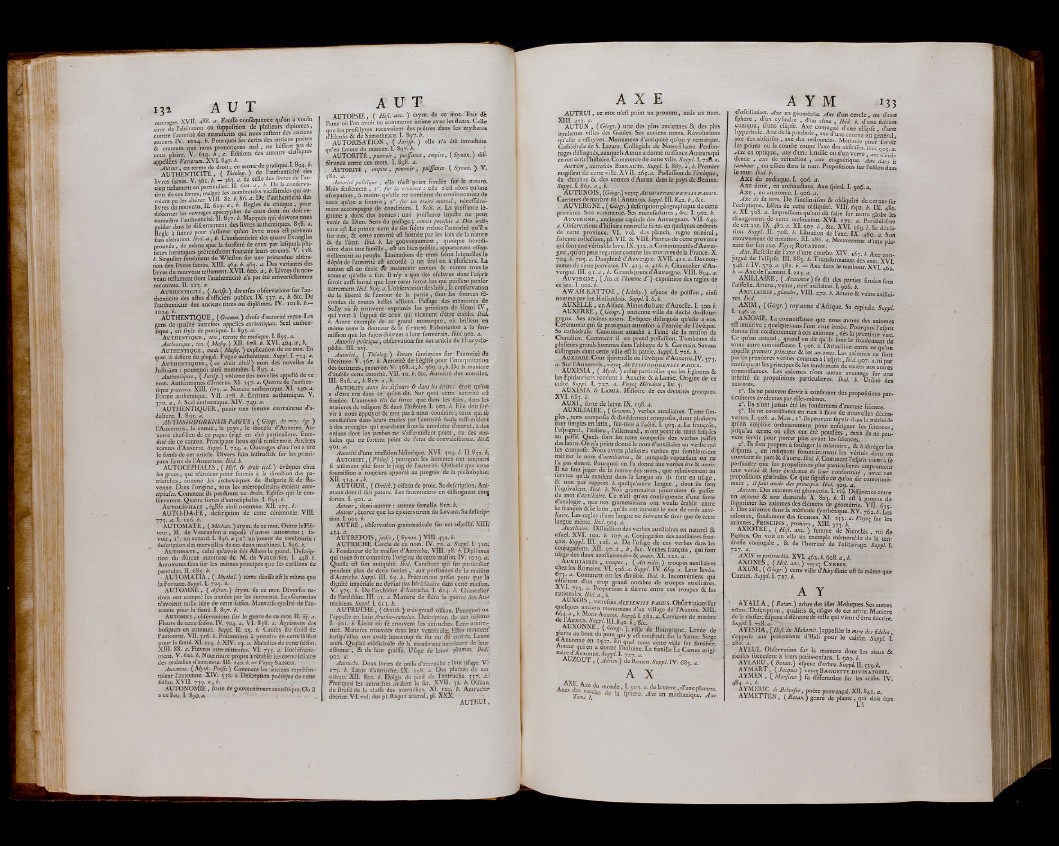
13t2î AUT 1 HR ouvrages. XVII. 488. 4. Fauffe conféquence qu’on a voulu
tirer de l’altération ou fuppofition de plufieurs diplomes,
contre l’autorité des manuicrits qui nous reftent des anciens
auteurs. IV. 1004. b. Pourquoi les écrits des anciens poetes
& orateurs que nous prononçons mal, ne laiffent pas de
nous plaire. V. 639. ¿ , c. Éditions des auteurs claffiques
appellees Variorum. XVI. 847. b. . T Q ,
Auteur, en terme de droit, en terme de prauque.1. 894,b.
AUTHENTICITÉ, ( Théolog.) de lauthent.cirè des
r.vr« fncrés V 161. b. — 363. a. de celle des livres de 1 ancien
teftameilt en particulier, xi. 601. a , b. De hrconferva-
tion de ces livres, malgré les nombreuses viciffitudes qui au-
raoinen t pu■ lie„sc tahlt'jéiwrerr., Vv aIIuI. o8za . b., 86. a.. De , 1 autheriticité& d&e&s
livres du nouveau. U. 6.9; a , i. Regles de critique, pour
difeerner les ouvrages apocryphes de ceux dont on doit re-
connoitre l’authenticité. II. 857. fc Marques qui doivent nous
guider dans le difeernement des livres authenuques. 858. a.
Regle à Suivre pour s’affurer qu’un Üvre nous eft parvenu
fans altération. Ibid. a , b. L’authenticité des quatre Evangiles
prouvée, de même que la fauffeté de ceux par lefquels plusieurs
hérétiques prétendirent foutenir leurs erreurs. V. 118.
b. Singulier fentiment de Whifton fur une prétendue altération
des livres Sacrés. XIII. 464. b. 465. a. Des variantes des
livres du nouveau teftament. XVII. 600. a , b. Livres du nouveau
teftament dont l’authenticité n’a pas été univerfellement
reconnue. II. 213. a. .
A u t h e n t i c i t é , ( Jurifp.) diverfes obfervations fur 1 authenticité
des ailes ffofficiers publics. IX. 337. a, b. &c. De
l’authenticité des anciens titres ou diplômes. IV. 1018. b.—
1024. b.
AUTHENTIQUE, ( Gramm. ) chofe d’autorité reçue; Les
gens de qualité autrefois appellés authentiques. Scel authentique
, en Style de pratique. I. 805. à.
A u t h e n t iq u e , ton, terme de mufique.1. 895. a.
Authentique, ton. ( Mufiq. ) XII. 678. b. XVI. 404. a, b.
A u t h e n t i q u e , mode ( Mufiq. ) explication de ce mot. En
quoi il difiere du plagal. Fugue authentique. Suppl. 1. 724. a.
A u t h e n t i q u e s , ( en droit civil| nom. des novelles de
Juftinien : pourquoi ainfi nommées. L 893. a.
Authentiques, ( Jurifp. ) vôlume des novelles appellê de ce
nom. Authentiques d’ïrnerus. XI. 257. a. Quarte de l’authentique
praterea. XlIL 675. a. Notaire authentique. XI. 240. a.
Forme authentique. VII. X78. ¿. Écriture authentique. V.
370. a , b. Scel authentique. XIV. 749. a.
. AUTHENTIQUER, punir une femme convaincue d’a-
dultere. I. 893. a.
. AUTISSIODORENSIS PAGUS, ( Géogr. du moy. âge.)
l’Auxerrois, le comté, le pays, le diocêfe d’Auxerrê. Au-
xerre chef-lieu de ce pagus érigé en cité particulière. Étendue
de ce canton. Principaux lieux qu’il renfermoit. Anciens
comtes d’Auxerre. Suppl. I. 724. ¿. Ouvrages d’où.l’on a tiré
le fonds de cet article. Divers faits- inftruétifs fur les principaux
lieux de l’Auxerrois. Ibid. b.
AUTOCÉPHALES, ( Hifi. & droit eccl. ) évêques chez
les grecs, qui n’étoient point fournis à la direélion des patriarches,
comme les- archevêques de Bulgarie 6c de- Ra-
venne. Dans l’origine, tous les métropolitains étoient auto-
oéphales. Comment ils perdirent ce droit. Eglifes qui le confer
verent. Quatre fortes d’autocêphales. I. 895. b.
. A u t o c é p h à l e , é g li fe a infi n om m é e . Xfl. 1 7 5 . b.
AUTO-DAtFÉ , defeription de cette cérémonie. VIII.
773. a. L. 116. b.
AUTOMATE , ( Mechan. ) étym. de ce mot. Outre leFlû-
teur,M. de Vaucanfon a expoi'ê d’autres automates; fa-
voir, i°. un canard. I. 896. a ; 20. un joueur dè tambourin :
defeription des merveilles de ces deux machines. 1. 8961 b.
A u t o m a t e , celui qu’avoic fait Albert le grand. Defeription
du Auteur automate de M. de Vaùcanfoti. I. 448. b.
Automates fàits fur les mêmes principes que les carillons de
pendules. H. 685. b.
AUTOMAT! A , ( Mythol.') cette déeffe eft la même que
la Fortune. Suppl. I. 725. b.
AUTOMNÉ , I Afiron. ) étym: de ce mot. Diverfes nations
ont compté les années par les automnes. Les Germains
n’avoient nulle- idée de cette faifon. Mauvaife qualité de l’automne
pour la fanté. I. 897. b.
A u t o m n e , obfervations fur le genre d e ce. mot; II. iiji-4.
Fleurs de cette faifon. IV. 704. a. VI. 858. a. Agrémeris des
bofqucts en automne. Suppl. ¡Ht 23. b. CaufeS du-froid de
l ’automne. VII. 316/ b. Précautions à prendre éri cette iàîfpri
pour la fanté. XI. 219. b. XIV. 13. a. Maladies de éettè fâîfôn.
XIII. 88. a. Fièvres intermittentes. VL 735% a. Enchifrene-
ment. V. 622. ¿. Nourriture propre à rétablir les coñvalefcens
des maladies -d’automne. III. 240. b. — Vôyè; SaïSDN.
■ Automne. ( Myth. Poéfie ) Comment íes-ancifens rèpréfen-
toient l’automne. XIVv 530: 0. Defcnption poétique de cette
faifon. XVII. 739. a , b.
AUTONOMIE, forte de gduvemèment anarchique. Où il
a eu lieu. 1. 890.4.
A U T
AUTOPSIE, ( Hifi. anc. ) étym. de ce- mot..’ Etat dfe
l’ame où l’on avoit un commerce intime avec les dieüx. Celle
que les profèlytes recevoient- des prêtres: dans les myfteres
d’Eleufis & de Samothrace. I. 897. b. . ^
AUTORISATION, ( Jurifp. ) elle n’a été introduite
qu’en faveur du mineur. I. 897. b. . : vJ . “.
AUTORITÉ, pouvoir, puijfance, empire, ( Synon. ) différence
entre ces-mots. 1 .898. a. _ f .
AUTORITÉ ,- empire , pouvoir , puijfance ( Synon. ) V.
582. a. : - ^ :
Autorité politique j elle ri’eft- point fondee fur la nature.
-Mais feulement, 1 fur la violence : elle n’ell alors qu’une
ufurpation, à moins qu’elle ne continue du confentement de
ceux qu’pn a fournis ; 2°. fur un traité mutuel, néceflaire-
ment accompagné de conditions. I. 898. a. La pujiïance légitime
a donc des bornes : une puiiiance injulle ne peut
venir de Dieu. Sens du pàfiàge ; oninis poteftas à Deo ordi•*
nata eft. Le prince tient de fes fujets même l’autorité qu’il a
fur eux, & cette autorité eft bornée par les loix de la nature
& de l’état. Ibid. b. Le gouvernement, quoique -héréditaire
dans une famille, eft Un bien public, appartenant efifen-
tiellement au peuple. limitations de tems félon lelquelles le
dépôt de l’autorité eft accordé à un feul ou à plufieurs. La
nation eft en droit dfe maintenir envers & contre tous le
contrat qu’elle a fait. Il n’y a que des efclaves dont l’efprit
feroit aufli borné que leur coeur feroit bas qui puiflent penfer
autrement. Ibid. 899. a. L’obfervation des loix, la coñfervatioa
de la liberté & l’amour de la patrie, font les fources fécondes
de toutes belles aérions. Paflage des mémoires de
Sully où fe trouvent exprimés les principes de Henri IV ,
qui vont- à l’appui de ceux qui viennent d’être établis. Ibid.
b. Autre exemple de ce grand monarque, où brillent ea
même tems la douceur &Ta fermeté. Exhortation à la fou»
million que les fujets doivent à leur fouverain. /W. 900. a.
Autorité politique, obfervation fur cet article de l’Encyclo1
pédie. III. xvj.
Autorité y ( Théolog. ) divers fentiméns fur l’autorité dè
l’écriture. V . 367. b. Autorité de l’églife pour l’interprétation
des écritures,prouvée: Vv 368.a,b. 369- u-yb,De là maniere
d’établir cette autorité. VU. 10. b. &c. Autorité des conciles:
III. 816. a , ¿. 817. a ÿ b .
A u t o r i t é dans les difeours & dans les écrits ': droit qu’oii
a d’être cru dans ce qu’on dit. Sur qnoi cette autorité eft
fondée. L’autorité ñ’a de force que dans les faits, dans les
matières de religion & dans l’hiftóire. I. 900. b. Elle doit feri-
vir à noiis appuyer & non pas à nous conduire ; ceux qui fe
conduiront dans leurs études par l’autorité feule refleinblent
à des aveugles qui marchent fous la conduite d’autrui, à dei
enfans dont les jambes ne s’affermiflent point, ou des mai
lades qui ne fortent point de l’état de cónvalefcence. Ibidí
çfoi. a. '
Autorité d’une tradition hiftorique. XVI. 509. b. II. 851. b.
A u t o r i t é , ( Pkibf. ) pourquoi les hommes ont toujours!
fi aifément plié fous le joug de l’autorité. Obftacle que cette
foumifiion a toujours apporté au progrès de la philofophiel
XII. 514. a,b.
AUTOUR, ( Omitk.) oiieau de proie. Sa defeription. Animaux
dont il fait pâture. Les fauconniers en diftinguent cinq
fortes. I. 901. a.
Autour, demi-autour : autour femelle. 810. b.
Autour, écorce que les épiciers tirent du Levant Sa defeription.
1 .901. b. t ;
AUTRE, obfervation grammaticale fur cet adjeétif. XUL
454. a.
AUTREFOIS, jadis, ( Syiton. ) VIH. 43 2. b.
AUTRICHE. Cercle de ce nom. IV. 70. a. Suppl. I. 310.’
b. Fondateur de la maifon d’Autriche. VIII. 18. ¿. Diplômes
qui nous font connoître l’origine de cette maifon.IV. 1019. a:
Quelle eft fon antiquité. Ibid. Caraélere qui fut particulier
pendant plus de deux fiecles , aux perfoniies de la maifort
d’Autriche. Suppl. III. 6e.. b. Précautions prifes pour que la
- dignité impériale ne devînt jias héréditaire dans cetté maifon.
V. 575. b. De l’archiduc d’Autriche. I. 614. b: Chancelier
de l’archiduc. III. 91. d. Mahierè dé faire - la ’güèrfè des AuJ
trichiens. Suppl. L 61 \r b.
AUTRUCHE, (• Orhitk.J trés-grand'ôifoau. Pourquoi on
l’appelle en latin ftruthio-camelus. Defeription de- èet oifeau.t
I. ÿoi. b. Lieux où fé trouvent les aüiruches. Leur nourriture.
Matières trouvées dans leur ventricule; Elles meurenr
lorlqu’ellqs, ont avalé beaucoup dè fer ou de cuivre. Leurs1
oeufs. Qualité médicinale de la membrane intérieure de leur
eftomac, 8c de leur graifle, Ufage de lciirs plumes. Ibid?
; 902Í ¿rV •“ ' • -, • l
Autruche. Deux fortes de poils d’autruche : leur iifage. V--
173. ^ ,Í£¡ne d’ahtfliché. IX. 198. a.' Des plumes de cet
oiieau. XIÍ. 800. b'. Doigts du pied de l’autruche. 557. a.1
Pourquoi les autruches avalent le fer. XVII. 32. b. Oifeau.
duBrçfilde la claffé des kntruches. XI. 129. b. Autruche?"
décrite; VT. vol; des pl. Rfegnè'animal, pl. XXX.
AUTRUI,
AXE A Y M
AUTRUI, ce mot n’eft point un pronom, mais un nom.
XIII. 433. u.
AUTUN, ( Géogr. ) une des plus anciennes 8c des plus
opulentes villes des Gaules. Ses anciens noms. Révolutions
qu’elle a eflùyées. Monument d’antiquité qu’on y remarque.
Cathédrale de S. Lazare. Collégiale de Notre-Dame. Perfon-
nages diftingués, auxquels Autun a donné naiflknee. Auteurs qui
en ont écrit l’hiftoire. Commerce de cette ville. Suppl. 1. 728. a.
A u t u n , autrefois B i b r a c t e . Suppl. I. 887. a,b. Premier
magiftrat de cette ville. XVII. 265. a. Pofidfion de l ’évêque,
du chapitre 8c des comtes d’Autun dans le pays de Beaune.
Suppl. L 861. a f b.
AUTUNOIS, (Géogr.) voyeç A u g v s to d vn e n s is p ag u s .
Carrières de marbre de l’Autunois. Suppl. III. 842. ¿ , 8cc.
AUVERGNE, ( Géogr. ) defeription géographique, de cette
province. Son commerce. Ses manufaétures, &c. I. 902. b.
A u v e r g n e , ancienne capitale des Auvergnats. VU. 643.
a. Obfervations dliiftoire naturelle faites en quelques endroits
de cette province. VI. vol. des planch.. regne minéral,
fixieme collection, pl. VII. 8c VIII. Pierres de cette province
qui font une véritable lave. IX. 312. a. Communautés a’Auvergne
, qu’on peut regarder comme les moraves delà France. X.
704. b. 705. a. Dauphiné d’Auvergne. XVII. 411. a. Descou-
tuines de cette province. IV. 413. a. 416. b. Chancelier d’Auvergne.
III. 91. a y b. Grands jours d’Auvergne. VIII. 894. a.
A u v e r g n e , (Jeu de l'homme d ') expoûtion des régies de
ce jeu. I. 902. b. . _ -
AWAH-KATTOE, (Ichthy.) efpece de poifion, ainfr
nommé par les Hollandois. Suppl. 1. 6. b.
AUXELLE , en Alface. Mines du banc d’Auxelle. I. 300. b.
AUXERRE, ( Géogr.) ancienne ville du duché de*Bour-
gogne. Ses anciens noms. Evêques diftingués qu’elle a eus.
Cérémonie qui fe pratiquoit autrefois à l’entrée de Tévêque.
Sa cathédrale. Canonicat attaché à l’aîné de la maifon de
Chatellux. Comment il en prend pofTeflion.,Tombeaux de
plufieurs grands hommes dans l’abbaye de S. Germain. Savans
diftingués dont cette ville eft la patrie. Suppl. 1. 726. ¿.
A u x e r r e . Cour ipirituelle de l’évêque d’Auxerre. IV. 373.
a. Sur l’Auxerrois, voyez A u t is s io d o r en s is pagu s .
AUXESIA, ( Myth. ) cuit« particulier que les Eginetes 8c
les Epidauriens rendent à Auxefie & à Lamie. Origine de ce
'culte. Suppl. I. 727. a. Voye^ Hérodote, liv. 5.
AUXESIA 6* L am ia . Hiftoire de ces divinités grecques.
XVI. 685. ¿; 6 4
AUXI, forte dè laine. IX. 198. a.
AUXILIAIRE, (Gramm.) verbes auxiliaires. Tems (impies
, tems compofés 8c doublement compofés, dont plufieurs
font fimples en latin, fur-tout à l’aâif. I. 903. a. Le françois,
Pefpagnol, l’italien, l’allemand,- n’ont point de tems fimples
au pafiif. Quels font les tems compofés des verbes paiïïfs
des laftns. On n’a point donné le nom d’auxiliaire au verbe1 qui
les compofe. Nous ayons plufieurs verbes qui fembleroient
mériter le nom d’auxiliaires, 8c auxquels cependant on ne
l’a pas donné. Pourquoi on l’a donné aux verbes être 8c avoir.
Il ne faut juger de la nature des mots, que relativement au
forvice qu’ils rendent dans la langue où ils font en ufage ,
oc non pas rapport à quelqu’autre langue , dont ils font
1 équivalent. Ibid. ¿. Nos grammaires pourraient fe pafler
du mot f auxiliaire. Ce n’eft qu’en conféquence d’une forte
d’analogie, que nos grammairiens ont voulu établir entre
le françois 8c le latin , qu’ils ont inventé le mot de verbe auxiliaire.
Les règles d’une langue ne doivent fe tirer que de.cette
langue même. Ibid. 904. a.
Auxiliaire. Diflinélion des verbes auxiliaires en naturel 8c
nfuel. XVI. 102. ¿. 107. a. Conjugaifon des auxiliaires françois.
Suppl. III. lati. a. De l’ufage de ces verbes dans les
conjugaifons. XII..97. a , ¿ , &c. Verbes françois , qrn font
uH>ge des deux auxiliaires être & avoir. XI. 121. a.
A u x i l i a i r e s , troupes , ( An milit. ) troupes auxiliaires
chez les Romains. VI. 506. a. Suppl. IV. 669. a. Leur levée.
J?\ a ^'°îlîment on ^es divifoit. Ibid. b. Inconvéniens qui
réfoltent d’un trop grand nombre de troupes auxiliaires.
AVI. 713. a. Proportion à fuivre entre ces troupes 8c les
nationales. Ibid. a , b. ' • A
AUXOIS t autrefois A l e se x sis p a c u s . OblefVnüons'iin-'
quelques anciens m0numens d’un village de' l’Auxois. XIII.
664. a , b. Mont'Auxois. SuppU. 282. «...Carrières de marbre
de 1 Auxois. Suppl.III..842:ivSoe.'
UXONNE , ( Géogr. ). ville de Bourgogne. Levée de
pierre au bout du pont qui y ert conjlfûit liir la Saône. Siege
dAuxonne eu ,527. En quel rems emte'vUle fut fomfie^e.
I « LCamus origi-
AUZOUT, (Adrien) de Rouen. Suppl. IV: 683. a.
A X
Tome 1 fphere. Axe en mechamque. Axe
m d ofcillation. Axe en géométrie. Axe d’un cercle, ou d’une
fphere , d un cylindre d’un cône , Ibid. b. d’une feftion
im%ellÎpfC- ^ Xf COniu6u® d’une ellipfe, d’une
hyperbole. Axe delà parabole axe d’une courbe en général,
axe des abfciffes, axe des ordonnées. Méthode pou? ùvoir
les points ou la courbe coupe Taxe des abfciffes. Ibid ooe a
Axe en optique, axe d’une lentille ou d’un verre, axe d’incidence
, axe de réfraétion , axe magnétique. Axe dans le
tambour , ou effieu dans le tour. Propofitions fur l’eflieu dans
le tour. Ibid. b.
A xe du zodiaque. I. 906. a.
A xe droit, en architecture. Axe ipiral. I. 906. a.
A x e , en anatomie. 1. 906. a.
Axe de la terre. De l’inclinaifoii 8c obliquité de cet axe fur
leclintique. Effets de cette obliquité. VIII. 650. b. IX. 480.
a. XI. 308. a. Impreflioiis qu’ont dû faire fur notre globe les
changement de cette inclinaifon.- XVI. 171. Parallélifine
de cet axe. IX 480. a. XI. 907. b , &c. XVI. 169. b. Sa déviation.
Suppl. . 11. 708. b. Libradon de l’axe. IX. 480 a Son
mouvement de nutation. XI. 286. g Mouvement d’une pk-
nete lurfon axe. Voye^ R o t a t i o n . r
Axe. Refeéte de ,1’axe d’une courbe. XIV. | | p b. Axe conjugué
de l’cllipfe. III. 883. b. Transformatfon des axes XVI
546. b IV. 379. a. 381. b. - Axe dans 1« tambour. XVI. 462’
b.— Axe de laimantil. 215.4.
„ jgH B & iH B ! (AÎnatomie) fe dit des parties fttuéesfous
1 auleile. Artere, veine. nerf axillaires. 1. 906. b.
A x i l l a i r e s , glandes, VIII. 270. b. Artere & veine axillai-
res. Ibid.
I 146™ ’ ^ Gi°Ë'' ^ r°y a“me d’Afrique. Sa capitale. Suppl.
AXIOME. La connoiflânce que nous avons des axiomes
efl intuitive ; quelques-uns l’ont crue innée. Pourquoi l’efprit
donne fon confentement à ces axiomes , dès la premi»re vue
Ce qu on entend . quand on dit qu’ils font le fondement de'
toute autre connoiffance. I. 906. b. Diftinéiion entre ce nu’on
appelle prsnuirs principes & les axiomes. Les axiomes ne font
pas les premières vérités connues à l’efprit,/¿¡A 907 « ni par
conféqucnt les principes & les fondemens de toutes nos autres
connoiffancês. Les axiomes n’ont aucun avantage fur une
infinité de propofitions particulières. Ibid. b. Utilité des
axiomes..
m Ils ne peuvent fervir à confirmer des propofitions particulières
évidentes par elles-mêmes.
ViS n ° nt îama*s ^ ^es fondemens d’aucune fcience.
3 . Ils ne contribuent en rien à faire de nouvelles découvertes.
I..998. a. Mais, i°. ils peuvent fervir dans la méthode
qu on emploie ordinairement pour enfeigner les fciences
jufquau terme où eUes ont été pouffées , mais ils ne peuvent
fervir polir porter pluis avant les fciences.
& § § ïls fonfpropres à foulager là mémoire, 8c à abréger les
difputes , en indiquant fommairement les vérités dont on
convient de part 8c d’autre. Ibid. b. Comment l’efprit vient à fe
perfuader que les propofitions piùs particulières emprunteur
leur vérité 8c leur évidence de leur conformité , avec ces
propofitions générales. Ce que fignifiè ce qu’on dit communément
, ilfiout avoir des principes. Ibid. 909. a.
Axiome. Des axiomes en géométrie. I. viij. Différence entre
un axiome 8c une demande. X. 803. b. Il e f t l propos de
fuppnmer les axiomes des élémens de géométrie. VII. 63 c
¿. Des axiomes dans la méthode fynthétique. XV. 762. ¿. Les
axiomes, fondement des fciences. XI. 253. 4. Voyez fur les
axiomes, P r i n c i p e s , premiers, XIII. 373. b. x
' AXIOTÉE, ( Hifi. anc. ) femme de Nicoclès , roi de
Paphos. On voit en elle un exemple mémorable de la ten-
dreffe conjugale , 8c de l’horreur de l’efclavage. Suppl. I.
AXIS ïnperitrochio. XVI. 462. b. 608. a b.
AXONES , ( Hifi. anc. ) voyirr.'CYRBES.
AXUM, ( Géogr. ) cette ville a’Abyifime'eft la même que’
Cuzum. Suppl. I. 7 2 7 . b.
A Y
A YALL A , ( Botan.) arbre des Ules Moluques. Ses autres
nôms.'Defçrfotion, qualités uùges de cet arbre. Maniéré
de le claffer.’Éfpece différente de celle qui vient d’être décrite.
Suptil. I. '728; 4. •
, AYESHA, ( Hifi. du Mahomét. ) appellée la mere des fideles
s’oppofe aux prétentions d’Hali pour le califat. Suppl. I.
-280. V
AYEUL. Obfervation fur la maniéré dont les aïeux 8c
aïeules fuccedent à leurs petits-enfàns. I. 909. ¿.
^ } xfpece d'îrbre-SupMII. n 9.f.
« v î î v i r v o y< 5B a g u e t t e d i v in a t o i r e .
484 « f ’ J“ ur > f l ■ ■ ■ ■ A«- 1m IV.
AYMFTTPW poëte provençal. XII. 841. a.
■fxiiuc.1 ic jn f {/sotan.) genre de plante, qui doit êç-e