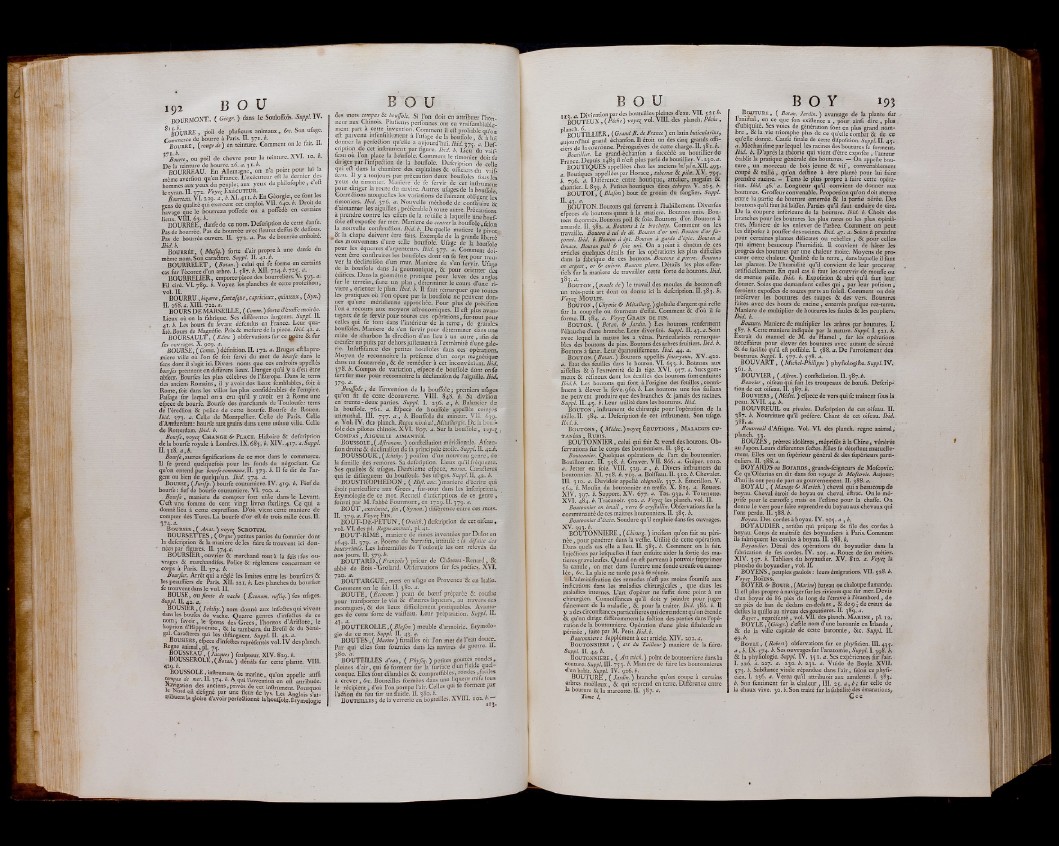
iç)i B O U
BOURMONT., ( Géogr. ) dans le Souloilois. Suppl.Vf.
^IèoURRE , poil de plufieurs animaux, bc. Son ufage.
Commerce de bourre à Paris. II. 371. *. '
B o u r r e , (rougede) en teinture. Comment on le tait. u .
f l Bourre, ou poil de chevre pour la teinture. XVI. 10. b.
De la teinture de bourre. 26. a. 31. b. ;
BOURREAU. En Allemagne, on n’a point pour lui la
même averiion qu’en France. L’exécuteur eft le dernier des
hommes aux yeux du peuple; aux yeux du plulofophe, ceit
f £ | g - ron, .es
cens de qualité qui exercent cet emploi. VII. 640. b. Droit de
havage que le bourreau poffede ou a poffédè en certains
lieux. VIII. 63» b. . . .
BOURRÉE, danfede ce nom. Defcription de cette dame.
Pas de bourrée. Pas de bourrée avec fleuret deffus & deffous.
Pas de bourrée ouvert. II. 372. a. Pas de bourrée emboîté.
Ibid. b. \ g , , .
B ourrée, ( Mufiq.) forte d’air propre à une danie du
même nom. Son caraâere. Suppl. II. 41. b. -
BOURRELET, (Botan.) celui qui fe forme en certains
cas fur l’écorce d’un arbre. I. 587. b. XII. 724. b. 725. a.
BOURRELIER, emporte-piece des bourreliers. V* 593. a.
Fil ciré. VI. 789. b. Voyez les planches de cette profeflion,
▼ol. U. . . . • / c \
BOURRU, bigarre ,fantafque, capricieux, qumteux, {Syn.)
n.268.<* .x r a .722.fl. ¡ 9 s s i i . ,
BOURS DE MARSEILLE, ( Comm.) forte d’étoffe moirée.
Lieux où on la fabrique. Ses différentes largeurs. Suppl. II.
41. b. Les bours du levant défendus en France. Leur qualité.
Bours de Magnéfie. Prix 8c mefure de la piece. Ibtd. 42. a.
BOURSAULT, (Edme ) obfervations fur ce âoëte 8c fur
fes ouvrages. X. 909. a.
BOURSE, ( Comm. ) définition. IL 172. a. Bruges eft la première
ville où l’on fe foit fervi du mot de bourfe dans le
fens dont il s’agit ici. Divers noms que ces endroits appellés
bourfes prennent en différens lieux. Danger qu’il V a d’en être
abfent. Bourfes les plus célébrés de l’Europe. Dans le tems
des anciens Romains, il y avoit des lieux femblables, foit à
Rome, foit dans les villes les plus confidérables de l’empire.
Paffage fur lequel on a cru qu’il y avoit eu à Rome une
efpece de bourfe. Bourfe des marchands de Touloufe: tems
de l’éreétion & police de cette bourfe. Bourfe de Rouen.
Ibid. 373. a. Celle de Montpellier. Celle de Paris. Celle
d’Amfterdam: bourfe aux grains dans cette même ville. Celle
de Rotterdam. Ibid. b.
. Bourfe, voye[ C h a n g e b P l a c e . Hiftoire & defcriptiori
de la bourfe royale à Londres. IX. 683. b. XIV. 417. a. Suppl.
II. 318. a, b.
Bourfe,autres lignifications de ce niot dans le commerce.
Il fe prend quelquefois pour les fonds du négociiant. Ce
qu’on entend par bourfe commune. II. 373. b. Il fe dit de l’argent
ou bien de quelqu’un. Ibid. 374. a.
B o u r s e , (Jurïfp.) bourfe coutumiere. IV. 419. b. Fief de
bourfe : fief de bourfe coutumiere. VL 700. a.
. Bourfe , maniéré de compter fott utile dans le Levant.
C’eft une fomme de cent vingt livres fterlings. Ce qui a
donné lieu à cette expreflion. D’où vient cette maniéré de
compter des Turcs. La bourfe d’or eft de trois mille écus. II.
374-*.
B o u r s e s , ( Anat.) voyez S c r o t u m .
BOURSETTES, (Orgue) petites parties du fommier dont
la defcription 8c la maniéré de les faire fe trouvent ici don-
* nées par figures. II. 374. u.
BOURSIER, ouvrier & marchand tout à la fois : fes ou- \
vrages 8c marchandifes. Police 8c réglemens concernant ce
corps à Paris. IL 374. b.
Bourfier. Arrêt qui a réglé les limites entre les bourfiers 8c
les peaufffers de Paris. XII. 221. b. Les planches du bourfier
fe trouvent dans le vol. II.
BOUSE, ou fiente de vache ( Économ. rufiiq.) fes ufagés.
Suppl. II. 42. a.
BOUSIER, ( lchthy.) nom donné aux infeftes qui vivent
dans les boufes de vacne. Quatre genres d’infeéles de ce
nom ; favoir, le fporas des Grecs , l’hontos d’Ariftote, le
kopnon tfHippocrate, & le tambeira du Brefil & du Sénégal.
Caractères qui les diflinguent. Suppl. II. 42. a.
B o u s ie r s , efpece d’infeétes repréfentés vol. IV des planch.
Regne animal, pl. 73.
) fculpteur. X IV. 829. b.
• BOUSSEROLÊ, (Botan. ) détails fur cette plante. VIII.
419-
BOUSSOLE,infiniment de marine, qu’on appelle aufli
compas de mer. II. 374. b. A qui l’invention en eft attribuée,
«aviganon des anciens,pnvés de cet infiniment. Pourquoi
te Nord eft défigné par une fleur de lys. Les Anelois s’at-
VibuentU gloire d’avoir perfefliooné la bouffoVs. Étymologie
BOU des mots compas & bouffole. Si l’on doit en attribuer l’honneur
aux Chinois. Plufieiirs perfonnes ont eu vraifemblable-
ment part a cette invention. Comment il eft probable qu’on
eft parvenu înfenfiblcment à l’ufage de la bouflole, 8c à lui
donner la perfection qu’elle a aujourd’hui. Ibid. 37c. a. Defcription
de cet infiniment par figure. Ibid. b. Lieu du vaif-
feau où l’on place la bOUffole. Comment le timonier doit fe
diriger par l’infpeCtion de la bouflole. Defcription de celle
qui eft dans la chambre des capitaines 8c officiers du vaif-
lê.iu. Il y a toujours par précaution deux boufloles fous les
yeux du timonier. Maniere de fe fervir de cet infiniment
pour diriger la route du navire. Autres ufages de la bouflole
Corrections auxquelles les variations de l’aimant obligent les
timoniers. Ibid. 376. a. Nouvelle méthode de conftruire 8c
d’aimanter les aiguilles, préférable à toute autre. Précautions
à prendre contre les effets de la rouille à laquelle unebouf-
fole eft expofée fur mer. Maniere de centrer la bouflole félon
la nouvelle conilruition. Ibid. b. De quelle matière le* pivot
& la chape doivent être faits. Exemple de la grande liberté
des mouvemeHs d’une telle bouflole. Ufage de la bouffole
pour les équerres d’arpenteurs. Ibid. 377. ¿¿ Comment doivent
être conftruites les boufloles dont on fe fert pour trouver
la déclinaifon d’un mur. Maniere de s’en fervir. Ufage
de la bouffole dans la gnomonique, 8c pour orienter des
édifices. Dans la géométrie pratique pour lever des angles
fur le terrein, faire un plan, déterminer le cours d’une°rivière
, orienter le plan. Ibid. b. Il faut remarquer que toutes
les pratiques où l’on opere par la bouffole ne peuvent donner
qu’une méridienne approchée. Pour plus de précifion
l’on a recours aux moyens aftronomiques. Il eft plus avantageux
de fe fervir pour toutes ces opérations, fur-tout pour
celles qui fe font dans l’intérieur de la terre, de grandes
boufloles. Maniere de s’en fervir pour déterminer dans une
miñe de charbon la diredion d’un lieu à un autre , afin de
creufer un puits par dehors juftement à l’extrémité d’une galerie.
Infuflifance des petites boufloles dans ces opérations.
Moyen de r-econnoître la préfence d’un corps magnétique
dans un fouterrein, 8c de remédier à cet inconvénient. Ibid.
378. b. Compas de variation, efpece de bouffole dont onfe
fert fur mer pour reconnoître la déclinaifon de l’aiguille. Ibid.
379- a-
Bouffole, de l’invention de la bouflole ; premiers ufâges
qu’on fit de cette découverte. VIII. 848. b. Sa divifion
en trente - deux parties. Suppl. I. 236. a , b. Balancier de
la bouflole. 761. a. Efpece de bouflole appellée comprs
azimuthal. III. 737. a , b. Bouffole du mineur. VII. 639.
a. Vol. IV. des planch. Regne minéral,Métallurgie. De la boaffole
des pilotes chinois. XVI. 807. a. Sur la bouffole , voycç_
C o m p a s , A i g u i l l e a im a n t é e .
B o u s s o l e , (Afironom. ) conftellation méridionale. Afcen-
fion droite 8c déclinaifon de fa principale étoile. Suppl. II. 42h.
BOUSSOUK, ( lchthy. ) poiflon d’un nouveau,genre, de
la famille des remores. Sa defcription. Lieux qu’il fréquente.
Ses qualités & ufages. Deifxieme efpece, moron. CaraCleres
qui le diflinguent du bouffouk. Ses ufages. Suppl. II. 42. b.
BOUSTROPHEDON , ( Hifi. anc. ) maniere d’écrire qui
étoir particulière aux Grecs, fur-tout dans les infcripticas.
Étymologie de ce mot. .Recueil d’inferiptions de ce genre,
fourni par M. l’abbé Fourmont, en 1729. II. 379. a.
BOUT, extrémité, fin ,(Synon.) différence entre ces mots.
H. ’379. a. Voyeç F i n .
BOUT-DE-PETUN, ( Omith.) defcription de cet oifeau,
vol.-VL des ph Regne animal, pl. 41.
BOUT-RIMÉ, maniere de rimes inventées par Dulot en
1649. H. 379. a. Poëme de Sarrafin, intitulé : la défaite des
bouts-rimés. Les lanterniftes de Touloüfe les ont rélevés de
nos jours. IL 379. ¿.
BOUTARD, ( François) prieur de Château-Renard, &
abbé de Bois -Groland. Obfervations fur fes poéfies. XVI.
720. a.
BOUTARGUE, mets en ufage en Provence ‘8c en Italie.
Comment on le fait. II. 380. a.
BOUTE, (Économ.) peau de boeuf préparée 8c coufue
pour tranfporrer le vin oc d’autres liqueurs, au travers des
montagnes, 8c des lieux difficilement pratiquables. Avantages
de cette forte de vaiffeau. Leur préparation. Suppl. U-
43. a.
BOUTEROLLE, ( Blafon ) meuble d’armoirie. Étymologie
de ce mot. Suppl. II. 43. a.
BOUTES,(Marine) futailles où l’on met dé l’eau douce.
Par .qui: elles font fournies dans les navires de guerre. IL
380.
BOUTEILLES d’eau, ( Phyfiq. ) petites gouttes rondes,
pleines d’air, qui fe forment fur la furface d’un fluide quelconque.
Elles font dilatables 8c compreflibles', rondes »faciles
à crever, bc. Bouteilles formées dans une liqueur mue fous
le récipient | d’où l’on pompe l’air. Celles qui fe forment par
l’aétion du feu fur 1111 fluide. II. 38o.b. .
B o u t e i l l e s ; de la verrerie en bouteilles. XV111. 102. ^
B O U
. . a ¿7 Divination par des bouteilles pleines d’eau. VIL
B O Ù T E U X , ( Pêche ) voyei vol. VIU. des planch. Peche ,
plaBnOUTILLIER, (Grand B. de France) en latin buticularius,
aujourd’hui grand échanfon.Il étoit un des cinq grands officiers
de la couronne. Prérogatives de cette charge. II. 381. b.
Boutillier. Le grand-échanfon a fuccédé au boutillier de
France. Depuis 1483 il n’eft plus parlé de boutillier. V. 230. a.
BOUTIQUES appellées chez les anciens tafpua.XII. 493.
a. Boutiques appellées par Horace, tabema 8c pila. XV. 795.
b. 796. a. Différence entre boutique* attelier, magafin oc
chantier. 1. 839. b. Petites boutiques dites, échopes. V. 263. b.
BOUTOI, (Blafon) bout de grouin du fanglier» Suppl.
BOUTON. Boutons qui fervent à l’habillement. Diverfes
efpeces de boutons quant à la maticre. Boutons unis. Boutons
façonnés. Boutons poil & foie. Boutons d’or. Boutons à
amande. II. 382. a. Boutons à la brochette. Comment on les
travaille. Bouton à cul de dé. Bouton d'or uni. Bouton d or façonné.
Ibid. b. Bouton à épi. Bouton a garde d ¿pce. Bouton a
limace. Bouton poil & foie uni. On a joint a chacun de ces
articles quelques détails fur les opérations les plus difficiles
dans la fabrique de ces boutons. Boutons à pierre. Boutons
en argent, or b cuivre. Bouton plane. Détails les plus effen-
tiels fur la maniéré de travailler cette forte de boutons. Ibid.
^ èouTON, (moule de) le travail des moules de bouton eft
un très-petit art dont on donne ici la defcription. H. 383. b.
■Voye1 M o u l e s .
B o u t o n , ( Chyme b Métallurg. ) globule d’argent qui refte
fur la coupelle ou fourneau d’effai. Comment 8c d’où il fe
forme. I I . 384. a. Voyez G r a i n d e f i n .
B o u t o n . ( Botan. b Jardin. ) Les boutons renferment
l’ébauche d’une branche. Leur diverfité. Suppl. II. 43. a. Soin
avec lequel la nature les a vêtus. Particularités remarquables
des boutons de pins. Boutons des arbres fruitiers. Ibid. b.
Boutons à fleur. Leur épânouiffement. Ibid. 44. a.
B o u t o n . (Botan. ) Boutons appellés fous-y eux. XV. 422.
a. Etat des feuilles dans le bouton. VI. 633. b. Bobtons aux
aiffelles & à l’extrémité de la tige. XVI. 937. a. Sucs gommeux
8c réfineux dont les écailles des boutons font enduites
Ibid.b. Les boutons qui font à l’origine des feuilles, contribuent
à élever la feve. 960. b. Les boutons une fois faillans
ne peuvent produire que des branches 8c jamais des racines.
Suppl. II. 43. b. Leur utilité dans les boutures. Ibid.
B o u t o n , infiniment de chirurgie pour l’opération de la
taille. II. 384. a. Defcription de cet infiniment. Son ufage.
Ibid.b.
B o u t ô Ns , ( Médec. ) voyei É r u p t i o n s , M a l a d i e s c u t
a n é e s , R u b i s .
BOUTONNIER, celui qui fait 8c vend des boutons. Obfervations
fur le corps des boutonniers. II. 383. a.
Boutonnier. Quelques opérations de l’art du boutonnier.
Bouillonner. II. 330. b. Graver. VIL 866. a. Guiper. 1010.
a. Jetter en foie. VIII. 329. a , b. Divers inftrumens du
boutonnier. XI. 718. b. 719. a. Boiffcau. II. 310. ¿.Chevalet.
III. 310. a. Dévidoir appeué chignolle. 337. b. Émerillon. V.
564. b. Moulin du boutonnier en treffe. X . $13. <z. Rouets.
XIV. 397. b. Support. XV. 677. a. Tas. 932. b. Tournette.
XVI. 484. b. Tracanoir. 302. a. Voye| les planch. vol. H.
Boutonnier en émail, verre b cryflallin. Obfervations fur la
communauté de ces maîtres boutonniers. H. 283. b.
Boutonnier d'étain. Soudure qu’il emploie dans fes ouvrages.
XV. 393. b.
BOUTONNIERE, ( Chirurg. ) inciflon qu on fait au périnée
, pour pénétrer dans la veflie. Utilité de cette opération.
Dans quels cas elle a lieu. II. 383. b. Comment on la fait,
Injeélions par lefquelles il faut enfuite aider la fortie des matières
graveleufes. Quand on eft parvenu à pouvoir fupprimer
la canule, on met dans l’uretre une fonde creufe ou cannelée
, bc. La plaie ne tarde pas à fe réunir.
^ L ’àdminiftration des remedes n’efl pas moins foumife aux
indications dans les maladies chirurgicales , que dans les
maladies internes. L’art d’opérer ne fuffit donc point à un
chirurgien. Connoiffaftces qu’il doit y joindre pour juger
fainement de la maladie, 8c pour la traiter. Ibid. 3 86. b. Il
y a des circonflances particulières qui demandent qu’on étende
8c qu’on dirige différemment la feclion des parties dans l’opération
de la boutonnière. Opération d’une plaie fiftuleufe au
périnée , faite par M. Petit. Ibid. b.
Boutonnière : fupplément à cet article. XIV. 202. a.
B o u t o n n i è r e , ( art du Tailleur) maniéré de la faire.
Suppl. II. 44. b.
B o u t o n n i è r e , ( Art méch. ) point de boutonnière dans la
couture. Suppl. III. 733. b. Maniéré de faire les boutonnières
d’un habit. Suppl. IV. 926. ¿.
BOUTURE, (Jardin.) branche qu’ori coupe à certains
arbres moelleux, 8c qui reprend en terre. Différence entre
la bouture 8c la marcotte. II. 387. a.
Tome I.
B O Y 193
B o u t u r e , ( Botan. Jardin. ) avantage dé la plante fur
I animal , en ce que fon exiflence a , pour ainfi dire , plus
d ubiquité. Ses voies de génération font en plus grand nombre
, oc la vie triomphe plus de ce qu’elle combat 8c de ce
qu’elle donné. Caufe finale de cette difpofuion. SuppU U. 43.
a. Méchanifme par lequel les racines des boutures fe forment*
Ibid. b. D’après la théorie qui vient d’être expofée ,• l’auteur
établit la pratique générale dés boutures. — On appelle bouture
, un morceau de bois jeune 8c v i f , convenablement
coupé 8c taillé , qu’on deftine à être planté pour lui faire
prendre racine. - Tems le plus propre à faire cette opération.
Ibid. 46.' a. Longueur qu’il convient de donner aux
boutures. Groffeur convenable. Proportion qu’on doit nlettre
entre la partie de bouture enterrée 8c la partie aérée. Des
boutons qu’il faut lui laiffer. Parties qu’il faut enduire de cire.
De la coupure inférieure de la bouture. Ibidt b. Choix des
branches pour les boutures les plus rares ou les plus opiniâtres.
Maniéré de les enlever de l’arbre. Comment on peut
les difpofer à pouffer des racines. Ibid. 47. a. Soins à prendre
pour certaines plantes délicates ou rebelles * & pour celles
qui aiment beaucoup l’humidité. Il convient de hâter les
progrès des boutures par une chaleur moite. Moyens de procurer
cette chaleur. Qualité de la terre , dans laquelle il faut
les planter. De l’humidité qu’il convient de leur procurer
artificiellement. En quel cas il faut les couvrir de moufle ou
de menue paille. Ibid. b. Expofition 8c abri qu’il faut leur,
donner. Soins que demandent celles qui, par leur pofition
feroient expofées de toutes parts au foleil. Comment on doit
préferver les boutures des taupes 8c des vers. Boutures
faites avec des bouts de racine, enterrés prefque rez-terre.
Maniéré de multiplier de boutures les faules 8c les peupliers*
Ibid. b. J
Bouture, Maniéré de multiplier les arbres par boutures. I.’
387. b. Cette maniéré indiquée par la nature. Suppl. I. 321. b.
Extrait du manuel de M. du Hamel , fur les opérations
néceffaires pour élever des boutures avec autant de sûreté
8c de facilité qu’il eftpoflible. I. 388. a. De l’arrofement des.
bouturés. Suppl. I. 377. b. 378. a.
BOUVART, (Michel-Philippe) phyfiologifte. Suppl. IV*
361. b.
BOUVIER, (Afiron.) conftellation. H. 387.b.
Bouvier, oifeau qui fuit les troupeaux de boeufs. Défcrip-
tion de cet oifeau. II. 387. b.
B o u v i e r s , ( Médec. ) efpece de vers qui fe traînent fous la
peau. XVn. 44. b.
BOUVREUIL ou pivoine. Defcription de cet oifeau. II.
387. b. Nourriture qu’il préféré. Chant de cet oifeau. Ibid,
388. a.
Bouvreuil d’Afrique. Vol. VL des planch. regne animal*
planch. 33.
BOUZÉS , prêtres idolâtres, méprifés à la Chine* vénérés
au Japon. Leurs différentes feéles. Elles fe détellent mutuellement.
Elles ont un fupérieur général 8c des fupérieurs particuliers.
IL 388. a,
BOYARDS ou B o j a r d S , grands-leigneürs de Mofcovie.’
Ce qu’Oléarius en dit dans ibn voyage de Mofcovie. Aujourd’hui
ils ont peu de part au gouvernement. II. 388. a.
BOYAU, ( Manège b Maréch. ) cheval qui a beaucoup de
boyau. Cheval étroit de boyau ou cheval eftrac. On le mé-
prife pour le carrôffe ; mais on l’eftime pour la chaffe. On
donne le vertpour faire reprendre du boyau aux chevaux qui
l’ont perdu. II. 388. b.
Boyau. Des cordes à boyau. ÏV. 203. a , b.
BOYAUDIER, artifan qui prépare & file des cordes à
boyau. Corps de maîtrife des boyaudiers à Paris. Comment
ils fabriquent les cordes à boyau. II. 388, b.
Boyaudier, Détail des opérations du boyaudier dans la
fabrication de fes cordes, IV. 203. a. Rouet de ibn métier*
XIV. 397. b. Tabliers du boyaudier. XV. 810. a. Voye^ la
planche du boyaudier, vol. II.
BOYENS, peuples gaulois : leurs émigrations. VU. 328. b,
m m m
BOŸER b B o u i r , (Marine) bateau çu chaloupe flamande,
II eft plus propre à naviger fur les rivières que fur mer. Devi9
d’un boyer de 86 piés de long de l’étrave à l’érambord, de
2©piés de ban de dedans en-aedans , & de 9 £ de creux de
deffus la quille au niveau des gouttières. II. 389. a,
Boyer, repréfenté, vol. VII. des planch. M a r i n e , pl. 12;
BOYLE, (Géogr.) c’eft le nom d’une baronnie en Irlande ,•
8c de la ville capitale de cette baronnie, 8cc. Suppl. IL
49-b, - .. .
B o y l e , ( Robert) obfervations fur ce phyficien. III. 433;
a , b. IX. 374. b. Ses ouvrages fur l’anatomie, Suppl. 1. 398. b,
8c la phyfiologie. Suppl. I v . 331. a. Ses expériences fur l’air.
I. 226. a. 227. a. 230. b, 232. a, Vuide de Boyle. XVIL
373 .b. Subftance vitale répandue dans l’air, félon ce phyfi-
cien. I. 236. a. Vertu qu’il attribuoit aux amulettes. I. 382;
b. Son fentiment fur la chaleur , III. 23. a , b; fur celle de
la chaux vive. 30. b. Son traité fur la fubtilité des émanations^.