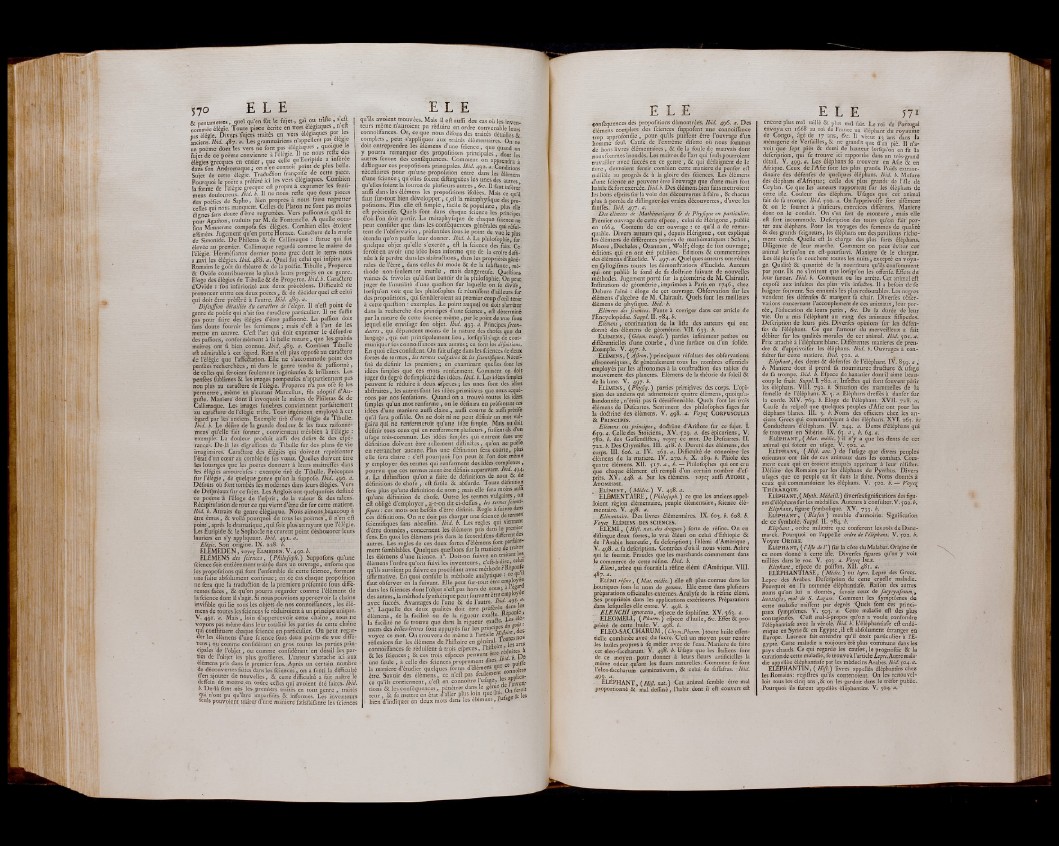
5 7 O E L E
Divers fujets traités en vers élégiaques P^A^
ancien i. leiu. ao/. w. iæj tío»»»«..—« ;--rr- • »
nn poème dont les vers ne font pas élcgiaques, quoique c
fuiet de ce poëmc convienne à lílcgie. I « nous refle des
èle'eiesgrecques en entier, que celle quEunp.de a inférée
dans fon Atîdromaque; on gén conçoit point de plus belle.
Sujet de cette élégie. Tradu8ion fraiiÇO.Çe de cette piece.
Pourquoi le poète a préféré ici les vers elégiaques. Combien
la forme de l’élégie grecque eft propre a exprimer les fenu-
mens douloureux, lbid. i. Il ne nous refte que deux pièces
des poéfics de Sapho, bien propres à nous faire regretter
celles qui nous manquent. Celles de Platon ne font pas moins
dignes fans doute d’être regrettées. Vers paffionnés qu’il ht
pour Agathon, traduits par M. de Fontenellc. A quelle occa-
\ion Mimnerme compota fes élégies. Combien elles étoient
e/limées. Jugement qu’en porte Horace. Caraflere de la mufe
de Simonide. De Philetas & de Callimaque : ftatue qui fut
élevée au premier. Callimaque regardé comme le maître de
l’élégie. Herméfianax dernier poëte grec dont le tems nous
a ravi les élégies, lbid. 488. a. Quel Tut celui qui infpira aux
Romains le goût du théâtre & de la poéfic. Tibulle, rroperce
& Ovide contribuèrent le plus à leurs progrès en ce genre.
Eloge des élégies de Tibulle & de Properce, lbid. b. Caraftere
d’Ovide : fon infériorité aux deux précédons. Difficulté de
prononcer entre ces deux poetes, & de décider quel efl celui
qui doit être préféré à l’autre. lbid. 489. a.
DifcuJJion détaillée du caraftere de l'élégie. Il n’eft point de
genre de poéiie qui n’ait fon Caraftere particulier. Il ne fuffit
pas pour faire des élégies d’être pamonné. La paffion doit
■fans doute fournir les fentimens ; mais c’eft à l’art de les
mettre en oeuvre. C’eft l’art qui doit exprimer le défordre
des pallions, conformément à la belle nature, que les grands
maîtres ont fi bien connue, lbid. 489. a. Combien Tibulle
eft admirable à cet égard. Rien n’eft plus oppofé au caraftere
de l’élégie que l’affeôation. Elle ne s’accommode point des
penféés recherchées 5 ni dans le genre tendre 8c palfionné,
de celles qui feraient feulement ingénieufes & brillantes. Les
peniêes fubümes & les images pompeufes n’appartiennent pas
non plus au caraftere de l’élégie, rroperce n’a pas ofé fe les
permettre , même en pleurant Marcellus, fils adoptif d’Au-
gufte. Maniere dont il invoquoit le mânes de Philetas & de
Callimaque. Les images fúnebres conviennent parfaitement
au caraftere de l’élégie trifte. Tour iñgénieux employé à cet
'égard par lés' àrïciëàs. Exemple" tiré d une élégie de Tibulle.
lbid. b. Le délire de la grande douleur 8c les faux raifonne-
mens' qu’elle fait former, conviennent très-bien à l’élégie :
exemple; La douleur produit aum' des défirs 8c des efpé-
rancés. De-là les djgreftions de Tibulle fur des plans de vie
imaginaires. Caraftere des élégies qui doivent repréfenter
l’état d’un coeur au comble de íes voeux. Quelles doivent être
les louanges que les poetes donnent à leurs maîtreffes dans
les élégies amourcùfcs : exemple tiré de Tibulle. Préceptes
fur l’élegie, de quelque genre qu’on la fuppofe. lbid. 490. a.
Défauts où font tombés les modernes dans leurs élégies. Vers
de Défpréaux fur ce'fujer. Les Anglois ont quelquefois deftiné
ce poëme à l’éloge de l’efprit, de la valeur 8c des talens.
Récapitulation de tout ce qui vient d’être dit fur cette matière.
lbid. b. Attraits du genre clégiaque. Nous aimons.béaucoup à
être émus, & voilà pourquoi de tous les poèmes', il n’en eft
point, après le dramatique, qui foit plus attrayant que l’élégie.
Les Euripide & le Sophocle ne crurent point déshonorer leurs
lauriers en s’y appliquant, lbid. 491. a.
Elégie. Son origine. IX. 228. b.
ELEMEDEN, voye^ E lm ed e n . V. 490. b.
ELÉMENS des Jciences, ( Philofoph. ) Suppofons qu’une
fcience foit entièrement traitée dans un ouvrage, enforte que
les propofitions qui font l’enfemble de cette (cience, forment
une fuite abfolument continue ; en cç cas chaque propofition
ne fera que la traduftion de la première préfentée fous différentes
faces, & qu’on pourra regarder comme l’élément de
la fcience dont il s’agit, Si nous pouvions appercevoir la chaîne
invifible qui lie tous les objets de nos connoiifances, les élé-
mens de toutes lesfciences le réduiraient à un principe unique.
V . 491. a. Mais , loin d’appcrcevoir cette chaîne, nous ne
voyons pas même dans leur totalité les parties de cette chaîne
qui conmtuent chaque fcience. en particulier. On peut regarder
les élémens d’une fcience fous deux points de vue différées
; ou comme confidérant en gros toutes les parties principales
de l’objet, ou comme confidérant en détail-les parties
de l’objet les plus groffieres. L’auteur s’attache ici aux
élémens pris dans le premier fens. Après un certain nombre
de découvertes faites dans les fciences, on a fenti la difficùUé
d’en ajouter de nouvelles, 8c cette difficulté a fait,naître le
deffein de mettre .en ordre celles qui avoient été faites, lbid.
b. De-là font nés lés premiers traités en tout genre , traités
qui n’ont pu qu’être imparfaits 8c informes. Les inventeurs
lcnls pouvoient traiter d’une maniere' fatîsfaifantc lès fcicnces
E L E
qu’ils avoient trouvées. Mais il eft auffi des cas où les inven-
teurs meme n auroient pu réduire en ordre convenable leurs
connoiifances. Or, ce que nous difons des traités détaillés &
complets, peut s’appliquer aux traités élémentaires. On ne
doit entreprendre les élémens d’une fcience, que quand on
y pourra remarquer des propofitions principales, dont les
autres feront des conféquences. Comment on apprendra à
diftineuer ces propofitions principales, lbid. 402. a. Conditions
néceflaires pour qu’une propofition entre dans les élémens
d’une fcience ; qu'elles foient diftinguées les unes des autres
qu'elles foient la fource de plufieurs autres, &c. Il faut inférer
auffi dans les élémens les propofitions ifolées. Mais ce qu’il
faut fur-tout bien développer, cteft la métaphyfique des propofitions.
Plus elle eft fimple , facile 8c populaire, plus elle
eft précieufe. Quels font dans chaque fcience les principes
d’où l’on doit partir. Le métaphyfique de chaque fcience ne
peut confifter que dans les conféquences générales qui réful-
tent de l’obfervarion, préfentées fous le point de vue le plus
étendu qu’on puiffe leur donner. lbid. b. La philofophie, fur
quelque objet qu’elle s’exerce, eft la fcience des fàits. Ce
ferait en avoir une idée bien informe que de la croire defti-
née à fe perdre dans les abftraftions, dans les propriétés générales
de l’être, dans celles du mode 8c de la fubftancc, méthode
non-feulement inutile , mais dangereufe. Queftions
vaincs 8c frivoles qu’il faut bannir de la philofophie. On peut
juger de l’inutilité d'une queftion fur laquelle on fe divife,
lorfqu’on voit que les philofophes fe réunifient d’ailleurs fur
des propofitions, qui fembleroient au premier coup d’oeil tenir
à cette queftion : exemples. Le point auquel on aoit s’arrêter
dans la recherche des principes d’une fcience, eft déterminé
par la nature de cette fcience même, par le point de vue fous
lequel elle envifage fon objet, lbid. 493. a. Principes fecon-
daires, qui dépendent moins de la nature des chofcs que du
langage, qui ont principalement lieu, lorfqu’il s’agit de communiquer
les connoiifances aux autres; ce font les définitions.
En quoi elles confiftent. On fait ufage dans les fcicnces de deux
1 fortes de termes, Us termes vulgaires 8c Us feientifiques. Nècef-
fité de définir les premiers ; en examinant quelles font les
idées funples que ces mots renferment. Comment on doit
juger du aegré de fimplicité des idées. lbid. b. Les idées (impies
peuvent fe réduire à deux efpeces ; les unes font des iaées
abftraites, les autres font les idées primitives que nous acquérons
par nos fenfation;. Quand on a trouvé toutes les iaées
(impies qu’un mot renferme, on le définira en préfentant ces
idées d’une maniéré auffi claire., auffi courte oc aufii précife
qu'il fera poffible. On ne doit ni ne peut définir un mot vulgaire
qui ne renfermerait qu’une idée fimple. Mais on doit
définir tous ceux qui en renferment plufieurs, fufient-ils d’un
ufage très-commun. Les idées (impies qui entrent dans une
définition doivent être tellement aiftinftes, qu’on ne puiffe
en retrancher aucune. Plus une définition fera courte, plus
elle fera claire : c’eft pourquoi l’on peut 8c l’on doit même
y employer des termes qui renferment des idées complexes,
pourvu que ces termes aient été définis auparavant. lbid. 494*
a. La diuinftion qu’on a faite de définitions de nom & de
définitions de choie , eft futile 8c abfurde. Toute définition
fera plus qu’une définition de nom ; mais elle fera moins auffi
qu’une définition de chofe. Outre les termes vulgaires , on
eft obligé d’employ e r , a-t-on dit ci-deffus, les termes feientifiques
: ces mots ont befoin d’être définis. Réglé à fuivre dans
ces définitions. On ne doit pas charger une fcience de termes
feientifiques fans néceffité. lbid. b. Les réglés qui viennent
d’être données, concernent les élémens pris dans le premier
fens. En quoi les élémens pris dans le fécond fens différent des
autres. Les réglés de ces deux fortes d’élémens font parfaitement
femblables. Quelques queftions fur la maniéré de traiter
les élémens d’une fcience. i°. Doit-on fuivre en traitant
élémens l’ordre qu’ont fuiviles inventeurs, c’cft-à-dire, ce
qu’ils auroient pu fuivre en procédant avec méthode ? Kepon
affirmative. En quoi confiftc la méthode analytique : ce q
faut obferver en la fuivant. Elle peut fur-tôut être empK>y
dans les fcienccs dont l’objet n’eft pas hors de nous; à 1 g
des autres, la méthode fynthétique peut fouvent être empioy
avec fuccès. Avantages de l’une 8c de l’autre. /««• 491* ‘
20. Laquelle des deux qualités doit être préférée dan
élémens, de la facilité ou de la rigueur exa^®' f «^Jé-
la facilité ne fe trouve que dans la rigueur exafte. Les ^
mens des belles-Uttres font appyyés fur les principes
yoyez ce mot. On trouvera de même à l’a r t ic le ,/ * '/ nos'
réflexions fur les élémens de l’hiftoirc en général^ . artS
connoiifances fe réduifent à trois cfpeces, l’hiito,re ?j u;teS à
8c les fcicnces; 8c ces trois cfpeces peuvent être j .
une feule, à celle des fciences proprement dites-- • •
là maniéré d’étudicr quelques fortes d’élémens qu *,0jtre
être. Savoir des élémens , ce n’eft pas feulement aD_|ica.
ce qu’ils contiennent, c’eft en connoître 1 ufage, l'inventions
& les conféquences , pénétrer dans le gérne .£
teur , 8c fc mettre en état d’aller plus loin queh •. ^ ^
bien d’indîqüer en deux mots dans les e l e m e n s ,»
E L E E L E 5 7 1
conféquences des propofitions démontrées; lbid. 496. a. Des
élémens complets des fciences fuppofent une connoiffance
trop approfondie, pour- qu’ils puiffent être l’ouvrage d’un
homme feul. Caufe de l’extrême difette où nous (ommes
de bons livres élémentaires, 8c de la foule de mauvais dont
nous Tommes inondés. Les maîtres de l’art qui feuls pourraient
travailler avec fuccès en ce genre , & qui dédaignent de le
faire, devraient fentir combien cette manière de penfer eft
nuifiblc au progrès & à la gloire des fciences. Les élémens
d'une fcience ne peuvent être l’ouvrage que d’une main fort
habile & fort exercée, lbid. b. Des élémens bien faits mettraient
les bons efprits fur la voie des découvertes à faire, & chacun
plus à portée de diftinguer Jes vraies découvertes, d’avec les
fauffes. lbid. 497. a.
Des élémens de Mathématiques 6* de Phyfique en particulier.
Premier ouvrage de cette efpcce, celui de Hérigonc, publié
en 1664. Contenu de cet ouvrage : ce qu’il a de remarquable.
Divers auteurs qui, depuis Hérigone, ont expliqué
les élémens de différentes parties de mathématiques : Schot,
Moore, Dechales, Ozannam, Wolf ; éloge de Ion ouvrage ;
éditions qui en ont été publiées. Editions & commentaires
des élémens d’Euclidc. V. 497. a. Quelques auteurs ont réduit
en fyllogifmcs toutes les dèmonftrations d’Euclide. Auteurs
qui ont publié le fond de fa doflrine fuivant de nouvelles
méthodes. Jugement porté fur la géométrie de M. Clairault.
Inftitutions de géométrie, imprimées à Paris en 1746, chez
Debure l’aîné : éloge de cet ouvrage. Obfervation fur les
élémens d’algebrc de M. Clairault. Quels font les meilleurs
élémens de phyfique. lbid. b.
Elémens des fciences. Faute à corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. II. 784. b.
Elémens, continuation de la lifte des auteurs qui ont
donné des élémens de géométrie. VII. 633. b.
E lémen s , (Géom. tranfe.) parties infinimenr petites ou
différentielles d’une courbe , d’une furface ou d’un folide.
Exemple. V. 497. b.
E lem e n s , ( AJlron.) principaux réfultats des obfervationa
aftronomiques, 8c généralement tous les nombres cffentiels
employés par les aftronomcs à la conftruflion des tables du
mouvement des planetes. Elémens de la théorie du foleil 8c
de la lune. V. 497. b.
E lém e n s , ( Phyfiq. ) parties primitives des corps. L’opinion
des anciens qui admettoient quatre élémens, quoiqu’a-
bandonnêe, n'étoit pas fi déraifonnable. Quels font les trois
élémens de Defcartes. Sentiment des philofophes fages fur
la doflrine des élémens. V. 498. a. Voye{ C o r p u s c u l e s
8c P r in c ip e s .
Elémens ou principes, doârine d’Ariftote fur ce fujet. I.
6<ç. a. Celle des Stoïciens, XV. 529. a. des épicuriens, V.
780. b. des Gaffendiftcs, voye^ ce. mot. De Defcartes. II.
722. b.Des Chymiftes. III. 4x8. b. Dureté des élémens, des
corps. III. 606. a. IV. 261. a. Difficulté de connoître les
élémens de la matière. IV. 270. b. X. 189. b. Phiole des
quatre élémens. XII. 317. a , b. — Philofophes qui ont cru
que chaque élément eft rempli d’un certain nombre d’ef-
prits. XV. 448. d. Sur les élémens. voyeç auffi A tom e ,
Atom ism e.
E lém e n t , (Médec.) V. 498. a.
ÉLÉMENTAIRE, (Philojoph.) ce que les anciensappel-
ioient région élémentaire, peuple élémentaire, fcience élémentaire.
V. 498. a.
Elémentaire. Des livres élémentaires. IX. 603. b. 608. b.
Voyez Elémens d es s c ie n c e s .
ÉlEMI, (Hifi. nat. des drogues) forte de réfine. On en
diftingue deux fortes, le vrai élémi ou celui d’Ethiopie 8c
de l’Arabie heureufe, fa defeription ; l’élémi d’Amérique ,
V. 498. ¿.fa defeription. Contrées d’où il nous vient. Arbre
qui le fournit. Fraudes que les marchands commettent dans
je commerce de cette réfine. lbid. b.
Elémi, arbre qui fournit la réfine élémi d’Amérique. VIII.
487. a.
E lém i réfine, ( Mat. médic. ) elle eft plus connue dans les
boutiques fous le nom de gomme. Elle entre dans plufieurs
préparations, officinales externes. Analyfe de la réfine élémi.
Ses propriétés dans les applications extérieures. Préparations
.dans lesquelles elle entre. V. 498. b.
ELENCHl ignoratio, efpece de fophifme. XV. 263. a.
ELEOMELI, ( Pharm. ) efpece d’huile, &c. Effet 8c propriété
de cette.. huile. V. 498. b.
ELEO-SACCHARUM, ÇChym.Pharm. ) toute huile effen-
tielle combinée avec- du fucre. C ’eft un moyen pour rendre
les huiles propres à fe mêler avec de l’eau. Manière de faire
.cet eleo-iaccharum. V. 498. b. Ufage que les Italiens font
de ce moyen pour donner à leurs fleurs artificielles la
.même odeur q uW les fleurs .naturelles. Comment fe font
"l’eleo-faccharum carminativum, 8c celui de faffafras. lbid.
499- 2-
ÉLÉPHANT, ( mft. nat. ) Cet animal femble être mal
proportionné ,6c mal deffiné, l’habit dont il eft couvert eft
encore plus mal taillé & plus mal fait. Le roi île Ponogal
envoya en 1668 au roi de France un èltphanr du royaume
de Congo, age de 17 ans, &c. 11 vécut 13 ans dans la
ménagerie de Verfailles, 8c ne grandit que d’un pié. Il n’a-
voit que fept piés 8c demi de hauteur lorfqu’on en fit la
defeription, qui fe trouve ici rapportée dans un très-grand
détail. V. 499. a. Les éléphans le trouvent en Afic 8c en
Afrique. Ceux de l’Afie font les plus grands. Poids extraordinaire
des défenfes de quelques éléphans. lbid. b. Mcfure
des éléphans d’Afrique; celle des plus grands de l’iflc de
Ceylan. Ce que les auteurs rapportent iur les éléphans de
cette idc. Couleur des éléphans. Uiàges que cet animal
fait de fa trompe. lbid. 500. a. On l’apprivoiie fort aifément
8c on le foumet à plufieurs. exercices différens. Maniéré
dont on le conduit. On s’en fert de monture , mais elle
eft fort incommode. Defeription des tours qu’on fait porter
aux éléphans. Pour les voyages des femmes de qualité
8c des grands feigneurs, les éléphans ont des pavillons richement
ornés. Quelle eft .la charge des plus forts éléphans.
Diligence de leur marche. Comment on peut éviter cet’
animal lorfqu’on en cft-pourfuivi. Maniéré de le charger.
Les éléphans fe couchent toutes les nuits, excepté en voyage.
Qualité 8c quantité de la nourriture qu’ils confomment
par jour. Ils ne s’irritent que lorfqu’on les offenfe. Effets de
leur fureur. lbid. b. Comment on les arrête. Cet animal eft
expofé aux infultes des plus vils infefles. Il a befoin de fe
baigner fouvent. Ses ennemis les plus redoutables. Les nègres
vendent fes défenfes 8c mangent fa chair. Diverfes obfervation
s concernant l’accouplemertt de ces animaux, leur portée
, l’éducation de leurs petits, 6v. De la durée de leur
vie. On a mis l’éléphant au rang des animaux fiffipedes.
Defeription de leurs piés. Diverfes opinions fur les aéfèn-
fes de l’éléphant. Ce que l’amour au merveilleux a fait
débiter fur les qualités morales de cet animal. lbid. 501. a.
Prix attaché à l’éléphant blanc. Différentes maniérés de prendre
8c d’apprivoifor les éléphans. lbid. b. Ouvrages à con-
fulter fur cette matière, lbid. 502. a.
Eléphant y des dents 8c défenfes de l’éléphant. IV. 839. a ,
b. Maniéré dont il prend fa nourriture: ftruflure 8cufage
de fa trompe. lbid. b. E(pecc de bananier dont il aime beaucoup
le fruit. Suppl. 1. 780. a. Infeâes qui font fouvent périr
les éléphans. VIII. 792. b. Situation des mammelles de la
femelle de l’éléphant. X. 5. a. Eléphans dreffés à danfer fur
la corde. XIV. 769* b. Eloge de l’éléphant. XVII. 728. a.
Caufe du rcfpcct que quelques peuples d’Afie ont pour les
éléphans blancs, itl. 3. b. Noms des officiers chez les anciens
Grecs qui commandoient à des éléphans. XVI. 265. é.-
Condiiélèûrs d’éléphans. IV. 244. a. Dents d’éléphans qui
fe trouvent en Sibérie. IX. 63. a , b. 64. a.
E l é p h a n t , (Mat. médic. ) il n’y a que les dents de cet
animal qui foient en uiàge. V. 502. a.
E lép h an s^ Ç//?/?. anc.) de l’ufage que divers peuples
orientaux ont fait de ces animaux dans les combats. Comment
ceux qui en étoient attaqués apprirent à leur réfifter.
Défaite des Romains par les éléphans de Pyrrhus. Divers
ufages que ce peuple en fit. dans la fuite. Noms donnés à
ceux qui commandoient les éléphans. V. 502. b. — Voye^
T h é r a r q u e .
E l é p h a n t , ( Myth. Médàïll.) diverfesfignifications des figures
d’éléphans fur les médailles. Auteurs à confulter. V. 502. b.
Eléphant, figure fymbolique. XV. 732. b.
E l é p h a n t , ( Blafon ) meuble d’armoirie. Signification
de ce fymbole. Suppl. II. 784. b.
Eléphant, ordre militaire que confèrent les rois de Dane-
marck. Pourquoi on l’appelle ordre de l ’éléphant. V. 502. b.
Voyez O r d r e .
É l é p h a n t , ( l'lfle del"\ fur la côte du Malabar. Origine de
ce nom donné à cette ifle. Diverfes figures qu’on y voit
taillées dans le roc. V. 503. a. Voyeç I s le .
Eléphant, efpece de poiffon. XII. 481. a.
ELÉPHANTIASE, {Médec.) ou Upre. Lcpre des Grecs.
Leprc des Arabes. Defeription de cette cruelle maladie.
Pourquoi on .l’a nommée éléphantiafe. Raifon des autres
noms qu’on lui a donnés, (avoir ceux de Jdtyryafmum.y
Uontiafis, mal de S. Lazare. Comment les (ymptômes de
cette maladie naiffent par degrés Quels font ces principaux
(ymptômes. V. 503. a. Cette maladie eft des plus
contagieules. C’eft mal-à-propos qu’on a voulu confondre
l’éléphantiafe avec la vérole. lbid. b. L’éléphantiafe eft endémique
en Syrie8c en Egypte,il eft abfolument étranger en
Europe. Lucrèce fait entendre qu’il étoit particulier à l’Egypte.
Cette maladie a toujours été plus commune dans les
pays chauds. Ce qui regarde les caufes, le prognoftic & la
curation de cette maladie, fe trouveà l’article Leprc A utre maladie
appellée éléphantiafe par les médecins Arabes, lbid. 504. a.
ELEPHANTIN, ( Hijl. ) livres appellés éléphantins chez
les Romains: regiftres qu’ils contenoient. On les renouvcl-
loit tous les cinq ans ,&on les gardoit dans le tréfor public.
Pourquoi ils furent appellés éléphantins. V. 504. a.