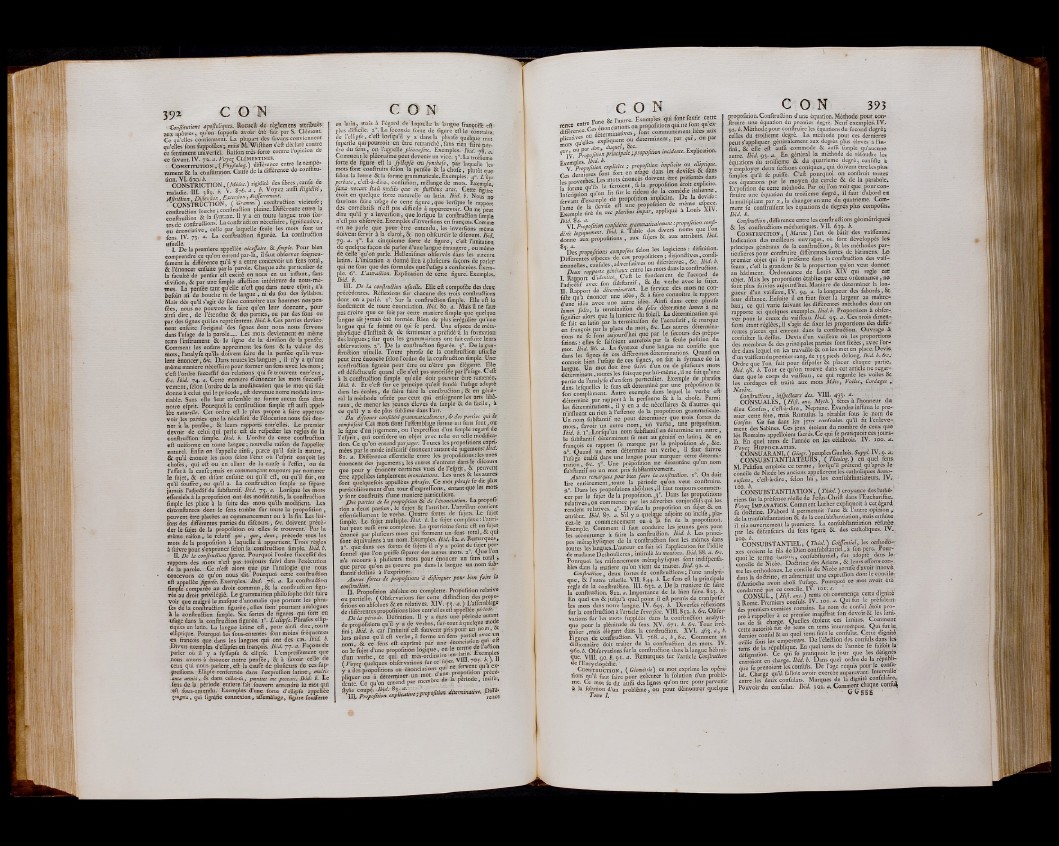
39a € ON ; ■&,„]Mutions apo'ftoliques. Recueil de règlem’ens attribués
aux apôtres» qu’on luppofe avoir été fait par S. Clément.
Ce qu’elles contiennent. La plupart des favans conviennent
qu’elles font fuppofées ; -mais M. Wifthon s’eft déclaré contre
ce fentiment univerfel. Raifon très-forte contre l’opnuon de
•ce favant.1V. 72. a. Voyez Clémentines.
: C o n s t i t u t i o n '., ( Phyftolog. ) différence entre le temp-
rament 8c la conflàtution. Caufe de la différence de
n° c c S s r a i c n o N , (mîjcc.) S Ê jÈ
maladie. III. 389. b. V. 876. a i. Voyez au<CiR.gtd,u.
m & m m m fâ OE Ê OE B Ë S î g m ■
conftruffion louche ; conftrùiiion pleine. Différence entre la
conitruflion & la fymaxe. II y a en tonte langue trois for-
tes de conftruftions. La conftruftion neceflaire, figmhcattve,
ou énonciative, celle pat-laquelle feule les mots font un
I fens. IV. 73* Æ ^ conftruftion figurée. La conftrucuon
UÎj elDe la première appellée néceffaire 8c fimple. Pour bien
comprendre ce qu’on entend par-là, il faut obferver foigneu-
fement la différence qu’il y a entre concevoir un fens total,
& l’énoncer enfuite par la parole. Chaque afte particulier de
la faculté de penfer eft excité en nous en un inftant, fans
•divifion, 8c par une fimple affeftion intérieure de nous-me-
*nes. La penfée tant qu’elle n’eft que dans notre efprit, n’a
befoin ni de bouche ni de langue , ni du fon des fyllabes.
Mais dès qu’il s’agit de' faire connoître aux hommes nospen-
fées, nous ne pouvons le faire qu’en leur donnant, pour
ainfi dire, de l’étendue 8c des parties, ou par des fons ou
par des lignes qui les repréfentent. Ibid. b. Ces parties deviennent
enfuite l’original des fignes dont nous nous fervons
dam l’ufage de la parole Les mots deviennent en même
tems l’inltrument 8c- le figne de la divifion de la penfée.
Comment les enfans apprennent les fons 8c la valeur des
mots, l’analyfe qu’ils doivent faire de la penfée qu’ils veulent
énoncer, &c. Dans toutes les langues , il n’y a qu’une
même maniéré néceffaire pour former un fens avec les mots ;
c’eft l’ordre fucceflif des relations qui fe trouvent entr’eux,
&c. Ibid. 74. a. Cette maniéré d’énoncer les mots fuccefii-
vcment,félon l’ordre de la modificadon que le mot-qui fuit
donne à celui qui le précédé, eft devenue notre modèle invariable.
Sans elle leur enfemble ne forme aucun fens dans
notre efprit. Pourquoi la conftruftion fimple eft aufli appel-
lée naturelle. Cet ordre eft le plus propre à faire appercer
voir lés parties que la néceffité *de [’élocution nous fait donner
à la~penfée, 8c leurs rapports entr’elles. Le premier
devoir de celui qui parle eft de refpefter les réglés de la
conftruftion fimple. Ibid. b. L’ordre de cette conftruftion
eft uniforme en toute langue ; nouvelle raifon de l’appeller
naturel. Enfin on l’appelle ainfi, parce qu’il fuit la nature >
& qu’il énonce lés mots félon l’état où l’eiprit conçoit les
chofes, qui eft ou en allant de la caufe à l’effet, ou de
l’effet à la. caufe; mais en commençant toujours par nommer
le fujet, 8c en difant enfuite ou qu’il eft, ou qu’il fait, oti
qu’il fouffre, ou qu’il a. La conftruftion fimple ne fépare
jamais l’adjeftif.du fubilanrif. Ibid. 7c. a. Lorfque les mots
eflentiels à la propofidon ont des modificadfs, la conftruftion
fimple les place à la fuite des mots qii’ils modifient. Les
circonftances dont le féns tombe fur toute la propofidon,
peuvent être placées au commencement ou à la fin. Les liai-
fons des différentes parties du difeours, 6>c. doivent précéder
le fujet de la propofidon où elles fe trouvent.' Par la
même .raifon»'le relatif qui, que, dont, précédé tôüs les
mots delà propofidon à laquelle il appartient. Trois réglés
à fuivre pour s’exprimer félon la .conftruftion fimple. Ibid. b.
II. De la conftruilion figurée. Pourquoi l’ordre iuccêflif des
rapports des mots n’eft pas: totijours fuivi dans l’exécution
de la parole. Ce. n’eft alors que par l’analogie que nous
concevons ce qu’on nous dit. Pourquoi cette conftruftion
eft appellée figurée. Exemples. Ibid. 76. a. La conftruftion
fimple comparée au droit commun, 8c la conftruftion figurée
au droit privilégié. Le grammairien philbfophe doit faire
voir que malgré le mafque d’anomalie que portent les phra-
fes de la conftruftion figurée | elles' font pourtant analogues
ii la conftruftion fimple. Six fortes de figures qui font en
•uiàge dans la conftruftion figurée. i°. L ’ellipfe. Pnrafes elliptiques
en latin. La langue latine eft, pour ainfi j dire, toute
elliptique. Pourquoi les fous-eiitentes font moins fréquentes
en françois que dans les langues qui ont des cas. Ibid. b.
•Divers exemples d’ellipfes en. françois. Ibid. 77. a. Façons de
parler où il y a fyllepfe 8c ellipfe. L’empreflement que
nous avons à énoncer noire penfée, 8c à favoir. celle’ de
ceux qui nous: parlent, eft la caufe de plufieurs de ces fup-
prefltons. EUipie renfermée dans l’expreflion latine, multïs
ante a n n is8c dans celle-ci, poenitet me peccati. Ibid1’ bi Le
.fens de la. période’ entiere'faitfouvent entendre le mot qui
.çft fous-eiyendu. Exemples d’une forte d’dlipfe appellée
içugma, qui lignifie connexion, affemblage, figure foufferte
CON en latin, wais à l’égard de laqüêlle là laiigùé françoife çft
plus difficile. 20.'La fécondé forte de figure eft le contraire
de l’ellipfe, c’eft lorfqu’il y a dans la phrafe quelque mot
fuperflu qui pourrait en être retranché, fans rien faire perdre
du fens, on l’appelle pléonafmc. Exemples. Ibid. 78. a.
Comment le pléonalme peut devenir un vice. 30. La troifieme
forte de figure eft la fyllepfe ou fynthefe, par laquelle les’
mots font conftruits felón la penfée 8c la chofe, plutôt eue
felon ía lettre 8c la forme grammaticale. Exemples. 40. L’hy-
perbate, c’eft-à-dire, confufion, mélange de mots. Exemple,-
fixa vacant hali mediis qute in fluffibus aras. Cette figure
étoit en quelque forte naturelle au latin. Ibid. b. Nous ne
faurions mire ufage de cette figure,que lorfque le rapport
des corrélatifs n’eft pas difficile à appercevoir. On ne peut
dire qu’il y a inverfion, que lorfque la conftruftion fimple
n’eft pas obferyée. Exemples d’inverfions en françois. Comme
on ne parle que pour être entendu, les inverfions même
doivent fervir à la clarté , 8c non obfcurcir le difeours. Ibid.
79. a. 50. La cinquième forte de figure , c’eft l’imitation
de quelque façon de parler d’une langue étrangère, ou même
de celle qu’on parle. Hellenifmes obfervés dans les auteurs
latins. L’imitation a donné lieu à plufieurs façons de parler
qui ne font que des formules quel ufage a confacrées. Exemple.
6°. L’attraaion. Explication de cette figure. Exemples.
Ibid. b. - *
111. De la conftruaion ufuelle. Elle eft compofée des deux
précédentes. Réflexions fur chacune des trois conftruftions
dont on a parlé. i°. Sur la conftruftion fimple. Elle eft le
fondement de toute énonciation. Ibid. 80. a. Mais il ne faut
pas croire que ce foitpar cette maniere fimple que quelque
langue ait jamais été formée. Rien de plus irrégulier qu’une
langue qui fe forme ou qui fe perd. Une efpece de méta-
phyfique d’inftinft 8c de fentiment a préfidé’à la formation
des langues ; fur quoi les grammairiens ont fait enfuite leurs
obfervations. 20. De la conftruftion figurée. 30. De la fon-
ftruftion ufuelle. Toute phrafe de la conftruftion ufuelle
peut être énoncée félon l’ordre de la conftruftion fimple. Une
conftruftion figurée peut être ou n’être pas - élégante. Elle
eft dêfeftueufe quand elle n’eft pas autorifee par l’ufage. C’eft
à la conftruftion fimple qu’elle doit pouvoir être ramenée.
Ibid. b. Et c’eft fur ce principe qu’eft fondé l’ufage adopté
dans les écoles, de faire faire la conftruftion, 8c en général
la méthode ufitée par ceux qui enfeignent les arts libéraux
, de mener les jeunes éleves du fimple 8c du facile, à
ce qu’il y a de plus fublime dans l’arr. . ' . '
•' Du difeours confédéré grammaticalement des parties qui le
compofent Ces mots dont l’aflemblage forme un fens font, ou
le figne d’un jugement, ou l’expreflion d’un fimple regard de
l’e'fprit, qui confidere un objet avec telle ou telle modifica^
rion. Ce qu’on entend paxjuger. Toutes les propofitions exprimées
parle mode indicatif énoncent autant de jugemens.'i^.
81. a. Différence effentielle entre les propofitions r ies unes
énoncent des iugemens ; les autres n’entrent dans le difeours
que pour y énoncer certaines vues de l’efpQt, & peuvent
être appellées fiifiplement énonciations. Les unes 8c les autres
font quelquefois appellées phrafes. Ce mot phrafe fe dit plus
particulièrement d’un totir a’expreflions, entant que les mots
y font conftruits d’une maniere particulière. _ -
Des parties de la propofition 8c de Vénonciation. La proportion
a deux parties, le iujet 8ç l’attribut. L’attribut contient
effentiellement le verbe. Quatre fortes de fujets. Le fujet
fimple. Le'fujet multiple. Ibid. b. Le fujet complexe : 1 attribut
peut aufli être complexe. La quatrième forte eft un fujet
énoncé par plufieurs mots qui forment un fens total, 8c qui
font équivalens à un nom. Exemples. Ibid. 82. a. Remarques ,
i°. que dans ces fortes de fujets il n’y a point de fujet per-
fonnel que l’on puifle féparer des autres mots. 20. Que l’on
n’a recours à plufieurs mots pour énoncer un fens total ,
que parce qu’on ne trouve pas dans la langue un nom fub-
ftantifdeftiné à l’exprimer. .. V - Y
Autres fortes de propofitions à diftmguer pour bien faire ta
conflruaion. . . -
II. Propofition abfolue ou complette. Propofition relative
ou partielle. ( Obfervations fur cette diftinftion des propo-
fitions en abfolues 8cen relatives. XIV. 53- *•) L’aflemblage
de différentes propofitions liées entr’elles eft appellkp période.
Delà période. Définition. Il y a dans une période autant
de propofitions qu’il y a de verbes, fur-tout à quelque mode
fini; Ibid. b. car l’infinitif eft fouvent pris pour un nom, oc
lors même qu’il eft verbe, il forme un fens partiel- avec un
nom, 8c ce fins eft exprimé par une- éjionc'atton qui
ou le fiijet.d’une propofidon logique, ou le terme
tllun; verte, ce qui. eft irés-ordinaire en Jan . «P1»
y a des propofitions ou propofition précépltquer
bu a détermmer uu mot d P ^
dente. Ce qu on entend par mémo
C O N
Pune 8c l’autre. Exemples qui font fentir cette
rençe entre 1 énonciatioiis ou propofitions qui ne font qu exdifférence.^
term-inatiVes, font communement.liées aux
ploe qu’eUes expliquent ou déterminent, par çw,.ou par
^rTpwpofion ^¡iaUifropofimn inddM'. Explication. I W<K& H r J'dernières font fort en ufage dans les devtfes & dhns
£ „rovMbes Les mots énoncés doivent être prefentés dans
la ibrme qu’ils le feroient, fi la propofidon étoit explicite.
f ï f t n flu’on lit fur le rideau de la comédie italienne,
firvant d’exemple de propofidon implicite. De la devifi: :
l’ame de la devifi eft une propofmon de même efpece.
Exemple tiré du ntc plunbus impar, appliqué a Louis XIV.
* VI PrÔpoMcn confiirU¡rammamaUmnt :propofition confi-
k I L L sÊ Ê Ibid. b. Table des tbvers noms que I on
donne a2x propofidons , aux fu)ets 8e aux atttdams. Ibid.
^^¿)es propofitions compofics filon les logiciens ; définidon.
Différentes éfpeces de ces propofidons ; a.sjonatves eondt-
donnelles. caufales, adverfadves ou dtfcretives, d-e. Ibid. b.
d L rappom giniraux entre les mots dans la conftrua.on.
I FUpport d'idren«!.. C’eft le fondement de laeeotd de
l ' a S f avec fin fibftantif, 8e du verbe avec le fujet;
II Rapport de détermination. Le -fervice des moK ne con-
fifte qu’à énoncer une idée, .& à fmre connoître le rapport
d’une idée avec une autre idée. Ainfi dans cette phrafe
lumen folis. la terminaifon de folts détermine lumen à ne
fignifier alors que la lumière du foleil. La detemnnanon qui
fe feit en latin par la terminaifon de l accufatif, fe marque
en françois par la place du mot, &c. Les autres détermma-
tions ne feïont aujourd’hui que par le fecours des prépo-
fitions: elles fe faifoient autrefois par la feule poimon du
mot Ibid. 86. a. La fyntaxe d’une langue ne confifte que
dans les fignes de ces différentes déterminations. Quand on
connoît bien l’ufage de ces fignes , on fait la fyntaxe de la
langue Un mot doit être fuivi d’un ou de plufieurs mots
déterminans, toutes les foisque par lui-même, il ne fait qu une
partie de l’analyfe d’un fens particulier. Exemple de phrafes
fens lefquelles le fens eft déterminé par une prépofmon 8c
fon complément. Autre exemple dans lequel le verbe eftr
déterminé par rapport à la perfonne 8c a la chofe. Parmi
les déterminations, il y en a de néceflatres 8c d autres qui
n’influent en rien à Feffence de la propofition grammaticale.
Un nom fubftantif ne peut déterminer que trois fortes de
mots, favoir un autre nom, un verbe, une prépofmon.
Ibid. b. i<>.,Lorfqu’un nom fubftantif en détermineun autre,
le fubftantif déterminant fe met au génitif en latin ; 8c en
françois ce rapport fe marque par la prépofition de, 8cc.
a° Quand un nom détermine un verbe, il faut fuivre
l’ufage établi dans une langue pour marquer cette détermination,
6-c. 30. Une prépofmon ne déternune quunnom
fubftantif ou un mot pris fubftantivement. •
Autres remarques pour bien faire la conftruaion. i°. On doit
lire entièrement .toute la période qnon veut conftruire.
a°. Dans les propofitions abfolues,il faut toujours commencer
par le fujet de la propofmon. .3°. Dans les propofitions
relatives,on commence par les adverbes conjonftifsqui les
rendent relatives. 40. Divifez la propofition en fujet 8c en
attribut. Ibid. 87. a. S’il y a quelque adjoint ou incife , placez
le au commencement ou • à Ta fin de la propofition.
Exemple. Comment il faut conduire les jeunes gens pour-
les accoutumer à faire la conftruftion. Ibid. b. Les principes
métaphyfiques de la -conftruftion font les mêmes dans
toutes lés langues.L’auteur en fait ici l’application fur 1 îdille
de madame Deshoulieres, intitulé les moutons. Ibid. W. a. &c.
Pourquoi les raifonnemens métaphyfiques font indifpenfa-
bles dans la matière qu’on vient ae traiter. Ibid. 92. a.
Conftruaion, deux fortes de conftruftions ; 1 une analytique,
8c l’autre ufuelle. VII. 844. b. Le fens eft la principale
réglé de la conftruftion. III. 63 2. a. De la maniéré de faire
la conftruftion. 822. a. Importance de la bien faire. 823. b.
En quel cas 8c jufqu’à quel point il eft permis de tranfpofer
les mots dans notre langue. IV. 695. b. Diverfes réflexions
fur la conftruftion à l’article Inverfion. VIII. 852 .b. &c, Obfervations
fur les mots fuppléès dans la conftruftion analytique
pour la plénitude du fens. XV. 671. b. &c. Tour irrèfulier
,mais élégant dans la conftruftion. XVI. 463. a, b.
'igures .de conftruftion. VL 768. a, b, &c. Comment un
diftionnàire doit traiter de la conftruftion des mots. IV.
960. b. Obfervations fur la conftruftion dans la langue hébraïque.
VIII. 90. b. 91. a. Remarques fur l’article Conftruaion
de l'Encyclopédie. ‘ . ... ...
C o n s t r u c t i o n , ( Géométrie) ce mot exprime les opérations'
qu’il faut faire pour exécuter la folution d’un problème.
Ce mot fe dit aufli des lignes qu’on tire pour parvenir
à la folution d’un problème, ou pour démontrer quelque
Tome I,
C O N 393
propofition.Conftruftion d’urie équation.Méthodé pouf.conftruire
une équation du premier degré. Neuf exemples. IV*
92. b. Méthode pour conftruire les équations du fécond degré;
celles du troifieme degré. La méthode pour ces derniere9
peut s’appliquer généralement aux degrés plus élevés à l’infini,
8c elle eft aufli commode 8c aufli fimple qu’aucune
autre. Ibid. 93. a. En général la.méthode de réfoudre les
équations du troifieme 8c du quatrième degré, confifte à
y employer deux feftions coniques, qui doivent être les plus
fimples qu’il fe puiffe. C’eft pourquoi on conftruit toutes
ces équations par le moyen du cercle 8c de la parabole.
Expofition de cette méthode. Par ou l’on voit que. pour conftruire
une équation du troifieme degré, il faut d abord en
îamultipliant par * , la changer en une dit quatrième. Comment
fe conftruifent les équations de degrés plus compofês.
Ibid. b. . . :
Conftruaion, différence entre les conftruftions géométriques
8c les conftruftions méchaniques. VII. 639. b.
C o n s t r u c t io n , (Marine) l’art de bâtir des vaifleanx»
Indication des meilleurs ouvrages , où font développés les
principes généraux de la conftruftion, 8c les méthodes particulières
pour conftruire différentes.fortes de bâtimens. Le
premier objet qui fe préfente dans la. conftruftion des vaif-
feaux, c’eft la grandeur 8c la proportion qu’on veut donnée
au bâtiment. Ordonnance de Louis XIV qui regle cet
objet. Mais les proportions établies par cette ordonnance, ne
font plus fuivies aujourd’hui. Maniéré de déterminer la longueur
d’un vaifleau, IV. 94- a' la longueur des fabortk, 8c
éur diftance. Enfuite il en faut fixer la largeur au maître-
bau; ce qui varie fuivant les différentes méthodes dont on
rapporte ici quelques exemples. Ibid. b. Proportions^ à obfer-
ver pour le creux du vaifleau. Ibid. 95. a. Ces trois dimen-
fions étant réglées , il s’agit de fixer les proportions des différentes
pièces qui entrent dans la conftruftion. Ouvrage à.
confiilter là-deflùs. Devis d’un vaifleau où les proportions
des membres 8c des principales parties font fixées , avec^Tordre
dans lequel on les travaille 8c on les met en place. Deviô,
d’un vaifleau du premier rang, de 15 5 pieds de long. Ibid. b. &c.-
Ordre que l’on fuit pour cfifpofer 8c placer chaque partie.
Ibid. 98. b. Tout ce qu’on trouve dans cet article ne regardant
que le corps du vaifleau, ce qui regarde les voiles 8c
les cordages eft traité aux mots Mâts, Voiles, Cordages ,
Navire.
Conftruaions, infpeaeurs des. VIII. 493. a.
CONSUALES, ( Hift. anc. Mytk.) fêtes à l’honneur du
dieu Confus, c’eft-à-dire, Neptune. Evandreinftitua le premier
cette fête, mais Romulus la rétablit fous le nom de
Confus. Ce fut dans les jeux confuales qu’il fit l’enleve-;
ment des Sabines. Ces j.eux étoient du nombre de ceux que
lès Romains appelloient facrés. Ce qui fe pratiquât ces jours-
là. En quel tems de l’année on les célébroit. IV. 100. a.
Voyez H lP PO C R AT IE S .
CONSUARANI, ÇGéogr.)meuples Gaulois. Suppl. IV. 9. a:
CQNSUBSTÀNTIATEURS, .( Théolog. ) en quel fens
M. Peliffon emploie ce terme, lorfqu’il prétend qu’après le
concile de Nicèé les anciens appellerent les catholiques homo-
oufiens, c’eft-à-dire , félon lu i, les confubftantiateurs. IV.
IOCONSUBSTANTIATION, (Théol. ) croyance des luthériens
fur laprèfence réelle de Jeius-Chrift dans l’Euchariftie.,
Voyez Impanation. Comment Luther expliquoit à cet égard
fa doftrine. D’abord il permettoit l’une 8c l’autre opinion jg
de la tranfubftantiation 8c de la confobftanriation, mais enfuite.
il nia ouvertement là première. La confubftantiation réfutée
par lès déferifeurs du fens figuré 8c des catholiques. IV.
IOCONSUBSTANTIEL, ( Théol.) Coèjfentiel, les orthodoxes
croient -le fils de Dieu confubftantiel , à fon pere. Pourquoi
le terme confubftantiel, fut- adopté dans leconcile
de Nicée. Doftrine des Ariens, 8c leurs efforts con-,
tre les orthodoxes. Le ¿oncile de Nicée accufe d avoir mnovè,
dans la doftrine, en admettant une expreflion dont le Çgnejl|j
d’Antioche avoit aboli l’ufage. Pourquoi ce mot avoit été
condamné par ce concile. IV. 101: a.
CONSUL, (Hift. anc.) tems ou commença cette dignité
à Rome. Premiers confuls. IV. 101. e. Qui fut le préffdent
des premiers comices romains. Le nom de eonfulètoit pro-
orearappeller à ce premier magiftrat fon devoir8c les limi-,
tes de W charge. Quelles étoient ces limites. Comment
cette autorité (ut de tems eu tems interrompue. Qui fur ie,
dernier conful 8c eii quel tems finit le confulat. Cette dignité
avilie fous les empereurs. De l’êleftion des confuls dans les
tems dé la république. En quel tems de l’année fe faifoitla
défignation. Ce qui fe pratiquoit le jour que les défignés
entroient en charge. Ibid. b. Dans quel ordre de la république
fe prenoieht les confuls. De l’âge requis pour le conlu-
lat. Charge qu’il falloit avoir exercée auparavant. Intervalle
entre lés deux confulats. Marques de la dignité conlulaire.
Pouvoir du confulat.- Ibid, 102. a. Comment chaque conlu^
G Q g g g •