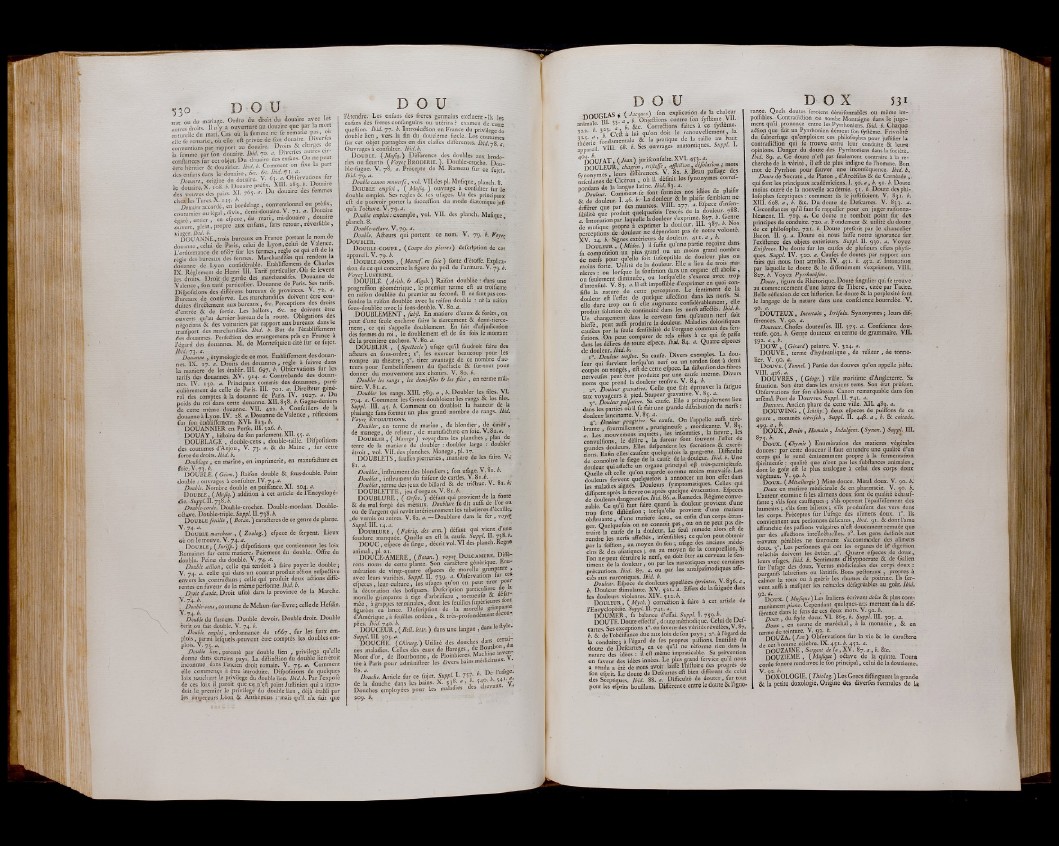
■530-. D O U
«rat on du mariage. Ordre du droit du douaire avec lés
autres droits. Il n’y a ouverture au douaire que par la mort
naturelle du mari. Cas où la femme ne fe remarie pas, ou
elle fe remarie, où elle cft privée de fan douaire. Uiverles
conventions par rapport au douaire. Droits Si charges ae
la femme par fon douaire. ibid. 70. a. f e r t f g f e & g ^ lg t ,
confiances fur cet objet. Du douaire des en fans. p
être héritier & douairier. Ibid. k- Comment on fixe la part
des enfans dans le douaire, ^ . 7 *- 5’ ■ ,
Douaire, origine du douaire. V.
le douaire. X. 108. -b. Douaire préfix. XIII. 183. b. Douare
des veuves des pairs. XI 7«! Du doua,re d“ fcmn,eS
d’3 o « ^ " c cSoïdé!eu' bordelage , conventionnel ou préfix,
c o u rum ie r ou légal, divis, demi-douaue. V . 71. u. Douaire
égaré entier , en efpece, du mari, mt-douaire , douaire
ouvert, plein,propre aux enfans, fans retour, reverüble,
viager. Ibid. b. . ,
DOUANNE, trois bureaux en France portant le nom de
douanne, cèjui de Paris, celui de Lyon,celui de Valence.
L’ordonnance de 1687 fur les fermes, rerie ce qui eft de a
régie des bureaux des fermes. Marchandnes qui rendent la
douanne de Lyon confidérable. Etabliffemens de Charles
IX. Règlement de Henri III. Tarif particulier. Ou fe lèvent
les droits. Droit de garde des marchandes. Douanne de
Valence, fon tarif particulier. Douanne de Paris. Ses tarifs.
Difpofuions des différens bureaux de provinces. V. 72. a.
Bureaux de conferve. Les marchandiles doivent être conduites
direaement aux bureaux, &e. Perceptions des droits
d’entrée & de fortie. Les ballots, &c. ne doivent être
ouverts qu’au dernier, bureau de la route. Obligations des
négocians & des voituriers par rapport aux bureaux dans le
tranfport des marchandifes. Ibid. b. But de 1 étabhflement
des douannes. Pèrfeâiôn des arrangemens pris en France à
l’égard des douannes. M. de Montefquieu cité fur ce fujet.
lbid:n\.a. j 1
Douanne , étymologie de ce mot. Etabhflement des douannes.
IX. 17. a. Droits des douannes, réglé a fuivre dans
la maniéré de les établir. 111. 697. b. Obfervations fur les
tarifs des douannes. XV. 914. a. Contrebande des douantes.
IV. 130. a. Principaux commis des douannes, particulièrement
de celle de Paris. III. 701. 4. Directeur général
des comptes à la douanne de Paris. IV. 1027. a. Du
poids du roi dans cette douanne. XII. 858. b. Gagne-demers
de cette même douanne. VU. 422. b. Confeifiers de la
douanne à Lyon. IV. 28. a. Douanne de Valence , réflexions
fur fon établiffement. XVI. 813. b,
DOÙANNIER en Perfe. III. 326. b.
DOUAY , hiiloire de fon parlement. XII. 35. a.
DOUBLAGE , double-cens, double-taille. Difpofuions
des coutumes d’Anjou, V. 73. a. 8c du Maine , fur cette
forte de droits. Ibid. b. • . n
Doublage , en marine, en imprimerie, en manufoéture en
foie.-y.73.é. , , _ .
DOUBLE. ( Géom.) Raifon double & fousdouble. Point
double ; ouvrages à confulter. IV. 74. a.
Double. Nombre double en puinance. XI. 204. a.
D o u b l e , (Mufiq.) addition à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 738. b. , _ « «
Double-corde. Double-crochet. Double-mordant. Double-
oétave. Double-triple. Suppl. II. 738. b.
D o u b l e feuille, ( Botan. ) carafteres de ce genre de plante.
V. 74. a. ■ -
D o u b l e marcheur, ( Zoolog.) efpece de ferpent. Lieux
où on le trouve. V. 74. a.
D o u b l e , ( Jurifp.) difpofuions que contiennent les loix
Romaines fur cette matière. Paiement du double. Offre du
double. Peine du double. V. 74. a.
Double aQion, celle qui tendoit à faire payer le double ;
V. 74. a. celle qui dans un contrat produit aétion refpeétive
envers les contraélans ; celle qui produit deux allions différentes
en faveur de la même perfonne. Ibid. b.
. Droit d’août. Droit ufité dans la province de la Marche.
V. 74. b.
Double-cens, coutume de Mebun-fur-Evre; celle de Hefdin.
Double du furcens. Double devoir. Double droit. Double
écrit pu fait double. V . 74. b.
Double emploi, ordonnance de 1667, fur les faux emplois
, parmi lefquels .peuvent être comptés les doubles emplois.
V. 75. a. - y
Double lien, parenté par double lien , privilège qu’elle
donne dans certains pays. La diftinélion du double lien étoit
inconnue dans l’ancien droit romain. V. 75. a. Comment
elle commença a être introduite. Difpofitions de quelques
loix touchant le privilège du double lien. Ibid.b. Par l’expofé
de ces loix il .paroît que ce n’eft point Juflinien qui a introduit
le, premier le privilège du double lien , déjà établi par
les empereurs Léon 8c Amliémijis ."mais qu’il n’a fait que
D O U
l’étendre. Les enfans des freres germains excluent - ils les
enfans des freres corifanguins ou utérins ? examen de. cette
queftion. Ibid. 77. b. IntroduéVion en France du privilège de
double lien, vers la fin du douzième fiecle. Les coutumes
fur cet objet partagées en dix claflès différentes. Ibid. 78. a.
Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Double. {Mufiq.) Différence des doubles aux broderies
ou fleurtis Broderie. ). Double-croche. Double
fugue. V. 78, a. Précepte de M. Rameau fur ce fujet.
Ibid. 79. a.
Double canon renverfè, vol. VII des pl. Mufique, planch. 8.
Double emploi, ( Mufiq.) ouvrage à confulter fur le
double emploi. Ses réglés & fes ufages. Un des principaux
eft de pouvoir porter la fucceiïion du mode diatonique juit
qu’à l’oâave. V. 79. a.
Double emploi : exemple, vol. VII. des planch. Mufique j
planch. 8.
Double-oSlave. V . 79. a.
Double. Aéteurs qui portent ce nom. V, 79. b. Koyeg
Doubler.
Double-coupe, {Coupe des pierres) defeription de cet
appareil. V. 79. b.
Double-rond , {Manuf. en foie ) forte d’étoffe. Explication
de ce qui concerne la figure du poil de l’armure. V . 79. b.
Foyer LUSTRINE.
DOUBLÉ. {Arith. & Algeb.) Raifon doublée : dans une
progreffion géométrique, le premier terme eft au troifieme
en raifon doublée du premier au fécond. Il ne faut pas confondre
la raifon doublée avec la raifon double : ni la raifon
fous-doublée avec la fous-double. V . 80. a.
DOUBLEMENT, fubfi. En matière d’eaux & forêts, on
peut d’une feule enchere faire le tiercement & demi-tierce-
ment, ce qui s’appelle doublement. En fait d’adjudication
des fermes du roi, le doublement eft de fix fois le montant
de la première enchere. V. 80. a.
DOUBLER , ( Spedacle ) ufage qu’il faudroit faire des
aéteurs en fous-ordre 3 i°. les exercer beaucoup pour les
rompre au théâtre ; 20. tirer avantage de ce nombre d’acteurs
pour l’embelliffement du fpeétacle & fur-tout pour
donner du mouvement aux choeurs. V. 80. b.
Doubler les rangs , les demi-files fi* les files , en terme militaire.
V. 81.
Doubler les rangs. XIII. 789* a » b. Doubler les files. VL'
794. a. Comment les Grecs doubloient les rangs 8c les files.
Suppl. III. 45. b. Comment on doubloit la hauteur de la
phalange fans former un plus grand nombre de rangs. Ibid.
Foye[ Évolutions. - _ ' r~
Doubler, en terme de marine , de blondier, de cirier ,
de manege, de relieur, de manufaéture en foie. V. Si.a.
Doubler , ( Manege ) voye[ dans les planches, plan de
terre de la maniéré de doubler : doubler large : doubler
■ étroit, vol. V 11. des planches. Manege, pl. 17. • j-
DOUBLETS, fauffespierreries, maniéré de les faire. V,'
$1, a. o l
Doublet, infiniment des blondiers ; fon ufage. V. 81. b.
Doublet, infiniment du faifeur de cardes. V . 81.b.
Doublet, terme des jeux de billard & de triétrac. V . 01. b.
DOUBLETTE, jeu d’orgues. V. 81. é. . .
DOUBLURE, ( Orfev. ) défaut qui provient de la fonte
& du mal forgé des métaux. Doublure le dit aufli de 1 or ou
ou de l’argent qui revêt intérieurement les tabatières d écaille,
.de vernis ou autres. V . 82. a. — Doublure dans le fer, voyei
Suppl. III. 14. a. . ., ' ’
D o u b l u r e , {Fabriq. des arm.) défaut qui vient dune
foudure manquée. Quelle en eft la eau ».Suppl. II. 73»-*•
DOUC, efpece de finge, décrit vol. VI des planch. Kegne
animal, pl 21. 'ii r ..a,
DOUCE-AMERE, {Botan.) voye^ D u l c a m e r e . D it tè -
rens noms de cette plante. Son caraétere générique, Ln
mération de vingt-quatre efoeces de morelle grimpante ,
avec leurs variétés. Suppl. II. 739- à Obfervations lur ces
efpeces , leur culture, les ufages qu’on en peuttirer pour
la décoration des bofquets. Defeription particulière
morelle grimpante à tige d’arbriffeau , tortueufe oc aem
mée, à grappes terminales, dont les feuilles fupérieurcs
figurées en lance. Defeription de la morelle Srin?P“”
d^Vmérique, à feuilles ondées , & t rè s -p ro fo n d ém en t aec
pées. Ibid. 740. b. , n i_ •
. DOUCEUR, ( Bell. Uttn ) dans une langue , dans le uy»-
^ S o U C iS [ “(chirurg.) Utilité des douches
nés maladies. Celles des eaux de Bareges, de ¡„ven-
Mont d’or, de Bourbonne, de Plombières. Ma ,)11? y
tée à Paris pour adminiftrer les divers bains médicinaux. 1
Douche. Article fur ce fujet. Suppl.L 737-
de la douche dans les bains. X. sM* a » , * ’ * x . V«
Douches employées pour les maladies des chev
209. b.
D O U
n O U G U S . (
animale. 33* g &c Cor^ ons faites à ce fyftêine.
322. b. 3 ^ qU’on doit le renouvellement, la
théorie * fondamentale & la pratique de la taille ait haut
appareil. VIII. 68. b. Ses ouvrages anatomiques. Suppl. 1.
4°DOUJAT, {Jean) jurifconfulte.XVI. 453. a.
DOULEUR, chagrin, trijlejfe, affliBion,defolaJion ; mots
fvnonymes, leurs différences. V. 82. é. Beau paffage des
tulculanes de Cicéron , où il défmit les fynonymes corref-
pondans de la langue latine. Ibid. 83. u. . . •
DouUur. Comment-fe font formées nos idées de plaifir
& de douleur. I. 46. b.- La douleur & le plaifir femblent ne
différer que par des nuances. VIII. 277. a. Efpece dmfen-
fibilité que produit quelquefois 1 exces de la douleur. 788.
a. Intonation par laquelle la douleur s’exprime. 8 1 7 - Genre
de mufique propre à exprimer la douleur. III. 387. b. Nos
perceptions de . douleur ne dépendent pas de notre volonté.
XV 24. b. Signes extérieurs de douleur. 411. a
D o u l e u r , {Midec.) il fuffir qu’une partie reçoive dans
fe compofition un plus grand ou un moins grand nombre
de nerfs pour qu’elle foit fufcepuble de douleur plus ou
moins forte. Utilité de la douleur. Elle a lieu de trois maniérés
: ou lorfque la fenfation dans un organe eft abolie ,
ou feuiement diminuée, ou lorfqu’elle s’exerce avec trop
d’intenfité. V. 83. a. 11 eft impoffible d’exprimer en quoi con-
fifte la nature de cette perception. Le fentiment de la
douleur eft l’effet de quelque affeélion dans les nerfs. î»i
elle dure trop ou fi elle augmente confidérablement , elle
produit folution de continuité dans les nerfs affeélés. Ibid. b.
Un changement dans le cerveau lans qu aucun nerf foit
bleffé, peut aiîifi produire la douleur. Maladies dolorifiques
caufées par la feule fenfibilité de l’organe commun des fen-
farions. On peut comparer de tels effets à ce qui fe paffe
dans les délires de toute efpece. Ibid. 84. a. Quatre efpeces
de douleur. Ibid. b. B • ,
i°. Douleur tenfive. Sa caufe. Divers exemples. Iæ douleur
qui furvient lorfqu’un nerf ou un tendon font a demi
coupés ou rongés, eft de cette efpece. La diftenfiondes fibres
nerveufes peut être produite par une caufe interne. Divers
noms que prend la douleur tenfive. V. 84. b.
2,0, Douleur gravative. CeUe que fait éprouver la fatigue
aux voyageurs à pied. Stupeur gravative.V. 85. a.
o*. DouUur pullative. Sa caufe. Elle a pnncipalement lieu
dans les parties ou Ü fe fait une grande diftribution de nerfs :
douleur, lancinante. V.85. a. h H h _ , ,
4®. Douleur pongitive. Sa caufe. On 1 appelle aufli téré-
brante , fourmillement, prurigineufe , mordicante. V. 8ç.
a. Les mouvemens inquiets, les infommes, la fievre, les
convulfions, le délire , la fureur font fouvent 1 effet de
grandes douleurs. Elles fufpendent les fecrétions &.«cré-
tions. Enfin eües caufent quelquefois la gangrene. Difficulté
de connoître le fiege de la caufe de la douleur. Ibid. AUne
douleur qui affeUe un organe principal eft tres-pernicifeule.
Ouelle ell celle qu’on regarde comme moins mauvaile. Les
douleurs fervent quelquefois à annoncer un bon effet dans
les maladies aiguës. Douleurs fymptomatiques. Celles qui
diflipent après la fievre ou après quelque évacuation. Efpeces
de douleurs dangereufes. Ibid. 86. u. Remedes. Régime convenable.
Ce qu’il faut faire quand la douleur provient dune
trop forte diftenfion; lorfqu’elle provient dune matière
obftruante, d’une matière âcre, ou enfin d un corps étranger.
Quelquefois on ne connoît pas, ou on ne peut pas détruire
la caufe de la douleur. Le feul remede alors eft de
xendre les nerfs affeftés, infenfibles ; ce quon peut obtenir
par la feftion, au moyen du feu ; ufage des anciens médecins
& des afiatiques ; ou au moyen de la compreflion. 5>i
l ’on ne peut détruire le nerf, on doit ôter au cerveau le len-
timent de la douleur , ou par les narcotiques avec certaines
.précautions. Ibid. 87. a. ou par les annfpaftnodiques affo-
ciès aux narcotiques. Ibid. b. . . . . . . r o t
Douleur. Efpece de douleurs appellees tpremus. V.8j6. a ,
b. Douleur ftimulante. XV. 521. a. Effets de lafaignée dans
les douleurs violentes. XIV. 5 1 2 _ •
D o u l e u r , {M y t h . ) correétion à faire à cet article de
l ’Encyclopédie. Suppl. II. 741. a.
DOUMER , fa balance d’effai. Suppl. I. 759. b.
DOUTE. Doute effeélif, doute méthodique. Celui de Def-
cartes. Ses exceptions t°. en faveur des vérités révélées, V. 87.
b. 8c de l’obéiffance due aux loix de fon pays ; 20. à l’égard de
k conduite; à l’égard de fes propres pallions. Inutilité du
doute de Defcartes„ en ce qu’il ne réforme rien dans la
nature des idées : il eft même impraticable. Sa prévention
en faveur des idées innées. Le plus grand fernee qu il nous
a rendu a été de nous avoir laiffé l’hiftoire des progrès de
fon efnrit. Le doute de Defcartes eft bien différent de celui
des Sceptiques. Ibid. 88. j Difficulté de douter, fur tout
pour les cfprits bouillans. Différence entre le doute 8c 1 igno-
D O X 5 3 1
ranee. Quels doutes feroient déraifonnables ou même i...
poflibles. ■ Contradiction .où tombe Montaigne dans le jugement
qu’il prononce entre les Pyrrhoniens. Ibid. b. Chaque
aélion que fait un Pyrrhonien dément fon iyftême. Frivolité
du fubrerfuge qu’emploient ces philofophcs pour juftifier la
contradiélion qui fe trouve entre leur conduite & leurs
opinions. Danger du doute des Pyrrhoniens dans la fociêté.
Ibid. 89. a. Ce doute n’eft pas feulement contraire à la recherche
de la vérité, il eft de plus indigne de l’homme. Bon
mot de Pyrrhon pour fauver une inconféquence. Ibid. b.
Doute de Socrate , de Platon , d’Arcéfilas & de Carnéade
qui font les principaux académiciens. I. 50. a , b. 51. b. Doute
moins outré de la nouvelle académie. 31. ¿..Doute des phi-,
lofophes feeptiques : comment ils le juftifioient. V. 831. b.
XIII. 608. 4 , b. &c. Du doute de Defcartes. V. 833. a.
Circonftances qu’il fout fe rappeller pour en juger railonna-
blement. II. 719. a. Ce doute ne tomboit point fur des
principes de conduite. 720. a. Fondement & utilité du doute.
de ce philofophe. 721. b. Doute preferit par le chancelier
Bacon. II. 9. a. Doute où nous laiffe notre ignorance fur
l’exiftence des objets extérieurs. Suppl. II. 930. a. Voyez
Exiftence. Du doute fur les caufes de plufieurs effets phyfi-
ques. Suppl. IV. 320. a. Caufes de doutes par rapport aux
faits qui nous font atteftés. IV. 451. b. 452. d. Intonation
par laquelle le doute .& le diffentiment s’expriment. VIII.
027. b.. Voyez Pyrrhonifme.
Doute, figure de Rhétorique. Douté fingulier qui fe trouve
au commencement d’une lettre de Tibere, citée par Tacite.
Belle réflexion-de cet hiftorien. Le doute & la perplexité font
le langage de la nature dans une confcience. bourrelée. V.
90. a.
DOUTEUX, Incertain , Irrèfolu. Synonymes ; leurs différences.
V. 90. a.
Douteux. Chofes douteufes. III. 373. a. Confcience dou-
•teufe. 902. b. Genre douteux en terme de grammaire. VII.
392. a , b.
D OW , {Gérard) peintre. V. 324. a.
DOUVE , terme d’hydraulique , de relieur , de tonnelier.
V. 90. a.
Douve. ( Tonnel. ) Partie des douves qu’on appelle jable.'
VIII. 426.4. •
DOUVRES , {Géogr.) ville maritime d’Angleterre. Sa
fituation. Son état dans les anciens tems. Son état préfent.
Obfervations fur fon château. Canon remarquable dans fon
arfénal. Port de Douvres. Suppl. II. 741. a.
Douvres. Ancien phare de cette ville. XII. 489. a.
DOUWING, ( Ichthy.) deux efpeces de poiffons de ce
genre , nommés citvifch , Suppl. II. 448. a , b. 8c coitade.
4 DOUX, Bénin , Humain , Indulgent. {Synon.) Suppl. III.
^Îjoux. ( Chymie ) Enumération des matières végétales
douces : par cette douceur il fout entendre une qualité d’un
corps qui le rend éminemment propre à la fermentation
fpiritueufe : qualité que n’ont pas les fubftances animales ,
dont le goût eft le plus analogue à celui des corps doux
végétaux. V. 90. b. 1 /
DO U X . {Métallurgie) Mine douce. Métal doux. V. 90. b:
Doux en matière médicinale 8c en pharmacie. V. 90. b.
L’auteur examine fi les alimens doux font de.qualité échauffante
; s’ils font cauftiques-; s’ils opèrent répaifîiffement des
humeurs ; s’ils font bilieux ; s’ils produifent des vers dans
les corps. Préceptes fur l’ufage des alimens doux. i°. Ils
conviennent aux perfonnes délicates, Ibid. 91. 8c dont l’ame
affranchie des pallions vulgaires n’eft doucement remuée que
par des affeftions intellectuelles. 20. Les gens dellinés aux
travaux pénibles ne fauroienr s’accommoder des alimens
doux. 30. Les perfonnes qui ont les organes de Id digellion
relâchés doivent les éviter. 40. Quatre efpeces .de doux,
leurs ufages. Ibid. b. Sentimens d’Hyppocrate 8c de Galien
fur l’ufage des doux. Vertus médicinales des corps doux :
purgatifs lubréfians ou lénitifs. Bons peéloraux , propres à
calmer la toux ou à guérir les rhumes de poitrine. Ils fervent
aufli à mafquer les refnedes défagréables au goût. Ibid.
9*boux. ( Mufique) Les Italiens écrivent doUe 8c plus communément
piano. Cependant quelques-ur.s mettent dala différence
dans le fens de ces deux mots. V . 92. b.
Doux , du ftyle doux. VI. 863. b. $uppl. III. 303. a.
Doux , en terme de maréchal, à la monnoie , 8c en
terme de teinture. V. 92. b.
DOUZA. {Jan) Obfervations fur la vie 8c le caraétere
de cet homme célébré. IX. 431. b. 432. a.
DOUZAINE , Sergent de la , XV. 87. a , b. 8cc.
DOUZIEME , {Mufique) oétave de la quinte. Toute
corde fonore rend avec le fon principal, celui de la douzième.
V.92 .b. \ [
DOXOLOGIE. ( Théolog. ) Les Grecs diftinguent la grande
& la petite doxologie. Origine des dlverfes formules de 1»