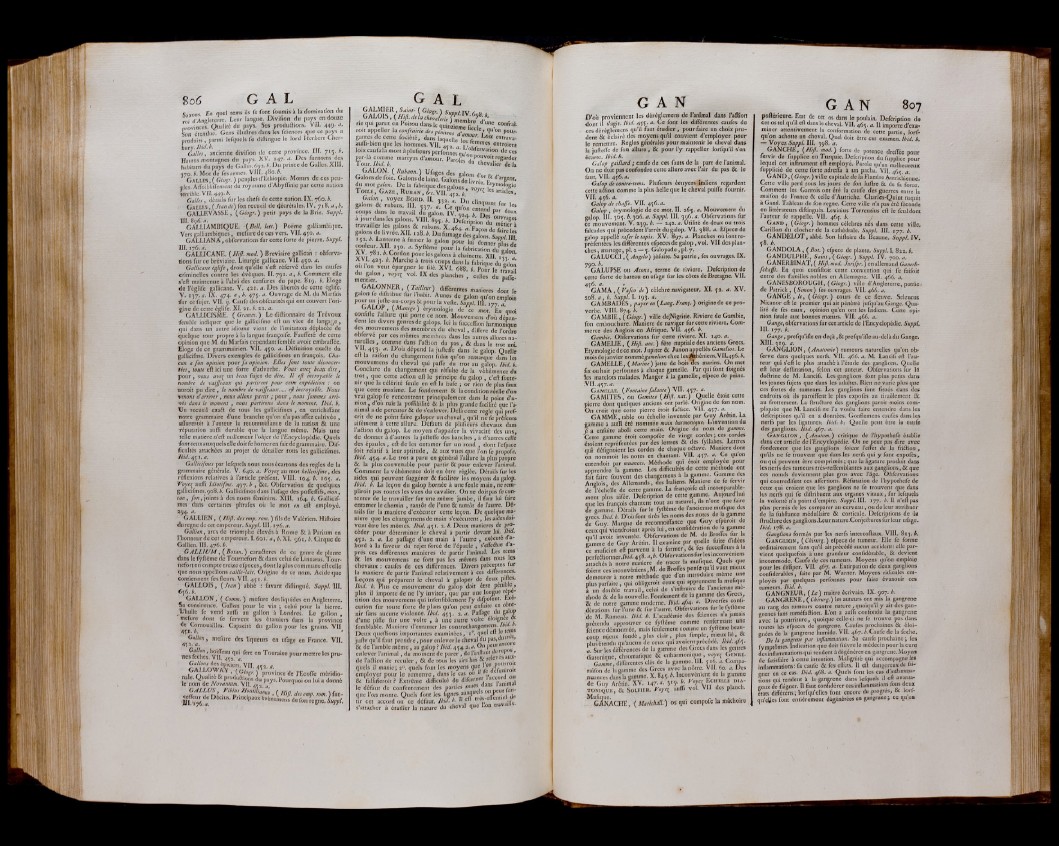
G A L
c ljr0n* En quel tom» il# Te font fourni* à la domination du
roi d'Angleterre. Leur langue. Divifion du paysi en douze
orovincc». Qualité du pays. Se* produéhon». VII. 449*
Son étendue. Gens ¡Huîtres dan* le* fcicncc» que ce pays a
produit*, parmi Icfquel* fe diftingué le lord Herbert Clterjjury.
Ibid, b. H H , f f t .
d a lle s , ancienne divifion do cette province. III. 715. b.
Hautes montagne* du pays. XV . »47. </• De# furnoms des
liabitan* du pays de Galles.6 0 t. b. Dw prince de Galle». X III.
170. b. Mot de fe* armes. VIII. 480.b.
G a u m , ( Géogr.) peuple*d'Ethiopie. Moeurs de ce» peuples.
Affoibliflcmem du royaume d’Abyflinic par cette nation
terrible. VII. 449* , . . , . .
Galles, détail* fur le* chef* de cette nation. IX. 760. b.
G A l l e s , ( Jean de) fon recueil de décrétalc». 1V. 7 18. a , b.
G AU .E V A S SE , ( Géogr. ) petit pays de la Brie. Suppl.
111. 8 96. a.
GALLIAMB1QUE. (B e ll, lett .) Poëmc galhambiquc.
Ver* galllambiqnc», inclure de ce» ver». VII. 470. a.
G ALL1A N A , obfcrvation» fur cette forte de pierre. Suppl.
1 1 1 .1 7 6 . a. , .
GALLICANE. ( N i il. mod. ) Bréviaire gallican : obferva-
tions fur ce bréviaire. Liturgie gallicane. V il. 470. a.
Gallicane églife, droit quelle s’eft réfervé dan» les caufc»
criminelle* contre le* évêques. II. 791. a , b. Comment elle
**cft maintenue i l’abri des ccnfurc» du pape. 819. b. Eloge
de l’eglife gallicane. V . 411. a. D e s liberté» de cette églife.
V . 137. a. IX. 474. a , b. 477. a. Ouvrage de M. du Marfai»
fu r c e fujet. VII. ii. Caufc de# obfcurité» qui ont couvert l’origine
de cette églllc. XI. a i. 6« 42. a.
GALLICISME. ( Gramm. ) Le diflionnairc de Trévoux
fcmblc indiquer que le gallicifmc cil un vioc de langage,
qui dans un autre idiome vient de l'imitation déplacée de
quelque tour propre II la langue françoifc. Faufleté de cette
opinion que 1VL du Marfai* cependant fcmblc avoir cmbraiïéc.
'Eloge de ce grammairien. V IL 430. a. Définition exaéle du
gallicifmc. Divers exemple» de gallicifmc» en françoi*. Chacun
a fon opinion pour fa opinion. Elles font toute déconcertées,
toute cft ici une forte d’adverbe. Vous avez beau dire,
p o u r , vous ave[ un beau fujet de dire. I l cfl incroyable le
nombre de vaiffeaux qui partirent pour cette expédition : on
suroît pu dire, le nombre de vaijj'caux cft incroyable. Nous
venons (Carriver , nous allons partir ; pour, nous fommes arrivés
dans le moment , nous partirons dans le moment. Ibid. b.
Un recueil exaél de tou» le» gallicifmc», en cnrichiflant
notre grammaire d'une branche qu'on n’a pas allez cultivée ,
affurcroit It l'auteur la rcconnoiuancc de la nation & une
réputation auITi durable que la langue même. Mai» une
telle matière n’eft nullement l'objet de l’Encyclopédie. Quel»
fon t ceux uuxqticlscllc doit fe borner en fuit de grammaire. Difficultés
attachée» au projet de détailler tou» le» gallicifmc*.
Ibid. m i . a.
Gallicifmcs par Icfquel» nous nous écartons des réglé» de la
grammaire générale. V. 640. a. Voye{ au mot hellentfme, de»
réflexions relative» 2t l’article préfent. VIII. 104. b. 107. a.
Ÿ oy c\ 8iifli Idiotifme. 497. b , tkc. Obfcrvation de quelque»
gallicifmcs.qoS./'. Gallicifmc» dan» l'ufagc de» pofleims, mon,
to n , f o n , joints A de* nom» féminins, X l ll , 164. b. Gallicif-
mc» dan» certaine» phrafe» 0(1 le mot en cft employé.
(tALLIEN , ( Hift. desemp. rom.) fils de Valéricn. Hiftoirc
du règne de cet empereur. Suppl. 111,176 . a.
Gallien, arc» de triomphe élevé» a Borne 8c A Pari uni en
l ’honneur de cet empereur. 1. 601. a , b. XL 96 t . b. Cirque de
Gallien. 111.476. b.
G A L L IU M , { Botan. ) cara&crc» de ce genre de plante
dan# le fyftémc de Toumefort Se dans celui de Linnams. Tour*
nefort en compte treize cfpccc». dont la plu» commune cft celle
que nous appelions caille-lait. Origine de ce nom. Acide que
contiennent fe* fleur», VU. 431 ,b.
G A L LO IS , ( Jean ) abbe : favant diftingué. Suppl. III,
676. b.
G A L LO N , ( Comm. ) mcfurc des liquides en Angleterre.
Sa continence. Gallon pour le vin ; celui pour la bierre.
^L’huile fe vend aufli au gallon & Londres. Le gallon ,
mcfurc dont fe fervent les étamicr» dan» la province
de Cornouaillcs. Capacité du gallon pour le* grain». VII
4 b.
Gallon, mcfurc de» liqueur» en tifagc en France. V IL
v e f f c iU c s *\r|fcau ^U1 ^crt cn T’oit raine pour mettre le» pru-
^ i A « ^ c i c r , ; V l I . A tx a
province de l’Ecoffc méridio-
°"iui i m G A L L U S , Vibius J/ont ilia nirv ( tain . ...... \ /*..
W ^ a . D tÜ m ' ^rinc^ ailx^vénemen# de l'on i c g n c . lW /‘
G A L
rie qui parut en Poitou dan» le q u i n / E S 1 unc. c<>nfnl
roit appcllcr la confrairie de, pénitens 7 1 1 1“ on P0Ur“
gantes de cette foeiété, d a n s ^ S c \1 T U a
aufli-bicn que le» homme». V II. 4*2 1 » entroient
loix caufala «ion ¡1 pluficurj perfonne, i i Æ ' J Ë * « *
par-IA comme martyrs d’amour. Parole* a’ P / '^ .^ g a rd e r
Tour. Ibid. b. w chevahcr de la
G A LO N . (R u b a n n .) Ufages de« «iIa .. » „
Galon» de foie. Galons de laine. Galon» de livré“ r d " f cnr-
du mot ¡¡alon. ü c la fabrique de» galon» vov.,'
T o i l e , G a z e , R u b a n , è e .V n . 45“ “ 1 lc’
Galon , v o y e z Bo it» . II, 22a a n». «u
galon» & rubans, III, , 37. J c o J Ï , , ‘ ‘" ‘' “ ï " 1 f,,r ' «
cqnp» dan» le travail du galon. lV . o a , S P * dtl«
à ,o„rdan»le» galon,. VIII. 8 „ . k. D l f c t l n r A Î Ï S S f
travailler t o T K T f t ian». 4
S I S
galon» de livrée. XII. i iS. k.. Du f
fumage de» g a L , Â w 'm
13a.» b . Lanterne v u ........................ li fumer le 8^galon ®“ kvuour »jï mi lin aï
\ b
eouicur.v î ” X I I1. r ! 130.î î : ' a.: Syiléme iy ilém e pour> pour la fabricadon fabrication d du i r galon:
°
X V .7 8 1 . k -Cordon pourlc» galon» i chaineitc. XII, .
XVI. 413. k. Marelle !i trots coup» dan» la fabrim,, dùï. i
ou Ion veut épargner le filé. XVI. 688. k. P o L l T n » S
dn „galon , vvyr{ vol. IX de, planche, , | | |
e a lo i f ° |NftN' f R V ^ i ' 7î galon fe diflrtbue fur l’bab“tt'.’ \Au‘lni,er»ir cdme cg’a lon q u ’ o n edmonptl oilee
pour un lofic-au-torp, Si pour la vefte. Suppl. III. 177. /
conMhÏA' U étymologie de ce mot. En quoi
conftftc 1 allure qui porte ce nom. Mouvement d’où dépen-
dent lc , dtver» genre» de galop,. Ici la fnceefiion barmonfqoo
de» mouvemens de» membre» du ch eval, diffère de l'ordre
obrervé par ce» même» membre» dan, le» autre» allure» na-
v i r com,T c .'ians I’, a i " n du ua», 8c dan, le trot uni.
A l’ dl î ’ Id ou dépend la judeffe dan» le galop. Quelle
clt la ration du cllangcmcni fubii qu’on remarque dan» le»
mouvement du cheval qui paffe dit trot au galop. IHJ. k.
Conclure du changement qui réfulic de la véhémence du
t ro t , que cette aélion cft le principe du galop , c’cft foutc-
mr que la célérité feule cn cft la bafe j or rien de plu» faux
que cctrc maxime. Le fondement de la condition réelle d’un
vrai galop fe rencontrent principalement dan» le point d’un
ion, d’où naît la poflibilité de la plu» grande facilité que l’a*
nimal a de percuter de de s’enlever. Delà cette règle qui pref-
crit de ne point faire galoper un cheval, qu’il ne fe préftmto
aifément ît cette allure. Défaut» de pluficurs chevaux dan»
l’aétion du galop. Lc moyen d’appailcr la vivacité de* un»,
de donner a d’autre» la jiiftciTc de» hanches, à d'autres celle
des épaule», cft de les entamer fur un rond , dont l’cfpace
foit relatif li leur aptitude, de aux vues que l’on fe propofe.
Ibid. 474, a. Le trot a paru cn général l’allure la plu» propre
de la plus convenable pour partir de pour enlever l’anitnal.
Comment la véhémence doit cn être réglée. Détails fur le»
aide» qui peuvent fuggércr de faciliter le» moyen» du galop.
Ibid. b. La leçon du galop bornée k unc feule main, ncrcm-
pliroit pas routes le» vue» du cavalier. On ne doit pas fccon*
tenter de le travailler fur unc même jambe, il faut lui faire
entamer le chemin , tantôt de l’une 6e tantôt de l’autre. Détail
» fur la manière d’exécuter cette leçon. De quelque manière
que le» changcmcns de main s’cxécurcnt, les aide» doivent
être le» môme». Ibid. 4 7 1. a. b. Deux manière» de procéder
pour déterminer le cheval A partir devant lui. ibid.
43a. a. a. Lc pafTage d’une main A l’autre , exécuté da-
bord A la faveur du rejet forcé de l’épaule , s’effcéhic d a-
prês ce» différente* manière* de partir l’animal. Le* tems
de les mouvemens ne font pas les même* dan» tou» le»
chevaux : caufc» de ce» différence». Divers précepte» fur
la manière de partir l’animal relativement A ce» différence».
Leçon» qui préparent le cheval A galoper de deux pifte»*
Ibid. b. Plu» ce mouvement du galop doit être pénible?
plu» il importe de ne l’y inviter, que par une longue répétition
de» mouvemens qui infcnfiblemcnt l’y difpofcnt. Execution
fur toute forte de plan» qu’on peut enfuite en obtenir
fan» aucune violence. Ibid. 433. 2. a. Paffage du galop
d’une pifte fur unc voire , A unc autre voltc éloignée <?c
fcmblablc. Manière d’entamer les contrcchangcmcn». /««•*'•
Deux qticflion» importante» examinée», t°. quc^ y r |S
jufte qu’il faut prendre, pour enlever le cheval du P
& de l’amble m ême, au galop i Ibid. 4 74. a. a. On peut et
enlever l’animal, du moment de parer, de l’inft«'mf du' rep ,
de l’aftion de reculer, 8c de tou* les air* ba* ÜOUrrojj
quels il manie: a", quels font les moyen» que lue I .
employer poui le remettre, dan* le ca» oit &
6e falfificroit ? Extrême difficulté de difeerner .
le défaut de consentement confenrcmcnt de» partie» muemue*» 0
.
que I on monte,
e. Quel» font le» ligne, auxquels 018 g |U |W ,
tir cet accordi »o,u, c«e ddééffiatuutt.. Imbidh. t>’ -. Í«® . V«»v-iilie,
s’Ettiutltcr it étudier lu nature du cheval que Um mivuuie.
G A N
D ’où proviennent les déréglcmcn» de l'animal dan» l’aftion
dont ii s’agit. Ibid. 437. a. C e fon; le» différentes caufc» de
ces dcréglcmcns qu’il faut étudier, pour faire un choix prudent
de éclairé des moyens qu’il convient d’employer pour
le remettre. Règle» générales pour maintenir le cheval dan»
la jufteffe de fon allure, 8c pour l’y rappcllcr lorfqu’il s’en
écarte. Ibid.b.
Galop gaillard ; caufc de ces faut» de la part de l’animal.
On ne doit pas confondre cette alturo avec l’air du pas 8c lc
faut. VII. 43 6. a.
Galop de contre-tems. Pluficurs écuycrs«italiens regardent
cette a«ion comme la plu» belle que le cheval puiffe fournir.
VU. 476. a.
Galop de chaffe. VII. 476. a.
Galop , étymologie de ce mot. II. 267. a. Mouvement du
gajop. f i l. 303. b.%06. a. Suppl. III. 306. a. Obfcrvation» fur
ce mouvement. V . 439. b. — 444. a. Utilité de deux ou trois
fnlcadc» qui précèdent l’arrêt du galop. V I. 388. a. Efpcce de
galop appelle râler le tapis. XV . 897. a. Planche» où font re-
prefentée» le»différente» efpeccsde galop,vol. V II de#plan-
G A N 8 0 7
che»
, manège, pl. 4 — 7. Galopade, pl. 7.
GALU
A LU C C I , ( Angelo) jéfuite. Sa patrie, fe» ouvrage». IX.
790. b.
GALUPSE ou A co n s, terme de rivière. Defeription de
cette forte de bateau cn ufage fur le» côte* de Bretagne. VII.
476. a. $
G A M A , ( Vafeo de ) célebre navigateur. XI. 34. a. X V .
208. a , b. Suppl. I. 193. a.
GAMB AD ES, payer en ( Lang. Franç. ) origine de ce proverbe,
VIII. 874. b.
GAMB IE, ( Géogr.) ville de)Nigritie. Rivière de Gambie,
fon embouchure. Maniere de naviacr fur cette rivière. Commerce
de# Anglois en Afrique, VII. 4^6. b.
Gambie. Obfcrvation# fur cette rivière. XI. 140. a.
GAMELIE, {H ift. anc.) fête nuptiale de# ancien» Grec».
Etymologie de ce mot. Jupiter 8c Junon appcllés Gameltos. Lc
mois de janvier nommégamelion chez leswl1611icns.VIl.436. b.
GAMELLE, {Marine) jatte de bois des marins. On met
fut ou huit perfonne» A chaque gamelle. Par qui font foignés
les matelots malade». Manger A la gamelle, efpcce de peine.
VU . 477. e.
G a m e l l e . {Fontaine f ila n te } V IL 437. a.
G AM ITE S , ou Gemites {Hift. nat. ) Quelle étoit cette
pierre dont quelque» ancien» ont parlé. Origine de fon nom.
On croit que cette pierre étoit fafticc. VII. 457. «.
GAMME,table ou échelle inventée par G u y Arétm. La
gamme a aufli été nommée main harmonique. L’invention du
f i a enfuite aboli cette main. Origine du nom de gamme.
Cette gamme étoit comppféc de vingt corde» ; ces cordes
étoient représentées par de» lettre# 8c des fyllabcs. Lettres
qui défignoicnt lc, corde» de chaque oftave. Manière dont
on nommoit le# note# en chantant. V il. 437. a. Ce quon
entendoit par muances. Méthode qui étoit employée pour
apprendre la gamme. Le» difficulté» de cette méthode ont
fait faire fouvent de» changcmcns A la gamine. Gamme des
Anglois, des Allemand», de# Italien». Maniere de fe lervir
de Téchcllc de cette gamme. La françoifc cft incomparable;
ment plu» aiféc. Dclcription de cette gamme. AujourdI hm
que le# françoi# chantent tout au naturel, il# n ont que faire
3c gamme. Détail# fur le fyftême de ’ancienne mufique de»
es. ¡bul. b. D ’où font tiré# le# nom#
de» note» de la gamme Srccs.m a . U ou tout tire»tes nom»e Guy. Marque de rcconnoiffancc que G u y cipéroit de
ceux qui viendroiont après lui, cn confidèration dc ia gamme
qu’il avoit inventée. ObfcrvaHon, de M. de Brofle, fur la
gamme de G u y Arétin. 11 examine par quelle fuite d idée»
ce mufleien cft parvenu A la former, 8c fe» fuccefTeur# A la
pcrfcélionncr./ém. 438. a, b. Obfcrvation» fur le».nconvén.cn»
attaché» A notre manière de tracer la mufique. Quels que
foient ce* inconvénicns, M. de Brofle» penfe qu il vaut mieux
demeurer A notre médiode que d’en introduire même une
plu» parfaite, qui obligeroit ceux qui apprennent la mufique
ï un double travail, celui de »’inflruirc de 1 ancienne méthode
de de la nouvelle. Fondement de la gamme des Orées,
Se de notre gamme moderne. Ibid. 464. a. Diverfe# conii-
déra lions fur Tune 8c fur l’aiirrc. Obfcrvation# fur le fyftémc
de M. Rameau. Ibid. b. L ’académie des fcicnces n a jamais
prétendu approuver ce fyflômc comme reuformant unc
fcicncc démontrée, mai» feulement comme un fyflômc beaucoup
mieux fondé, plus clair, plus Ample, mieux h é , ec
plu* étendu qu’aucun de ceux qui avoient précédé. Ibid. 463.
i Sur les différences de lu gamme des Grec# dans les genre#
diatonique, chromatique de ertharmdnique, v ô y n G e n r e .
Gamine, différente» clés de la gamme. III. <16. a. Comna*
ra’ifon de iagamme de» Grec» avec lanétre. VIL fia a. De»
nuance, daniU gamme. X. 8 « . *. Inconvéntem tJe Ila gamme
de G uy Arétin. XV. 147. u. ¡ g *• n ,f
TON1QUK, Si S o lf ie r . y °y ‘ l jjjl® vo1- dcs plancb.
g I n À C H Ë , (Mariehall.) o j qrti compofc la michoirc
pofténeure. F.tat de cet 05 dan» le poulain. Defeription do
cet os tel qu il cft dan» le cheval. V IL 465. o. Il importe d’exa-
mmer attentivement la conformation de cette partie, lorf-
qti on aebotte un cheval Quel doit être cet examen. Ikid. k.
— V o y e z Suppl. III. 308. a.
I GMAINiC H Er,r (' Hift. mod■. *) forte de potence dreffée pour
fervir de ftipplice cn Turquie. Defeription du fupplice pour
lequel cet inftrumcnt cft employé. Parole qu’un malheureux
fupplicié de cette forte adrefla A un pacha. VIL 467. a.
G A N D , ( Géogr. ) ville capitale de la Flandre Autrichienne.'
Cette ville perd fous les jours de fon luftre de de ht force.
Comment les Gantois ont été la caufc de» guerres entre la
maifon de France de celle d’Autriche. Charles*Quint naquit
A Gand. Tableau de fon règne. Cette ville n’a pas été féconde
cn littérateurs diftingué». Levinius Torrentius cft lc fculdont
l’auteur fe rappelle. VII. 463. b.
G a n d , {Géogr.) hommes célèbres nés dans cette ville.
Carillon du clocher de la cathédrale. Suppl. III. 177. b.
G A N D E LO T , abbé. Son hiftoirc de Bcaunc. Suppl. IV .
78. b.
G A N D O L A , ( Bot. ) cfpecc de plante. Suppl. 1, 844. b.
GANDULPHE, Sa in t, ( Géogr. ) Suppl. IV. 700. a.
GANERB1N A T , ( Hift. mod. Jurtfpr. ) en allemand Ganerb-
fchafft. En quoi confiftoit cette convention qui fe faifoit
entre de» familles nobles cn Allemagne. VIL 466. a.
GANESBOROUGH, ( Géogr.) ville d’Angleterre, patrio
de Patrick, {Simon) fe» ouvrages. VII. 466. *.
G A N G E , le , {G éo g r .} cour» de ce fleuve. Sclcucus
Nicanor cft le premier qui ait pénétré jufqu’au Gange. Qualité
de fe» eaux, opinion qu’en ont les Indiens. Cette opinion
fatale aux bonnes moeurs. VIL 466. a.
Gange, obfcrvatious fur cet article de l’Encyclopédie. Suppl.
III. 177. b.
Gange, prefqu’ifle en*deçA, de prefqu’iflc au-delA du Gange.
XIII. 310. a.
G ANG LIO N , {Anatomie) tumeur» naturelle» qu’on obr
ferve dan» quelques nerfs. VII. 466. a. M. Lancili cft l’auteur
qui s’eft lc plu» attaché A l’étude des ganglion». Quelle
cft leur dcftination, félon cet auteur. Obfcrvatious Tur I i
doftrinc de M. Lancifi. Lc» ganglions font plus petits dan»
le» jeunes fujet» que dans les adulte*. Rien ne varie plus que
ce» fortes de tumeur». Les ganglion» font litucs dans de*
endroits où il» paroiffent le plu» expofés au tiraillement 8b
au frottement. La ftruéhirc des ganglions paroit moins compliquée
que M. Lancifi ne l’a voulu faire entendre dans le*
defeription» qu’il cn a données. Gonflemen» caufés dan» le»
nerf» par les ligatures. Ibid. b. Quelle peut être la caufc
des ganglion». Ibid. 467. a.
G a n g l i o n , {Anatom.) critique de l’iiypothcfc établie
dans cet article de l ’Encyclopédie. O n tic peut pas dire avec
fondement que les ganglions foient l’effet de la fri&ion ,
qu’ils ne fe trouvent que dans les nerfs qui y font expofés,
ou qui peuvent être comprimés; que la ligature produit dans
les nerfs des tumeurs trés-rcflcmblantcs aux ganglions, de que
ces ncciids deviennent plus gros avec l’Age. Obfcrvation*
qui contredifent ces affertions. Réfutation de l’hypothcfc de
ceux qui croient que les ganglions ne fe trouvent que dan*
les nerfs qui fe diftribucm aux organes vitaux, fur lefquels
la volonté n’a point d’empire. Suppl. III. 17 7 . b. Il n’eftpas
plu» permis de les comparer au cerveau, ou de leur attribuer
de la fubflancc médullaire & corticale. Defeription«» de la
ftruéturc des ganglions.Lcurnaturc.Conjcfturc» fur leur ufage.
Ibid. 178. a.
Ganglions formés par les nerfs intcrcoftaux. V ili. 813. b.
G a n g l io n , {Chirurg.) cfpccc de tumeur. Elle fe forme
ordinairement fan# qu’il ait précédé aucun accident: elle parvient
quelquefois A unc grandeur conftdérablc, 8c devient
incommode. Caufc de ce# tumeurs. Moyens qu’on emploie
pour les difliper. VII. 467. a. Extirpation de deux ganglion#
conftdérablc#, faite par M. Warner. Moyen» ridicules employé
» par quelque» perfonne# pour faire évanouir ces
tumeurs. Ibia. b.
GANGNEUR, { L e ) maître écrivain. IX. 907. b.
GANGRENE, {Chirurg.) les auteurs ont mis la gangrené
au rang des tumeurs contre nature, quoiqu’il y ait des gangrènes
fans tuméfoétion. L’on a aufli confondu la gangrené
avec la pourriture, quoique celle-ci ne fe trouve pas dans
toutes les efpeccs de gangrené. Caufc» prochaines 8c éloignées
de la gangrené humide. VIL 467. b. Caufc de la fcchc.
De la gangrené par inflammation. Sa caufc prochaine ; fes
fymptômes. Indication que doit fuivre le médecin pour la cure
des inflammations qui tendent à dégénérer cn gangrène. Moyen
de fatisfairc A cette intention. Malignité qui accompagne les
inflammations: fa caufc 8c fes effet». U cft dangereux de fai-
gner ce cas. Ibid. 468. a. Quel» font les cas d'inflanmtattons
qui tendent A la ganerene dan» Icfquel» il cft avantageux
'CUX
de faigner. Il faut conitdcrcr ces inflammation* fous deux
état» différons; lorsqu'elle» font encore du progrès, Ce lorf-
qu’cUcs font entièrement dégénérées cn gangrené ; ce qu on