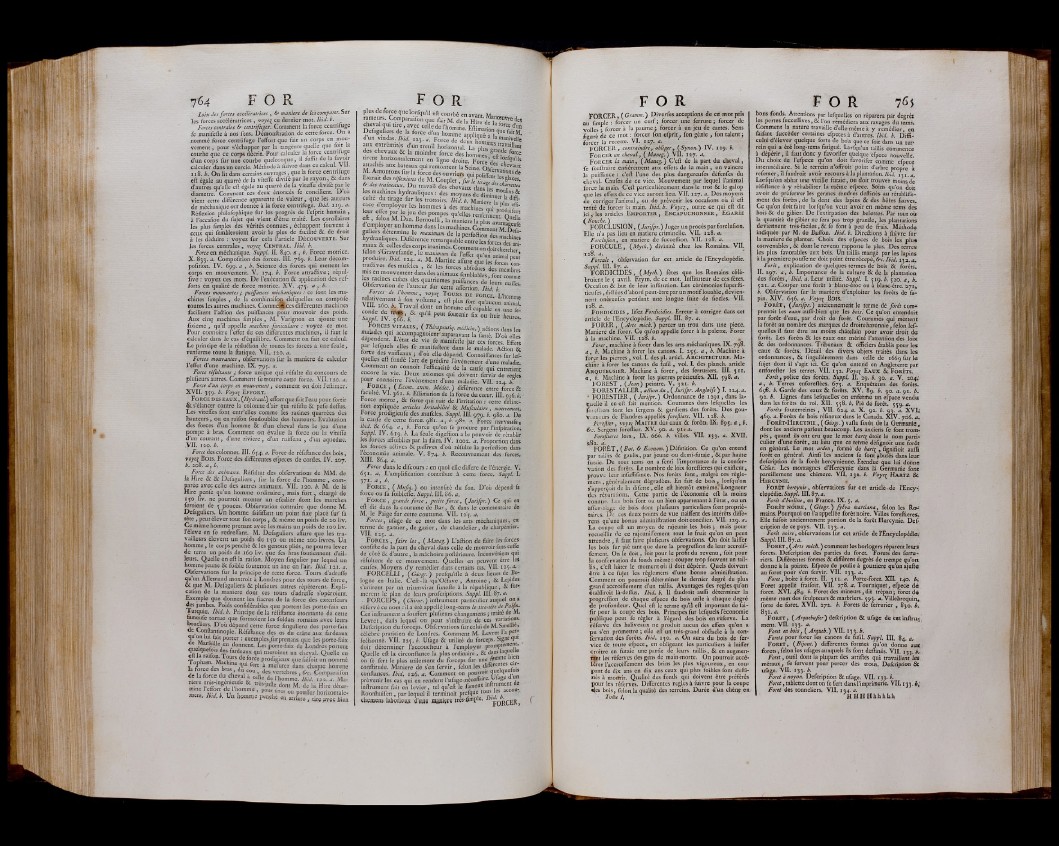
7 64 F O R
Lo ix des forces accélératrices, S* maniéré de les comparer. Sur
les forces accélératrices, voyc[ ce dernier mot. lbid. b.
Forces centrales & centrifuges. Comment la force centrifuge
fe manifefte à nos fens. Demonftration de cette force. On a
nommé force centrifuge l’effort que fait un corps en mouvement
-, pour s’échapper par la tangente quelle que foit la
courbe que ce corps décrit. Pour calculer la force, centrifuge
d’un corps fur une courbe quelconque, il fuffit de la lavoir
calculer dans un cercle. Méthode à fuivre dans ce calcul. V 11.
118. b. On Ut dans certains ouvrages, que la force centrifuge
eft égale au quarré de la vîteffe divifé par le Tayon , &dans
d’autres qu’elle cil égale au quarré de la vîteffe divifé par le
diamètre. Comment ces deux énoncés fe concilient. D ou
vient cette différence apparente de valeur, que les auteurs
de méchanique ont donnée à la force centrifuge, lbid. 119. a.
Réflexion pliilofophique fur les progrès de l’efprit humain ,
à l’occafion du fujet qui vient d’être traité. Les corollaires
les plus Amples des vérités connues, échappent fouvent à
ceux qui fembleroient avoir le plus de facilité 8c de droit
à les aéduire : voyez fur cela l’article D écouverte. Sur
les forces centrales, voyc{ C entral, lbid. b.
Force en méchanique. Suppl. II. 840. a , b. Force motrice.
X. 833. a. Compofition des forces. III. 769. b. Leur décom-
pofltion. IV . 699. a , b. Science des forces qui mettent les
corps en mouvement. V . 174. b. Force attraélive ; répul-
fivc : voyez ces mots. De l’exécution 8c application des ref-
forts en qualité de force motrice. X V . 475. a , b.
Forces mouvantes ; puiffances méchaniques : c e font les machines
Amples , de la combinaifom defquelles on compofe
toutes les autres machines. Commences différentes machines
facilitent l’aâion des puiffances pour mouvoir des poids.
Au x cinq machines Amples , M. Varignon en ajoute une
fixieme, qu’il appelle machine funiculaire : vo yez ce mot.
Pour connoitre l’effet de ces différentes machines, il faut le
calculer dans le cas d’équilibre. Comment on fait ce calcul.
Le principe de la réduâion de toutes les forces â une feule,
renferme toute la ilatique. VII. 120. a.
, Forces mouvantes, obfervations fur la maniéré de calculer
l’effet d’une machine. IX. 795. a.
Force réfultante ; force unique qui réfulte du concours de
plufleurs autres. Comment fe trouve cette force. VII. 120. a.
Force d'un corps en mouvement, comment 011 doit l’eftimer.
XVII. 359. b. Voye{ E f f o r t .
F orce des eaux , (Hydraul.) effort que fait l’eau pour fortir
& s’élancer contre la colonne d’air qui réfifte & pcfe deffus.
Les vîteffes font entr’clles comme les racines quarrées des
hauteurs, ou en raifon foudoublée des hauteurs. Evaluation
des forces d’un homme 8c d’un cheval dans le jeu d’une
pompe à bras. Comment on évalue la force ou la vîteffe
d’un courant, d’une rivicre, d’un ruiffeau , d’un aqueduc.
.VIL zao. b. 1
Force des colonnes. III. 6<¡4. a. Force de réflllance des bois,
voyei Bois. Force des différentes efpeces de cordes. IV . 207.
b. 208. a , b.
Force des animaux. Réfultat des obfervations de MM. de
là Hire 8c 8c Defàguliers, fur la force de l’homme , comparée
avec celle des autres animaux. VII. 120. b. M. de la
Hire penfe qu’un homme ordinaire, mais fo r t , chargé de
1 liv. ne pourrait monter un efcalier dont les marches
feraient de 3 pouces. Obfervation contraire que donne M.
Defaguliers. Un homme faififfant un point fixe placé fur' fa
tê te , peut élever tout fon corps, 8c même un poids de 20 liv.
C e même homme prenant avec les mains un poids de 100 liv.
l’éleve en fe redreffant. M. Defaguliers allure que les travailleurs
élevent un poids de 150 ou même 200 livres. Un
homme, le corps penché 8c les genoux pliés, ne pourra lever
de terre un poids de 160 liv. que fes bras foutiennent d’ailleurs.
Quelle en eft la raifon. Moyen fingulicr par lequel un
homme jeune 8c foible foutenoit un âne en l’air, lbid. 121. a.
Obfervations fur le principe de cette force. Tours d’adreffe
qu’un Allemand montrait a Londres pour des tours de force,
ce que M. Defaguliers 8c plufieurs autres répétèrent. Explication
de la manière dont ces tours d’adreffe s’opéraient.
Exemple que donnent les fiacres de la force des extenfeurs
des jambes. Poids confidérables que portent les porte-faix en
Turquie. lbid. b. Principe de la réfiitance étonnante de cette
«meufe t e fo e que formoient les foldats romains avec leurs
noucliers. D ’où dépend cette force finguliere des porte-faix
ce ^onttantinople. Réfiftance des os du crâne aux fardeaux
i °w i 1 Portf r : cxemples^furprenans que les porte-faix
« n J S S - le/ n rdoPnent* H Pone-faix de Londres portent
S la rawïn T far(iÇau/ qui tueraient un choyai. Quelle en
n de force Drodieieiut nn<» lin immmA
Topham.°Machinc ¡ i- i*§ ¡ ¡ 1£ * mcfurcr pdans& ciih°a“qu1,en phomËmle
U force des bras du e „„ , des vertèbres ! Oc. ¿omparsifon
de la force du cheval à « lie de l'homme, / ¿ « .r a a .u . Mas
b i i
F O R
cheval qui t ire, avec celle de l'homme FA m,5 ° fte
Defaguliers de la force d'un homme à p p W à V “ '
d un vrndas. lbid. r i j . Force de tic " '“ ‘Mlle
au* extrémités d'un treuil horizomal L f f " ? trï vaillj™
des chevaux & la moindre forcedes homS« W 6/ 0' “
tirent horizontalement en ligne droite. F o r c ’ ,l! i 1u js
attachés aux bateaux qui remontent la Seine O h l « S t É !
M. Amenions fur la f i c e des ouvrieft qu?poh®tmT'T É
Extra,r des rlflcxmn, de M. Couplet, fur le ü r a t i l '
O des ¡rameaux. Du travail des chevaux
les machines hydrauliques : des moyens de d li'- "“ "i &
cuit» 1 tirage'fur ^ t ro tto ir s ! ¡ 1
cace d employer les hommes à des machines qfti n , f e * '
Hydrauliques. Différence r e m a ^ i S e â S ^ ^ t ?
Sfélnons sr G- rrealvlCef?adnCd,SeC,0 ,lrep SmifaoxUimÉumS Cdeo lm'efmfet Tntuo'unn Î r c L m h r’
produire, lbid. ra4. a. M. Martine affure que les fomes ï ' “ '
traélives dcsmufcles , & les forces S h Z B S g E g S
nus en mouvement dans des animaux femblables, fôn” otnmè
■■■■i .
mÏ ° K.a S J ‘ TAL£S’ I Ï Ï f f S g i k : “ ¿ “ fil aflions dans les
S , qiliaccompagnoient'auparavant la fanté. D’où elles
h “ i e v ie .fo manifefte par ces forces. Effets
par lefquels elles fe mamfcftenr dans le malade. Aûion &
force des vaiffeaux; d’où elle dépend. Connoiffances fur lefquelles
eft fondé 1 art de prédire l’événement d’une maladie.
Comment on connoir l’efficacité de la caufe qui entretient
encore la vie. Deux axiomes qui doivent fervir de réglés
pour connoitre l’événement d’une maladie. VII. 124. b.
F o r c e , (E com .a n im . Mcdec. ) différence entre force &
faculté. VI. 361. b. Eftimation de la force du coeur. III. 596. b. \
Force morte, 8c force qui nait de l’irritation : cette diftinc-
tion expliquée articles irritabilité 8c Mufculaire, mouvement.
Force prodigieufe des mufcles. Suppl. III. 979. b. 980. a. De
la caufe de cette force. 981. a , b. 982. a. Force nerveufe,
ibid. 8c 664. a , b. Force qu’on fe procure par l’inipiratiom
Suppl. IV . 619. b. La feule digeftion a le pouvoir de rétablir
les fore,es affoiblies par la faim. IV. 1002. a. Proportion dans
les forces aâiyes & paflives d’où réfulte la perfeâion dans
l’économie animale. V . 874. b. Recouvrement des forces.
XIII. 864.
Force dans le difeours ; en quoi elle différé de l’énergie. V.
651. a. L’amplification contribue à cette force. Suppl. I.
371. a , b.
F orce , ( Mufia. ) ou intenfité du .fon. D ’oii dépend fa
force ou fa roiblene. Suppl. III. 86. a.
FO R C E , grande force , petite fo r c e , ( Jurifpr. ) Ce qui en
eft dit dans la coutume de B a r , 8c dans le commentaire de
M. le Paige fur cette coutume. VII. 12'ç. a.
Forces, ufage de ce mot dans les arts méchaniques, en
terme de gantier, de gazier, de chandelier, de charpentier.
v u . 123. k
Forces , faire les , ( Maneg. ) L’aélion de faire Jes forces
confifte de la part du cheval dans celle de mouvoir fans ceffe
de côté 8c d’autre, la mâchoirepoftéricure. Inconvéniens qui
réfultent de ce mouvement. Quelles en peuvent être le s ,
caufes. Moyens d’y remédier dans certains cas. VII. 123.«. !
FO R C E L L I , ( Giogr. ) prefqu’ifle â deux lieues de Bologne
en Italie. C ’e ft-là /qu’Oftave , Antoine, 8c Lepidus
s’unirent par un triumvirat funefte à la république, 8c formèrent
le plan de leurs proferiptions. Suppl. III. 87. a.
■ FORC EPS, ( Chïrur. ) inftrumcnt particulier auquel on a
référvé ce nom : il a été appcllé long-tems le tirertête de
Cet inftrument a fouffert plufieurs changemens j traité de M.
L e v r c t , darts lequel on peut s’inftruire de ces variations.
Dcfcription du forceps. ObfcrvationsfurceluideM.Smelhé,
célèbre praticien de Londres. Comment M. Levret l’a per“
feâionné. VII. 125. b. Ufagc 8c utilité du forceps. Signe qui
doit déterminer l’accoucheur à l’employer promptemen .
Quelle eft la circonftancc la plus ordinaire, 8c dans l3<lu
on fe fert le plus utilement du forceps fur tme femme
conftituée. Maniéré de s’en fe rvir , félon les diaircn
Confiances, lbid. 126. a. Comment on pourrait que q^ ^
ppirréévveenniirr lleess ccaass qquuii eenn rreennddeenntt l’ufage• nécenairc. I_ f Mg t de
inftrumcnt fait en lev ier, tel qu’eft le fameux m rum
Roonhuifcn , par lequel il terminoit prefquc tous ies^
chcmcns laborieux d’une manière tres-fMnplc' V o rC E R
F O R
FO R C E R , ( Gramm.) Diverfes acceptions de c e mot pris
au Ample : forcer un cerf j forcer une ferrure ; forcer de
voiles * forcer à la paume ; forcer à un jeu de cartes. Sens
figuré de ce mot : forcer fon efprit, fon génie , fon talent ;
forcer la recette. V I. 127. a.
FO R C E R , contraindre, obliger, (Synon,) IV. 119. b.
FO R CER un cheval, ( Maneg. ) VII. 127. a.
F o r c e r la main, ( Maneg. ) C ’eft de la part du cheval,
fe fouftraire entièrement aux effets de la main, en vaincre
la puiffance : c’eft l’une des plus dangereufes défenfes du
cheval. Caufes de ce vice. Mouvement par lequel l’animal
force la main. C ’eft particulièrement dans le trot 8c le galop
que les effets de ce vice auront lieu. VII. 127. a. Des moyens
de corriger l’animal, ou de prévenir les occafions où il eft
tenté de forcer la main. lbid. b. Voy c{ , outre ce qui eft dit
ic i, les articles E m p o r t e r , E n c a p u c h o n n e r , E g a r é e
( Bouche. )
FORCLUSION, ( Jurifpr. ) Juger un procès par forclufion.
Elle n’a pas lieu en matière criminelle. VII. 128. a.
Forclufion, en matière de fucceffion. VII. 128. a.
FO R CU L E , ( Myth. ) divinité chez les Romains. VII.
■128. a.
Forcule , obfervation fur cet article de l’Eilcyclopédie.
Suppl. Ifl. 87. a.
FORDIClDES , ( Myth. ) fêtes que les Romains célébraient
le 3 avril. F.tym. de ce mot. Inftituteur de ces fêtes.
Occafion 8c but de leur inftitution. Les cérémonies fuperfti-
tien fes, di&ées d’abord peut-être par un motif louable, deviennent
onéreufes pendant une longue fuite de fiecles. VII.
128. a.
F o rd ic id e s , lifez Fordicidies. Erreur à corriger dans cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. III. 87. a.
FO R E R , ( Ar ts méch.) percer un trou dans une piece.
Maniéré de forer. Ce qu’on appelle forer à la palette. Forer
à la machine. VII. 128. b.
Forer t machine à forer dans les arts méchaniques. IX. 798.
<2, b. Machine à forer les canons. I. 233. a t b. Machine à
forer les pierres, vol. î. des pl. artid. A rchitecture. Machine
à forer les canons de fufil, vol. I. des planch. article
A rquebusier. Machine à fore r, des ferruriers. III. 311»
a t b. Machine à forer les pierres précieufes. XII. 398. a.
FO R E S T , ( Jean) peintre. V . 321. b.
FORESTALLER, allion du , ( Jurifpr. Angloife ) I. 124. a.
• FORESTIER, ( Jurifpr. ) Ordonnance de 12 9 1 , dans laquelle
il en eft fait mention. Coutumes dans lefquelles les
foi cftiers font les fergens 8c gardiens des forêts. Des gouverneurs
de Flandres appellés foreftiers. VII. 128. b.
Forefliery voyez Maître des eaux 8c forêts. IX. 893. a , b.
& c . Sergent foreftier. XV. 90. a. 91» a.
Forefiteres lo ix , IX. 660. b. villes. VII. 133. a. XVII.
<282. a.
FO R Ê T , ( Bot. & Econom. ) Définition. Ce qu’on entend
par taillis 8c gaulis, par jeune ou dcmi-fùtaie, 8c par haute
futaie. De tout tems on a fenti l’importance de la confer-
vation des forêts. Le nombre de loix foreftieres qui exiftent,
prouve leur infuffifance. Nos forêts font, malgré ces régle-
xnens, généralement dégradées. En fait de b o is lo r fq u ’on
s’apperçoit de la difette, elle eft bientôt extrême! Longueur
des réparations. Cette partie de l’économie eft la moins
connue. Lus bois font ou un bien appartenant à l’état, ou un
ôffembhy'c de bois dont plufieurs particuliers font propriétaires.
De ces deux points de vue naiffent des intérêts diffé-.
Fens qu’une bonne adminiftration doit concilier. VII. 129. a.
La coupe eft un moyen de rajeunir les bois ; mais pour
recueillir de ce rajeuniffement tout le fruit qu’on en peut
attendre, il faut faire plufieurs obfervations. On doit laiffer
les bois fur pié tant que dure la progreffion de leur accroif-
fement. On le doit, foit pour le profit du revenu, foit pour
la conservation du fonds même : couper trop fouvent un taillis
, c’eft hâter le moment où il doit dépérir. Quels doivent
être à ce fujet les réglcmens d’une bonne adminiftration.
Comment on pourrait déterminer le dernier degré du plus
rand accroiffeinent d’un taillis. Avantages des réglés qu’on
tabüroit là-deffus. Ibid. b. 11 faudrait auffi déterminer la
progreffion de chaque efpcce de bois utile à chaque degré
de profondeur. Quel eft le terme qu’il eft important de iai-
fir pour la coupe des bois. Principes fur lefquels l’économie
publique peut fe régler à l’égard des bois en réferve. La
réferve des baliveaux ne produit aucun des effets qu’on a
pu s’en promettre ; elle eft'un très-grand obftacle à la con-
iervation des forêts. Ibid. 130. a. On aura du bois de fer-
vice de toute efpece, en obligeant les particuliers à laiffer
croître en futaie une partie de leurs taillis, 8c en augmentant
les réferves des gens de main-morte. On pourrait accélérer
l’accroiffcmcnt des brins les plus vigoureux, en coupant
de dix ans en dix ans ceux qui plus foibles font defti-
nés à motfrir. Qualité des fonds qui doivent être préférés
pour les réferves. Différentes réglés à fuivre pour la coupe
des bois, félon la qualité des terreins. Durée d’un chêne en
• Toihe 1%
F O R 76s
bons fonds. Attentions par lefquelles On réparera par degrés
les pertes fucceuives, 8c l’on remédiera aux ravages du tems»
Comment la nature travaille d’elle-même à y remédier, en
faifant fuccéder certaines eîpcces à d’autres, lbid. b. Difficulté
d’élever quelque forte de bois que ce foit dans un ter*
rein qui a été long-tems fatigué. Loriqu’un taillis commence
à dépérir, il faut donc y favorifer quelque efpece nouvelle.
Du choix de i’eipece qu’on doit favorifer comme efpece
intermédiaire. Si le terrain n’offroit point d’arbre propre à
refemer, il faudrait avoir recours à la plantation, lbid. 131. a.
Lorfqu’on abbat une vieille futaie, on doit trouver hioinsde
réfiftance à y réhabiliter la même efpece. Soins qu’on doit
avoir de préferver lés germes tendres deftiriés au rétabliffc-
ment des forêts, de la dent des lapins 8c des bêles fauves.
Ce qu’on doit faire lorfqu’on veut avoir en même tems des
bois 8c du gibier. De l’extirpation des belettes. Par tout où
la quantité de gibier ne fera pas trop grande, les plantations
deviennent très-faciles, 8c fe font à peu de frais. Méthode
indiquée par M. de Buffon. Ibid. b. Dircâions à fuivre fur
la maniera de planter. Choix des efpecés dé bois les plus
convenables, 8c dont le revenu rapporte le plus. Des terres
les plus favorables aux bois. Un taillis mangé par les lapins
à la première pouffe ne doit point être récepé, &c. lbid. 132. a.
Foret, explication de quelques termes de bois 8c forêts.
II. 297. a y b. Importance de la culture 8c de là plantation
des forêts, Ibid. a. Leur utilité. Suppl. 1. 319. b. 320. a t b.
321. a. Couper une forêt à- blanc-étOc ou à blanc-être. 271»
b. Obfervation fur la manière d’exploiter les forêts de fa-
pin. XIV. 636. a. Voyez Bois.
F o rÉ T , (Jurifpr.) anciennement le ternie dé forêt corn*
prenoit les eaux auffiLbien ' que les bois'. Ce qu’on entendoit
par forêt d’eau, par droit de forêt. Coutumes qui mettent
la forêt au nombre des marques de dfoife baronnie, félon ief-
quelles il faut être au moins châtelain pour avoir droit de
forêt. Les forêts 8c les eaux ont mérite l’attention des loix
8c des ordonnances. Tribunaux 8c Offiéiers établis pour les
eaux 8c forêts. Détail des divers objets traités dans les
ordonnances , 8c finguliérement dans celle de 1669 fur le
fujet dont il s’agit ici. Ce qu’on entend en Angleterre par
enforefter les terras. VII. 132. Voyeç E a u x 8c F o r ê t s .
Forêt y police des forêts. Suppl. Û. 29. b. 30. a. V . 204»
a y b. Terres enforeftées. 673. a. Enquêteurs des forêts.
698. b. Garde des eaux 8c forêts. X V . 89. b. 90. a. 91. b.
92. b. Lignes dans lefqueUer on enferme un efpace vendu
aans les forêts du roi. XII. 338. b. Pié de forêt. 339. a.
Forêts fouterreines, VII. 624. a. X. 92. b. 93. a. XVI,'
469. a. Forêts de bois réfineux dans le Canada. XIV. 706. a.
Forêt-Her c yn ie , ( Géogr.) vafte forêt de la Germanie,
dont les anciens parlent beaucoup. Les anciens fe font trompés
, quand ils ont cru que le mot hart[ étoit le nom particulier
d’une forêt, au lieu que ce terme déAgnoit une forêt
en général Le mot ardeny formé de h ar tf t Agnifioit àufli
forêt en général. Ainfi les anciens fe font ÿbufés dans leur
defeription de la forêt hercynienne. Etendue que lui donne
Céfar» Les montagnes d’Hercyrtie dans là Germanie font
pareillement une chimère. V ÏL 132. b. Voyeç H a r t z 8c
HercynIe.
F o r ê t hercyhiey obfervations fur cet article-de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 87. a.
Forêt dlveline, en France. IX. 3. à.
F o r ê t NÔire , ( Géogr. ■) fylva fnartiana, félon les Ro»
1 mains. Pourquoi on l’a appclléc forêt noire. Villes foreftieres»;
I Elle faifoit anciennement portion de la forêt Hercynie. Defeription
de ce pays. VII. 132. a.
Forêt noire -y obfervations lur cet article de l’Encyclopédie^
Suppl. III. 87 .a.
F o r e t , ( Ar ts méch. ) comment les horlogers réparent leurs
forets; Defeription des parties du foret. Forets des ferruriers.
Différantes formes 8c différens degrés de trempe qu’on
donne à la poiiite. Efpcce de poulie à gouttière qu’on ajuftô
au foret pour s’en fervir. VII. 133. a.
Forett boîte à foret. II. xxx. a. Porte-foret. XII. 140. bi
Foret appellé fraifoir. VU. 278. a. Tourniquet, efpece dé
foret. X v L 484. b. Foret des mineurs,dit trépan; foret dé
même nom des fculpteurs 8c marbriers. 393. a. Villebrequin,
forte de foret. XVII; 272. b. Forets de lerrurier , 830» b.
831. a.
Fo r e t , ( Arquebufer) defeription 8c ufage dé cetinftrliment.
VII. 133. a.
Foret en bois, ( Arqueb. ) VIL 133. b.
Forets pour forer les canons de fufiL Suppl. t l l . 84. a.
F o r e t , ( Bijout. ) différentes formes qu'on donne aux
forets ; félon les ufages auxquels ils font déitinès. VII. 133,b .
Foret y outil dont la plupart des artiftés qui travaillent les
métaux, fe fervent pour percer dés trous. Defeription 8c
ufage. VII. 133. bi
Foret ànoyon. Defeription 8c ufage. VII. 133. b.
Foret y tablette dont on fe fert dans l’imprimerie. VU. 13 3 -
Foret des tonneliers» V II, 13 4. a.
H H H H h h h h h