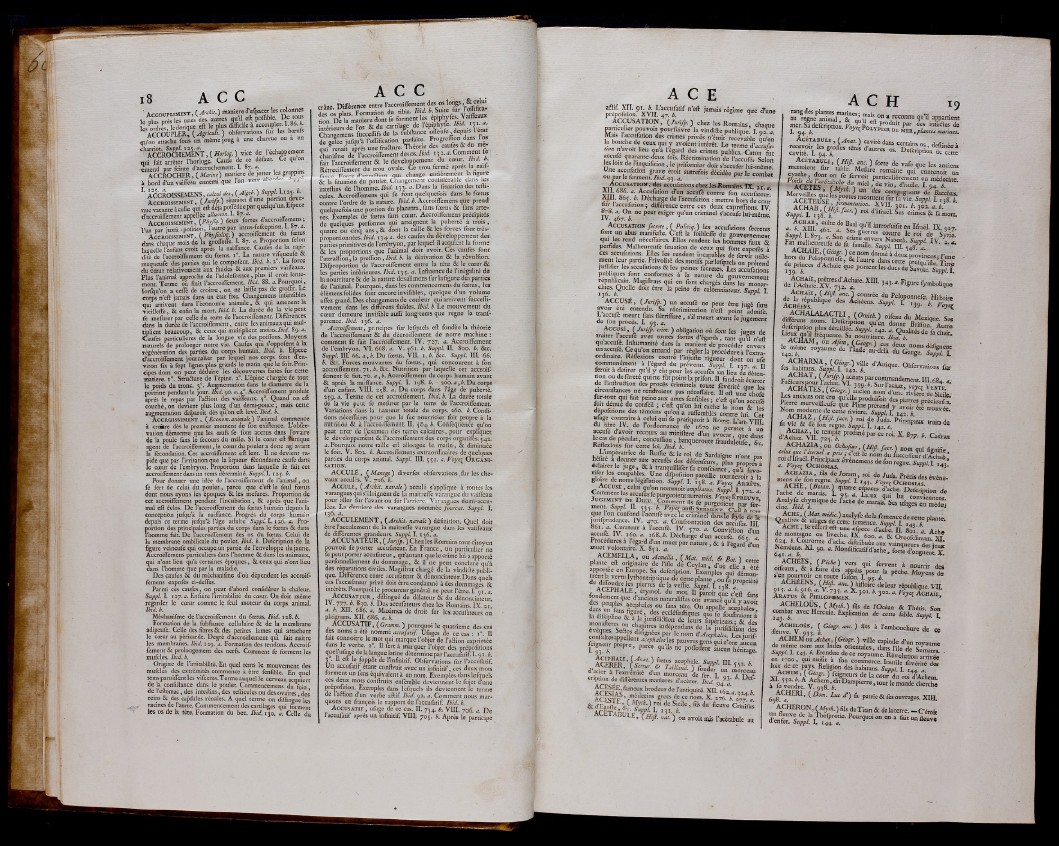
l 8 A C
' A r r n u P L E M B fT , ( Archit. ) minière d’efpacer les colonne!
le plus près les unes des autres qu’il.eft poffible. D e “ us
les ordres, le dorique eft le plus difficile à accoupler. 1. 86. b.
ACCOUPLER, C Agrlcult. ) obfervauons fur les boeufs
qu’on attache fous un même joug à une charrue ou a un
C l'A C C R O ^ H E m I n T , ( Horloe. ) vice de l’échappement
nul fait arrêter l’horloge. Caufe de ce défaut. Ce quon
<entend par feinte d’accrochement. 1. 8y. a. „
ACCROCHER, ( Marine ) maniéré de jetter lBgrÿpms
Il bord d’un vaiffeüu ennemi que l’on vent ” “ Lu . i i j '
P Â f r iiO lS SEM K N S , calcul les , ( Algeb. ) Suppl. \ .l le . b.
A c c r o i s s e m e n t , U portton ¿ v e nue
vacante à celle qui eft déjà poffêdéepar quetqu t
A C C
l’accroiffement des os longs, & celui
.. . V, ■ > f f , ,v 1 Ailin ru u
i.Efpece
(Jurifp.) réunion d’une pc
■ ■ ■ P eft dljapoffêdéepar quel,
d’accroiffement appellée diluvian. 1. 87- a. WSSStt iplw¿deu*. for,ec
Tun par | R B i S M É H É t e d“ il dans chaque mois de la groffeffe. L 87. a Proporuon felon
laquelle l’eu&nt croît après la natffance. Caufes de la rapt
dite de l’acctoiffement du feems. i°. La nature vtfqueufe 8c
jnuqueufe des parties qui le compofent. Ibid. b. a . La force
du coeur Telativement aux fluides & aux premiers vaifleaux.
Plus l’animal approche de l’adolefcence, plusil croit lentement.
Terme ou finit l’accroiflement. Ibid. 88. a.Pourquoi,
lorfqu’on a ceffé de croître, on ne laifle pas de gromr. Le
corps n’eft jamais dans un état fixe. Changemens mfenfibles
qui arrivent dans l’économie animale, oc qui amènent la
vieillefle, & enfin la mort. Ibid. b. La durée de la vie peut
fe mefurer par celle du tems de l’accroiflemenr. Différences
dans la durée de l’accroiflèment, entre les animaux qui multiplient
beaucoup, & ceux qui multiplient moins.Ibid. 89. a.
trufes particulières de la longue vie des poiffons. Moyens
naturels de prolonger notre vie. Caufes qui s’oppofent à la
régénération des parties du corps humain. Ibid. b. Efpece
d'accroiffement journalier par lequel nos corps font a environ
fix à fept lignes plus grands le matin que le foir. Principes
dont on peut déduire les découvertes faites fur cette
matière. i°. Stru&ure de l’épine. a°. L’épine chargée de tout
le poids du tronc. 30. Augmentation dans le diamètre de la
poitrine pendant le jour. Ibid. 90. a. 40. Accroiffement prqduit
âpres le repas par l’aftion des vaifleaux. 50. Quand on eft
couché,on devient plus long d’un demi-pouce; mais cette
augmentation difparoît dès qu’on eft levé. Ibid. b.
A ccroissement, (Econom.animait) l’animal commence
à croître dès le premier moment de fon exiftence. L’obfer-
vation démontre que les oeufs fe font accrus dans l’ovaire
de la poule fans le fecours du mâle. Si le coeur eft ftmique
agent de l’accroiffement, le coeur du poulet a donc agi avant
la fécondation. Cet accroiffement eft lent. Il ne devient raÎtide
que par l’irritation que la liqueur fécondante caufe dans
e coeur de l’embryon. Proportion dans laquelle fe fait cet
accroiflementdansun tems déterminé. Suppl. 1. 123. b.
Pour donner une idée de Paccroiflèment de l’animal, on
fe fert de celui du poulet, parce que c'eft le feul foetus
dont nous ayons les époques & les mefures. Proportion de
cet accroiffement pendant l’incubation, & après que l’animal
eft éclos. De l ’accroiffement du foetus humain depuis la
conception jufqu’à la naiflànce, .Progrès du corps humain
depuis ce terme jufqu’à l’âge adulte. Suppl. L 126. a. ProÇortion
des principales parties du corps dans le foetus & dans
homme fiait. De l’accroiffement des os du foetus. Celui de
la membrane ombilicale du poulet. Ibid. b. Defcription de la
figure veineufe qui occupe un partie de l’enveloppe du jaune.
Accroiffemens particuliers dans l’homme & dans les animaux,
qui n’ont lieu qu’à certaines époques, & ceux qui n’ont lieu
dans l’homme que par la maladie.
Des caufes 8c du méchanifme d’où dépendent les accroiffemens
expofés ci-deffus.
Parmi ces caufes, on peut d’abord confidérer la chaleur.
Suppl. I. 127. a. Enfuite l’irritabilité du. coeur. On doit même
regarder le coeur comme le feul moteur du corps animal.
Ibid. b.
Méchanifme deTaccroiflement du foetus. Ibid. 128. b.
Formation de la fubftance cellulaire & de la membrane
adipeufe. Celle des fibres & des petites lames qui attachent
le coeur au péricarde. Degré d’accroiffement qui fait naître
les membranes. Ibid, 129. a. Formation des tendons. Accroif
fement & prolongement des nerfs. Comment fe forment les
mufcles. Ibid. b.
Origine de l’irritabilité. En quel tems le mouvement des
mufcles des extrémités commence à être fenhble. En quel
tems paroiffent les vifeeres. Terme auquel le cerveau acquiert
de la confiftance dans le poulet. Commencemens du foie
de l’eftomac, des inteilins, des tefticules ou des ovaires des
reins 8c des capfules rénales. A quel terme on diftingue les
racines de l’aorte. Commencement des cartilages qui forment
les os de la tête. Formation du bec. Ibid, 130, a, CeUe du
de eetée iufqu’à l’offification parfaite. Progreflion dans los
qui renaît après une fra&ure. Théorie des caufes & du me-
chanifme de l’accroiffement des os. Ibid. 1 3 2 - g om m e n t fe ,
fait l’accroiffement 8c le développement du coeur. Ibid.b.
Rétreciffement du trou ovale. Ce trou fermé après la naïf
fhncc Tcircë ¿fertvnôtôn qui change entièrement la figure
8c la fituarion du poulet. Changement coniiderable dans les
inteftins de l’homme. Ibid. 133. ¿.Dans la fituation des tefticules.
Accroiffemens qui fe font quelquefois dans le foetus
contre l’ordre de la nature. Ibid. b. Accroiffemens que prend
quelquefois une portion du placenta, fans foetus 8c fans artères.
Exemples de foetus fans coeur. Accroiffemens précipités
de quelques perfonnes qui atteignent la puberté à trois,
quatre ou cinq ans, 8c oont la taille 8c les forces font tres-
proportionnées.Ibid. 134.a. des caufes du développement des
parties primitives de l’embryon, par lequel il acquiert la forme
8c les proportions que l’animal doit avoir. Ces caufes font
l’attraâion,la preflion, Ibid.b. la dérivation 8c la révuMion.
Difproportion de l’accroiffement entre la tête 8c le coeur 8c
les parties inférieures. Ibid. 135. a. Influence de l’inégalité de
la nourriture 8c de la nature desalimens fur la figure des parties
de l’animal. Pourquoi, dans les commencemens du foetus, les
élémensfolides font encore invifibles, quoique d’un volume
affez grand. Des changemens de couleur qui arrivent fuccefli-
vement dans les diftérens fluides. Ibid. b. Le mouvement du
coeur demeure invifible auflx long-tems que regne la tranf-
parencc. Ibid. 13 6. a.
Accroiffement, principes fur lefquels eft fondée la théorie
de l’accroiflement 8c au décroiflement de notre machine :
comment fe fait l’àçcroiffement. IV. 727. a. Accroiffement
de l’embryon. VI. 668'. a. V. 3.61. b. SuppL II. 800. b. 8cc.
Suppl. HL. 66. a,b. Du foetus. VII. 1. b. 8cc. Suppl. III. 66.
b. occ. Forces mouvantes du foetus., qui concourent à fon
accroiffement. 71.. b. 8cc. Nutrition par laquelle cet accroiffement
fe fait. 70. a , b. Accroiffement du corps humain avant
8c après la naiflànce. Suppl. I. 198. b. - 200. ayb. Du corps '
d’un enfant. VIII. 258. a. Du corps, dans l’âge de puberté.
239. a. Terme de cet accroiffement. Ibid. b. La durée totale
de la vie ¡peut fe mefurer par le tems de l’accroiffement.
Variations dans la hauteur totale du- corps. 260. b. Conditions
néceffaires pour que le fuc nourricier foit propre à la
nutrition 8c à l’accroiflement'. H. 304. b. Conféquence qu’on
peut tirer de l’examen, des terres calcaires, pour expliquée
le développement- 8c l’àccroiffement des corps organifes. 342.
a. Pourquoi notre taille eft allongée lé, matin, &c diminuée
le foir. V. 802. b. Accroiffemens extraordinaires- de quelques
parties du corps animal. Suppl. III. 331. a. Voyez O r g a n i sa
t io n .
ACCULÉ, (Manege) diverfes obfervations,fur les chevaux
acculés. V. 716. b.
A c cu l é , ( Archit. navale ) acculé s’applique à toutes les
varangues qui s’éloignent de la maîtreffe varangue du vaiffeau
pour aller fur l’avant ou furl’arriere. Varangues demi-accu-«
lées. La derniere des varangues nommée Jourcat. Suppl. I.
MÊjêk
ACCULEMENT, ( Archit. navale ) définition. Quel- doic
être l’acculement de la maîtreffe varangue dans l'es vaifleaux
de différentes grandeurs. Suppl. I. 136. a.
ACCUSATEUR, ^Jurifp. ) Chez les Romains tout citoyen
pouvoit fe porter accufateur. En France, un particulier ne
fie peut porter accufateur, qu’autant que lecrime lui a apporté
1 — 3 ------------------------ ^ u .a u in .i ,iL v » i , jv/.ins q n c i s
cas 1 accufateur privé doit être condamné à des dommages &
intérêts. Pourquoi lé procureur général ne peut l’être. I. 91. a.
A c cu sa teu r , diftingué du délateur & du dénonciateur!
i 7 v n ‘ ^ es accui*ateurs chez les Romains. IX. 21!
a. b. x n . 686 a. Maximes de droit fur les accufateurs ou
plaignans. XII. 686. a. b.
ACCUSATIF, ( Gramm. ) .pourquoi le quatrième des cas
“ ■ » ¡¡ j Ufagesdé
des noms a été nommé accufatif. Ufages de ce cas : i°. Il
fait connoitre le mot qui marque l’objet de l’a&l’àf
ion exprimée
dans le verbe. 2 . Il fert à marquer l’obiet des nréoofmons
3 .U eft fuppôt l’infinitif.Obfervations fur l’accufatif.
Un accufatif étant confirait avec un infinitif, ces deux mots
forment un fens équivalent à un nom. Exemples dans lefquels
ces deux mots conftraits enfemble deviennent le fujet d’une
Ç f ,n ! 10n' Exemples dans lefquels ils deviennent le terme
de 1 action d’un verbe aftif. Ibid. 92. a. Comment nous marquons
. ---- — , y .UUU1UUUI Jl
p *w j ' v': * • 41 Icrt a marquer l’objet des prépofitions
q^eÎiUl^S? “ ^ ^ g ^ t a h n e détermine par 3 l’accufatif.1.91 .b. ■ — ^ le luppot de 1 înfinmf. r .,. iTot'ic
en françois le rapport de 1-accufatif. Ibid. b.
A c cu sa t if , ufage de ce cas. II. 734. b. VIII. 706. a De
l’accufatif après un infinitif. VIII; 703. b. Après le participe
ACE A C U 19
?rfpoSn9XVÌlL 47CÌ at!f n’Cft ÌamaiS rég!me î “6 dW
ACCUSATION, [jurifp. ) chez les Romains, chaque
partieuher pouvon pouriiuvre la vindifte publique. I 02 u
Mais laccufauon des cnmes privés n’étoil recevable qu’en
la bouche de ceux qui y avoient intérêt. Le terme d W « .
non n avoit heu q u à l égard des crimes publicsvCaton fût
a É H H B B a B Récrimination de l’accufé, Selon
les Ioix de 1 inqmfuton, le pnfonnier doit s’accufer lui-même
Une accufatton grave étoit autrefois décidée par le combat
ou par le ferment. Ibid. 95. a. ■ ‘•umoai
J “ ™ ' des accuiàripns chez les Romains. TX. i f . /
v m l z - raCcUianon d’un accuiî contro fon accufateur.
AU1; 865. b. Décharge de l’accufation : mettre hors de cour
fur 1 acculatimi ; différence entre ces deux expreffions. IV.
878. a On ne peut exiger qu’un criminel s’accufe lui-même
IV. 467. é.
A c c u sa t io n fie rnt, ( Politiq. ) les accufations fecretes
font un abus manifefte. C ’eft la foibleffe du gouvernemeat
qui les rend néceffaires. Elles rendent les hommes faux Sc
perfides. Malheureufe fituation de ceux qui font expofés à
ces accufations. Elles les rendent incapables de fervir utile-
ment leur partie. Frivolité des motifs parlefquels on prétend '
jufttfier les accufations & les peines fecretes. Les accîfàtions
pubhques font conformes à la nature du gouvernement
républicam Magiftrats qui en font chargés dans les monar-
% T b pcir.t: du calomniateur. Suppl. I.
ACCUSÉ, ( Jur'fp. ) un acculé ne peut être iugé fans
ayon été entendu. Sa récrimination n’eft point admife.
L’acculé meurt fans fléniffure , s’il meurt avant je ugemèm
de fon procès. I. 03. a. 6 '
- A c cu s é , ( Jurifp. crim. ) obligation où font les îuees de
traiter 1 acculé avec toutes fortes d’égards, tant qu’U n’eft
qu acculé. Inhumanité dans la maniere de procéder envers
unacculé. Çequ’on entend par régler la procédureà l’extraordinaire.
Réflexions contre l’injufte rigueur dont on ufe
communément à l’égard du prévenu. Suppl. I , , , , n
. o i t * éefiter qu’il y eût pour les acculés un lieu de déten-
nonoudefiiretéqmne fût point la prifon. Il faudrait écarter
de hnftruéhon des procès criminels toute févérité que les
en-confiances ne rendroient pas néceffaire. Il eft une chofe
fur-tout qui fait peine aux ames fenfibles ; c’eft qu’u„ acculé
foit dénué de confed ; c e li qu’on lui cache le nom 8c les
dépofmons des témoins qu’on a raffemblés contre lui. Cet
f e ™ , 5 ! ^ fe H W W i ù Rome. L’art. VUL
du mre IV. de l’ordonnance de 1670 ne permet à un
daT°‘[ rec°urs au miniftere d’un avocat, que dans
lecas de péculat, concuffion , banqueroute frauduleufe, &c
Keflexions fur cette loi. Ibid. b.
I » & I e r o i de Sardaigne n’ont pas
héfité S doimeraux açcufés des défenfeurs, fins propres à
éclairer le juge, & à tranquilüfer fa confidence, qu a ftvo-
nfer les coupables. Une dilpofition pareille tourneroit à la
SS AAsscccscuuisrsrt ra,„ ”cerlIulséiS iq,lua .otin0 nn-o mSumppoLit 1am p-?li8a-m “i.■ ^Suppl I - ment. Suppl. II 53,. i f * ^
que 1 on confond!accuféavec le criminel dansle ftyle delà I
lurifprudence. IV. 470. a. Confrontation des accufés III
861. a. Curateur à l’accufé. IV. 370. a. Conviftirm
Procêli Déchars e d'“ " accufé. 665. a.
^ v 7 oniaireSX 8;.n M M ’& 4 W l
ACEMELLA, ou Acmclla, {Mal. mli. & Bat. ) cette
plante eft originaire de l’ille de Ceylan, d’où elle a été
apportée en Europe. Sa defcription. Exemples qui démon-
de d-lr vam,11y ,h?nmP“ q"o de cette plante , ou fa propriété
A r c n u f r c pi5 res dc Ia véfiîe. Suppl. 1. 138. a
ACEPHALE, étympl. du mot. Il paraît que c’eft fans
k " ^ U u r & 8à“ i^ ;t^ ^ „ n “ ?ues '(!“ fe fouftraient i
r v Z f r i e & s I é f ' t indipf " d- U| ¿ 1 u S d S :
1 . 93. b. q poffedent aucun héritage.
J e 111 *•
d acier à l’extrémité d’un morceau de fer I *!?, T r ?1’r
cription de différentes maniérés d’acérer. Ibid.
A c l u s feraeé T brodeur de11'a,'titiuitè- xn- t«2.a. 3 24.}.
A C F S T P V m,t def 1sS SreCS 1 ce nom- X . 276. b. 2 ,7 a
& P ® p H P ) i oi dc M i > S d“ fleuve Crinifui
r ,4 ™ ' ! s T g ï ï :4 <- w S i s i .pp.»!.«
mer.Sadeficripriou. F b y r jP o lv p ie r d e wrn 1
I. 94. b. 1£R D em e r tplantes marines,
^ ^ g X p ^ r a c o n t t oe S ^ .
-
de prmees dA chaie que portent les ducs de S a v L . Sü JpU.
A c h a ie , ( Hifl. une. ) contrée du Pelooonnefo Hin •
AcHéEt UbliqUe des Àché™- ÉËH 1 i f e
Sa uourriture. Aay “ &Chm-
ta même rayTumÎ î ' f e & S
d'AtÜtIUe- d a t i o n s fur
F a a ™ p l i i V S : ^ c"Topr s deme” - A C R À T K C ( r " \ ' achat, voyez V en te .
T p f / » ( Geogr. ) ancien nom' d’u n / r ivie ra d e S id îe <
d Æ ZV lÎ e “ 7 Pr° tani par “ X 877. é. Cadran
a ^ ? { OcZsÏTsX KmCnS de Con K«”e- 1 >43:
A c h a z ia , fils de Joram, roi de Juda. Précis des événe.
mTcMfL ( H T ‘ \ PJ,L f m ^ fO C H O S lA S
A u a l y f o c h r iq u e 'e & h e de m a r a ^ 'L '^ “ T m é d ^
' n A uIl £’/ d^ '' ” "?“ •) a"alyfc delà femence de cette niante
Quabrés & ufages de cette femence. Suppl. I. r a V T
A c b e , le célcn eft une elpece- d’aefre. B. 8ot a. Ache
de montagne ou hveche. I t . 600. a. & Oreofehnum XL
624. b. Couronne d ache diftribuée aux vainqueurs des i S
Néméens. XI. 90. a. Mondificarifd’ache, for?e d“ ^ , t X.
'ÆÊ * eiî P®ui V01r en toute fajfon. L oc. b. 7 de
^ A CH É EN S , (ffi/ l. anc. H ifto tre de leur république. V IL
1 de^1 remboucïure cetre I b l ^ f t
fleAveHV ° o 3 j . Ê à }de c e
A CH EM ou AcAeu, (Geogr. ) v ille capitale d’un rovaume
de même nom aux Indes onentales, dans l’Ue de S u m ^
Suppl. I. 143 - L Etendue de ce royaume. Révolution am v £ '
en 1700, qui ninfic a fon commerce. Inutile févérùé d «
loix de ce pays. Rehg,on des habitans. Suppl. I , L '
X I s t T i ’i A c i f - a-gn UfS de la cour du roi d’Achem.
SeVendra Pierre’ t0Utlem0nd' Cherche
69ACaHER1, ( D “m' fl» Patrie & les ouvrages. XIH.
Il n'ft?PIERlOIji ’ } ffls de Titan & de la terre. — C ’étoit
d’unki sîpp}. L P°UrqU0i0n £" a ^ “ufluuv«