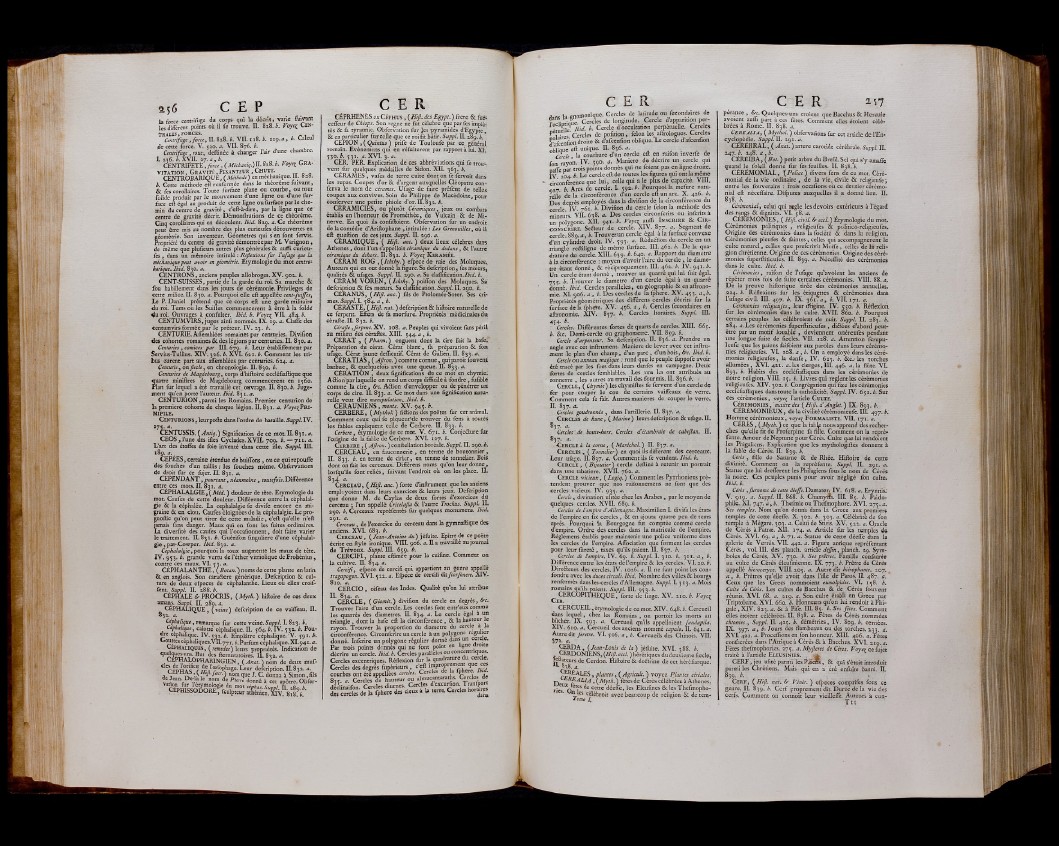
2 5 6 CEP la force centrifuge du corps qui la décrit» varie fuiyant
les différons points où il fe trouve. IL 828. b. Voye[ CENTRALES
, FORCES. . / ' i l
Centrifuge, force, II. 828. b. VII. 118. b. 119. a , b. Calcul
de cette force. V. 520. a. VU» 876. b.
Centrifuge , rouet deflinée à changer l’air d une chambre,
ï. 236. b. XVII. 27. * , b. v r n o , i H É
CENTRIPETE, force , ( Méchaniq.)U. 828. b. Voye^ GRAVITATION
, G ravité , Pesanteur , C hute.
CENTROBARIQÜE, (Méthode) en méchamque. II. 82»»
b. Cette méthode efl renfermée dans le théorème fiuvant,
& fes corollaires. Toute furface plane ou courbe, ou tout
tolide produit par le mouvement d’une ligne ou d’une iur-
fàce eft égal au produit de cette ligne oufurfece parle che-
ihin du centre de gravité, c’eft-à-dire, par la ligne que ce
centre de gravité décrit. Démonftrations de ce théorème.
Cinq corollaires qui eri découlent» Ibid. 829. a. Ce théorème
peut être mis au nombre des pius curieuies découvertes en
géométrie. Son inventeur. Géomètres qui s’en font fervis.
Propriété du centre dé gravité démontrée par M. Varignon,
de môme que plufieurs autres plus générales & aufli curieuies
, dans un mémoire intitule : Réflexions fur l ’ufage que la
mèchanique peut avoir en géométrie. Étymologie du mot centre*
banque. Ibid. 830. a.
CENTRONS, anciens peuples allobroges. XV. 902. b.
CENT-SUISSES,partie de la garde du roi. Sa marche &
fou habillement dans les jours de cérémonie. Privilèges de
cette milice. II. 830. a. Pourquoi elle eft appellée cent-fuijfes,
Le P. Daniel prétend que cè corps ell une garde militaire
du roi. Tems ou les Sûmes commencèrent à être à la folde
^u roi. Ouvrages à confulter. Ibid. b. Voyeç VIL 484. b.
CENTUMVIRS,juges ainii nommés.IX. 19.a. Clalle des
Centumvirsforméepar le préteur.IV. 23. b.
CENTURIE. AlTemblées romaines par centuries. Divifion
des cohortes romaines & des légions par centuries. II. 830. a.
Centuries, comices • par III. 670. b. Leur étabuiTement par
Servius-'t'uUius. XlV. 326. b. XVI. 621. b. Comment les tribus
curent part aux âuemblées par centuries. 624. a.
Centurie y oufiecle, en chronologie» II. 830. b.
Centuries de Magdebourg, corps d hifioire eccléiialtiqne que
?uatre miniilres de Magdebourg commencèrent en 1500.
lan fur lequel a été travaillé cet. ouvrage. II. 830. b. Jugement
qu’en porte fauteur. Ibid. 831. a.
CENTURION,parmi les Romains. Premier centurion de
la première cohorte de chaque légion. II. 831. a. Voye^P r i -
m i p i l e .
C enturions, leur pofte dans l’ordre de bataille.Suppl.IV.
7£enTUSSIS. ( Ântiq. ) Signification de ce mot. IL 831.«.
CEOS, l’une des iiles Cyclades. XVIl. 709. b. — 711. a.
L’art des étoffes de foie inventé dans cette îfle. Suppl. IIL
189. a.
CEPÉES , certaine étendue de buifions, ou ce qui repoufte
des Touches d’un taillis: les fouches même. Obfervations
de droit fur ce fujet. H. 831. a.
CEPENDANT, pourtant, néanmoins , toutefois. Différence
entre ces mots. II. 831. a.
CÉPHALALGIE, ( Méd. ) douleur de tète. Etymologie du
mot. Caufes de cette douleur. Différence entre la céphalalgie
& la céphalée. La céphalalgie fe divife encore en migraine
& en clou. Caufes éloignées de la céphalalgie. Le pro-
gnoitic qu’on peut tirer de cette maladie, c’eft qu’elle n’eft
jamais fans danger. Maux qui en font les fuites ordinaires.
La diverlitè des caufes qui l’occafionnent, doit faire varier
le traitement.' IL 831. b. Guérifon finguliere d’une céphalalgie
, par^Cowper. Ibid. 832. a.
Céphalalgie, pourquoi la toux augmente les maux de tête.
IV. 953 .b. grande vertu de l’éther vitriolique de Frobénius,
contre ces maux. VI. 53. a.
CÉPHALANTHE, (Botan.) noms de cette plante en latin
& en anglois. Son caraétere générique. Defcription & culture
de deux efpeces de céphalanthe. Lieux ou elles croif-
fent. Suppl. II. 288. b.
CÉPHALE & PROCRIS, ( Myth. ) hifioire de ces deux
amans. Suppl. H. 289. a.
CÉPHALIQUE, ( veine ) defcription de ce vaifleau. II.
Céphalique, remarque fur cette veine. Suppl. 1. 823. b.
Céphalique, calotte céphalique. II. 564.b. IV. 532. b. Poudre
céphalique. IV. 532. b. Emplâtre céphalique.’V. 591. b.
ixouttes céphaliques.VlL 77 r. b. Parfum céphalique. XI. 941. a.
Cep h a liq u e s , ( remedes) leurs propriétés. Indication de
atSX®ui Ü ! Rernutatoires. II. 832. a.
ÇÉPHALOPHARINGIEN , ( Anat. ) nom de deux muf-
r & H Ï w Leur defcription. n.832. a.
JaT n i W nom que J de Jean. De-la le nom de Pierre . C. donna à Simon, fils c ,,, _ , . uc. rierre donne aa ZceÛt apaô tre. nOib fre-rÇÉPHISSOÛORE,
fculp; ; „ f o d h m fi. »89. b. IV. 818. b.
C E R
CÉPRHENÈS ou C éphus , {Hiß- des Egypt. ) frere €c firc*
ccffeur de Chéops. Son regne ne fut célebre que par fes impi¿¿
tés & fa tyrannie. Obfervation fur jes pyramides d’Egypte,
& en particulier fur celle que ce roi fit batir. Suppl. II. 289. b.
CEPlON, ( Quintus ) prife de Toulbufe par ce général
romain. Evénemens qui en réfulterent par rapport à lui. XI.
530. b. 531. a. XVI. 3. a.
CER. PER. Explication, de ces abbréviations qui fe trous
vent fur quelques médailles de Sidon. XII. 363. b.
CÉRAMES , vafes de terre cuite dont on fe fervoit dans
les repas. Coupes d’or & d’argent auxquelles Cléopatre con-
ferva le nom de cérames. Ufage de faire préfent de telles
coupes aux convives. Soin de Philippe de Macédoine, pour
conter ver une petite phiole d’or. II. 832. b.
CÉRAMICIES, ou plutôt Céramiques y jeux ou combats
établis en l’honneur de Prométhée, de Vulcain & de Minerve.
En quoi ils confiftoient. Obfervation fur un endroit
de la comédie d’Ariffophane , intitulée : Les Grenouilles, où il
eil quefiion de ces jeux. Suppl. IL 290. a.
CÉRAMIQUE, ( Hiß. anc. ) deux lieux célebres dans
Athènes, dont l’un s’appelloit céramique du dedans y & l’autre
céramique du dehors. IL 832. b. Voyeç Keramée.
CÉRAM ROG , (Ichthy.) efpece de raie des JVloluques».
Auteurs qui en ont donné la figure. Sa defcription » fes moeurs,
Tífificatión./¿/</. b.
. S f
defcription & fes moeurs. Sa daâification. Suppl. II. 290.
CÉKANUS, (Hiß. anc.) fils de Ptolomée-Soter. Ses crimes.
Suppl. L 584. a y b.
CÉRASTE, (Hiß. nat. ) defcription & hifioire naturelle de
ce ferpent. Effets de fa morfure. Propriétés médicinales du
cérafie.II. 832. b.
Cérafie, ferpent. XV. xo8. a. Peuples qui vivoient fans péril
au milieu des cérafies. XIII. 544.a , b.
CÉRAT , (Pharm.) onguent dont la ciré fait la baie.'
Préparation du cérat. Cérat blanc, fa préparation & fon
ufage. Cérat jaune defficatif. Cérat de Galien. II. 833. 0. .
CÉRATIAS, ( Aßron.) comete cornue ^qurparoît iouvenj
barbue, & quelquefois avec une queue. IL 833. a.
CÉRATION , deux fienifications de ce mot en chymie.'
Aélion par laquelle on rend un corps difficile à fondre, fufible
comme la cire, &c. Aétion d’envelopper ou de pénétrer uii
corps de cire. Ú. 833. a. Ce mot dans une lignification naturelle
veut dire manipulation^lbid. b.
CERAUNIENS, monts. XV. 945. b.
CERBERE, (Mythol:) fixions des poètes fur cet animal.
Comment ceux qui fe piquent’de trouver du fens à toutes
les febles expliquent celle de Cerbere. II. 833. b.
Cerbere, étymologie de ce mot. V. 671. b. Conjecture fur
l’origine de la feble de Cerbere. XVI. 127. b.
C erbere , ( Aßron. ) confiellation boréale. Suppl. ü . 290. b.
CERCEAU, en fauconnerie, en terme de boutonnier,
H. 833. b. en terme de cirier, en terme de tonnelier. Boiâ
dont on feit les cerceaux. Différens noms qu’on leur donne,
lorsqu'ils font reliés, fuivant l’endroit où on les place. IL
834- a•
C erceau, (Hiß. anc. ) forte d’infirument que les anciens
emplcyoient dans leurs exercices 8c leqrs jeux. Defcription
que donne M. de Caylùs de deux fortes d’exercices du
cerceau 3 l’un appellé Cricelafia & l’autre Trochus. Suppl. IL
290. b. Cerceaux repréfentés fur quelques monumens. Ibid.
* 9 1C’e rac'e au, de l’exercke du cerceau dans la gymnafntii que dJ es
anciens. XVL 683. b.
C erc eau , (Jean-Antoine du) jéfuite. Epitrede ce poète
écrite en ftyle ironique. VIH. 906. a. R a travaillé au journal
de Trévoux. Suppl. 111. 659. b.
CERCIFI, plante efiimée pour la cuifine. Comment on
la cultive, ü . 834. a.
Cercifi y efpece de cercifi qui appartient au genre appelle
tragopogón. XVI. 522. a. Efpece de cercifi dit feorfonere. XIV.
8x0. a.
CERCIO, oifeau des Indes. Qualité qu’on lui attribue
H. 834. a. '
CERCLE, (Géomét.) divifion du cercle en degrés, vc:
Trouver l’aire d’un cercle. Les cercles font entr’eux comme
les quarrés des diamètres. II. 834. a. Le cercle égal à un
triangle, dont la bafe eft la circonférence , & la hauteur le
rayon. Trouver la proportion du diametre du cercle a la
circonférence. Circonfcrire un cercle à un polygone régulier
donné. Inferiré un polygone régulier donné dans un cercle.
Par trois points donnés qui ne font point en ligne c roite
décrire un cercle. Ibid. b. Cercles paralleles ou concentriques.
Cercles excentriques. Réflexion <Sr 1» quadrature du cercle.
Cercles des degrés fupérieurs , c’eft impr°Prfn1? it
courbes ont été appelfées ardes. Cercles de a fthere. lb,i.
835. e. Cercles de hauteur ou almucantaradis. Cercles de
diclinaifon. Cercles diurnes. Cercles d excuriion. Tranft
des cercles de la fphere des deux i la terre. Cercles hotajrg
C E R
, 1 enotnonique. Cercles de latitude ou feeondaires de
l’ecliDdque. Cercles de longitude. Cercle dappanuon per-
s file Ibid. b. Cercle d’occultation perpétuelle. Cercles
P , . Cercles de pofition, félon les allrologues. Cercles
Svftenfion droite & d’afeenfion oblique. Le cercle d’afeeniion
oblique eft unique. H. 836. a.
Cercle la courbure d’un cercle eft en raifon inverfe de
fon rayon. IV. 390. et. Maniéré de décrire un cercle qui
oafle par trois points donpès qui ne foient pas en ligne droite.
IV 204. b. Le cercle eft de toutes les figures qui ont la même
■ circonférence que lui, celle qui a le plus de capacité. VIII.
027. b. Arcs de cercle. I. 392. b. Pourquoi la mefure naturelle
de la dreonférenee oun cercle eft un arc. X. 426. b.
Des degrés employés dans la divifion de la circonférence du
cercle IV. 761. b. Divifion du cercle félon la méthode des
mineurs VII. 638. et. Des cercles circonfcrits ou inferits à
un polygone. Xll. 94x. b. Voyez Inscrire & C irconscrire.
Se&eur de cercle. XIV. 877. *. Segment de
cercle. 889. a, b. Trouver un cercle égal à la furface convexe
ti’un cylindre droit. IV. 593. Réduélion du cercle en un
triangle reftiligne de même furfece. III. 462. b. De la quadrature
du cercle. XIII. 639. b. 640. a. Rapport du diametre
à la circonférence : moyen d’avoir l’aire du cercle, le diametre
étant donné, & réciproquement. III. 462. b. IV. 941. b.
Un cercle étant donné , trouver un quarré qui lui foit égal.
735. b. Trouver le diametre d’un cercle égala un quarré
donné. Ibid. Cercles parallèles, en géographie & en aftrono-
mie. XI. 906. a , b. Des cercles de la fphere. XV. 453. ayb.
Propriétés géométriques des différens cerclés décrits fur la
furface delà fphere. XV. 456. a , b. Cercles feeondaires en
aftronomie. XlV. 857. b. Cercles horaires. Suppl. III.
434. b. _____
' Cercles. Différentes fortes de quarts de cercles. XIII. 663.
b. &c. Demi-cercle ou graphoraetre. VII. 839. b.
Cercle d’arpenteur. Sa defcription. II. 836. a. Prendre un
angle avec cet infiniment. Manière de lever avec cet inftru-
anent le plan d’un champ, d’un parc, d’un bois, 6»c. Ibid.b.
Cercle ou anneau magique : rond que le peuple fuppofe avoir
été tracé par les fées dans leurs danfes en campagne. Deux
fortes de cercles femblables. Les uns les ont attribués au
tonnerre , les autres au travail des fourmis. II. 836. b.
C ercle, ( Chymie) les chymiftes fe fervent d’un cercle de
fer pour couper le cou de certains vaiffeaux de verre.
Comment cela fe feit. Autres maniérés de couper le verre.
IL 837. a. '•
Cercles goudronnés , dans l’artillerie. IL 837. 'a.
C ercles de hune, (Marine) leurs defcription & ufage. H.
837. a.
Cfrcles [ de boute-hors. Cercles d'ci ambrai e de cabejlan. IL
837. a.
CERCLE d la corne, (Maréchal.) II. 837. a.
C ercles , ( Tonnelier) en quoi ils différent des cerceaux.
Leur ufage. II. 837. a. Comment ils fe vendent. Ibid. b.
C^-e-r--c-l--e ,j ('( Bijout ier) c )e c ercle deftiné à retenir un portrait
dans une tabatière. XVlI. 762. a.
C ercle vicieux, ( Logiq. ) Comment les Pyrrhoniens prétendent
prouver que nos raiionnemens ne font que des
cercles vicieux. IV. 933. a.
Cercle y divination ulitée.chez les Arabes, par le moyen de
quelques cercles. XVII. 689. b.
Cercles de l’empire d’Allemagne. Maximilien I. divifa les états
de l’empire en fix cercles, ot en ajouta quatre peu de tems
après. Pourquoi la Bourgogne fut comptée comme cercle
d’empire. Ordre des cercles dans la matricule de l’empire.
Réglemens établis pour maintenir une police uniforme dans
les cercles de l’empire. Affociation que forment les cercles
pour leur fureté, taxes qu’ils prient..11. 837. b. ,
Cercles de Iempire. IV. 69. b. Suppl. I. 310. b. 311. <x, b.
Différence entre les états de l’empire & les cercles. VI. 20. b.
Direfteurs des cercles. IV. 1026. a. Il ne feut point les confondre
avec les duces circuli. Ibid. Nombre, des villes & bourgs
renfermés dans les'cercles d’Allemagne. Suppl. 1. 313. a. Mois
romains qu’ils paient. Suppl. III. 933. b.
^ CERCOPITHEQUE, forte de finge. XV. 210. b. Voyeç
CERCUEIL, étymologie de ce mot. XIV. 648. b. Cercueil
dans lequel, chez les Romains , 011 portoit les morts au
bpeher. IX. 393. a. Cercueil qu’ils appelloient fandapila.
XIV. 610. a. Cercueil des anciens nommé capulo. il. 641. a.
Autre dit feretre. VI. 306. a , b. Cercueils des Chinois. VII.
37»- a.
CERDA, (Jean-Louis de la) jéfuite. XVI. 388. b.
f £ ERD°NIENS, (Hifl. eccl. ) hérétiques du deuxième fiecle,
««ateurs de Cerdon. Hifioire & doélrine de cet héréfiarque.
c ï ' *' '
voyez Plantes céréales.
D ”f - 4LIA, ( Myth. ) fêtes de Cêrès célébrées à Athènes,
ries OrT?8 cette les Eleufines & les Thefmophountes'célébroit
avçcbeaucoup de religion & detera-
C E R 257
pèrance, ê*c. Quelques-uns croient que Bacchus & Hercule
avoient aufli part à ces fètes. Comment elles étoient célébrées
a Rome. II. 838. a.
Cerealia y ( Mythol. ) obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 291 .a.
CÉRÉBRAL, ( Anat. ) artere carotide cérébrale. Suppl. H.
247. b. 248. a y b.
CÉRÉIBA, ( Bot. ) petit arbre du Brefil. Sel qui s’y amaffe
quand le foleil donne fur fes feuilles. IL 838. b.
CÉRÉMONIAL, ( Police ) divers fens de ce mot. Cérémonial
dé la vie ordinaire , de la vie, civile & religieufe ;
entre les fouverains : trois occafions où ce dernier cérémonial
eft nèceffaire. Difputes auxquelles il a donné lieu. II.
838. b.
Cérémonial» celui qui regle les devoirs extérieurs à l’égard
des rangs & dignités. VI. 38. a.
CÉRÉMONIES, ( Hiß. civil. £> eccl. ) Étymologie du mot.
Cérémonies politiques , religieùfes « politico-religieufes.
Origine des cérémonies dans la fociété oc dans la religion.
Cérémonies pieufes & feintes, celles qui accompagnèrent le
culte naturel, celles que preferivit Moïfe, celles de là religion
chrétienne. Origine de ces cérémonies. Origine des cérémonies
fuperftitieufes. II. 839. a. Néceîfité des cérémonies
dans le culte. Ibid. b.
Cérémonies y raifon de l’ufage qu’avôient les anciens de
répéter trois fois de fuite certaines cérémonies. VIII. 88. a.
De la preuve hiftorique tirée des cérémonies annuelles.
224. b. Réflexions fur les étiquettes & cérémonies dans
l’ufege civil. III. 497. b. IX. 361T0, b. VII. 171 .a.
Cérémonies religieùfes y leur drigine. IV. 330. b. Réflexion
fur les cérémonies dans le culte. XVII. 860. b. Pourquoi
certains peuples les célébraient de nuit. Suppl. IL 283. b.
284. a. Les cérémonies fuperftitieufes , diftées d’abord peut-
être par un motif louable , deviennent onéreuiès pendant
une longue fuite de fiecles. Vil. 128. a. Attention ferupu-
leufe que les païens feifoient aux paroles dans leurs cérémonies
religieùfes. VI. 208. a , ¿.'On à employé dans les cérémonies
religieùfes, la danfe, IV. 623. b. &c.- les torches
allumées , XVI. 421. a. les cierges, III. 446. a. la flûte. Vï.
893. b. Habits des ecdèfiaftiques dans les cérémonies de
noue religion. VIII. 13, b. Livres qui regle» les cérémonies
religieùfes. XIV. 302. b. Congrégation qui fixe lès cérémonies
ecdèfiaftiques dans toute la catholicité. Suppl. IV. 631. b. Sut
ces cérémonies, voye^ l’article C ulte.
CÉRÉMONIES, 'maître des ( Hiß» d’Anglet.) ÎX. 893. b.
CÉRÉMONIEUX, de la civilité cérêmonieufe. IH. 497. b.
Homme cérémonieux, voyer F ormaliste. VIL 171. a.
CÉRÈS, (Myth.) ce que la fabk nous apprend des recherches
qu’elle fit de Proferpine fe fille. Comment on la repréfente.
Amour de Neptune pour Cérès. Culte que lui rendoient
les Phigalicns» Explication que les mythologiftes donnent <l
la fehle de Cérès. II. 839. b.
Cérès, fille de Saturne & de Rhée. Hifioire de cette
divinité. Comment on la repréfente. Suppl. IL 291. u»
Statue que lui drefierent les Philagiens fous le ndm de Cérès
la noire. Ces peuples punis pour avoir négligé fon culte»
Ibid. b.
Cérès yfurnoms de cette déejfe. Damater» IV. 618. a. Erynnis.'
V. 919. a. Suppl. H. 868. b. ChamyfTa. III. 83. b. Paido-
phile. XI. 747. a,b. ThefmieouThefmophore. XVI. 273» a.
Ses temples. Nom qu’ôn donna dans lâ Grece aux premiers
temples de cette deefle. X. 302. b. 303. a. Célébrité de fon
temple à Mégare. 303. a. Celui de Stiris. XV. 322. a. Oracle
de Cérès àPatræ. Xll. 174. a. Article fur les temples dç
Cérès. XVI. 69. a , b. 71. a. Statue de cette déefie dans la
galerie de Verrès. VII. 442. a. Figure antique repréfenrant
Cérès, vol. III. des planch. article deffm, planch. 29. Symboles,
de Cérès. XV. 730. b. Ses prêtres'. Famille confecrée
au culte de Cérès éleulinienne. IX. 773. b. Prêtre de Cérès
appellé hieroceryce. VIII. 203. a. Autre dit hiérophante. 207..
a , b. Prêtres qu’elle avôit dans l’ifle de Paras. H. 487. a.
Ceux que les Grecs nommoient eumolpides. VI. 138. ¿.
Culte de Cérès. Les cultes de Bacchus & de Cérès fouvent
réunis. XVI. 68. a. 219. <*. Soa culte établi en Grece par
Triptoleme. XVI. 660. ¿..Honneurs qu’on lui rendoit à Phi-
gale, XIV. 822. a. & à Pife. IIL 83. b. Ses fites. Comment
elles étoient célébrées. IL 838. a. Fêtes de Cérès nommées
chtonies y Suppl. II. 425. b. démétries, IV. 809. b. cernées.
IX. 397. a, b. Jours des flambeaux ou .des torches. 233. a.
XVI. 421. a. Proceiïions en fon honneur. XIÎL 406. a. Fêtes
confacrées dans l’Attique à Cérès & à Bacchus. XVI. 219. a.
Fêtes thefmophories. 273. a. Myfleres de Cércs. Voye{ ce fejet
traité à l’article Eleüsinies. *
CERF, jeu ufité parmi le sP jïe» , 8c qui s’étoit introduit
parmi les Chrétiens. Mais qui en a été enfuite banni. IL
¡ P i i 5 ¡ ¡ g | M ■
Cer f , (Hiß. nah & Vénèr. ) efpeces comprifés fous ce
genre. II. 839. b. Cerf proprement dit. Durée de la vie de?
cerfs. Comment on connoit leur Yieilleiïè. Auteurs à con-
T t t