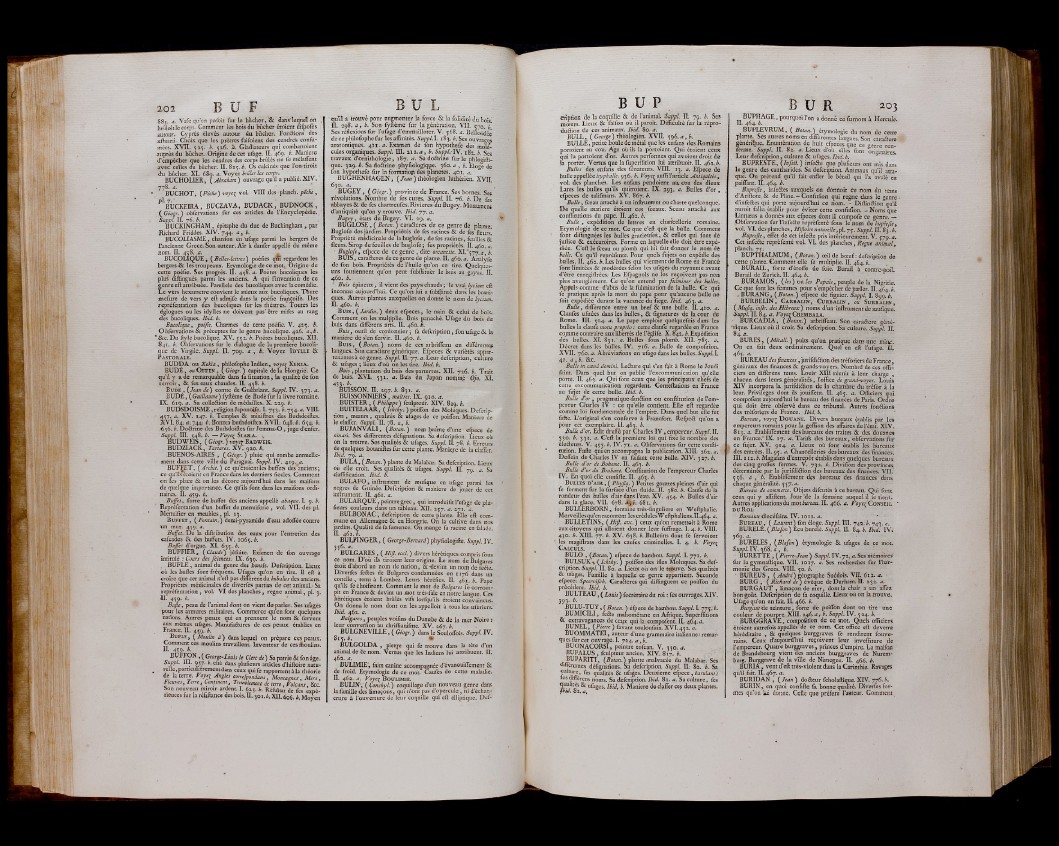
202 B U F B U L
88ç. a. Vafe qu’on pofoit fur ie hucher, dans'lequel on .
brûloir le corps. Gomment les bois du bûcher étoient difpofés
autour. Cyprès élevés autour du bûcher. Fondions des
ufhiarii. Choix que les prêtres faifoienc des cendres confirmées.
x v n . <525. b. 526. a. Gladiateurs qui combattoient
auprès du bûcher. Origine de cet ufage. II. 469. b. Maniéré
d’empêcher que les cendres des corps brûlés ne fe mêlaffent
avec celles au bûcher. II. 8iç. b. Os calcinés que l’on*droit
du bûcher. XI. 689. a. Voyez brûler les corps.
BUCHOLIER, ( Abraham ) ouvrage qu’il a publié. XIV.
778. a.
BUCHOT, (Pêche) voyei vol. VIII .des planch. peche,
pl. 7. ' •
BUCKEIRA, BUCZAVA, BUDACK, BUDNOCK,
( Géogr.) obfervations fur ces articles, de l’Encyclopédie.,
Suppl. IÏ. 76. b.
BUCKINGHAM, épitaphe du- duc de Buckingham, par
Richard Friddes. XIV. 744. a , b.
BUCOLIASME, chanfon en "ufage parmi les bergers de
L’ancienne Grece. Son auteur. Air à danfer appelle du même
nom. II. 4V8. a.
BUCQLIQUE, ( Beües-lettres ) poéfies qui regardent les
bergers 8c les troupeaux. Etymologie de ce mot. Origine - de
cette poéfie. Ses progrès. II. 458. a. Poètes bucoUques les
plus diftingués. parmi les anciens. A qui l’invention de ce
genre eft attribuée. Parallèle des bucoliques avec la comédie.
Le vers hexametre convient le mieux aux bucoliques. Tbute
mefure de vers y eft admjfe dans la poéfte françoife. Des
repréfentations des bucoliques fur les théâtres.* Toutes les
églogues ou les idylles ne doivent pas’ être mifes au rang
des bucoliques, lbid. b.
Bucolique, poéfie. Charmes de cette poéfte. V. 425. b.
Obfervations & préceptes fur le genre bucolique. 426. a,b.
* Scc. Du ftyle bucolique. XV. 552. b. Poè'tes bucoliques. XII.
841. b. Obfervations fur le dialogue de la première bucolique
de Virgile..Suppl. H. 709. a , b. Voyez Idylle 8c
Pastorale.
BUDDA ou Xekia, philofophe Indien, voyez X e k i a .
BUDÉ, ou O f f en , (Géogr.) capitale de la Hongrie'. Ce
qu’il y a de remarquable dans la fttuation, la qualité de fon
terroir, & fes eaux chaudes. Q. 458. b.
Bude , ( Jean de ) comte de Guébriant. Suppl. TV. 373. a.
BUDÉ, ( Guillaume) iyftême de Budé fur la livre romainé.
IX. 619. a. Sa collection de médailles. X. 229. b.
BUDSDOISME, religion Japonoifc. I. 733. b. 754. a. VIII.
• 437. a. XV. 147. b. Temples & miniftres des Budsdoïftes.
XVI. 84. a. 744. b. Bonzes budsdoïftes. XVII. 648. b. 634. b.
.656. b. Do&rine des Budsdoïftes fur Jemma-O, juge d’enfer.
Suppl. III. 548, b. — Voye^ SlAKA. t
JdUDWEIS , ( Géogr. ) voyez Ba üWEIS.
BUDZIACK, Tartares. XV. 920. b.
BUENOS-AIRES , (Géogr.) pluie qui tombe annuellement
dans Cette ville du Paraguai. Suppl. IV. 419. a.
BUFFET, ( Archit.) ce qu’étoientles buffets des anciens;
ce qu’ils étoient en France dans les derniers ftecles. Comment
on les place & on les décore aujourd’hui dans les maifons
de quelque importance. Ce qu’ils font dans les maifons ordinaires.
II.. 43 9. b. ¡5
Buffet, forte de buffet dés anciens appellé abaque. I. 9. b.
Repréfentation d’un buffet de menuiferie, vol. v il. des pl.
Menuiftcr en meubles, pl. 13..
Bu ffe t , (Fontain. ) derai-pyramide d’eau adoflée contre
un mur. 459.'<1.
Buffet. De la diftribution des eaux pour l’entretien des
cafcades & des buffets. IV. 1065. b.
Buffet d’orgue. XI. 635. b.
BUFFIER, ( Claude) jéfuite. Examen de fon ouvrage
intitulé : Cours des fciences. IX. 639; b.
. BUFLE, animal du genre des boeufs. Defçription. Lieux
où les bufles font fréquens. Ufages qu’on en tire. Il eft à
croire que cet animal n’eft pas différent du bubalus des anciens.
Propriétés médicinales de diverfes parties de cet animal.- Sa
repréfentation, voL VI des planches, regne animal, pl. 3.
11.459- b. . \
Bufle, peau de l’animal dont on vient do parler. Ses ufeges
pour les armures militaires. Commerce qu’en font quelques
nations. Autres peaux qui en prennent le nom 8c fervent
aux mêmes ufages. Manufactures de ces peaux établies en
France. U. 459. b.
Bufle, ( Moulin à ) dans lequel on prépare ces peaux.
Comment ces moulins travaillent. Inventeur de ces ifioulins.
U. 459-
BUFFON, ( George-Lôuis le Clerc de) Sa patrie & fon âge.
Suppl. 111. 957. b. cité dans plufteurs articles d’hiftoire natu-
i reUe,particulièrement dans ceux quife rapportent àla théorie
de la terre. Voyez Angles correfpondans, Montagnes, Mers,
Fleuves, Terre,4 Continent, Tremblement de terre, Volcans &c.
Son nouveau miroir-ardent. I. 625. b. Rèfultat de fes expériences
fur la réûftance des bois. II. 301. b. XU. 60$. b, Moyen
qu’il a trouvé pour augmenter la force & la folidité du fcoîs.
IL 298. a, b. Son- fyltême fur la génération. VII. *70. b
Ses réflexions fur l’ufege d’emxtiailloter. V. 568. a. Belle«idcê
de ce philofophe fur les affinités. Suppl. I. 183. b. Ses ouvrages
anatomiques. 411. a. Examen de ion hypothefe des molécules
organiques. Suppl. III. 212. <z, b. Suppl.' IV. 182. b. Ses
travaux d’ornithologie, 187. a. SadoCtrine furie phlogifti-
que. 329. b. Sa doftrine phyftologique. 360. a , b. Eloge de
fon hypothefe fur la formation des planetes. 401 .a.
BUGHENHAGEN , ( Jean ) théologien luthérien. XVU.
630. a.
BUGEY, (Géogr.) province de France. Ses bornes. Ses
révolutions. Nombre de fes cures. Suppl. II. 76. b. De fes
abbayes & de fes chartreufes. Rivières du Bugey. Monumiens
d’antiquité qu’on y trouve. Ibid. 77. a.
Bugey, états du Bugey. VI. 29. a.
BUGLOSE, (Botan.) carafteres de ce genre de plante.
Buglofe des jardins. Propriétés de fes racines & de fes fleurs.
Propriété médicinale de la buglofe, de fes racines, feuilles 8c
fleurs. Sirop de feuilles de buglofe; fes propriétés. II. 460. a.
■ Buglofe, efpcce de ce genre , dite orcanette. XL’ 577.a, b.
BUIS, caraéteres de ce genre de plante. H. 460. a. Analyfe
de fon bois. Propriétés de l’huile qu’on en tire. Quelques-
uns foutiennent qu’on peut fubitituër le buis au gayac. II.
460. b.
i Buis épineiLx, il vient des pays chauds ; le vrai; lycium eft
inconnu aujourd’hui. Ce qu’ori lui a futyjitué dans les boutiques.
Autres plantes auxquelles on donne le nom de Ivcium.
B. 460. b. ■
Buis, ( Jardin. ) deux efpeces, le nain & celui de bols.
Comment.on les multiplie, Buis panaché. Ufage du bois de
buis dans différens arts. II. 460. b.
Buis, outil de cordonnier ; fa defçription, fon ufage & la
manière de s’en fervir. II. 460. b.
Buis, (Botan.) noms de cet arbrifleau en différent»
langues. Son caraûere générique. Efpeces & variétés appartenantes
à ce genre. Suppl. II. 77. a. Leur defçription, culture
& ufages ; lieux d’où on les tire. lbid. b.
Buis, plantation du buis des parterres. XII. 726. b. Trait
de buis. XVI. 531. a. Buis du Japon nommé Ojo. XI,
4 BUISSON, n. 197. b. 831. a.
BUISSONNIERS , maîtres. IX 910. a.
BUISTER, ( Philippe ) fculptedr. XIV. 829. b.
BUITELAAR, ( lchthy. ) poiffon des Moluques. Defcrip-
tion , moeurs, qualités & ufeges de ce poiffon. Maniéré de
le daffer. Suppl. II. 78. a, b.
BUJANVALI, (Botan.) nom brame d’une efpece de
ninari. Ses différentes déftgnations. Sa defçription. Lieux où
on la trouve. Ses qualités & ufages. Suppl. IL 78. b. Erreurs
de quelques botaniftes lur cette plante. Maniejre de la claffer.
lbid. 79. a.
BULA, ( Botan. ) plante du Malabar. Sa defçription. Lieux
où elle croît. Ses qualités & ufages. Suppl. II. 70. a. Sa
claflîftcation. Ibid. b.
BULAFO, inftrument de muftque en ufage parmi les
nègres de Guinée. Defçription & manière de jouer de cet
initrument. II. 461. a.
BULARQUE, peintre grec, qui introduiftt l’nfage de plu-
fieurs couleurs dans un tableau. XII. 237. à. 271. a.
BULBONAC , defçription de cette plante. Elle ëft commune
en Allemagne & en Hongrie. On la cultive dans nos
jardins. Qualité de fa femence. On mange fa racine en falade
II. 461. b.
BULJFINGER, ( George-Bernard.) phyfiologifte. Suppl. IV.
336. a.
BULGARES, ( Hifi. eccl. ) divers hérétiques compris fous
ce nom. D’où ils tiroient leur origine. Le nom de Bulgares
étoit d’abord un nom de nation, & -devint un nom de ièfte.
Diverfes feétes de Bulgares condamnées en 1176 dans un
concile, tenu à Lombez. Leurs héréftes. II. 461. b. Pape
qu’ils fe choifirent. Comment le mot de Bulgares ie corrompit
en France & devint un mot très-fale en notre langue. Ces
hérétiques étoient brûlés vifs lorfqu’ils étoient convaincus.
On donna le nom dont on lesappclloit à tous les ufuriers.
Ibid. 462. a.
Bulgares »peuples voiflns du Danube & de la mer Noire :
leur converfion au chriftianifme. XV. 267. b.
BULGNEVILLE, (Géogr.) dans le Souloffois. Suppl. IV.
81e. b. •
BULGOLDA , pierye qui fe trouve dans la tête d’un
animal de te nom. Vertus que les Indiens lui attribuent. IL
462. a.
BULIMIE’, faim canine accompagnée d’évanouiffement &
de froid. Etymologie de ce mot. (Jaufes de cette maladie.
U . 462. a. Voye[ B o u l im i e .
BULINy ( Çonchyl. ) coquillage d’un nouveau genre dans
la famille des nmaçons, qui n’ont pas d’opercule, ni d’échan-
I crujre à l’ouverture de leur coquille qui eft elliptique. Def-
B U P
cription de la coquille & de ranimai. Suppl. IL 79. b. Ses
moeurs. Lieux & faifon où il paraît. Difficulté fur la répro-
duâion de ces animaux. Ibid. 80. a. ;
BULL, (George) théologien. XVII. 396.a, b.
BULLE, petite boule de métal que les enfans des Romains
portoient au cou. Age où ils la portoient. Qui étoient ceux
qui la portoient d’or. Autres perfonnes qui avoient droit de
la porter. Vertus que la fuperftition lui attribuoit. II. 462. b.
Bulles des enfàns des ienateurs. VIII. 13. a. Efpece de
bulle appellée ityphalle. 936. b. Voyez aufli l’article Antiquités,
vol. des planches. Les enfans pendoient au cou des dieux
Lares les bulles qu’ils quittoient. IX. 293. a. Bulles d’o r ,
efpeces de talifmans. XV. 867. b.
Bulle, fceau attaché à un inftrument ou charte quelconque.
De quelle matière étoient ces fceaux. Sceau attaché aux
conftitutions du pape. IL 462. b.
Bulle , expédition de lettres en chancellerie romaine.
Etymologie de ce mot. Ce que c’eft que la bulle. Comment
font diftinguées les bulles gracieufes, & celles qui font dé
juftice & exécutoires. Forme en laquelle elle doit être expédiée.
C’eft le fceau ou plomb qui lui fait donner le nom dé
bulle. Ce qu’il représente. Pour quels fujets on expédie des
bulles. II. 462. b. Les bulles qui viennent de Rome en Francé
font limitées & modérées félon les ufages du royaume avant
d’être enregiftrées: Les Efpagnols ne les reçoivent pas non
plus aveuglément. Ce qu’on entend par fulminer des bulles.
Appels'comme d’abus de la fiilmination de la bulle. Ce qui
fe pratique après la mort du pape pour qu’aucune bulle ne
foit expédiée durant la vacance du ftege. lbid. 463. a.
Bulle, différence entre un bref 8c une bulle. II. 410. a.
Claufes ufttées dans les bulles, & fignatures de la cour de
Rome. III. y 14. a. Le pape emploie quelquefois dans les
bulles la claufe motu proprio : cette claufe regardée en France
comme contraire aux libertés de l’églife. X. 842. b. Expédition
des bulles. XI. 831.' a. Bulles fous plomb. XII. 785. a.
Décret dans les bulles. IV. 716. a. Bulle de compofttion.
XVII. 760. a. Abréviations en ufage dans les bulles. Suppl. L
4i. a,b . &c.
Bulle in cana domìni. Leâure qui s’en fait à Rome le Jeudi
faint. Dans quel but on publie l'excommunication qu’elle
porte. II. 463. a. Qui font ceux que les principaux chefs de
cette, excommunication regardent. Cont'eftations en France
au fujet de cette bulle. Ibid. b.
Bulle d’or, pragmatique-fanâion ou Conftitution de l’em*-
pereur Charles IV : ce qu’elle contient. Elle eft regardée
comme loi fondamentale de l’empire. Dans quel but elle fut
fafte. L’original s’en conferve à Francfort. Kefpeét qu’on a
pour cet exemplaire. II. 463. b.
Bulle d'or. Eait dreffé par Charles I V , empereur. Suppl. II.
330. b. 331. a. C’eft la premiere loi qui fixe le nombre des
elèéleurs. V. 453. b. IV. 71. a. Obfervations fur cette conftitution.
Fafte qui en accompagna la publication. XIII. 262.0.
Deffein de Charles IV en faifant cette bulle. XIV. 327. A.
Bulle d'or de Boheme. II. 463. b.
Bulle d'or du Brabant. Conftitution de l’empereur Charles
IV. En quoi elle confifte. II. 463. b.
Bulles d’a ir , ( Phyfiq. ) Petites gouttes pleines d’air qui
fe forment fur la furface d’un fluide..II. 380. b. Caufe de-la
rondeur des bulles d’air dans Peau. XV. 454. b. Bulles d’air
dans la glace. VIL 678. d&é. 681. b.
BULLERBORN, fontaine très-ftnguliere en Weftphalie.
Merveilles qu’en racontent les crédules WeftphaUens.II.464. a.
BULLETINS, ( Hifi. anc.) ceux qu’on remettoit à Rome
aux citoyens qui alloient donner leur fuffrage. 1. 4. b. VIII.
430. b. XIII. 77. b. XV. 638. b. Bulletins dont fe fervoient
les magiftrats dans lés caufes criminelles. I. 4. b. Voyez
C alculs. • ■
BULO , (Botan.) efpece de bambou. Suppl. I. 771. b.
BULSUK y -(lchthy. ) poiffon des ifles Moluques. Sa def-
cription. Suppl. il. 80. a. Lieu* où on‘ le trouve. Ses quaUtés
& ufages. FaniiUe à laquelle ce genre appartient. Seconde
efpece.- Speeryifch. Caractères qui diftinguent ce poiffon du
précédent. Ibid. b.
BULTEAU, ( Zo«w)fecrétaire du roi : fes ouvrages. XIV.
39Î-JBULU
TUY, ( Botan. ) éfpece de bambou. Suppl. 1. 773; b.
BUMICILI, feéte manométane en Afrique. Supermtions
& extravagances de ceqx qui la.compofcnt. II. 464.a.
BUNEL, ( Pierre ) favant touloufain. XVI. 452. a. .
BUOMMATEI, auteur d’une grammaire itaUenne: remarques
fur cet ouvrage. I. 724. a, b.
BUONACORSi, peintre tofean. V . 330. a.
BUPALUS, fculpteur ancien. X iy . 817. b.
..IMPARITI, (Botan.) plante >malvacée du Malabar. Ses '
différentes déftgnations. Sa .defçription. Suppl. II.- 80. b. Sa
Î i'îr ’ ^es qualités & ufages. Deuxième efpece, barulant :
les différens noms. Sa defçription. lbid. 81. a. Sa culture, fes
quahtés 8c ufages. Ibid, b. Maniere de coiffer ces deux plantes.
foia. 02. a.
B U R 203
BUPHAGE, pourquoi l’on a donne ce furnom à Hercule.
II. 464. b.
BUPLEVRUM, ( Botan.y étymologie du nom de cette
plante. Ses autres noms en différentes langues. Son caraétere :
générique. Enumération de huit efpeces que ce genre renferme.
Suppl. II. 82. a. Lieux d’où elles font originaires.
Leur defçription, culture & ufages. Ibid.b.
BUPRESTE, (InfeéL ) infeéte que plufteurs ont mis dans
le genre des cantharides. Sa defçription. Animaux qu’il attaque.
On prétend qu’il feit enfler le bétail qui l’a avalé en
paiffant. 11. 464. b.
Buprefie, infeôes auxquels on donnoit ce nom du tems
d’Ariftote» & de Pline. - Confufion qui regne dans le genre -
d’infeftes qui porte aujourd’hui ce nom. - Diftimftion qu’il
aurait fallu établir pour éviter cette confufton. - Noms que
Linnæus a donnés aux elpeces dont il compofe ce genre. —
Obfervation fur l’inféré reprèfenté fous le nom de buprefie,
vol. VI. des planches, Hifloire naturelle, p i 75. Suppl. IL 83. b.
Buprefle, effet de cet infefte pris intérieurement. V. 579. a.
Cet infefte repréfenté vol. VI. des planches, Regne anunal,
planch. 75. •
BUPTHALMUM, (Botan.) oeil de boeuf: defçription de
cette plante. Comment elle fe multiplie. II. 464. b.
BURAIL, forte d’étoffe de foie. Burail à contrc-poiL
Burail de Zurich. II. 464. b.
BURAMOS, (les) ou les Papais, peuple de la Nigritie.
Ce que font les femmes pour s’empêcher de parler. II. 464. b.
. BüRANG, (Botan.) efpece de figuier. Suppl. I. 899. b.
BURBELIN, C a r b a l in , C ürbalin , ou Su r b a lw ,
( Mufiq. inftr. des Hébreux) noms d’un inftrument de muftque.
Suppl. R. 84. a. Voyez C rembala.
• BURCADIA, (Botan.) arbrifleau. Son cara&ere géné-
•rique. Lieux où il croit. Sa defçription. Sa culture. Suppl. IL
84. a. '
BURES, (Métall.) puits qu’on pratiqué dans une mine.
On en fait deux ordinairement. Quel en eft l ’ufeeo. II.
m m ... BUREAU des finances, jurifdiétion des tréforiers de France ,
généraux des finances & grands-voyers. Nombre de ces officiers
en différens tems. Louis" XIII réunit à leur charge ,
chacun dans leurs, généralités, l’office de grand-voyer. Louis
XIV incorpora la jurifdiftion de la chambre du tréfor à la
leur. Privileges dont ils jouiffent. II. 465. a. Officiers qui
compofent aujourd’hui le bureau des finances de Paris. Ordre 3ui doit être obfervé dans ce tribunal. Autres fondions
es tréforiers de France. Ibid. b.
Bureau, voye^ D ouane. Divers bureaux établis par les
empereurs romains pour la geftion des affaires de l’état. XIV.
813. a. Etabliffement des bureaux des traites & des douanes
en France.* IX. 17. a. Tarifs des bureaux, obrervàtions fur
ce fujet. XV. 914. a. Lieux où font établis les bureaux
des entrées. II. 95. a. Chancelleries des bureaux des finances.
III. 112. b. Magaftns d’entrepôt établis dans quelques bureaux
des cinq großes fermes. V. yx2. b. Divifion des provinces,
déterminée par la jurifdidion des bureaux des finances. VII.
736. a , b. Etabliffement des bureaux des finances dans
chaque généralité. 557. a.
Bureau de commerce. Objets difeutés à ce bureau. Qui font
ceux qui y affiftent. Jour 'de la femaine auquel il le tient.
Autres applications du mot bureau. II. 466. a. Voyc^ C o n s e i l *
DU ROI:
Bureaux diocéfains. IV. 1012. a. ' ■
Bureau , ( Laurent) fon éloge. Suppl. III. 742. b. 743. a.
BURELÉ. (Blafon) Éçu burelé. Suppl. II. 84. b. Ibid. IV»
369. a.
BURELES, (Blafon) étymologie & ufages de ce mot.
Suppl. IV. 368. à , b.
BURETTE, ( Pierre-Jean ) Suppl. IV. 72. a. Ses mémoires
fur la gymnaitique. VII. 1017. a. Ses recherches fur l’ha'r-
monie des Grecs. VIII. 50. b.
■ BUREUS , (André) géographe Suédois. VII. 612. a. ■
BURG , (Richard de) évêque deDurham. II. 232. a.
BURGAUT , limaçon de mer, dont la chair a un affez
bon goût. Defçription de fe coquille. Lieux où on la trouve,
Ufage qu’on en feit. IL 466. b.
Burgautde teinture, forte de poiffon dont on tire une
couleur de pourpre. XIII. 246.0, b. Suppl. IV. 524. b.
BURGGRAVE, compofttion de ce mot. Quels officiers
étoient autrefois appellés'de ce nom. Cet office eft devenu
héréditaire , & quelques burggraves fe rendirent fouve-
rains. Ceux d’aujourd’hui reçoivent leur inveftiture de
l’empereur. Quatre burggraves, princes d’empire. La maifon
de Brandebourg vient des anciens burggraves de Nurem-
bere. Burggrave de la ville de Nimegue. II. 466. b.
BURIA, vent d’eft très-violent dans la Carinthie. Ravages
qu’il fait. II. 467. a.
BURIDAN , ( Jean ) doâeur fcholaftique. XIV. 776. b.
BURIN, en quoi confifte fa bonne qualité. Diverfes formes
qu’on lui donné. Celle que préféré l’auteur. Comment.