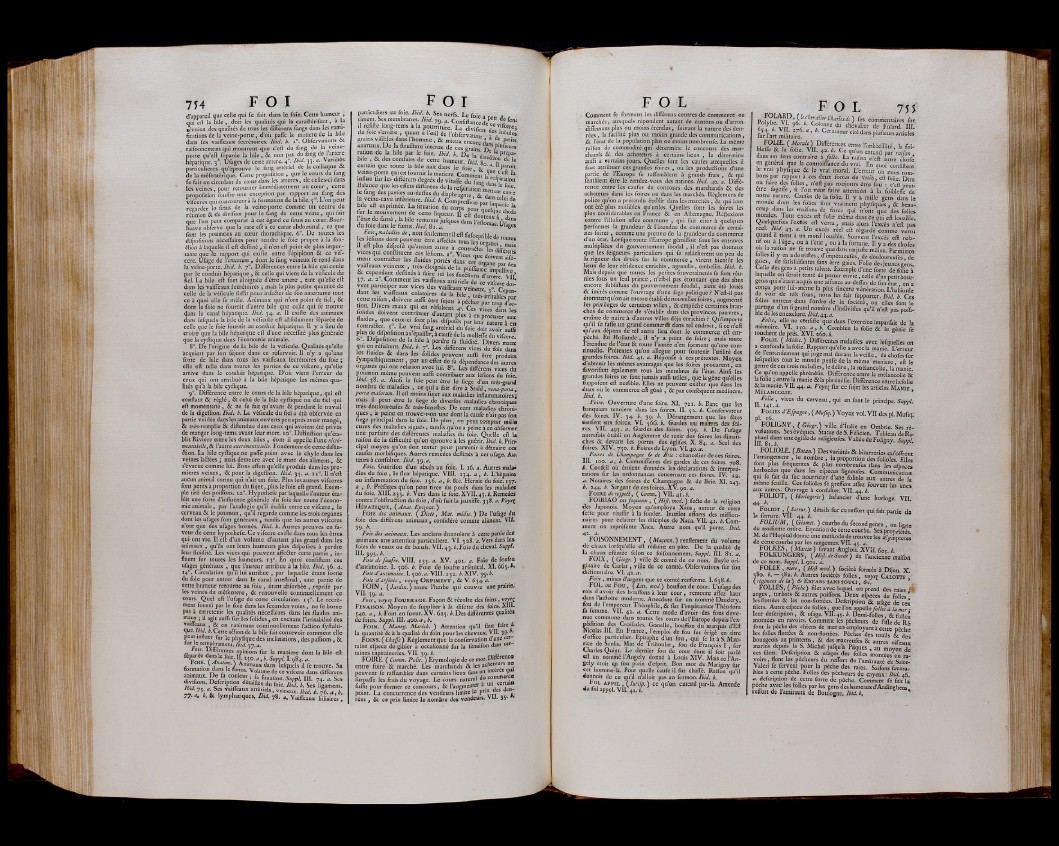
754 F O I
d’appareil que celle qui fe fait dans le foie. Cette humeur ,
qui cil la bile, doit les qualités qui la caraâérifent, à la
»¿union des qualités de tous les différons fangs dans les ramifications
de la veine-porte, d’où paffe la matière de la bile
dans fes vaiffeaux iccrètoires. Ibid. b. a°. Obfervations &
raifonnemens qui montrent que c’eft du fang de la veine-
porte qu’eft feparée la b ile, 8c non pas du fang de 1 artere
népatique. 3*. Ufages de cette artère. 4" Ibid. 33. a. Variétés
particulières qu’éprouve le fang artériel de la coehaque oc
de la méfentérique. Cette proportion , que le cours du fang
fc fait en circulant du coeur dans les artères, de celles-ci dans
les veines pour retourner immédiatement au coeur , cette
propofition foudre une exception par rapport au fang des
vifeeres qui concourent à la formation de la bile. 50. L on peut
regarder le finus de la veine-porte comme un centre de
réunion & de divifton pour le lang de cette v ein e, qui fait
que l’on peut comparer à cet égard ce finus au coeur. Bocr-
haave obferve que la rate eft a ce coeur abdominal, ce que
font les poumons au coeur thorachique. 6°. De toutes les
difpo/îrions nèceffaires pour rendre le foie propre a la fonction
à laquelle il eft deftiné, il n’en eft point de plus importante
que le rapport qui exiffe entre l’épiploon & ce vif-
cere. Ufage de Yomentum, dont le fang veineux fe rend dans
la veine-porte. Ibid. b. 70. Différences entre la bile qui coule
par le conduit hépatique, & celle qui vient de la véftcule du
fiel. La bile eft fort éloignée d’être amere , tant qu’elle eft
dans les vaiffeaux iecrétoires ; mais la plus petite quantité de
celle de la véftcule fuffit pour infe&er de fon amertume tout
ce a quoi elle fe mêle. Animaux qui n’ont point de fiel, 6c
dont le foie ne fournit d’autre bile que celle qui fe trouve
dans le canal hépatique. Ibid. 34. a. 11 exifte des animaux
dans lefquels la bile de la véficulc eft abfolument 'féparée de
celle que le foie fournit au conduit hépatique. 11 y a lieu de
croire que la bile hépatique eft d’une néceilité plus générale
que la cyftique dans l’économie animale.
8°. De l’origine de la bile de la véftcule. Qualités qu’elle
'acquiert par ion féjour dans ce réfervoir. Il n’y a qu’une
forte de bile dans tous les vaiffeaux fecrétoires du foie ;
elle eft telle dans toutes les parties de ce vifc cre, qu’elle
arrive dans le conduit hépatique. D ’où vient l’erreur de
ceux qui ont attribué à la bile hépatique les mêmes qualités
qu’à la bile cyftique.
90. Différence entre le cours de la bile hépatique, qui eft
confiant & réglé, & celui de la bile cyftique ou du fiel qui
eft momentané, & ne fe fait qu’avant 8c pendant le travail
de la digeftion. Ibid. b. La véftcule du fiel a été obfervée en
partie vuidée dans les animaux ouverts peu après avoir mangé,
& très-remplie 8c diftendue dans ceux qui avoient été privés
de manger long-tems avant leur mort. io°. Diftinélion qu’établit
Rivière entre les deux biles , dont il appelle l’une re'crê-
mentitielle,8c l’autre excrèmentitielle. Fondement de cette diftin-
étion. La bile cyftique ne paffe point avec le chyle dans les
veines laétées ; mats demeure avec le marc des alimens, 8c
s’évacue comme lui. Bons effets qu’elle produit dans les premières
veines, 8c pour la digeftion. Ibid. 35. a. 11". Il n’eft
aucun animal connu qui n’ait un foie. Plus les autres vifeores
font petits à proportion du fujet, plus le foie eft grand. Exemple
tiré des poiffons. 12°. Hypothefe par laquelle l’auteur établit
une forte d’infiuence générale du foie fur toute l’économie
animale, par l’analogie qu’il établit entre ce vifeere, le
cerveau & le poumon, qu’il regarde comme les trois organes
dont les ufages font généraux , tandis que les autres vifeeres
n’ont que des ufages bornés. Ibid. b. Autres preuves en faveur
de cette hypothefe. Ce vifeere exifte dans tous les êtres
qui ont vie. 11 eft d’un volume d’autant plus grand dans les
animaux , qu’ils ont leurs humeurs plus difpofées à perdre
leur fluidité. Les vices qui peuvent affeéler cette partie , influent
fur toutes les humeurs. 130. En quoi confiftent ces
ufages généraux , que l’auteur attribue a la bile. Ibid. 36. a.
14°. Circulation quil lui attribue , par laquelle étant fortie
du foie pour entrer dans le canal inteftinal, une partie de
cette humeur retourne au fo ie , étant abforbée , reprife par
les veines du méfentere, 8c renouvelle continuellement ce
cours. Quel eft l’ufagc de cette circulation. 1 ç°. Le recré-
ment fourni par le foie dans les fécondés voies, ne fe borne
pas à entretenir les qualités nèceffaires dans les fluides animaux
5 il agit auffi fur les folides, en excitant l’irritabilité des
vaiffeaux , & en ranimant continuellement l’aâion fyftalti-
que. Ibid. b. Cette aftion de la bile fait concevoir comment elle
peut influer fur le phyfique des inclinations, des pallions, 8c
p - tcÎP^rament. ïbid.yj. a.
f i n.°rù" opinions fur la maniéré dont la bile eft
H Ü S u iv i 1. 084. a.
f ■’ dans lefquels il fe trouve. Sa
formation dans le foetus. Volume de ce vifeere dans dlfférens
an,maux. De fa couleur ; fltuatio„ S L m „ Scs
d vdions. Defeription détmlli. d„ fo,e. - j f â b Scs ligament.
" f “ “ veineux, l l i i . 4. .76. a , 4.
77. 4, 4. & lymphatiques, Ih d . 78. , f Vaiffeaux biliaires ,
F O I
particuliers au foie. Ibid. b. Ses nerfs Le fo'
tintent. Scs membranes. Ibid. 79. CtinMan« f<W
il refiite long-tems à la pourriture. La divifon j , ccrci
du foie serrete , quant à l'oeil de l’obfervatenr ¡“ 1 obul«
grains vifibles dans l'homme, & mieux ciicni. a “ " PC"K
animaux. D e la ftruâure in te™ de c = s S . dC i lufK»»
ration de la bile par le foie. Ibid. b. De ; . P'-pabüe
, & des conduits de cette humeur. Ibid s dc §
certain que toute la bile nait dans je foie & “ ' f aroit
veine-porte qui en fournit la matière. Comnicn, l,U%Ce<t k
influe fur les diflérens degrés de viteffe du <•„« H rcfP«nion
Balance que les effets diflérens de la reftiration8 “ S lc foic-
le fang des parties au-deffus du diaphragme
la veine-cave inférieure. Ibid. b. C o m S o ’n „ r scelui de
bile eft exprimée. La fituaiion du corps t J a f i& M S K ■*
fur le mouvement de cette liqueur, i c S d o iïï rC Cj ° fe
l'état de fauté, la bile remon.e'iufoues dam l 'X
du foie dans le foetus. Ibid. 8 1 . i dans ‘ eftomac. Ufages
Foie .maladies d e, non feulement il eft fufceotible d»
If:! kcfT S Î T Pi°UV1 n‘ être i m i s tous les organes m ■*
il eft plus difpofé qu'aucun autre i c o n t r a f l e r S »
vices qui continuent ces léfions. 1”. Vices n , f . ?
ment contrafler les fluides
vaiffeaux veineux , très-éloienés de la • !§£'des
& cependant deftinés à faire ici les fo n f l i „ n s " d w r é V l£
37. a. 2 . Comment les vaiffeaux artériels de ce vifeere doi-
ven participer aux vices des vaiffeaux veineux. 3»
dant les vaiffeaux colatoires de la bile rrèc.:J;MKix!.P
cette raifon, doivent auffi être fuiets à Décher nar î^ j»par
.ion Divers maux qui en r é f u E 4 ^ s' Z s Im
folides doivent contribuer d'autant plus à en procurer aux
Comrafl contraélcr. 3 “. fLe' “v rai fSa Pnlg“ aS rtériel du ff”oie doit avoir 1a u™ffi
5» iS Jîf r»à caufe de la molleffe du vifeere.
6 . Difpofition de la bile à perdre fa fluidité. Divers maux
les' f ln id i x ’ ; ? l'-i^5 <üiRrcns vices du foie dam
les fluides 8c dans les folides peuvent auffi être produits
fympa.hiquement, par un effet de fa dépendance des autres
organes qui ont relation avec lui. 8". Les différens vices du
poumon meme peuvent auffi contribuer aux léfions du foie.
Ibtd. 38. a. Ainfi le foie peut être le fiege d’un très-grand
nombre de maladies , ce qui a fait dire à Stahl, vena-porta
p °n a malorum. Il eft moins fujet aux maladies inflammatoires;
ma,s ** peut être le fiege de diverfès maladies chroniques
três-douloureufes 8c très-funeftes. De cent maladies chroniques
, à peine en trouve-t-on une dont la caufe n’ait pas fou
fiege principal dans le foie. D e plus, on peut compter millo
cures des maladies aiguës, tandis qu’on a peine à en obferver.
une parfaite des différentes maladies du foie. Quelle eft ht
raifon de la difficulté qu’on éprouve à les guérir. Ibid. b. Principal
moyen qu’on doit tenter pour parvenir à détruire ces
caufes morbifiques. Autres remedes deftinés à cet ufage. Auteurs
à confulter. Ibid. 39.a .
Foie. Guérifon d’un abcès au foie. I. 16. a. Autres mal*«
dies du foie , le flux hépatique. VIII. 134. a , b. L’hépaute
ou inflammation du foie. 136. a t b. &c. Hernie du foie. 137. "
a , b. Préfaees qu’on peut tirer du pouls dans les maladies
du foie. X 1IL 233. b. Vers dans le foie. XVIL 43. b. Remedes
contre l’obftruaion du fo ie , d’où fuit la jauniffe. 338. a. Foyeç
H é p a t iq u e , (A n a t. Epi^oot.)
F oie des animaux. ( D ic te , Mat. mldic. ) D e l’ufage du
foie des diflérens animaux, confidéré comme aliment. VIL
39- b\ .
Foie des animaux. Les anciens donnoient à cette partie des
animaux une attention particulière. V I. 3 28. a. Vers dans les
foies de veaux ou de boeufs. VII. 43. ¿.Foie du cheval. Suppl.
III. 393. b.
Foie de foufre. VIII. 133. a. XV . 401. a. Foie de foufro
d’antimoine. I. 306. b. Foie de foufre arfénical. XI. 663. b.
Foie d ’antimoine. I. 306. a. VIII, 132. ¿ .X IV . 39. b.
Foie d ’arfénic, voyq O rpiment , 8c V . 634. a.
F O IN , ( Jardin. ) toute l’herbe qui couvre une prairie.'
VH. 39. a.
F o ie , voyc{ F o u r r a g e . Façon 8c récolte des foins, voyt£
F ena ison. Moyen de fuppléer à la difette des foins. XIIL
340. a , b. Foin en fucur. A V . 623. b. Des différentes qualités
de foins. Suppl. III. 400.a , b. .
F oin. ( Maneg. Marich. ) Attention qu’il ftut faire a
la quantité 8c à la qualité du foin pour les chevaux. VII. 3?>b-
Foins. ( ChaJJe ) Règlement que la confervation d’une certaine
efpecc de gibier a occafionné fur la fénaifon dans cer-.
taines capitaineries. V IL 39. b.
FOIRE. ( Cornm. Polit. ) Etymologie de ce mot. re
entre foire 8c marché. Les marchands 8c les acheteurs
peuvent fe raffembler dans certains lieux fans un,,nt r H
furpaffe les frais du voyage. Le cours naturel du com
fuffit pour former ce concours, 8c l’augmenter .
point. La concurrence des vendeurs limite le P“ ? .« y,
rées , 8c ce prix limite lc nombre des vendew** v u . 39«
F O L
Comment fe forment les différens centres de commerce ou
marchés, auxquels répondent autant de cantons ou d’arron-
diffemens plus ou moins étendus, fuivant la nature des denrées
, la facilité plus ou moùis grande des communications,
,8c l’état de la population plus ou moins nombreufe. La même
raifon de commodité qui détermine le concours des marchands
8c des acheteurs à certains lieux , le détermine
auffi à eertains jours. Quelles font les caufes auxquelles il
faut attribuer ces grandes foires , où les produ&ions d’une
partie de l’Europe fe raffemblent à grands frais , 8c qui
îeinblent être le rendez-vous des nations. Ibid. 40. a. Différence
entre les caufes du concours des marchands 8c des
acheteurs dans les foires ou dans les marchés. Réglemens de
police qu’on a prétendu établir dans les marchés, oc qui leur
ont été plus nuifibles qu’utiles. Quelles font les foires les
plus confidérables en France 8c en Allemagne. Réflexions
contre l’illufion affez commune , qui fait citer à quelques
perfonnes la grandeur 8c l’étendue du commerce de certaines
foires , comme une preuve de la grandeur du commerce
d’un état. Lorfque toute l’Europe gémiffoit fous les entraves
multipliées du gouvernement féodal , il n’eft pas douteux
que les feigneurs particuliers qui fe relâchèrent un peu de
la rigueur des droits fur le commerce , virent bientôt les
lieux de leur réfidence enrichis , agrandis, embellis. Ibid. b.
Mais depuis que toutes les petites fouverainetés fe font réunies
fous un feul prince , n’eft-il pas étonnant que des abus
encore fubfiftans du gouvernement féodal, aient été loués
8c imités comme l’ouvrage d’une fage politique ? N’eft-il pas
étonnant qu’on ait encore établi de nouvelles foires, augmenté
les privilèges de certaines ville s, 8c empêché certaines branches
de commerce de s’établir dans des provinces pauvres,
crainte de nuire à d’autres villes déjà enrichies ? Q u ’importe
qu’il fe faffe un grand commerdè dans tel endroit, fi ce n’eft
qu’aux dépens de tel autre lieu dont le commerce eft em-
Sêché. En Hollande, il n’y a point de foire ; mais toute
étendue de l’état 8c toute 1 année n’en forment qu’une continuelle.
Prétextes qu’on allégué pour foutenir l’utilité des
grandes foires. Ibid. 4 1 . a. Réponfe à ces prétextes. Moyen
d ’obtenir les mêmes avantages que les foires procurent, en
fàvorifant également tous les membres de l’état. Ainfi les
grandes foires ne font jamais auffi utiles, que la gêne qu’elles
luppofent eft nuifible. Elle* ne peuvent exifter que dans les
états où le commerce eft gêné , 8c par conféquent médiocre.
Ibid. b.
Foire. Ouverture d’une foire. XI. 721. b. Banc que les
banquiers tenoient dans les foires. II. 32. b. Confervateur
des foires. IV. 34. b. 39. b. Dérangement que les fêtes
caufent aux foires. VI. 366. b. Gardes ou maîtres des foires.
VIL 493. a. Gardes des foires. 309. b. D e l’ufage
autrefois établi en Angleterre de tenir des foires les dimanches
8c devant les portes des églifes. X. 84. a. Scel des
foires. XIV. 730. b. Foires de Lyon. V I .40.a.
Foires de Charppagne & de Brie : chancelier de ces foires.
III. 100. a , b. Commiffaires des gardes de ces foires. 708.
b. Confeil où étoient données les déclarations 8c interprétations
fur les ordonnances concernant ces foires. IV. 22.
a. Notaires des foires de Champagne 8c de Brie. XI. 243.
b. 244. b. Sergent de ces foires. XV. 90. a.
FOIRE de refpefl, ( Comm. ) VIL 41. b.
FOIRIAO ou f o queux, ( Hijl. mod. ) feôe de la religion
des Japonois. Moyen qu’employa Xaca, auteur-de cette
fefte pour réufiir à la fonder. Inutiles efforts des miflion-
naires pour éclairer les difciples de Xaca. VII. 41. b. Comment
on repréfente Xaca. Autre nom qu’il porte. Ibid.
42. a.
FOISONNEMENT , (Maçonn.) renflement du volume
de chaux lorfqu’elle eft réduite en pâte. D e la qualité de
la chaux eftimée félon ce foifonnement. Suppl. lll . 81. a.
• F O IX , (Giogr. ) ville 8c comté de ce nom. Bayle originaire
de Carlat, ville de ce comté. Obfervations fur fon
diétionnaire. VI. 42.4.
F o ix , mines d’argent que ce comté renferme. 1. 638. A.
FO L ou F o u , ( Lin. mod.) bouffon de cour. L’ufage des
rois d avoir des bouffons à leur cour, remonte affez haut
dans 1 hiffoire moderne. Anecdote fur un nommé Daudery,
fou de 1 empereur Théophile,8c fur l’impératrice Théodora
fa femme. VII. 42. a. Cette mode d’avoir des fous deve-
nVj. ^on,nJune dans toutes les cours de l’Europe depuis l’ex-
P”^ 1'00- des Croifades. Gonelle, bouffon du marquis d’Eft
Nicolas 111, En France, l’emploi de fou fut érigé en titre
d’office particulier. Epitaphe d’un fo u , qui fe lu à S. Maurice
de Senlis. Mot de Triboulet, fou de François I fur
Charles Quint. Le dernier fou de cour dont U foit parlé
eft un nommé l’Angely donné à Louis XIV. Mais ce rAn-
gely ¿toit uji fou plein d’eiprit. Bon mot de Marigny fur
cet homine-là. Pour quelle caufe il fut chaffé. Raifon qu’il
donnoit de ce qu’il n’alloit pas au fermon. Ibid. b.
, F ol' a p p e l , (Jurifp. ) ce qu’on entend par-là. Amende
du fol appel. VII. 42. à.
, F O L 7 5 5
S S I I m:
ruVi-art militaire ‘ | Pluflcurs articles
b i e ^ « , Différ r ? CMttl’imbSciffité, la foi-
bleffe & la folie. VII. 42 4. Ce quon entend par raifon
dans un Cens contraire a f i l e . La raifon n'eft autre choie
en général nue la connoifence du vrai. En quoi confident
le vrai phyfique 8c le vrai moral. L’erreur où nous tombons
par rapport à ces deux fortes de Vrais, eft folie. Dire
ou faire des folies, n’eft pas toujours être fou : c’eft peut-
être fageffe, fi l’on veut faire attention à la. foiblefle de
notre nature. Caufes de la folie. Il y a mille gens dans le
monde dont les folies font vraiment phyfiques, 8c beaucoup
dans les maifons de force qui n’ont que des folies
morales. Tout excès eft folie même dans ce qui eft louable.
Quelquefois 1 extes eft vertu, mais alors l’excès n’eft pas
réel. ibid. 43. a. Un excès réel eft regardé Comme vertu
quand il tient à un motif louable. Souvent l’excès eft rela-
m °.u à. | aSe » o» à l’é tat, ou à la fortune. Il y a des chofes
ou la raifon ne fe trouve que dans unjufte milieu. Parmi nos
folies il y en adetriftes, d’impétueufes, de douloureufcs de
gaies, de fatisfaifantes fans être gaies. Folie des jeunes eens.
Celle des gens à petits talens. Exemple d’une forte de folie à
laquelle on feroit tenté de porter envie, celle d’un petit bourgeois
qui s étant acquis une aifance au-deffus de fon état en a
conçu pour lui-même la plus fincere vénération. L ’habitude
de voir de tels fous, nous les fait fupporter. Ibid. b. Ces
folies entrent dans l’ordre de la fociété, ou elles font le
partage d un fi grand nombre d’individus qu’ü n’eft pas poffi-
ble de les en exclure. Ibid. 44. a.
Folie, elle ne cOnfifte que dans l’exercice imparfait de la
mémoire. VI. 130. a , b. Combien la folie 8c le génie te
touchent de près. XVI. 260. b.
F ° lie . ( Mèdec.) Différentes maladies avec lefquelles ort
a confondu la folie. Rapport qu’elle a avec la manie. L ’erreur
de 1 entendement qui juge mal durant la v eille, de chofes fur
lelquelles tout le monde penfe de la même ‘maniéré, eft le
genre de ces trois maladies, le délire, la mélancolie, la manie.
Ce qu on appelle phrénéfie. Différence entre la mélancolie &
la folie ; entre la manie 8cla phrénéfie. Différence entre lafolie
8c la manie. V IL 44. a. Voye^ fur ce fujet les articles M an ie .
MELANCOLIE. *
II • * V*CeS CerveaU » fl111 en ft>nt Ie principe. Suppl.
pl F i*6IES d Ef paene’ ( Muf iq' 5 V ° y ez v °l-VI1 des pl. Mufiq,'
FO L IG N Y , ( Géogr.) ville d’Italie en Ombrie. Ses révolutions.
Ses évêques. Statue de S. Félicien. Tableau de Ra-
FlI 8 1 T * UneégIifede reliSicufes- Vallée de Foligny. Suppl.
FOLIOLE. ( Botan.) Des Variétés 8c bizarreries qu’offrent
1 arrangement, le nombre , la proportion des folioles. Elles
font plus fréquentes 8c plus nombreufes dans les efpcces
herbacées que dans les efpeces ligneufes. Communication
qui le fait du fuc nourricier d’une foliole aux autres de la
même feuille. Ces folioles fe greffent affez fouvenr les unes
aux autres. Ouvrage à confulter. VII. 44. b.
FO L IO T , ( Horlogerie ) balancier d’une horloge. V IL
44. b.
FOLIOT , (Scrrur.) détails für Ce reffort qui fait partie dé
la ferrure. VU. 44. b.
F O L IU M , ( Gèomet. ) courbe du fécond genre , ou ligne
du troifieme ordre. Equation de cette courbe. Ses propriétés
M. de l’Hôpital donne une méthode de trouver les afÿmptotes
de cette courbe par les tangentes. V II. 43. a.
FOLKES , (M a r t in ) favant Anglois. XVIÏ. 60e b
FOLKUNGERS, ( Hijl. deSuede ) de l’ancienne maifon
de ce nom. Suppl. L901. a.
FOLLE , mere, ( H ijl mod.) fociété formée à Dijon. XI'
380. b. — 382. b. Autres fociétés folles , voyez C a l o t t e ,
( régiment de la ) & ENFANS SANS SOUCI, &c.
FOLLES, ( Pêche) filet avec lequel on prend des raies M
anges, turbots 8c autres poiffons. Deux efpeces de folles '
les flottées 8c les non-flottées. Defcriprion 8c ufage de ces
filets. Autre efpece de folles, que l’on appelle folles à la mer •
leur defeription, 8c ufage. V IL 43. b. Demi-folles, 8c folles
montées en ravoirs. Comment les pêcheurs de l’ifle de R é
font la pêche des chiens de mer en employant à cette pêche
les folles flottées 8c non-flottées. Pêches des touils 8c des
bouageois au printems, 8c des macreufes 8c autres oifeaux
marins depuis la S. Michel jufqu’à Pâques , aii moven
ces filets. Defeription & uftges des filles m on tte en re-
yoirs, «ont les pêcheurs du reffort de l’amirauté de Saint-
Valcri fe fervent pour la pêche des raies. Saifons favorables
à cette pêche. Folles des pêcheurs de cayeux : Ibid. 46
a. defeription de cette forte de pêche. Comment fe frit là
pêche avec les folles par les gens des hameaux d’Andinghem.
reflort de 1 amirauté ae Boulogne. Ibid. bK