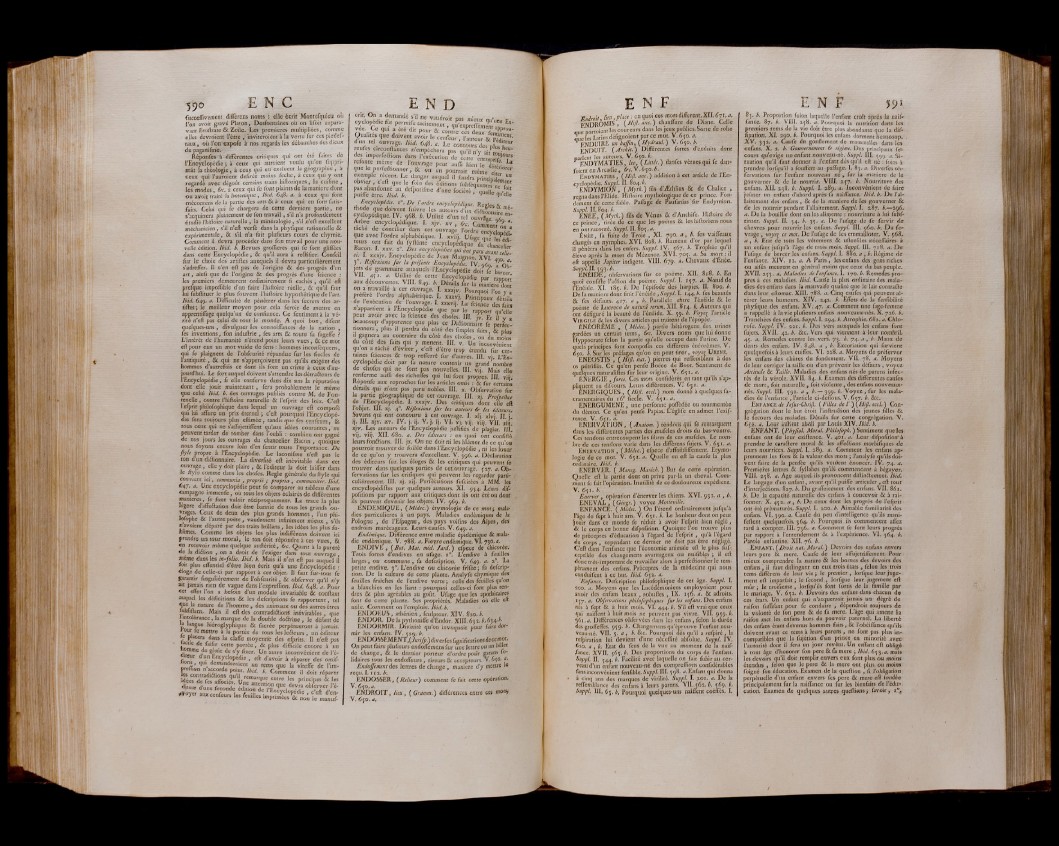
5 9 <? ENC
■fucccffiveinent différons noms : elle écrit Monrcfquicu ou
l’on avoir gravé Platon, Desfontaines oü on lifoit auparavant
Eroflrate & Zoîlc. Les premières multipliées, comme
elles devraient l’être , inviteroient k la vertu fur ces piedef-
taux, où l’on -expofe à nos regards les débauches des dieux
du paganifme.
Képonfes 'k différentes critiques qui ont été faites de
l’Encyclopédie ; k ceux qui auroicm voulu qu’on fuppri-
mât la théologie, k ceux qui en excluent la géographie, à
ceux qui l’auroicnt dciiréc moins fcchc, a ceux qui y ont
regardé avec dégoût certains traits hiiloriaucs, b ciiifinc ,
les modes, Oc. k ceux qui fe font plaints de la manière dont
ou avoit traité la botanique , Ibid. 648, a. k ceux qui font
mécontcns de la partie des arts de k ceux qui en font fatisfaits.
Celui qui fe chargera de cette dernière partie, ne
s’acquittera pleinement de fon travail, s’il n’a profondément
étudié J’hi/loirc naturelle , la minéralogie, s’il n’eft excellent
méchanicicn, s’il n’eft verfé dans la phyfique rationnelle Se
expérimentale, Se s’il n’a fait pluftcurs cours de chymie.
Comment il devra procéder dans fon travail pour une nouvelle
édition. Ibid. b. Bévues groHiercs qui le font gliffécs
dans cette Encyclopédie, Se qu’il aura k rcâificr. Confeil
fur le choix des artilles auxquels il devra particulièrement
s’adrelfcr. 11 n’en cft pas de l'origine & des progrès d'un
art, ainft que de l’origine Se des progrès d’une fcicnce ;
les premiers demeurent ordinairement fi cachés, qu’il cil
prclquc impoflible d'en faire l’hiiloirc réelle, Se qu’il faut
lui fubilituer le plus fouvent l’hifloirc hypothétique de l’art.
Ibid. 649. a. Difficulté de pénétrer dans les fccrcts des artilles;
le meilleur moyen pour cela feroit de mettre en
apprentilTage quelqu’un de confiance. Ce fentiment k la vérité
n’ell pas celui de tout le monde. A quoi bon, difent
quelques-uns, divulguer les connoifTanccs de la nation ,
les inventions, fon induflrie , fes arts Se toute fa fagefle ?
L’intérêt de l’humanité n’étend point leurs vues, Se ce mot
cûpour eux un mot vuide de fens : hommes inconféqucns,
qui fe plaignent de l’obfcurité répandue fur les fiecles de
1 antiquité, Se qui ne s’apperçoivent pas qu’ils exigent des
hommes d’autrefois ce dont ils font un crime à ceux d’aujourd'hui.
Le fort auquel doivent s’attendre les détracteurs de
l'Encyclopédie, fi elle con fervc dans dix ans la réputation
dont elle jouit maintenant, fera probablement le même
que celui Ibid, b. des ouvrages publiés contre M. de Fon-
tencllc, contre l’hifloirc naturelle Se l’cfprit des loix. Ccft
l'efprit philofophique dans lequel un ouvrage cil compofé 3ui lui affurc un prix éternel ; c’cfl pourquoi l’EncycIopé-
ie fera toujours plus eftiméc, tandis que fes ccnfcurs, Se
tous ceux qui ne raflùjcttifTcnt qu’aux idées courantes t'ne
peuvent tarder de tomber dans l’oubli : combien ont gagné
de nos jours les ouvrages du chancelier Bacon , quoique
nous foyons encore loin d’en fentir toute l’mportancc. Du
ftylc propre à l’Encyclopédie. Le laconifmc n’cfl pas le
ton d’un diâionnairc. La diverfité cft inévitable dans cet
ouvrage, elle y doit plaire , Se l’éditeur la doit laiftcr dans
le Ityb comme dans les chofcs. Regle générale du ftylc qui
convient ici, communia, proprii: propria, communitcr. Ibid.
047. a. Une encyclopédie peut fe comparer au tableau d’une
campagne immenfê, où tous les objets éclairés de différentes
manieres, fe font valoir réciproquement. La trace la plus
légère d’affeélation doit être bannie de tous les grands 011-
Î3®?* Ç6“? dc àcux **** Plus grands hommes, l’un phi-
lofophe Se l’autre poete, vaudraient infiniment mieux , s’ils
n’avoient déparé par des traits brillans, les idées les plus fu-
bJime*. Comme les objets les plus indifférent doivent ici
prendre un tour moral, le ton doit répondre k ces vues Se
en recevoir même quelque auftérité, Oc. Quant à la pureté
de la diâion , on a droit de l’exiger dam tout ouvrage
même dans les in-folio. Ibid. b. Mais il n’en cft pas auquel il
Mit plus cffentiel d’étre biçn écrit qu’à une Encyclopédie ;
éloge de celle-ci par rapport k cet objet. Il faut fur-tout fe
garantir finguliércmcnt de l’obfcurité, & obfcrvcr qu’il n’y
ait jamais rien de vague dans l’cxprcftion. /é/V. 648. a. Pour
cet effet l’on a befan d’un modele invariable Se confiant
auquel les définitions & les deferiptions fe rapportent, tel
naturc i*® y^omme, des animaux ou des aurresétres
ubfillan*. Mais il eft des contradiâîom inévitables que
| intolérance, la marque de la double doârine, le défaut de
g ungue hiéroglyphique Se ftcrêc perpétueront a jamais.
Me mettre a la portée de tous les lcâeurs, un éditeur
se Pwera dans la ciarte moyenrle des cfprits. Il n’eft pas
& Plus difficile encore â un
»yftwr. Un autre inconvénient de l’é-
f i Ï Ï ’ cil <i’avo‘r 1 réparer d o omif-
- i * demander«™^ un re™ que la virarte de Mm-
•arer
I V
I
».../r. » v— un que 13 vitelle eie 11
i ® f e ¡ f e í Commem ¡I doit ripa
M t e X f c f X d â i . “ “ "!“ '« príncipe, fe
aux ccnTcur, le. feuille, Im p r í i , & L lc Mnuï
E N D
cr!t-, ° !\.a i c” ,iií,(1é »’íi
cyclopídie fut permife lâchement, qn’cxDrcffiSin™.''""
vie. Ce qut a été dit pour 8e emite
Qtnlui. que doivent avoir le cenfcur, l'mitew & " S “ " '
g un <el ouvrage. Ibid. 648, 1,. .* «"leur
reufes circonflanccs n'empêchera pa» q u 'il n*y à i A o * ' "
de. imperfcflion. dam l'exécution de cette e n t r e S T '
refonte mime de l'ouvrage peut aulTi bien le
que le perfeâionncr, & ou eu pourroit mime citai
exemple récent. Le danger auquel il faudra ptiticidaul
obvier, çeft que le foin dm édition. fubftqSenw n eT *
pa. abandonné au defpotifme d'une fociété , q u X
puiflc être, Ibid. b. » c,lc quelle
W m Sm Ê Êm l" D/ . l '” dr‘ «“ ydepMiliu. Regle»
thode que doivent fuivrc le» auteur, d'un diaíomuL.
cyclopêdiquc, IV. 06S. b Utilité d'un tel o u v r jg e .'X T
Arbre encyclopédique. I, xjv. xv „ fre CnmûzÆ&k
tâché de concilier dans cet ouvrage l’ordre endycltmlv
que avec I ordre alphabétique. I. xvüi. U f a g e S l^ M L
«un ont fai, du fyftéme encyclopidique^du chan“ lier
Bacon. I. XXV. i . Dtl. cncjcbf ldiçi qui ont paru avant alUa.
I. xxx/v. Encyclopédie de /eau Maignon. XVI ™
j • lu/ltxumi fur la prlf.nu Kncycbpidtc. IV, «lío ¿ o í
im1 de grammaire auxquels l'i-ncycfopédic doit i l bfencr
VII. 4j 1. a. Utilité de cette tncydopédie par rannm,
aux découvert«. VIII. 849. b Détail, jftr la maniere C
on a travaillé à « t ouvrage. I. xxxjv, p„„rq„„i |'„„ y f
préféré 1 ordre alphabétique. I. xxxvj. Principaux détail,
•de I exécution de I ouvrage. I. xxxvi). La fcicnce de» fait,
n appartient il I Encyclopédie que par le rapport qu'elle
peur avoir avec la fcicnce des chofes. 111. jv. Et il v a
beaucoup d’apparence que plus ce Diflionnaire fe perfectionnera,
plus il perdra du côté des fimples faits, Se plus
il gagnera au contraire du côté des chofes, ou du moins
du ctité de* faits qui y mènent. 111. v. Un inconvénient
quonataché déviter, c’cft d’étre trop étendu fur certaines
fciciiccs Se trop refferré fur d’autres. III, vj. L’Encyclopédie
doit par fa nature contenir un grand nombre
de chofes qui ne font uas nouvelles. 111. vij. Mais elle
renferme aufïi des richcifcs qui lui font propres. 111. viij;
Réponfc aux reproches fur les articles omis ; Se fur certains
détails qui n’ont pas paru nobles. III. x. Obfervation fur
la partie géographique de cet ouvrage. 111, xi. ProfpcÜiu
de l’Encyclopédie. 1. xxxjv. Des critiques dont elle cft
l objet. III. xj. 4°. Répxiom fur ta auteurs & Us idïteurs.
Savans qui ont concouru k cet ouvrage. ï. xlj. xlvj. II. j.
íj. III. xjv. xv. IV. j. ij. V. j. Ji. VI. vj. víj. viij. Vil. xiiil
xjv. Les auteur* de l'Encyclopédie juflifiés de plagiat, lit.
vij. viíj. XII. (8o. a. Des ¿ditturs : en quoi ont confifté
leurs fonélíons. III. jx. On ne doit ni les blâmer de ce qu’on
pourroit trouver de foible dans l’Encyclopédie , ni les louer
de ce qu’on y trouvera d’excellent. V. 396. a. Déclaration
des éditeurs ftir. les éloges Se les critiques qui peuvent fe
trouver dans quelques parties de cet ouvrage. <vt. a. Ob-
fervations fur les critiques qui peuvent les regarder particulièrement.
III. xj. xij. Persécutions fufeitées k MM. les
cncyclopédiftes par quelques auteurs. XI. 934. Leurs d/f-
poutions par rapport aux critiques dont ils ont été ou dont
ils peuvent devenir les objets. IV. 069. b.
ENDEMIQUE, (Mtdec.) étymologie de ce mot; maladies
particulières â un pays. Maladies endémiques de la
Pologne , de l'Efpagnc, des pays voirtns des Alpes, des
endroits marécageux. Leurs caufcs. V. 649. </.
Endémique. Différence entre maladie épidémique Se maladie
endémique. V. 788. Fícyrc endémique. Vi. 730,//,
ENDIVE, (ifor. A/^r. mid. Jard.) cfpecc de chicorée»
Trois fortes d’endives en ufage. 1*. L endive à feuilles
larges, ou commune, fa defeription, V. 649. e. a°. La
petite endive. 30. L’endive ou chicorée fri fée i fa defeription.
De la culture de cette plante. Analyfc chymique des
feuilles fraîches de l’endive verte ; celle des feuilles qu'on
a blanchies en les liant ; pourquoi celles-ci font plus tendres
Se plus agréables au goût. Ufage que les apothicaires
font de cette plante. Scs propriétés. Maladies où elle eu
utile. Comment on l’emploie, Ibid. b.
ENDOKUS, athénien, Sculpteur, XIV. 8uo. b.
ENDOR. De la pythoniffe a'Kndor. XII1. 63a. b. 6ig;L
ENDORMIR. Divinité qu’on invoquoit pour faite dormir
les enfans, IV. 529, b.
EN DOSSEM ENT,(Jurí(pMi veries rtgnirtcations de ce mot.
On peut faire plurteur* enaofïemens fur une lettre ou un billet
de change, a le dernier porteur d’ordre pour gatan*
lidaircs tous les endoffeurs, tireurs Se accepteurs, v'.ojo* ç-
Endoffement des lettres de change , maniere d'y mettte 1®
reçu, 1. /12, b.
ENDOSSER, ( Relieur) comment fcfait cette opération»
V .Ô K O .a .
ENDROIT, //*#, ( Cramm. ) différences entre ces motif
V. <>jo. a,
E N F E N F VJ1
«rtt, place : en quoi ces mot. différent. XII. 671. a.
FNDROMiS , ( Mijl. une. ) clwiiffurc de Diane. Celle
mie Dortoient les courcut. dans le» jeux publia. Sorte de robe
mie le. Latin» défignoient par ce mot. V. 6<o. a
ENDUIRE un btijjin, ( Hydraul.) V. 650. b.
E N D U I T . ( Archii. ) Différentes fortes d’enduits dont
varient les auteurs. V. 650. b.
E N D Y M A T J E S , Us\ ( Littir. ) danfes vêtues qui fe dan-
foient en Arcadie, bc. v .630. b.
Endvmaties, (Mil.une.) addition a cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. 11. 804. b.
ENDYMION, (Myi/i.) fil* d’Æthlius Se de Chalicc »
regna dans l’Elidc. Hiftbirc mythologique de ce prince. Fondement
de cette fable. Partage de Paufanias 'fur Endymion.
Suppl. IL804. b. . ■ ,
ENÉË, ( Myth.) fils de Vénus Se d’Anchifc. Htftoire de
ce prince, tirée de ce que les poètes 6e les hiftoriens nous
en ont raconté. Suppl. IL 805 .a.
Énék , fa fuite de Troie , XI. 790, v. fes vairteaux
changés en nymphes. XVI. 808. b. Rameau d’or par lequel
jl pénétra dans les enfers, Suppl. IV. <67. b. Trophée quil
élève après la mort de Mézence. XVI. 70Ç. a. Sa mort ; il
cft appellé Jupiter Sndigctc. VIII. 679. a. Chevaux d’Enéc.
^Nt-ïStP, obfervations fur ce poème. XII. 818. b. En
quoi conrtftc l’aftion du poème. Suppl. I. 137. a. Noeud de
l’Enéide. XI. 183. b. De l’énifode des harpie*. II. 800. b.
De la manière dont finit l’énéidc, Suppl. I. 144. b. fes beautés
Se fes défauts. 417. a , b. Parallèle cfitrc l’énéidc Se le
poème de Lucrèce de naiurâ rerutn. XII. 814. b. Auteur* qui
ont défiguré la beauté de l’énéidc. X. 39. b. Voyez l’article
V iro ilk Se le* divers articles qui traitent de l’épopée.
ÉNJÉORÊME , ( Midec. ) partie hétérogène des urine*
gardée* un certain tems, S>c. Divers noms que lui donne
Hyppocratc félon la partie qu’elle occupe dans l’urine. De
quels principes font compofcs ces différons énéorémes. V .
(»30. ¿.Sur les préfages qu’on en peut tirer, voyez Uriwk.
ENE0 ST1S , ( M/l. nat. ) pierres qui rcrtcmblcnt k des
os pétrifiés. Ce qu’en penfe Boècc de Boot. Sentiment de
quelque* naturalise» fur leur origine. V, 631. a.
ÉNERGIE , force. Ces mot* confidérés cn tant qu’il* s’appliquent
au difeours. Leur* différences. V.' ( y . a.
ENERGIQUES, (Mil. eccl.) nom donné à quelques fa-
cramcntaire* du 10* iieefe. V. 631. a.
ENERGUMENE, une perfonne poffédéc ou tourmentée
du démon. Ce qu’en penfe Papias. L’églife en admet l’exif-
tence. V. 631. a.
ENERVATION, ( Anatom. ) tendons qui fe remarquent
dans le» différentes parties des jnufcles droits du bas-ventre.
Ces tendons entrecoupent les fibres de ces mufclcs, Le nombre
de ces tendons varie dan* les différons fujets. V. 631, a.
Enervation , (Médec.) efpece d’affoibliffemem. Etymologie
de ce mot. V. 65 t. a. Quelle en cft b caufe b plus
ordinaire. Ibid. b.
ENERVER. ( Maneg. Maréch. ) But de cette opération.
Quelle cft b partie dont oh prive par-b un cheval. Comment
fe fait l’opération. Inutilité de ce douloureux expédient.
V. 651» b. ,
Enerver, opération d’énerver les chiens, XVI. 932 .a , b.
ENKVAL , (Géogr.) voyez. Moüeville.
ENFANCE. ( Midec.) On l’étcnd ordinairement jufqu’à
l’âge de fept k huit ans. V. 631. b. Le bonheur dont on peut
jouir dan* ce monde fe réduit à avoir l’efprit bien réglé,
Se le corps en bonne difpofition. Quoique l’on trouve plus
de préceptes d’éducation & l’égard de lcfprit, qu’â l’égard
du corps, cependant ce dernier ne doit pas être négligé.
C’cft dans l’enfance que l’économie animale oft le plus fuf-,
ccptiblc des cliangcmens avantageux ou nuifibles ; il cft
donc très-important de travailler alors à perfeélionner le tempérament
des enfans. Préceptes de b médecine qui nous
conduifent k ce but, Ibid. 632. a.
Enfance. Defeription philofophique de cet âgc.^ Suppl. I.
200. a. Moyens que les Lacédémoniens employoient pour
avoir des enfant beaux, roburtes , IX. 130, a. Se adroits.
1 <7. a. Obfcrvatiom philofophiqua fur la enfans. Des enfans
nés k fept Se k huit mois. VI, 444. b. S’il cft vrai que ceux
qui naiflent k huit mois ne peuvent pas vivre. VII. 959. b.
961 .a. Différences obfervécs dans les enfans, félon b durée
de* groffeffes. 939. b. Changemens qu’éprouve l’enfant nouveau
né. VU. 3. a , b. Sec. Pourquoi dès qu’il a rcfpiré, 1a
l'cfpiration lui devient d’une néccfiité ahfoiuc. Suppl. IV.
Sio. a , b. Etat du fens de b vue au moment de la naif-
fance. XVII. 363. b. Des proportions du corps de l’enfant.
Suppl, II, 344, b. Facilité avec laquelle on fait fubir au cerveau
d’un enfant nouveau-né de* comprcflion* confidérablc*
fan* inconvénient fcnfiblc. Suppl. III. 398. a. Enfant qui donna
k cinq ans des marques de virilité. Suppl. l. p.01. a. De b
rcffembbnce des entan* k leurs parens. VII, 36a. b. <69. b.
Suppl. 111, 63. b. Pourquoi quelques-uns naiflent coèffés. I.
Proportion félon laquelle l’enfant croit après la naif-
fance. 87. b. VIII, 238. a. Pourquoi b nutrition dans les
premiers rems de la vie doit être plu* abondante que b dif-
fiparion. XL 290. b. Pourquoi les enfans dorment beaucoup.
XV. 332, a. Caufe du gonflement de mammclie» dan* les
enfans. X. 2. b. Gouvernement (/ régime. De» principaux f<£-
cours qu’exige un enfant nouveau-né. Suppl. III, 599, a. Situation
qu’il -faut donner k l'enfant dés qu’il cft né : foins &
prendre lorfqu’ii a fouffert au paflage. I, 81. a. Diverfes obfervations
fur l’enfant nouveau n e , fur la manière de le
gouverner Se de le nourrir. VIII, 237. b. Nourriture des
enfans. XII. 238, b. Suppl. I. 289. a. Inconvénient de faire
jéfjner un enfant d’abord après fit naiflànce. Ibid. b. De l’allaitement
des enfans, Se de b manière de les gouverner Se
de les nourrir pendant l’allaitement. Suppl. I. 287. b.—icjÇ.
a. De b bouillie dont on les alimente ; nourriture à lui fubf■
rimer. Suppl. II. 34, b. 33. a. De l’ufagc de fe fervir de
chèvres pour nourrir les enfans. Suppl. III. p6o. b. Du fe-
vrage, voyez ce mot. De l’ufagc de les emmailloter. V. 368»
a , b. Etat de tolis les vétemens & iiflcnfilcs néccflaircs k
un enfant jufqu’â l’âge de trois mois. Suppl. III, 718. a. De
l’ufaec de bercer le» enfin*. Suppl. 1. 880. a , b. Régime de
l’enfance. XIV. 12. a. A Paris, les enfans des gens riches
ou aifé.s meurent en général moins que ceux du Bas peuple.
XVII. 233. a. Maladies de tenfance. I, 170. b. Remeocs propres
k ces maladie*. Ibid. Caufe 1a plus ordinaire des maladies
des enfans dans b mauvaife qualité que le bit contraéle
dans leur cftomac. XIII, 788. a. Cinq caufcs qui peuvent altérer
leurs humeurs. XIV. 242. b. Effets de b fenfibilité
phyfique des enfans. XV. 47. a. Comment une fage-femme
a rappel lé k la vie pluficur» enfans nouvcaiix-nés, X, 72<5. b.
Tranchées des enfans. Suppl. 1. 294. b. Atrophie. 682. a. Chlo-
rofe. Suppl. IV. 221. b. Des vers auxquels les enfans font
fujets. X v ll. 42, b. Sec. Vers qui viennent à leur nombril.
43. a. Remèdes contre les vers. 73. b. 74. a , b. Maux de
dents des enfans. IV. 848. a , b. Excoriât ion qui furvicne
quelquefois k leurs cuiflc*. VI. 228. a. Moven» de préferver
les enfans des chutes du fondement. Vil, 78. a. Moyens
de leur corriger la taille ou d’en prévenir les défauts, voyez
Attitude Se Taille. Maladies des enfans nés de parens infectés
de b vérole. XVI1, 8a. b. Examen des différentes caufcs
de mort, foit naturelle, foit violente, des enfans nouveaux-
nés. Suppl. III. 392. a , />,— 399. b. Voyez, fur les maladie*
de (’enfance , l'article ci-deflou*. V. 637. b. Sec.
E n f a n c e de Jefus-Chrijl. ( Filles de V ) (Mfl. eccl.) Congrégation
dont le but ¿toit rmftruélion des jeunes .fille* Se
le fccours de* malades. Détails fur cette congrégation. V .
632. a. Leur inflmit aboli par Louis XIV. Ib'ta. b.
ENFANT. (Phyftol. Moral. Pltilofoplt.) Sentiment que les
enfans ont de leur cxiftence. V. 401. a. Leur difpoutiotf h
prendre le caraélere moral Se les affcélions morbifiuues de
leurs nourrices. Suppl. I. 289. a. Comment les enfans apprennent
les fons Se b valeur des mots ; l’anaiyfe qu’ils doivent
faire de b penfée qu’ils veulent énoncer. IV. 74, a.
Prcmiçfcs lettres Se fylbbc* qu’ib commencent k bégayer.
VIII. 238. a. Age auquel ils prononcent diflinélement. Ibid.
Le langage d’un enfant, avant qu’il puiffe articuler, eft tour
d’intcr/cétions, 827. b. Du graflciemcnt des enfans. VII. 861.
b. De b capacité naturelle des enfan* k concevoir Se k rai-
fonner. X. 432. a , b. De ceux dont les progrès de l’efprit
ont été prématurés. Suppl. I. 200. b. Aimable familiarité des
enfans. Vl, 390, a. Caufe du peu d’intelligence qu’ils mani-
fertem quelquefois. 364. b. Pourquoi ils commencent aflez
tard à compter. III. 796. a. Comment fe font leurs progrès
par rapport â l’entendement & k l’expérience. VI, 364. b.
Parole enfantine. XII. 76. b.
E n p a n t . (Droit nat. Moral.) Devoirs des enfans envers
leurs pere Se mere. Caufe de leur affujettiffement. Pour
mieux comprendre la nature Se les bornes des devoirs des
enfans, il faut diftinguer en eux trois états , félon les trois
tems différons de leur vie ; le premier , lorfquc leur jugement
cft imparfait ; le fécond , lorfquc leur jugement eft
mûr ; le troifieme , lorfqu’ils font fortis de la famille par
le mariage. V. ¿32. b. Devoirs des enfans dans chacun do
ces états. Un enfant qui »’acquerrait jamais un dégré de
rai fon (ùffifant pour fe conduire , dépendrait toujours de
la volonté de fon pere Se de fa mere. L’âge qui amène la
raifon met les enfans hors du pouvoir paternel. La liberté
des enfant étant devenus hommes faits, & l’obéiffance qu’ils
doivent avant ce tems k leurs parens, ne font pas plus incompatibles
que b fujétion d’un prince en minorité avec
l’autorité dont il fera un jour revêtu. Un enfant cft obligé
k tout âge ¿ honorer fon pere Se fa mere : Ibid. 633.4. mais
les devoirs qu’il doit remplir envers eux lont plus ou moins
étendus , félon que le pere Se la mere ont plu*, ou moins
foigné fon éducation. Examen de la qucflion , fi l’obligation
perpétuelle d’un enfant envers fes pere 8c mere cft fondée
principalement fur b naiflance ou fur les bienfaits de l’édu*»
cation. Examen de quelques autres qucflion* J favoir, i u„