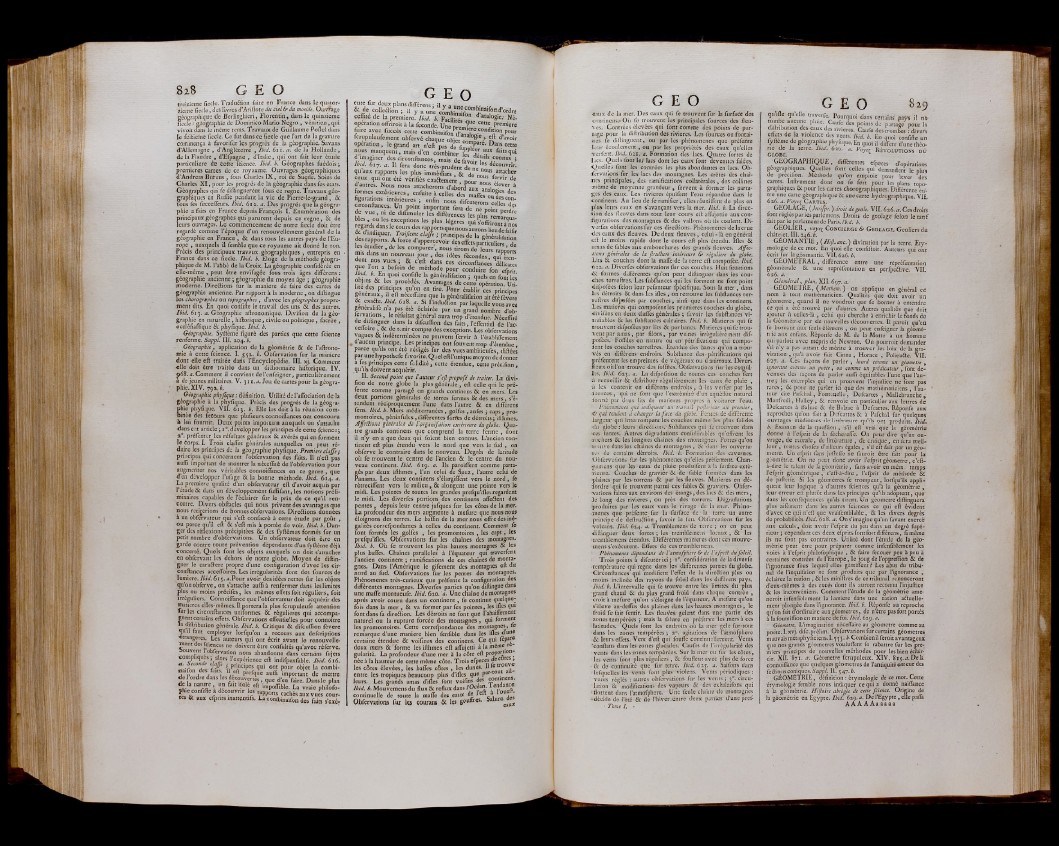
8 i 8 G E O
treizième fleclc. Traduétion faite en France dans le quatorzième
ñecle, des livres d’Ariftote du ciel & du monde. Ouvfagc
géographique de Bcrlinghieri, Florentin, dans le quinzième
Uticic : géogiaphie de Dominiéo Mario N eg ro , vénitien, qui
vivoit dans le même rems. T ravaux de Guillaume Portel dans
le ièftieine fiecle. Ce fut dans ce fiecle que l’art de la gravure
commença à frvorifer les progrès de la géographie. Savans
d’Allemagne , d'Angleterre , Ibid. 6 n . a. de la Hollande,
de la Flandre , d’Efpagne , d’Italie, qui ont fait leur étude
particulière de Cette fcicnce. Ibid. b. Géographes fuédois ;
premieres cartes de ce royaume. Ouvrages géographiques
d’Andreas Bnteus, fous Charles IX , roi de Suçde. Soins de
Charles X I , pour les progrès de la géographie dans fes états.
Géographes qui fe distinguèrent fous ce règne. Travaux géographiques
en Rurtie pendailt la vie de Pierre-le-grand, 8c
tous fes fucceffeirfsw Ibid. 612. a. Des progrès que la géographie
a faits en France depuis François I. Enumération des
principaux géographes qui parurent depuis ce regne, & de
leurs ouvrages. Le commencement de notre fiecle doit être
regardé comme l’époque d’un renouvellement général de la
géographie en France , & dans tous les autres pays de l’Europe
, auxquels il femble que ce royaume ait donné le ton.
Précis des principaux travaux, géographiques , entrepris en
France dans ce fiecle. Ibid. b. Eloge de la méthode géographique
de M. l’abbé de la Croix. La géographie confiderée en
elle-même , peut être envifagée fous trois âges différons :
géographie ancienne ; géographie du moyen âge ; géographie
moderne. Directions liir la maniere de faire des cartes de
géographie ancienne. Par rapport à la moderne, on dirtingue
les chorographes ou topographes, d'avec les géographes proprement
dits. En quoi confirte le travail des uns & des autres.
Ibid. 613. a. Géographie artronomique. Divifion de la géographie
en naturelle, hiftorique, civile ou politique, facrée ,
eccléfiartique & phyfique. Ibid. b.
Géographie. Syftéiiie figuré des parties que cette fcience
renferme. Suppl. III. 204. b.
Géographie, application de la géométrie & de l’artrono-
mie à cette fcience. I. «ça. b. Obfervation fur la maniere
dont elle ert traitée dans l’Encyclopédie. III. xj. Comment
«lie doit être traitée dans un dictionnaire hirtorique. IV.
068. a. Comment il convient del’cnfeigner, particulièrement
a de jeunes militaires. V . 31 x. a. Jeu de cartes pour la géographie.
XIV. 79a. b. r b 6
Géographie phyfique: définition. Utilité d e l’affociation de la
géographie à la phvfique. Précis des progrès de la géographie
phyfique. V i l . o r 3. b. Elle les doit à la réunion combinée
des fecours que plufieurs connoiffances ont concouru
à lui fournir. Deux points importans auxquels on s’attache
dans çet article ; i°. développer les principes de cette fcience;
20. préfemer les réfultats généraux & avérés qui en forment
le corps. I. Trois clafi’es générales auxquelles on peut réduire
les principes de la géographie phyiique. Première clajffe ;
principes qui concernent l’obfervation des faits. Il n’eft pas
aufli important de montrer la néceflité de l’obfervation pour
augmenter nos véritables connoiffances en ce genre, que
d’en développer l’ufage 8c la bonne méthode. Ibid. 614. a.
La première qualité d’un obfervatcur ert d’avoir acquis par
l ’étude & dans un développement fuififant,les notions préliminaires
capables de l’éclairer fur le prix de ce qu’il rencontre.
Divers obrtades qui nous privent des avantages que
nous retirerions de bonnes obfervations. Directions données
à un obfcrvateur qui s’eft confacré à cette étude par goût ,
ou parce qu'il ert 8c s’eft mis à portée de voir. Ibid. b. Danger
des réflexions précipitées 8c des fyftêmes formés fur un
petit nombre d’obîervations. Un oblervateur doit être en
garde contre toute prévention dépendante d’un fyftème déjà
■concerté. Quels font les objets auxquels on doit s’attacher
en obfcrvant les dehors de notre globe. Moyen de dirtin-
guer le caraCtere propre d’une configuration d’avec les circonftances
acceffoires. Les irrégularités font des fources de
lumicre. Ibid. 61 ç. ¿.Pour avoir des idées nettes fur les objets
qu’on obferve, on s’attache aufli à renfermer dans les limites
plus ou moins précifes, les mêmes effetsfoit réguliers, foit
irréguliers. Connoiffance que l’obfervateur doit acquérir des
matières elles-mêmes. Il portera la plus fcrupuleufe attention
fur les circonftances uniformes & régulières qui accompa-
gnenteertains effets. Obfervations effentielles pour connoitre
jjjrtribution générale. Ibid. b. Critique & difeuflion févere
qu u faut employer lorfqu’on a recours aux deferiptions
trangercs. ^ Les auteurs qui ont écrit avant le renouvelle*
ent des jçtences ne doivent être confultés qu’avec réferve.
! l vatl0n nous abandonne dans certains fujets
compliqués ¡ a ló n l'expérience cft indifpenfable. Ibid. 6 16 .
A;« * Prjpc*pes qui ont pour objet la combioe
oe g M l r r . 1 f -, , ;n ” ' que den faire. Dans le plan
™ S $ 6,1 ‘!olf el> Lmpoffibfc: La vraie philofo-
ph.e confifte à découvrir lea r.p¡,„r[! cachés aux vues cour-
tes & aux efprus inancnufs, La combinaifon des faiis s’exég
e o
ceffué .de la première7 Ù T b T ^ Z * ™ ^ ^
opération offrirai ;i la fcconde. Une i , J ■ Premiere
faire avec fuccés cette combinaifon S í r' - ií0n P0“
fcrupuleufement obfervé chaque obict n voir
oneratmn . » _>_/l j ‘ Comparés Dans op»«
nous manquent, mais d’en combiner t e j“ fa iB qui
d imaginer des circonftances, mais de favoit U, ^.0" " “ 5. 1
, 6 i 7- u- H fera donc très-prudent de è . „ couvrjr-
quaux rapports les plus immétfiats , & de n èm V “ “ ï r
ceux qui ont été vérifiés exaSement, pour“ mis
d autres. Nous nous attacherons d’a b o ri aux anaU- a "
formes extérieures, enfuite à celles des malles o u S S
figurations intérieures ; enfin nous difeuterons celles d™
circonrtances. Un point important fera ri» n» 7 *
de v u e , ni de diflimuler les différences les plus remam
bles , ou les exceptions les plus légères nui «’offrir» l**13’
regards dans le cours des rapports que nous aurons lieu de frifif
& d indiquer. Troifieme claffe : pr.nciues de la - Ir
des rapports. A force d’apperçevoir des effets p anteltes*'“ ?
t e e tud ier.d e les comparer, nous tirons de leurs rapport?
nus dans un nouveau jo u r , des idées fécondes, qui ètè£
& ceft, ,da" s Circonflances délicates
Tbid i V ° ? P,“ ur in d u i r e fon efprit.
o b it s & I q“ ° ‘ “ T ÿ * a généralifation ; quels en foniles
objets & les procédés. Avantages de cette opération. Utiè
é J , PrT P« S ■?“ ? " C" “ re- Po” r P U ® « s principes
généraux, il ert néceffaire que la généralifation ait été févere
f é n S f i * ' f / ’ , .1 .1 !ndu^ on Par laquelle vous avez
général!fé n a pas été éclairée par un grand nombre d’ob-
réfultat général aura trop d’étendue. Néceflité
de distinguer dans la difeuflion des faits, l’eflenticl de l’ac-
cefloire , & de t , nir compte des exceptions. Les obfervations
vagues &. indéterminées ne peuvent fervir à l’élabliiTemcnt
9 d aucun principe. Le* principes ont fouvent trop d’étendue,
parce qu’ils ont été rédigés fur des vuesambiiieufcs, diftées
par une hypothefe favorite. Q uel eft l’unique moyen de donner
a les principes cette folidité, cette étendue, cette précifion ,
qu ils doivent acquérir.
IL Second point que l'auteur s'efi propofé de traiter. La divifion
de notre globe la plus générale, eft celle qui le préfente
comme partagé en grands continens & en mers. Les
deux portions générales de terres fermes & des mers, s’étendent
réciproquement l’une dans l’autre & en différens
fens. Ibid. b. Mers méditerranées, golfes, anfes ; caps, promontoires,
péninfulcs,différentes iorfes de détroits; ifthmes..
Affcftions générales de forganifdtion extérieure du globe. Quatre
grands continens que comprend la terre ferme , dont
il n’y en a que deux qui foient bien connus. L’ancien continent
ert plus étendu vers le nord que vers le fud , on
obferve le contraire dans le nouveau. Degrés de latitude
où fe trouvent le centre de l’ancien & le centre du nouveau
continent. Ibid. 6 19. a. Ils paroiffent comme partagés
par deux ifthmes, l’un celui de âu e z , l’autre celui de
Panama. Les deux continens s’élargiffent vers le nord, fe
rétreciffent vers le milieu, & alongcnt une pointe vers le
midi. Les pointes de toutes les grandes prefqu ¡îles regardent
le midi. Les diverfes portions des continens affeftent des
pentes , depuis leur centre jufques fur les côtes de la mer.
La profondeur des mers augmente à mefurc que nous nou9
éloignons des terres. Le baffm de la mer nous offre des inégalités
correfpondantes à celles du continent. Comment fe
lont formés les golfes , les promontoires, les caps, les
prefqu’iflcs. Obfervations fur les chaînes des montagnes.
Ibid. b. Où fe trouvent les plus hautes montagnes 8c les
plus baffes. Chaînes parallèles à l’équateur qui traverfent
l’ancien continent ; ramifications de ces chaînes de montagnes.
Dans l’Amérique le gifement des montagnes eft du
nord au fud. Obfervations fur les pentes des montagnes.
Phénomènes très-curieux que préfente la configuration des
différentes montagnes. Diverfes parties qu’on diftingue dans
une maffe montueufe. Ibid. 620. a. Une chaîne de montagnes
après avoir couru dans un continent, fe continue quelquefois
dans la mer , & va former par fes pointes, les ifles qui
font dans fa dire&ion. Les détroits ne font que l’abaiffement
naturel ou la rupture forcée des montagnes , qui forment
les promontoires. Cette correfpondance des montagnes, le
remarque d’une manière bien fenfible dans les ifles u un®
certaine étendue 8c voifines des continens. Ce qui **P3r,_
deux mers 8c 'forme les ifthmes eft affujetti à la
gularité. La profondeur d’une mer à la côte eft Pr*jP(>? ie s .
née à la hauteur de cette même côte. Trois efpeces a c c »
les côtes élevées, les baffes côtes , les dunes. B *e tr „
entre les tropiques beaucoup plus d’ifles que par-tou ai
leurs. Les grands amas d’iiles font voifins des con * •
Ibid. b. Mouvemens du flux 8c reflux dans l’Océan, en
continuelle de toute la maffe des eaux de 1 elt *
Obfervations fwr les coiiram 8c les gouffres, balur
G E O
eaux de la mer. Des eaux qui fe trouvent fur la furfade des
continens.* Où fe trouvent les principales fources des fleuves.
Contrées élevées qui font comme des points de partage
pour la diftribution des rivicres. Les fources ou fontaines
ic diflinguent, ou par les phénomènes que préfente
leur écoulement, ou par les propriétés des eaux qu’elles
verfent. Ibid. C i l . a. Formation des lacs. Quatre fortes de
lacs. Quels font le/ lacs dont les eaux font devenues falées.
Quelles font les contrées les plus abondantes en lacs. Obfervations
fur les lacs des montagnes. Les crêtes des chaînes
principales, des ramifications collatérales , des collines
même de moyenne grandeur, fervent à former les partages
des eaux. Les rivières épuifcnc l’eau répandue dans le
continent. Au lieu de fe ramifier, elles réuniffent de plus en
plus leurs eaux en s’avançant vers la mer. Ibid. b. La direction
des fleuves dans tout leur cours eft affujettic aux configurations
des montagnes & des vallons où ils coulent. Diverfes
obfervations fur ces directions. Phénomènes de la crue
des eaux des fleuves. D e deux fleuves, celui - là en général
cft le moins rapide dont le cours eft plus étendu. Ifles 8c
amas de fables aux embouchure? des grands fleuves. Affections
générales de la firuflure intérieure 6» régulière du globe.
Lits 8t couches dont la maffe de la terre eft compoféc. Ibid.
622. a. Diverfes obfervations fur ces couches. Huit fituations
8c formes différentes qu’on peut diftinguer dans les couches
terreftres. Les fubftances qui les forment ne font point
dilpofées félon leur pefanteur ipécifique. Sous la mer , dans
les détroits 8c dans les ifles , on retrouve les fubftances terreftres
difpofécs par couches, ainfi- que dans les continens.
Les matières qui compofcntles premières couches du globe,
divifées en deux claffes générales ; favoir les fubftances vi-
tnfiables 6c les fubftances calcaires. Ibid. b. Matières qui fe
trouvent difpoféespar lits 8c par bancs. Matières qui fe trouvent
par amas, par filons, par veines irrégulièrement dif-
pofées. Fofliles en nature ou en pétr’fications qui compo-
fent les couches terreftres. Etendue des bancs qu’on a trouvés
en différens endroits. Subftance des • pétrifications qui
!)réfcntent les empreintes de végétaux ou d'animaux. Divers
ieux où l’on trouve des fofltles. Obfervations fur les coquilles.
Ibid. 623. a. La difpofition de toutes ces couches fert
à recueillir oc diftribuer régulièrement les caux.de pluie ,
■à les contenir en différens endroits, à les verfer par les
fources, qui ne font que l'extrémité tl’un aqueduc naturel
lormé par 'deux lits de matières propres à voiturcr l’eau.
l'/iénomeues qui indiquent un travail pofli'icur au premier,
O qui tendent à changer la face du globe. Fentes de différente
largeur qui interrompent les couches même les plus folides
du globe : leurs direCLons.' Subftances qui {s trouvent dans
ces fentes. Autres dégradations confidérables qu'offrent les
■rochers 8c -les longues chaînes des montagnes. Portes qu’on
tmuvc dans les chaînes de montagnes, 8c dans les ouvertures
de certains détroits. Ibid. b. Formation des cavernes.
Obfervations fur les phénomènes qu’elles préfentenr. Chan-
•femens que les eaux de pluie produifent à la fur face extérieure.
Couches de gravier 8c de fable formées dans les
plaines par les torrens 8c par les fleuves. Matières en détordre
qui fe trouvent parmi ces fables 8c graviers. Obfervations
faites aux environs des étangs, des lacs 8c des mers,
le long dès rivières, ou près des torrens. Dégradations
produites par les eaux vers le rivage de la mer. Phénomènes
que préfente fur la furface de - la terre un autre
principe de deftru&ion, favoir le feu. Obfervations fur les
volcan;. Ibid. 624. a. Tremblemens 'de terre ; on en peut
diftinguer deux fortes ; les tremblemens locaux -, 8c les
tremblemens étendus. Différentes maniérés dont ces mouvemens
s’exécutent. Effets de ces tremblemens.
Phénomènes dépendans de Vdtmofphere 6* de l ’afpefl du foleil.
Trois points à difcuterici; i Q. confidération de la diverfe
température qui regne dans les différentes parties du globe.
Circonftances qui modifient l’effet de la direftion plus ou
•moins inclinée des. rayons du foleil dans les différens pays.
Ibid. b. L’intervalle qui fe trouve entre les limites du plus
grand chaud 8c du plus grand froid dans chaque contrée ,
croît à mefurc qu’on s’éloigne de l’équateur. A mefure qu’on
s’élève au-deffus des plaines dans les~hautcs montagnes, le
froid fe fait fentir. Les fleures gelcnf dans une partie des
zones tempérées ; mais la falure en préftrvc les mers à ces
latitudes. Quels font les endroits ou la mer gele fur-tout
dans les zones tempérées ; 20. agitations de T'atmolphere
8c leurs effets. Vent d’eft qui foufle continuellement. Vents
’conftans dans les zones glaciales. Caufcs de l’irrégularité des
vents dans les zones tempérées. Sur la mer ou fur les côtes,
les vents font plus réguliers , 8c foufleut avec plus de force
• 8c de continuité que fur terre. Ibid. 62«. a. Saifons dans
•lefquelles les vents font plus violens. Vents périodiques :
vents réglés : autres obfervations fur les vents ; 3®. circulation
8c modifications des vapeurs 8c des cxhalaifons qui
• flottent dans l’atmofphere. Une feule chaîné de montagnes
-décide de l'été 8c de l’hiver.entre deux parties d’une pref-
• Tome 11 -
G E O 8 2 9
I “ % eaux g t »
c(tes de la violence d« veim. m d. b. En quoi confifte un
iÿftême de géographie phyfigoe.En quoi il diltee d'une théo-
ne de la terre. lb,d. 620. ». y ,y K R é v o lu t io n s dû
I G ÉO G R A PH IQ U E , différentes efpeces d'opérations
géographiques. Quelles font celles qui demandent le plus
de préciiion. Méthode qu’on emploie pour lever des
cartes. Infiniment dont on fe fert pour les plans topographiques
8c pour les cartes chorograpniques. Différence erf-
tre une carte géographique 8c une carre hydrographique. V IL
626. a. Voyer CARTtS.
GEOLAGE, ( Jurifpr. ) droit de geôle. VII. 626. a. Ces droi fi
font régies par les parlemcns. Droits de geolagc félon le tarif
faitpar le parlement de Paris. Ibid. b.
GEOLIER , voye^ C o n c ie rg£ 6* G e o la g e . Geôliers du
châteiet. III. 24 6.b.
G ÉOM AN T IE , ( Hifi. anc. divination par la terre. Etymologie
de ce mot. En quoi elle confiftoit. Auteurs qui ont
écrit fur la céomantic. VIL 626. b.
G ÉOM E TR A L , différence entre une repréfentation
géométrale 8c une repréfentation en perfpeàivc. V IL
626. a.
. Géométral, plan. XII. 697. a.
GEO M ETRE, ( Mat hem. ) on applique en général ce
nom à tout mathématicien. Qualités que doit avoir un
géomètre, quand il ne voudroit que ie borner à entendre
ce qui a été trouvé par d’autres. Autres qualités que doit
ajouter à celles-là , celui qui cherche à enrichir le tonds de
la Géométrie par de nouvelles découvertes. Il paroit qu’en
fe bornant aux fetils élémens , on peut cnleigner la géométrie
aux enfahs. Réponfe de M. de la Motte à un nomme
qui parlolt avec mépris de Newton. On potirroit demander
s’il n’y a pas autant de mérite à trouver les loix de la gravitation
, qu’à avoir fait Cinna, Horace , Polieuâe. VII.
627. a. Ces façons de parler , lourd comme un géomètre ,
ignorant comme un poète, ou comme un prédicateur, font devenues
des laçons de parler aufli équitables l’une que l’autre
; les exemples qui en prouvent l’injuflice ne font pas
rares; 8c pour ne parler, ici que des mathématiciens , l’au- '
teur cite Pafehal, Fonteaelle, Dcfcartes , Mallebranche ,
Manfrcdi, Halley, 8c renvoie en particulier aux lettres de
Defcartes à Balzac 8c de Balzac à Defcartcs. Réponfe aux
reproches qu’on fait à Defcartcs 8c à Pafchal fur quelques
ouvrages médiocres de littérature qu’ils ont produits. Ibid.
b. Examen de la queflion , s’il eft vrai que la géométrie
donne â l'efprit de la féchcrefle. On peut dire qu’un ouvrage,
de morale, de littérature , de critique, en-fera meilleur
, toutes dioies d’ailleurs égales, s’il elt fait par un géomètre.
Un efprit fans jufteffe ne faiiroit être fait pour la
géométrie. On ne peut donc avoir l’efprit géomètre, c ’eft-
à-dire le talent de la géométrie, fans avoir en mêm temps
l’efprit géométrique , c’cft-à-dire, l’efprit de méthode 8c
de jufteiiè. Si les géomètres fe trompent, lorfqu’ils appliquent
leur logique à d’autres fciences qu’à la géométrie ,
leur erreur elt plutôt dans les principes qu’ ils adoptent, que
dans les conféqucnccs qu’ils tirent. Un géomètre diftinguera
plus aifémen: dans les autres fciences ce qui eft évident
d’avec ce qui n’eft que vraifemblable, 8c les divers degrés
de probabilités. Ibid. 628. a. On s’imagine qu’un favant exercé
aux calculs, doit avoir l’efprit du jeu dans un degré fupé-
rieur; cependant ces deux efprirs font fort différens, ftmême
ils ne font pas contraires. Utilité dont l’étude de la géométrie
peut être pour préparer comme infcnfiblement les
voies à l'efprit philofopmque , 8c frire fecouer peu à peu à
certaines conrrées de 1 Europe, le joug de l’oppreflion 8c de
l’ignorance fous lequel elles gémi lient ? Les abus du tribunal
de l’inquifition ne font produits que par l’ignorance ,
éclairez la nation , 8c les miniftres de ce rribunal renonceront
d’eux-mémes à des excès dont ils auront reconnu l ’injuftice
8c les inconvéniens. Comment l’étude de la géométrie ame-
neroit infcnfiblement la lumière ddns une nation actuellement
plongée dans l’ignorance. Ibid. b. Réponfe au reproche
qu’on fait d'ordinaire aux géomètres, ;dè n’être pas fort portés
à la foumiflion en matière de foi. Ibid. 629. a.
Géomètre. L’imagination néceffaireau géomètre comme au
poëte.I.xvj.difc.prélim. Obfervations fur certains géomètres
mauvais métaphyficiens. 1. 533. b. Combien il feroit avantageux
que nos grands géomètres vouluffem fe rabattre fur les premiers
principes de nouvelles méthodes pour les bien éclaircir.
XII. 871. a. Géometre fcrupuleiix. XIV . 8iç.<r.Delà
connoiffance que quelques géomètres de l’antiquité ont eue des
feàions coniques. Suppl. II. 5 47. b.
GÉOMÉTRIE, définition : étymologie de ce mot. Cette
•étymologie femble nous indiquer ce qui a donné naiffance
à la géométrie. Hiftoire abrégée de cette fcience. Origine de
la géométrie en Egypte. Ibid. 629. a. De l’Egypte, elle paffa
A A A A A a a a a a