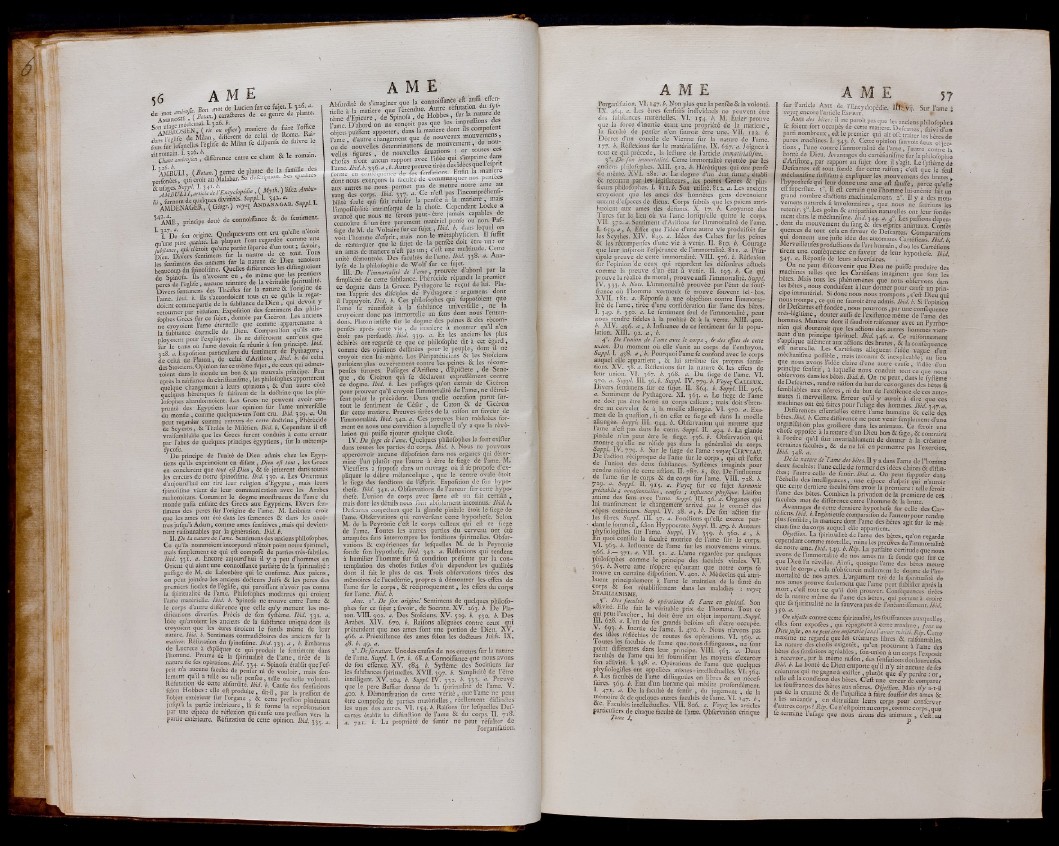
5« A M E A M E
„mbtofit Bon moi de Lucien fur ce fujet.1. 31«- «•
du mot ambre! caraifores de ce genre de plante.
Ambrosi* , v , > , ,
S°ÎMBJlOSIfS, ( rit ou office) maniéré de faire l’office
, ¡ S é S I % Milan-, différant de celui de Rome. Raa-
fo n s fur lefqncllcs l’églife de Milan fe difpenfa de fuivre le
n lOwTàmÎrl}m , différence entre ce chant & le romain.
t i AMBULI , (Boten.) genre de plante de Emilie des
perfoliées, qui c r o î t au Malabar. Sa deftripuon. ^ 9 . I
Abfurditè de s’imaginer que la connoiffance eft
tieUe à la matière que l’étendue. Autre rêfutauon du iyG
tême d’Epicure, de4 Spinofa , de Hobbes ^ k ^ u e d e
l’ame. D’abord on ne conçoit pas que la ‘ ’¿ fent
objets puiffent apporter, dans la mauere dont d
l’ame , d’autre changement que de nouveaux mo >
ou de nouvelles déterminations de mouvement>.
veUes figures , de nouveUes Ouations j °?
chofes n’ont aucun rapport avec lidée J“ 1.* '”’ !’ ‘ p ¡t
l’ame. IHi.b. 336. a , é .lm ra preuve tirée<&s.tto w e 1 tfpnt
forme en couiéqucncc de fes fenfations. Enfin la maniéré
dont nous exerçons la faculté de communiquer nos penlecs
aux autres ne nous permet pas de mettre notre ame au
rang des corps, lbid. 337. a. Ce n’eft pas 1 incompréhenfi-
biliîé foule qui fait refufer la penfée à la mariera, mais
l’impoffibilité intrinfcque de la chofe. Cependant Locke a
avancé que nous ne ferons peut-être jamais capables de
I connoître fi un être purement matériel penfe ou non. Paf-
fage de M. de Voltaire fur ce fujet, lbid- | dans lequel on
furnom de quelques divinités. Suffi. L 34a- g .
ÀMDENAGER, ( Gêogr.) v?M An d an a g au . Suffi. I. I
34AME, principe doué de connoiffance & de fentiment. |
1 r ?De fon origine. Quelques-uns ont cru qu’elle n’étoit
qu’une pure ,t J t é . La plupart l’ont regardée comme
S t o r . q u i n ’étoit qu’une partie féparée d un g g E S
Dieu Divers fentimens fur la nature • de ce tout. Tous
les fentimens des anciens fur la nature de Dieu tenoient
beaucoup du {pmofifme. QueUes différences les diftinguoient
de Spinofa. Ils, n’avoient eu , de même qiie ies
peres de l’éalife, aucune teinture de la véritable fpmtualité.
divers fentimens des Théiftes fur la nature & 1 origine de
rame. lbid. b. Ils s’accordoient tous en ce quils la regar-
doient comme partie de la fubftance de Dieu, qui devoir y
retourner par réfiifion. Expofition des fentimens des philo-
fophes Grecs fur ce fujet, donnée par Cicéron. Les anciens
ne croyoient l’ame éternelle que comme appartenante a
la fubftance éternelle de Dieu. Comparaifon quüs em-
ployoient pour l’expliquer. Ils ne différaient entr eux que
fur le tems où l’ame devoir fe . réunir à fon pnncipe. lbid.
¿ l i i l Expofition particulière du fentiment de Pythagore ,
de celui de Platon , de celui d’Ariftote, lbid. b. de celui
des Stoïciens. Opinion fur ce même fujet, de ceux qui adinet-
toient dans le monde un bon & un mauvais principe. Peu
après la naiifance du chriftianifme, les philofophes apportèrent
quelque changement à leurs opinions ; & d’un autre cote
quelques hérétiques fe faifirent de la doftrine que les philofophes
abandonnoient. Les Grecs ne peuvent avoir emprunté
des Egyptiens leur opinion fur l’ame univerfeUe
du monde , comme quelques-uns l’ont cru. lbid. 329.-a. On
peut regarder comme auteurs de cette doftrine , Phérécide
de Scycros, & Thaïes le Miléfien. lbid. b. Cependant il eft
vraifemblable que les Grecs furent conduits à cette erreur
par l’abus de quelques principes égyptiens, fur la métemp-
iÿcofe.
Du principe de l’unité de Dieu admis chez les Egyptiens
qu’ils exprimoient en difant, Dieu ejl tout, les Grecs
en conclurent que tout eft Dieu, & fe jetterent dans toutes
les erreurs de norre ipinoiiime. lbid. 330.- a. Les Orientaux
d’aujourd’hui ont tiré leur religion d’Egypte , mais leurs
fpinofifme vient de leur communication avec les Arabes
mahométans. Comment le dogme monftrueux de l’aine du
monde pafla enfuite des Grecs aux Egyptiens. Divers fentimens
des peres fur l’origine de l’ame. M. Leibnitz croit
que les ames ont été dans les femences & dans les ancêtres
jufqu’à Adam, comme ames fenfitives, mais qui deviennent
raifonnables par la génération. lbid. b.
II. De la nature de. l'ame. Sentimcns des anciens philofophes.
Ce qu’ils nommoient incorporel n’étoit point notre fpirituel,
mais Amplement ce qui eft compofé de parties très-fubtiles.
lbid. 331. a. Encore aujourd’hui il y a peu d’hommes en
Orient qui aient une connoiftance parfaite de la fpiritualité :
paifage de M. de Laloubére qui le confirme. Aux païens,
on peut joindre les anciens do&eurs Juifs & les peres des
premiers fiecles de l’églife, qui paroiffent n’avoir pas connu
la fpiritualité de l’ame. Philofophes modernes qui croient
l ’ame matérielle, lbid. b. Spinofa ne trouve entré l’ame &
le corps d’autre différence que celle qu’y mettent les modifications
diverfes. Précis de fon fyftême. lbid. 33 a. a.
Idée qu’avoient les anciens de la fubftance unique dont ils
croyoient que les êtres tiroient le- fonds même de leiir
nature. lbid. b. Sentimcns contradictoires des anciens fur la
matterei Réfutation du fjpinofifme. lbid. 333. a s b. Embarras
de Lucrèce à expliquer ce qui produit le fentiment dans
1 homme. Preuve de la fpiritualité de l’ame, tirée de la
nature de fes opérations, lbid. g g j Spinofa établit quel’ef-
pnt na aucune faculté de penfer ni de vouloir, mais feulement
qu 1la teUe ou telle penfée, telle ou telle volonté.
Réfutation -de cette abfordité. lbid. b. Caufc des fenfotions
félon Hobbçs : elle eft produite , dit-il, par la preffion de
lobjet extérieur fur l'organe , & cette preffion pénétrant
juftpia la partie intérieure, là fe forme la reprèfemation
par une efpece de réflexion qui caufe une preflion vers la
partie extérieure. Réfutation de cette opinion, lbid, 335. 4.
voit l’homme d’cfprlt, mais non le mètaphyfieien. Il fuffit
I de remarquer que le fujet de la penfée doit être un: or
un amas de matière n’eft pas un; c’eft une multitude. Cette
unité démontrée. Des facultés de l’ame. lbid. 33». a. Ana-
I lyfe de la philofophie de W o lf fur ce fujet.
I III. De l'immortalité de l'ame , prouvée d abord par la
I fimplicité de cette fubftance. Phérécide repandit le premier
I ce dogme dans la Grece. Pythagore le reçut de lui. Platon
l’apprit des difciples de Pythagore : argumens dont
il l’appuyoit. lbid. b. Ces philofophes qui fuppofoient que
l’ame fe réuniffoit à la fubftance univerfelle , ne la
I croyoient donc pas immortelle au fens dont nous 1 entendons.
Platon infifte fur le dogme des peines & des récojn-
I penfes après cette v ie , de maniéré à montrer qu il n en
I étoit pas perfuadé. lbid. 339. a. Et les anciens les plus
I éclairés ont regardé ce que ce philofophe dit a cet égard,
1 comme des opinions deftinées pour le peuple, dont il ne
I eroyoit rien lui-même. Les Péripatéticicns & les Stoïciens 1 parloient plus ouvertement contre les peines & les récom-
1 penfes futures. Paffages d’Ariftote, d’Epi&ete , de Sene-
I que , de Cicéron qui fe déclarent expreffément contre
I ce dogme, lbid. b. Les paffages qu’on extrait de Cicéron
pour prouver qu’il eroyoit l’immbrtalité de l’ame, ne détrui-
fent point le précédent. Dans quelle occafion parut fur-
tout le fentiment de Céfar , de Caton & de Cicéron
fur cette matière. Preuves tirées de la raifon en faveur de
l’immortalité, lbid. 340. a. Ces preuves bien méditées forment
en nous une conviétion à laquelle il n’y a que la révélation
qui puiffe ajouter quelque chofe.
IV. Du fiege de l’ame. Quelques philofophes la font exifter
dans toutes les parties du corps, lbid. b. Nous rie pouvons
r appercevoir aucune difpofition dans nos organes dui détermine
l’un plutôt que l’autre à être le fiege de l’ame. M.
Vieuffens a fuppolé dans un ouvrage où il fe propofe d’expliquer
le délire mélancolique , que le centre ovale étoit
le fiege des foriftions de l’âfprit. Expofition de fon hypo-'
thefe. lbid. 341. a. Obfervations de l’auteur fur cette hypo-’
thefe. L’union du corps avec llame eft un fait certain ,
mais dont les détails nous font abfolument inconnus. lbid. b.
Dcicartes conjeéiura que la glande pinéale étoit le fiege de
l’ame. Obfervations qui renverfent cette hypothefe. Selon
M. de la Peyronie c’eft le corps calleux qui eft ce fiége
| de l’ame. Toutes les autres parties du cerveau ont été
attaquées fans interrompre les tonftions foirituelles. Obfervations
& ’ expériences fur lefquelles M. de la Peyronie
I fondé fon hypothefe. lbid. 342. a. Réflexions qui tendent
I à humilier l’homme fur fa condition préfente par la con-
I templation des chofes futiles d’où dépendent les qualités
I dont il fait le plus de cas. Trois obfervations tirées des
I mémoires de l’académie, propres à démontrer les- effets de
I l’ame fur le corps, & réciproquement, lès effets du corps
I fur l’ame. lbid. b. ,
Ame. i°. De fon originel Sentimcns de quelques pjiilofo-'
I phes fur ce fujet jfavoir, de Socrate. XV. 263. b. De Pla-
I ton. VIIL 902. a. Des Stoïciens. XV. 529. b. m Ê b. Des
I Arabes. XIV. 670. b. Raifons alléguées contre ceux qui
I prétendent que nos ames font une portion de Dieu. XV.
466. a. Préexiftence des ames félon les do&eurs Juifs. IX.
I 48. b. 49. a.
20. De fa nature. Une des caufes de nos erreurs fur la nature
de l’ame. Suppl. I. 67. b. 68. a. Connoiffance que nous avons
I de fon effence. XV. 584. b. Syftême des Sociniens fur
I les fubftances fiurituelles. XVII. 397. b. Simplicité de l’être
intelligent. XV. 204. b. SuppL IV. 332. b. 333. al Preuve
I que le pere fiuffier donne de la fpiritualité de l’ame. V .
I 400- %• Démonftration de cette vérité, que 1 ame ne peut
I être compofée de parties matérielles, réellement diftin&es
les unes des autres. VI. 154- b- Raifons fur lefquelles Def-
cartes établit la diftinétion de l’ame & du corps. II. 718.
I a. 721. b. La propriété de fentir ne peut réfulter de
' l’organifation,
A M E A M E 57 Porganifation; VI. 147. b. Non plus que la penfée & la volonté.
TX. 464. a. Les êtres fenfitifs individuels ne peuvent être
des fubftances matérielles. VI. 134. b\ M. Éuler prouve
que la force d’inertie étant une propriété de la matière ,
la faculté de penfer n’en fauroit être une. VII. 112. b.
Décret d’un concile de Vienne fur la nature de l’ame.
177. b. Réflexions fur le matérialifirie. IX. Gzj.'a. Joignez à
tout ce qui précédé, la leéture de l’article immatérialifme.
3°* De fon immortalité. Cette immortalité rejettée par les
anciens philofophes. XIII. 512. b. Hérétiques qui ont penfé
de même. XVÎ. 281. a. Le dogme d’un état futur, établi
& reconnu par les léeiilateurs, les poètes Grecs 8c plusieurs
philofophes. I. o iï.b . Son utilité. 812. a. Les anciens
croyoient que les ames des: honnêtes gens devenoient
autant d’eipeces de dieux. Corps fubtils que les païens attri-
buoient aux ames des défunts. X. 17. b. Croyance des
Turcs fur le lieu où va l’ame lorfqu’elle quitte le corps.
VII. 372. a. Sentiment d’Ariftote fur l’immortalité de l’ame.
I. 659.a , b. Effet que l’idée d’une autre vie produifoit fur
les Scythes. XIV. 049. a. .Idées des Celtes fur les peines
& les récompenfes d’une vie à venir. II. 810. b. Courage
que leur infpiroit l’efpérance de l’immortalité. 811. a. Principale
preuve de cette immortalité. VIII. 576. b. Réflexion
fur l’opinion ‘de ceux qui regardent les aéfordres a&uels
comme la preuve d’un état à. venir. II. 193. b. Ce qui
prouve la réalité du moral, prouve aufli l’immortalité. Suppl.
IV. 333. b. Note. L’immortalité prouvée par l’état de fouf-
•france où l’homme vertueux fe trouve fouvent. ici-bas.
XVII. 181. a. Réponfe à une objeélion contre l’immortalité
de l’ame, tirée d’une confidération fur famé des bêtes.
I. 349. b. 3 ço. a. Le fentiment feul de l’immortalité, peut
nous rendre fideles à la probité & a la vertu. XIII. 400.
A XIV. 406. a y b. Influence de ce fentiment fur la population.
XIÏL 92. a , b.
4°’ De l ’union de l'ame avec le corps , & des effets de cette
union. Du moment où elle s’unit au corps de l’embryon.
Suppl.-1. 438. a , b. Pourquoi l’ame fe confond avec le. corps
auquel elle appartient , 8c lui attribue fes propres fendrions.
XV. 38. a. Réflexions fur la nature & les effets de
leur union. VI. 367. b.. 368. a. Du fiege de l’ame. VI.
370. a. Suppl. III. 36. b. Suppl. IV. 779 .b. Voye| CALLEUX.
Divers fentimens fur ce fujet. H. 864. b. Suppl. III. 936.
a. Sentiment de Pythagore. XI. 362. a. Le fiege de l’ame
ne doit pas être borné aii "corps calleux; mais doit s’étendre
au cervelet & à la moelle allongée. VI. 370. ¿. Exa-
ïrien de la queftion, fi en effet ce fiege eft dans la moelle
allongée. Suppl. III., 044. b. Obfervation qui montre que
l’ame n’eft pas dans le coeur. Suppl. II. 494. b. La glande
pineale n’en peut être le fiege. 536. b. Obfervation qui
montre qu elle ne réfide pas dans la généralité du corps.
Suppl. IV. 779. b. Sur le fiege de l’amé : voye^ C e r v e a u .
D e l’aétion réciproque de l’ame fur le corps, qui eft l’effet
de l’uniùn des deux fubftances. Syftémes imaginés pour
rendre raifon de cette aétiori. II. 787. b, &c. De l’influence
de l’ame fur le eprps & du corps fur l’ame. VIE. 728. b.
f.\ SuPpl- IL 915. a. Voye[ fur ce fujet harmonie
préétablie j occafionnelles, caufes s influence phyftque: Liaifon
intime des fens avec l’ame. Suppl. III. 36. a. Organes qui
lui tranfmettent le changement arrivé par le contaél des
objets extérieurs. Suppl. TV. 28. a , b. De fon aétion fur
les fibres. Suppl. fil. 37. a. Fonftions qu’elfe exerce pendant
le fommeu, félon Hyppocrate. Suppl. II. 479. b. Auteurs
phyfiologiftes, fur l’ame. Suppl. "IV. 359. b. 360. a , b.
En quoi confifte la faculté motrice de l’ame fur le corps.
VI. 363. b. Influence de l’ame fur les mouvemens vitaux.
366. b. 371. a.- VII. 31. a. L’ame regardée par quelques
philofophes comme le principe des facultés vitales. VI.
365. b. Notre ame n’opere qu’autant que notre corps fe
trouve en certaine difpofition. V.401. b. Médecins qui attribuent
principalement à l’ame le maintien de la fanré du
corps & fon rétabliffement dans les maladies : voyez
OTAHLIANISME. ‘
: P el facultés 6» opérations de l'ame en général. Son
activité. Elle fait le véritable prix de l’homme. Tout ce
qui peut 1 exciter , lui doit être un objet important. ^«/»/,
lu . 620. a. L’un de fes grands befoins eft d’être occupée.
,V. 692. b. Inertie de l’ame. I. 470. b. Nous n’avons pas
des idées .réfléchies de toutes fes opérations. VI. 369. a.
Toutes les facultés de l’ame que.nousdiftinguons, ne font
point ^différentes dans leur principe. VIII. 363. g | Deux
facultés de 1 ame qui lui fourniffent les moyens d’exercer
fon activité. I. 348. a. Opérations de l’ame que quelques
phyfiologiftes ont appellées mixtes - intellé&uelles. VI.- 364.'
A Les facultés de l’ame diftioguées en libres & en riécef-
faires. 369. b. Etat d’un homme qui médite profondément.
I. 471. a. De la faculté de fentir , du jugement , de la
mémoire & de quelques autres facultés de l’ame. V I. 147. b ,
. Facultés intellectuelles. VII. 806. a. Voyeÿ les articles
particuliers de chaque faculté de l’ame. Obfervation critique
fonte 7, ’ • ‘
fur l’article Ame du l’Encyclopédie. ife'Vij.. Sur l’ame j
voye% encore 1 article Es p r it . H . #
A me des bétes : il ne paraît pas que les anciens pllilofoph«
fe foient fort occupés de cette matière. Defcartcsv fuivi d’un
parti nombreux, eft le premier qui ait ofê traiter les bêtes de
pures machines. I. 343. b. Cette opinion fauvoit deux ohjec*
' tions , l’une contrel’iinmortalité de l’ame, l’autre contre la
bonté, de Dieu. Avantages du cartéfianifme fur la philofophie
d’Ariftote, par rapport au fujet dont il s’agit. Le fyftême de
Deicartes eft tout fondé fur cette raifon ; c’eft que le feul
méchanifine fuffiiànr à expliquer les mouvemens des brutes a
l’hypothefe qui leur donne une ame eft fauffe, parce qu’elle
eftiuperflue. i°. Il eft certain que l’hoinme lui-mênie fait un
grand nombre d’aélions machinalement. 20. Il y a des mout
vemens naturels fi^ involontaires , que nous ne (aurions les
retenir. 30. Les goûts & antipathies naturelles ont leur fonde»
ment dans le méchanifme. lbid. 344. a. 40. Les paillons dépen»
. dent du mouvement dufang & desefprits animaux. Confé»
quences de tout cela en faveur de Deicartes. Compa'raifons
qui donnent une jufte idée des automates Cartéfiens. lbid. A
Merveilleufes produirions de l’art humain, d’où les Cartéfiens
tirent une conféquence en faveur de leur hypothefe. Ë É 1
345. a. Réponfe de leurs adverfaires. .
On ne peut difeonvenir que Dieu ne puiffe produire des
machines telles que les Cartéfiens imagirient que font les
betes. Mais tous les phénomènes que nous obiervons dans
les bêtes ; nous conduifent à leur donner pour caufc un principe
immatériel. Si donc nous nous trompons, c’eft Dieu qui
noustrompe, ce qui ne fauroit être admis, lbid. b. Si i’opiniori
de Defcartes eft fondée, nous pourrons,par une conféquence
tres-légitime,, douter aufli de î’exiftence même de l’ame des
•hommes. Maniéré dont il faudrait raifonner avec un Pyrrho*
nien qui douterait que les aérions des autres hommes viennent
d un principe fpirituel. lbid. 346. a. Ce raifonnement
s applique aifément aux aélions des brutes, & la conféquence
eft naturelle. Les Cartéfiens allèguent l’idée vague d’un'
méchanifme poflible, mais inconnu & inexplicable ; au lien
que nous avons l’idée claire d’une autre caufe , l’idée d’un
pnncipe fenfitif, à laquelle nous conduit tout ce que nous
obiervons dans les bêtes. lbid. b. On ne peut, dans le fyftême •
f t i i i rteS’ rendre raifon du but de ces organes des bêtes fi
lemblables aux nôtres, ni du but de l’èxiftence de ces automates
fi merveilleux. Erreur qu’il y auroit à dire que ces
i p l i ° nt ^a*t.es Pour ^’uiage nés hommes. lbid. 347. | |
, . Difoerences effentielles entre l’ame humaine & celle des
betes. lbid. b. Cette différence ne peut venir Amplement d’une
orgamfation plus grofliere dans les animaux/Ce ferait une
chofeoppofe à la nature d’un Dieu bon & fage, & contraire
à 1 ordre qu’il fuit invariablement de donner à la créature
certaines facultés, & de ne lui en permettre pas l’exercice.
lbid. 348. a. ; . . ..
Delà nature de'Tame des bêtes. Il y a dans l’ame de l’hommç
deux facultés : l’une celle de former des idées claires & diftin-i
êtes; l ’autre celle- de fentir. lbid. a. On peut fuppofer dans •
1 échelle des intelligences, une eipece d’elprit qui n’auroit
que cette derniere faculté fans avoir la première : telle ferait
Lame des bêtes. Combien la privation de la première de ce$.
facultés met de différence entre l’homme & la brute.
Avantages de cette derniere hypothefe fur celle des Car-
tehem.lbid. b. Ingénieufe comparaifon de l ’auteurpour rendre
plus leniihle, la maniéré dont l’ame des bêtes agit fur le méchanifme
du corps auquel elle appartient.
Objeflion. La fpiritualité de l’ame des bêtes , .qu’on regarde
cependant comme mortelle, ruine les preuves de l’immortalité
de notre ame. lbid. 249. b. Rép. La parfaite certitude que nous
avons de 1 immortalité de nos ames ne fe fonde que fur ce
que Dieu la révélée. Ainfi, quoique l’ame des bêtes meure
avec le corps g cela n’obfcurcit nullement le dogme de l’immortalité
de nos ames. L’argument tiré de la fpiritualité de
nos ames prouve feulement que l’ame peut fubfifter après la
mort, c eft tout ice qu’il doit prouver. Conféquences tirées
de la nature même de l’ame des bêtes, qui portent à croire
que fa fpiritualité ne la fauvera pas de i ’anéantiflèment. Ibïd*.
350 n
On objeéle contre cette fpiritualité, les iouffrances auxquelles
elles font expofées , qui répugnent à cette maxime, Jous un
Dieu jufte , on ne peut être mijerablefans l'avoir mérité. Rép. Cette
maxime ne regarde que les créatures libres & raifonnables.
La nature des chofes exigeoit, qu’en procurant à l’ame des
bêtes des fenfations agréables, fon-union à un cotps l’exposât
àr,f®c?v?ir» par1,a1mème raifon, des fenfationsdouloureufes.
lbid. b. La bonté de Dieu emporte qu’il n’y ait aucune de fes
créatures qui ne gagne à exifter, plutôt que d’y perdre : or,
telle eft la condition des bêtes. C’eft une erreur de comparer
les iouftrances des bêtes aux nôtres. Objeflion. Mais n’y a-t-il
pas de la cruauté & de l’injuftice à faire, fouffrir des ames &
a les anéantir , en détruifànt leurs corps pour conferver
d autres corps ? Rép. Ce n’eft point au corps, comme corps, que
le termine l’ufage que nous tirons des animaux, c’.eft.au
n