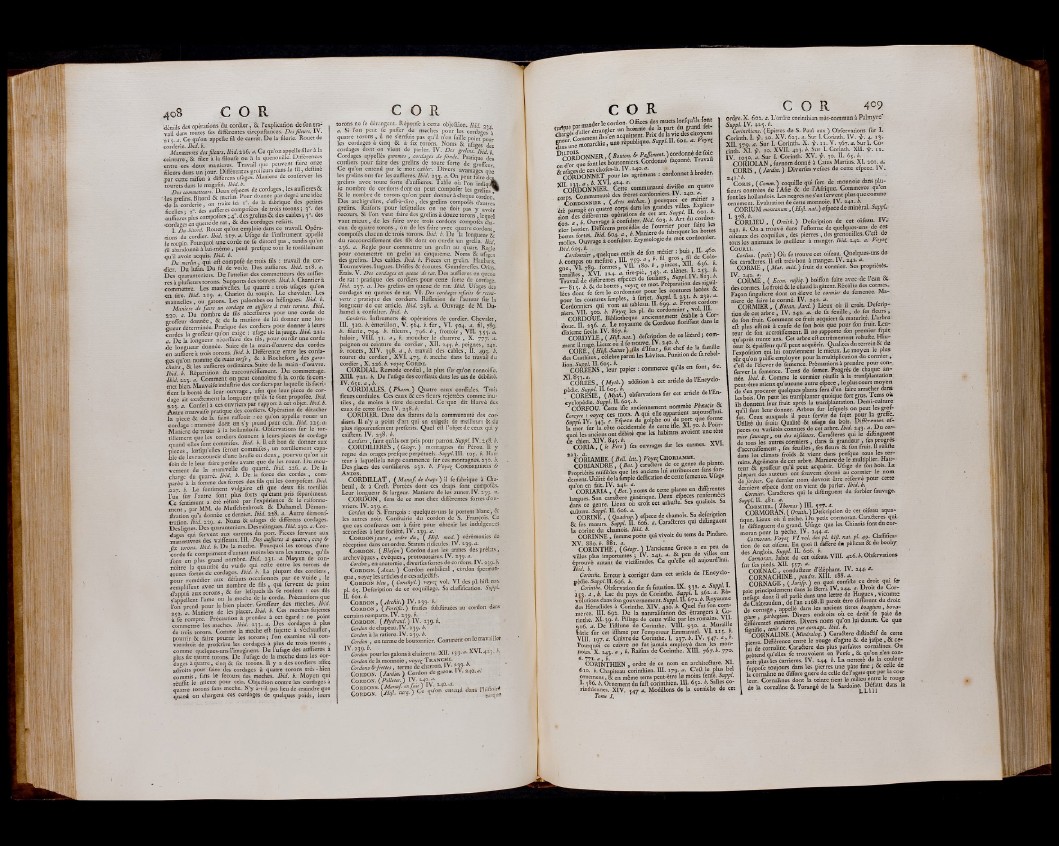
•détails des opérations 'du cordier, & l’explication de fon travail
dans toute? fes différentes circonftances. Des fileurs. IV.
s i 5, a. Ce qu’on appelle fil de «arrêt. De la filerie. Rouet de
corderie. lbid. b. _ t M , ,
Manoeuvres des fileurs. lbid. 0.16. a. Ce qu on appelle hier a la
ceinture-, & filer à la filoufe ou à la quenouille. Différences
entre ces deux maniérés. Travail que peuvent faire onze
fileurs dans un jour. Différentes groiieurs dans le fil, deffiné
par cette raifon à différens ufages. Maniéré de conferver les
tourets dans le magafui. lbid. b. sù
Des commctteurs. Deux efpeces de cordages, es auflieres&
'des erelins. Bitord & merlin. Pour donner par degre une idée
•de Fa corderie, on traite ici x°. de la fabrique des petites
ficelles * 2° des auffieres compofées de trois torons ; 3 . des
auffieres plus compofées 5 4 “. M grelins & des cables; p des
•cordages en queue de rat, & des cordages refaits.
I Du hkord. Rouet qu’on emploie dans ce travail. Opérations
du cordier. Ibid. 217. a. Ufage de l'inftrumenr appellé
le toupin. Pourquoi une corde ne fe détord pas , tandis qu un
fil abandonné 4 lui-même , perd prefque tout le tortillement
-qu'il avoit acquis. Ibid. b. _
Du merlin, qui eft compofè de trois fils : travail du cordier.
Du lufin. Du fil de voile. Des auffieres. Ibid. a i8. a.
Des quaranteniets. De l’attelier des commctteurs des aiiflie-
res à plufieurs torons. Supports des tourets. Ibid. b. Chantier à
commettre. Les manivelles. Le quarré : trois ufages quon
en tire. lbid. *19. a. Chariot du toupin. Le chevalet. Les
manuelles , ou gâtons. Les palombes ou hélingues. lbid. b.
Manière de faire un cordage en äußere i trots torons. Ihi.
sao a Du nombre de fils néccffiiires pour une corde de
nroffeur -donnée, & de la maniéré de lui donner une Ion-
lueur déterminée. Pratique des cordiers pour donner à leurs
cordes la groffeur qu’on exige : ufage de la jauge. Ibtd. mi.
a De la longueur néceflaire des fils, pour ourdir une corde
de longueur donnée. Suite de la main-d’oeuvre des cordes
en auffiere à trois torons, lbid. b. Différence entre les cordages
qu’on nomme de main torfe , & h R.ocheforr, des garo-
eboirs Si les auffieres ordinaires. Smte de la main - d oeuvre.
Ibtd b Répartition du raccourciffement. Du commettage.
lbid nun. a. Comment on peut connoître fi la corde fe commet
bien Mauvaifeindultrie des cordiers par laquelle ilsfacri-
ient la bonté de leur-ouvrage , afin que leur piece de cordage
ait exaflement la longueur qu ils fe font propofée. Ibtd.
ni-t a Confeil à ces ouvriers par rapport à cet objet. Ibtd. b.
Amte mauvaife pratique des cordiers. Opération de détacher
la piece & de la Élire raffeoir : ce quon appelle rouer un
cordage ! maniéré dont on s’y prend pour cela. Ibtd. 22,. a.
Maniéré de rouer à la hollandoife. Obfervauons fur le tortillement
que les cordiers donnent à leurs pièces de cordage
quand elles font commifes. Ibid. b. Il eft bon de donner aux
rneces lorfqu’elles feront commifes, un tortillement capable
de les raccourcir d’une braffe ou deux, pourvu qu’on ait
foin de le leur faire perdre avant que de les rouer. Du mouvement
de la manivelle du quarré. Ibtd. 116. a. De la
charge du quarré. Ibid. b. De la force des cordes , comparée
il la Pomme des forces des fils qui les compofenr. Ibtd.
ï n b. Le fendaient vulgaire eft que deux fils tortilles
l’un fur l’autre font plus forts qu’étant pris feparémenr.
Ce fendment a été réfuté par l’expérience & le rayonnement
par MM. de Muffchenbroek & Duhamel. Demon-
ftration qu’a donnée ce dernier. Ibtd. 118. a Autre démonf-
trarion. Aid. 22e,. a. Noms 6C ufages de différens cordages.
Des lignes. Des quaranteniers. Des ralingues. Ibtd. 230. a. Cordages
qui fervent aux carénés du port. Picces fervant aux
manoeuvres des vaiffeaux. 111. Des auffieres à quatre , cinq &
fix torons, lbid. b. De la meche. Pourquoi les torons d’une
corde fe compriment ¿’autant moins les uns les autres, qu’ils
font en plus grand nombre, lbid. 231. a. Moyen de connoître
la quantité du vuide qui refte entre les torons de
toutes fortes de cordages, lbid. b. La plupart des cordiers ,
pour remédier aux défauts occafionnes par ce vuide , le
rempliffent avec un nombre de fils , qw fervent de point
d’appui aux torons, & fur efque s ils fe roulent : ces fils
s’appellent l’ame ou la meche de la corde. Précautions que
l’on prend pour la bien placer. Groffeur des meches. Ibtd.
I f i va Maniéré de les placer, lbid. b. Ces meches fujettes
à fe rompre. Précaution à prendre à cet égard : ne point
commettre les meches. lbid. 233. | Des cordages a plus
de trois torons. Comme la meche eu fujeue a s échauffer,
pourrir 8c faire pourrir les torons; l’on examine su con-
vieadroit de proferire les cordages à plus de trois torons ,
comme quelques-uns l’imaginent. De l’ufage des auffieres a
plus de quatre torons. De .l’ufage de la meche dans les cordages
à quatre , cinq & fix torons. Il y a des cordiers affe^.
adroits pour faire des cordages à quatre torons très-bien
commis, fans le fecours des meches. lbid. b. Moyen qui
réuffit le mieux pour cela. Objeélion contre les cordages à
quatre torons fans meche. N’y a-t-il pas lieu de craindre que
quand on chargera ces cordages de quelques poids, leurs
torons ne fe dérangent. Réponfe à cette objeâion. lbid. 2
a. Si l’on peut fe paffer de meches pour les cordages à
quatre torons , il ne s’enfuit pas qu’il n’en faille point pour
les cordages à cinq & à fix torons. Noms & ufages des
cordages dont on vient de parler. IV. Des grelins, lbid. b
Cordages appellés ginnmes , cordages de fonde. Pratique des
cordiers pour faire des grelins de toute forte de groffeur
Ce qu’on entend par le mot câbler. Divers avantages que
les grelins bnt fur les auffieres. lbid. 235. a. On peut faireÉIÈ
grelins avec toute forte d’auffieres. Table où l’on indiqué
le nombre de cordons dont 011 peut compofer les grelins^
& le nombre de torons qu’on peut donner à chaque cordon*.
Des archigrelins, c’eft-à-dire, des grelins compofés d’autres
grelins. Raifons pour lefquelles on ne doit pas y avoir
recours. Si l’on veut faire des grelins à douze torons, lequel
vaut mieux, de les faire avec trois cordons compofés chacun
de quatre torons-, ou de les faire-avec quatre cordons
compofés chacun de trois torons, lbid. b. De la longueur &
du raccourciffement des fils dont on ourdit un grelin. lbid.
236. a. Réglé pour commettre un grelin au quart. Réglé
pour commettre un grelin au cinquième. Noms & ufages
des grelins. Des cables. lbid. b. Pièces en grelin. Haubans.
Tournevires. Itagues. Driffes & écoutes. Guindereffes. Orihs.
Etais. V. Des cordages en queue de rat. Des auffieres en queue
de rat : pratique des cordiers pour cette forte de cordage.
lbid. 237. a. Des grelins en queue de rat. lbid. Ufages des
cordages en queues de rat. VI. Des cordages refaits 6* recouverts
: pratique des cordiers. Réflexion de l’auteur fur la
longueur de cet article, lbid. 238. a. Ouvrage de M. Duhamel,
à confultcr. lbid. b.
Corderie. Inffrumens &. opérations de cordier. Chevalet,
III. 310. b. émeri lion, V. 564. b. fer , VI. 504. a. fil, 789;
b. filerie, 794. b. fileurs, 796. b , frottoir, VIT. 355.11.
haloir, VIII. 31. a, b. moucher le chanvre , X. 777. a.
peignon ou ceinture du cordier , XII. 245. b. peignes, 241.
b. rouets, XTV. 398. a , b. travail des cables, II. 493. b.
touret du cordier, XVI. 473. b. meche dans le travail du
cordier, X. 226. b. voye{ C o r d e .
CORDIAL. Remede cordial, le plus fur qu’on connoiffe.
XI1L 721. b. De l’ufage des cordiaux dans les cas de débilité.
IV. 651 .a ,b .
CORDIALES. ( Pharm.) Quatre eaux cordiales. Trois
fleurs cordiales. Ces eaux & ces fleurs rejettées comme inutiles,
du moins à titre de* cordial. Ce que dit Harvé des
eaux de cette forte. IV. 238. b.
CORDIER. Date des fiatuts de la communauté des cor-
diers. Il n’y a point d’art qui en exigeât de meilleurs & de
plus rigoureufement preferits. Quel eft l’objet de ceux qui y
exiftent. IV. 238. b.
Cordiers , faintqu’ils ont pris pour patron.Suppl. IV. 258.b.
CORDILIERES , ( Géogr. ) montagnes du Pérou. Il y
regne des orages prefque perpétuels. Suppl. III. 105. b. Hauteur
à laquelle la neige commence fur ces montagnes. 230. b.
Des glaces des cordilieres. 231. b. Voyeç C o r d e l ie r e s &
A n d e s .
CORDILLAT , ( Manuf. de draps ) il fe fabrique à Cha-
beuil, & à Creft. Portées dont ces draps font compofés.
Leur longueur & largeur. Maniéré de les auner. IV. 230. n.
CORDON, fens de ce mot chez différentes fortes d’ouvriers.
IV. 239. a.
Cordon de S. François : quelques-uns le portent blanc, &
les autres noir. Confrairie du cordon de S. François. Ce
que ces confrères ont à faire pour obtenir les indulgences
accordées à leur fociété. IV. 239. a.
C o r d o n jaune, ordre du, ( Hifi. mod. ) cérémonies de-
réception dans cet ordre. Statuts ridicules. IV. 239. a.
C o r d o n . ( Blafon) C o r d o n dans le s arm es d e s p r é la t s ,
a r c h e v ê q u e s , é v ê q u e s , p ro to n o ta ir e s .IV. 239.a.
Cordon, en anatomie, aiverfes fortes de cordons. IV. 239. b>
C o r d o n . (Anat. ) Cordon ombilical , ebrdon fpermatique,
voyelles articles de ces adjeftifs. 1
CO RD ON bleu, ( Conchyl.) voye{ vol. VI des pl. hift. nat.
pl. 65. Defcription de ce coquillage. Sa claffification. Suppl-
I H. 601. b.
C o r d o n , (Archit.) IV. 239. b.- ^
C o r d o n , (Fortifie.) fraifes fu b ftitu é e s au co rd o n dans
ce r ta in s rem p arts . IV. 230. b.
C o r d o n . ( Hydraul. ) IV. 239. b.
Cordon de chapeau. IV. 239. b.
Cordon à la ratiere. IV. 239. b.
Cordon , en terme de boutonnicr. Comment on le travailler
Cordon pour les galons à chaînette. XII. »33* a‘ XVI. 423. b.
Cordon de la monnoie, voyeç T r a n c h e .
Cordons & fret te s , te rm e d e ch ar ron. IV. 239. . •
C o r d o n . ( Jardin. ) C o r d o n d e gazon. .24 .a.
C o r d o n . (Pelleter.) IV-24°-a-
Set le cordon. Offices des muets lorfqu ils (ont I
•»«¡ue par»“ ier „ „ homme de la part du grand fei-
chargésdaU er toang^ y g » pnlt de la vie des citoyens
Eun^monarchie, une ¿publique. Suffi IL fo i. * Voy't
D rnRDONNER, ( Bouton. b Puffemnl.) cordoimé de foie
oi. d V que font les boutonnière. Cordon,.é façonné. Travail
& C08RDONNETfj)Our les agrémens : cordonnet à broder. I
^CO&ONNLER. Cette communauté divifée en quatre I
Communauté des freres cordonniers. IV. 240. a. 1
C o rd o n n ie r , ( Ans mlchan.) pourquoi ce la in 't " 1
été partagé en quatre corps dans les grandes
molles. Ouvrage i confolter. Etymologiedu mot cordonnier. 1
n C o ^ Ù ,r , q u e l q u e s d e fon ^ ‘'‘' ' ¿ ^ ^ ’ de'Colt
» X - t m e ^ V W ê', pinces, ML d,6. |
Tmvlft d’e « ¿ e n « ^ » " ' . ' 1 ^ ^
nour les coutures funples, à futjet..Suppl L m i. b. 23a. a.
Cordonniers qui vont au tableau. II. 690. * f°,n
niers. VU. 30a i. Voyn les pl. du cordonnier , vol. 1U.
CORDOUE. Bibliothèque anciennement étabhe à Cor-
doue. II. 236. a. Le royaume de Cordoue floriffant dans le
^CORDYLe'^C Htl.nat.) defcription de ce lczard; comment
il naae. lieux ou il fe trouve. IV. 240. i.
COKÉ f ( Bifi. Suinte ) i l s d’Ifaar, fut chef de >a fanulfc
des Caathites, célébré parmi les Lévites. Punition de fa rebellion.
Suppl. II. 605. b. /•„. a ,
CORÉENS, leur papier : commerce quils en font, tyc.
XIC<5èÉES, ( Myth.) addition à cet article del’Encyclo-
^CO RE ^ E , {Myth.) obfervations fur cet article delEn-
Cyc 2 ’RrOU. ^ette ifle^ anciennement nommée PhæacuSç I
Corcyrc : -wvk ees mots. A qui elle apparrient aujourdhui. I
Suffi. IV. 343- Efpece de golphe ou de pott que forme I
la mer fur la côte occidentale de cette ifle. XL 70.4. Pour I
quoi les anciens ont débité que les habitans avoient une tete I
de chien. XIV. 845. b. w i I
CORIA, ( le Pere) fes ouvrages fur les carmes, a v i . i
’ 2^iORIAMBE. (Bell Ittt.) Poytj;Choriambi. I
CORIANDRE, ( Bot. ) caraftere de ce genre de plante. I
Propriétés nuiftbles que les anciens lui attribuoient fans fon- |
dement. UtUitè de la fimple deffication de cette femence. Ufage I
qu’on en fait. IV. 241. a. j-a-. |
CORIARIA, ( Bot. ) noms de cette plante en différentes I
langues. Son caraîlere générique. Deux efpcces renfermées I
datl ce genre. Lieux ou oroit cet arbufte. Ses qualités. Sa 1
culture. Suppl. II. 6o6. u. „ . . . I
CORINE, ( Quadrup.) efpece de chamois. Sa defcription I
& fes moeurs. Suppl. H. 606. Carafteres qm diftinguent
la corine du chamois. lbid. b. D.„j,rA I
CORINNE, femme poète qui vivoit du tems de rmüare.
XV. 880. b. 881. a. * .
CORINTHE, (Géogr.) L’ancienne Grece a eu peu de
villes plus importantes ; ÎV. 241. a. & peu de villes ont
éprouvé autant de viciffitudes. Ce qu’elle eft au)ourdhui.
lbid. b. .
Corinthe. Erreur à corriger dans cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. II. 606. b. 0 1 t
Corinthe. Obfervation fur fa fituation. IX. 332. a. SuppUt.
j ^3. a , b. Lac du pays de Corinthe. Suppl. I. 262. a. Révolutions
dans fon gouvernement. Suppl. H. 672. b. Royaume
des Héraclides à Corinthe. XIV. 420.fi. Quel fut fon commerce.
III. 692. De la naturalifation des étrangers à Co-
rinthe. XI. 39. b. Pillage de cette ville par les romains. VII.
916. u. De l’ifthme de Corinthe. VIII. 930. a. Muraille
bâtie fur cet ifthme par l’empereur Emmanuel. VI. 215. b.
VIII. 197. a. Cuivre de Corinthe. I. 237. b. IV. 547. u,b.
Pourquoi ce cuivre ne fut jamais employé dans les mon-
poies. X. 243. a , b. Raifins de Corinthe. XIII. 767. b. 770.
COMNTHOEN , ordre de ce nom en archite&ure. XI.
6to. b. Chapiteau corinthien. III. 179. a. C’eft le plus bel
ornement, & en même tems peut-être le moins fenfé. Suppl.
1. 586. b. Ornement du fuft corinthien. III. 65*. Salles corinthiennes.
XIV. 547 a. Modillons de la corniche de cet
Tome 1.
ordre. X . 6 0 2 . a. L’ordre corinthien trè s -com m u n à Palmyre
Suppl. IV. 2 2 5 . b. ' r ’ t ‘
Corinthiens. (Epitres de S. Paul aux) Obfervations fur I.
Gorinth. L ÿ . 20. XV. 622. a. Sur l.Corinth. IV. -ÿ. 4- *3-
XII. 379. a. Sur I. Corinth. X. if. 11. V. 367. a. Suri. Co-
rinth. XI. f - 10. XVII. 423. b. Sur I. Connth. XII. if. 11.
IV. 1030. a. Sur I. Corinth. XV. f . 30. IL 65. b.
CORIOLAN, furnom donné à Caïus Maruus. XI. 201. a.
CORIS, (Jardin.) Diverfes vefees de cette efpece. IV.
’ 4 C o r i s , ( Cotnnt. ) coquille qui fert de monnoie dans plu-
fieurs contrées de l’Afie & de l’Afrique. Commerce quen
font les hollandois. Les negres ne s’en fervent plus que comme
ornement. Evaluation de cette monnoie. IV. 241.
CORIUM montanum, (Hifi. nat.) efpece de minéral. Suppl.
1 FoRLIEU , ( Ornith. ) Defcription de cet oifeau. IV;
241. b. On a trouvé dans l’eftomac de quelques-uns de « s
oifeaux des coquilles, des pierres , des grenouilles. C’eft de
tous les animaux le meilleur à manger, lbid. 242. a. Voytç
C o u r l i . ( H H H J ,
Corlieu. (petit ) Où fe trouve cet oifeau. Quelques-uns de
fes caraôeres. Il eft très-bon à manger. IV. 242. a.
CORME, (Mat. mèd.) fruit du cormier. Ses propriétés.
CORMÉ, ( Econ. ruftiq. ) boiffon faite avec de l’eau &
I des cormes. Le froid & le chaud la gâtent. Récolte, des cormes.
Façon finguliere dont on éleve le cormier de femence. Maniéré
de faire le cormé. IV. 242. a. ,
CORMIER, ( Botan. Jard. ) Deux ou il croit. Delcnp-
tion de cet arbre , IV. 242. *. de fa feuille, de fes fleurs ,
de fon fruit. Comment ce fruit acquiert fa maturité. L arbre
eft plus eftimé à caufe I de fon bois que pour fon fruit. Len- teur de fon accroiffement. Il ne rapporte fon premier iÿut I qu’après trente ans. Cet arbre eft extrêmement robufte. HauI
teur& épaiffeur qu’il peut acquérir. Qualités du terrein & de l’cxpofition qui lui conviennent le mieux. Le moyen le plus I sur qu’on Puiffe employer pour la multiplication du cormier , 1 c’eft de l’élever de femence. Précautions à prendre pour con-„ 1I ferver la femence. Tems de ferner. Progrès de chaque an- née. lbid. b. Comme le cormier réuffit à la tranfplantation
* peut-être mieux qu’aucune autre efpece, le plus court moyen
de s’en procurer quelques plants fera d’en faire arracher dans
les bois. On peut les tranfplanter quoique fort gros. Tems ou
ils donnent leur fruit après la tranfplantation. Demi-culture
qu’il faut leur donner. Arbres fur lefquels on peut lesgret-
fer. Ceux auxquels il peut fervir de fujet pour la greffe.
Utilité du fruit/ Qualité & ufage du bois. Différentes efc
peces ou variétés connues de cet arbre, lbid. 243. a Du cormier
fauvage, ou des oifeleurs. Caraûeres qui le diftinguent
de tous les autres cormiers , dans fa grandeur, fes Pr°51]” ‘
d’accroiffement, fes feuilles, fes fleurs & fon fruit. 11 réfifte
dans les climats froids & vient dans prefque tous les ter-
reins. Agrémens de cet arbre. Maniéré de le multiplier. Hauteur
& groffeur qu’il peut acquérir. Ufage de fon bois. La
plupart des auteurs ont fouvent donné au cormier le nom
de forbier. Ce dernier nom devroit être réfervé pour cette
derniere efpece dont on vient de parler. Ibid. b. g
Cormier. Carafteres qui le diftinguent du forbier fauvage.
Suppl. II. 481. a.
C o r m i e r . ( Thomas ) III. 577* , .*
CORMORAN. ( Omith. ) Defcription de cet oifeau aquatique.
Deux où il niche. Du petit cormoran. Caractères qqv
le diftinguent du grand. Ufage que les Chinois font du cormoran
pour la pèche. IV. 244. a. _ ■
I Cormoran. Voye[ VI vol. des pl. hifi. nat. pl. 49. Claffifica-
tion de cet oifeau. En quoi il différé dm pélican & du booby
jaïiot ' ff e ' cet oifeau. VIIL 426.4. Obfcrv.fons 1 fur fes pieds. XII. 557* a- , „ r ^ 1 CORNAC , conduâeur d éléphant. IV. 244» <*• II CCOORRNNAACGHEI, N(E Ju, rpifopu.d )r ee. nX IqluIo. i 1c8o8n. faif.te ce droit qui Cet
I paie principalement dans le Bern. IV. 244. a. Droit de Cor-
nefage dont il eft parlé dans une lettre de Hugues , vicomte
de Châteaudun, de l’an 1 1 6 8 . Il paroit être différent du droit
de cornage, appellé dans les anciens titres boagium, bova-
eium , garbagium. Divers endroits ou ce droit fe paie de
différentes maniérés. Divers noms qu on lui donne. Ce que
fienifie, tenir du roi par cornage. Ibid. b.
CORNALINE.(Aluiéralog.) Caraôere diftinâif de cette
pierre. Différence entre le rouge d’agate & de jafpe, & celui
de cornaline. Caraftere des plus parfaites cornalines. On
prétend qu’elles fe trouvoient en Perfe, & qu’on n’en con-
noît plus les carrières. IV. 244. b. La netteté de la couleur
fuppofe toujours dans les pierres une pâte fine ; & celle de
la cornaline ne différé guere de celle de l’agate que par la couleur.
Cornalines dont la teinte tient le milieuentre le rouge
de la cornaline & l’orangé de la Sardoine^ Défaut dans la