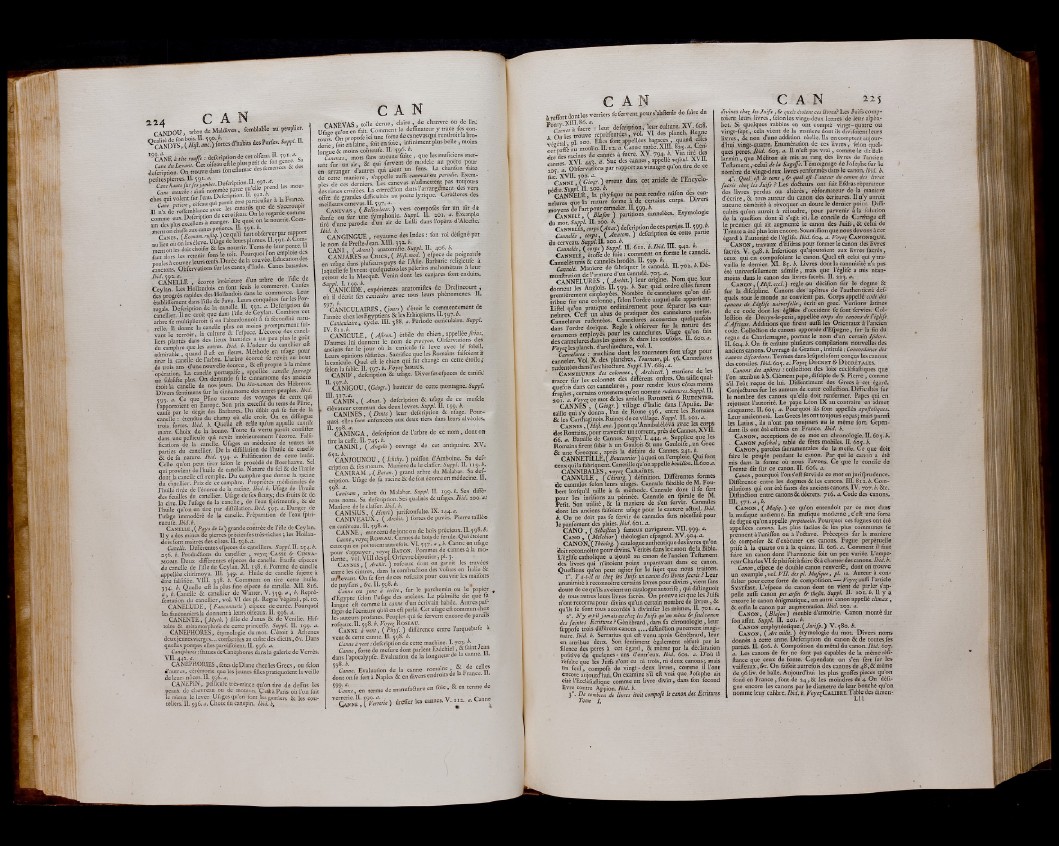
n 4 C A N
CANDOU, arbre de Maldives, femblaïle au penpUer. i,habiK desPerfes- BI ’ ^AN E à têt. touffe : dëfcription de cet oifeau. H. 591;*-
¿efcription. On trouve dans foneflomac deslemen
Can. ™ « 4 ;a in f . nommée parce nu g m « .
* » à la France.
Cane peticre, oifeau qu p canar(ls que de s’accroupir
1 "'a re^ mr vn^^de cet oifeaiu Oi?le regarde comme
r S p t e e r f lS à n r a n g e r . ■gBfln»a LTalors les retenir fousletoîr. Pourquoi 1 on emploie des
poules à couver leurs reufs.Durèe de^acouvé^Educationdes
Lierons. Obferyadons fur les canes, d Inde. Can e s bâtardes.
* c i& E L L E , écorce Intérieure d’un arbre de l’ifle de
Ceylan. Les HoUandols en font feuls le commerce. Caufes
des progrès rapides des Hollandais dans le commerce. Leur
ètabüffement dans l’ifle de Java. Leurs conquêtes furriesPortugais.
Dëfcription de la canelle. II. 59a. g Defcnpuon du
canellier. Il ne croît que dans l’ifle de Ceylan. C01^ " K
arbre fe multiplierait fi on l’abandonnoit a fa fécondité naturelle.
Il donne la canelle plus ou moins promptement lui
vant le terroir, la culture & l’efpece. Lécorce des canel
liers plantés dans des Ueux humides a u„ peuplus egout
du camphre que les autres, lbti. du canellier eft
admirable , quand il eft en fleurs. Méthode en ufage pour
rirer la canelle de l’arbre. L’arbre écorcé fe revet au bout
de trois ans d’une nouvelle écorce i & eft propre à la meme
Iopération. La canelle portugaife, appellée tan.ll. fauvap
ne fubfifte plus. On demande fi le cinnamome des anciens
étoit la canelle de nos jours. Du km-namam des Hébreux.
Divers fenumens fur la cinnamome des autres peuples. Ibtd.
<01. a. Ce que Pline raconte des voyages de ceux qui
ï'apportoient en Europe. Son prix exceflif du tems de Pluie,
caulé par le dégât des Barbares, Du débit qui fe fait de la
canelle : étendue du champ où elle croit. On en difiingue
■ trois fortes, Ibid. b. Quelle eft celle quon appelle caa.ll.
,natte. Choix de la bonne. Toute fa vertu paraît confifter
dans une pellicule qui revêt intérieurement l’écorce. Falfi-
fications de la canelle. Ufages en médecine de toutes les
parties du canellier. De la dUhllation de l’hulle de canelle
& de fa nature, ttid. 594. a. Falfification de cette huile.
Celle qu’on peut tirer félon le procédé de Boerhaave. Sel
qui provient de l’huile de canelle. Nature du fel & de l’huile
dont la canelle eft remplie. Du camphre que donne la racine
du canellier. Prix de ce camphre. Propriétés médicinales de
l ’huile tirée de l’écorce de la racine. lbid. b. Ufage de l'huile
des feuilles du canellier. Ufage defes fleurs; des fruits & dc
la cire. De l’ufage de la canelle, de l’eau fpiritueufe, 8c de
l’huile qu’on en tire par diftillarion. Ibid 595. a. Danger de
l ’ufage immodéré de la canelle. Préparation dé l’eau fpiri-
tueule. Ibid.b. »
C a n e l l e ,(Pays de la) grande contrée de l’ifte de Ceylan.
11 y a des mines de pierres précieufes très-riches ; les Hollan-
dois font maîtres des côtes. II. 596. a.
Canelle. Différentesefpeces de canelliers. Suppl.TL. 1^4.b.
356. b. Produirions du canellier , voytf^-C a s s e & C in n a m
om e . Deux différentes efpeces de canelle. Fauffe efpeces
de canelle de Fille de Ceylan. XI. 138. b. Pomme de canelle
appellée chirimoya. III. 349. a. Huile de canelle fojette à
être falfifiée. VIIL 538. b. Comment on tire cette huile.
334- % Quelle eft la plus fine efpece de canelle. XII. 816.
a , b. Canelle & canellier de Winter. V. 35^. a , b. Repré-
femation du canellier, vol. VI des pl. Regne végétal, pl. 10.
CANELUDE, | Fauconnerie) eibece de curée. Pourquoi
les fauconniers la donnent à leurs oileaux. II. «96. a.
CANENTE, (Myth. ) fille de Janus & de Venilie. Hif-
toire & métamorphofe de cette princefle. Suppl. II. 199. a.
CANEPHORES, étymologie du mot. C’éroit à Athènes
deux jeunesvierges.... confaprées au culte des dieux, &c. Dans
quelles pompes elles paroiffoient. IL 596. a.
C<2Rcpéor«j:ftatuesdeCanéphores dans la galerie de Verres.
.VII. 44a. a.
CANÉPHORIES, fêtes de Diane chez les Grecs , ou félon
d’autres, cérémonie que les jeunes filles pradquoient la veille
de leurs nôçes. II. 596. a.
CANEP1N, pellicule très-mince qu’on tire de deffus les
peaux de chevreau ou de mouton. Ç’eftàParis où l’on fait
le mieux le lever. Ufages qu’en font les gantiers & les couteliers.'
II. 596. a. Choix du canepin. Ibid, bA
C A N
CANEVAS , toile écrue, claire , de chanvre ou de lut;
Ufagequ’onen fait. Comment le deflinateur y trace f e cou-
r o u f On propofe ici une forte de canevasqn. rendrait labro,
derie, foit en laine, foit en foie , infiniment plus belle, moins
longue & moins coûteufe. II. 596. A
Canna,, mots fans aucune fuite, que lesmuficiens mettent
fur un air, 8c qui fervent de modele au ooete pour
en arranger d’autres qui aient un fens. La chanfon feue
âfe cette maniere, s’appelle aulii canevas ou parodie. Exemples
de ces derniers. Les canevas n’admettent pas toujours
des rimes croifées. La correftion dans 1 arrangement des vers
olire de grandes difficultés au poète lyrique. Carafteres des
meilleurs canevas. II. 597, u. - ■ .
C a n e v a s , ( Belles-lellr. ) vers compofes fur un air de
darde ou fur une fÿmphonie. Suppl. II. »01. a. Exemple
tiré d’une parodie d’un air de Lulh dans 1 opéra dAlcefte.
HCANGINGUE , royaume des Indes : fon roi défigné par.
le nom de Prrfte-Jem. XIII. J Ii. é-
CAN I, ÌArent') anatomifte. Suppl.IL’ 4P6. i. . ■■■ I
CANJARESob C ric s, ( Hß.mod. ) efpece de poignardé
en ufage dans plufieurs pays de fAfie. Barbarie religieufe u
laquelle fe livrent quelquefois les pèlerins mahométans à leur
retour de la Mecqué. Venin dont les canjares font endmts.
Ìii'(,'ANÌCt'i)E, expériences anatomiftes de Drelincourt ,’
où il décrit fes caatcidts avec tous leurs phénomènes. 11.
C a n i c u l a i r e s , {jours) c’étoit le commencement de
l’année chez les Egyptiens & les Ethiopiens. II. 597. L
Caniculaire, cÿcle. UI. 388. a. Période caniculaire. Suffi.
IV.811.A ' , . . ,,, r • •
CANICULE, ( Aftron.) étôile du chien, appelléefirms..
D’autres loi donnent le nom de procyon. Obfervanons des
anciens fur le jour où la canicule fe leve avec le foleiL
Leurs opinions réfutées. Sacrifice que les Romains faifoient*
la canicule. Quel eft le chien qui fut changé en cette étoile I
félon la fable. II. 597. b. Voyer Sirius.
CANIF , defcripdon 8c ufage. Diverfes efpeces de camts.
I P g H (CiAgr.) hauteur de cette montagne. Sappi.
^(?AN1N , ( Anat. ) dëfcription 8c ufage de ce mufde
élévateur commun des deux levres. Suppl. II. 199. b.
CANINES, ( Dents ) leur defcnpuon Sc nlage. Pourquoi
elles font enfoncées aux deux tiers dans leurs alvéoles.
Vf. <98. a. v
CANINGA, dëfcription de l’arbre de ce nom , dont on
tire la cafte. II. 745. b. . ;
CANINI, ( Angelo) ouvrage de cet antiquaire. XV.
^CANJOUNOU, ( lchthy. ) poiffon d’Amboine. Sa def-
cription & fes moeurs. Maniere de le claffer. Suppl. H. 119. b.
CANIRAM ,-^Botan.) grand arbre du Malabar. Sa def-
criprion. Ufage de fa racine & de fon écorce en médecine. H.
,9Cuniram, arbre du Malabar. Suppt. II. 199. i . Scs diffé-
rens noms. Sa dëfcription.Ses qualités & ufages. lbid. 200.ai
Maniere de le claffer. Ibid. b.
CANISIUS, (Henri) jurifconfulte.IX. 144.0. .
CANIVEAUX, I Archit. ) fortes de pavés. Pierre tailléo
en caniveau. II. 598. r. . . . . • n « «.
CANNE, morceau de jonc ou de bois précieux. 11.590. b.
Canne, voyez R oseau. Cannes de bois de ferule. Qui étoienc
ceuxqui en portoientautrefois. V I. 557. a , b. Canne en ufage
pour s’appuyer, voye^ Bâton. Pommes de cannes à la moderne,
vol. VIII des pl. Orfevre-bijoutier, pl. 3. •
C annes , ( Archit. ) rofeaux dont on garnit les travées
entre les cintres, dans la conftruaion des voûtes en Italie &
aiî*levant. On fe fert de ces rofeaux pour couvrir les maifons
de payfans, &c. II. 598. b. . . . * ;
Canne ou jonc à écrire, fur le parchemin ou le papier ,
d’Egypte félon l’ufage des anciens. Le pûlmifte dit que la
langue eft comme la canne d’un écrivain habile. Autres paf-
fages de l’écriture où il en eft parlé. Cet ufage eft commun chez
les auteurs profanes. Peuples qui fe fervent encore de pareils
rofeaux.il.<98.b. Voye^R oseau. ¡ B B
Can n e à vent, (Phyf. ) différence entre larquebufe à
vent & cette canne. II. 598. b. '
Canne à vent ; dëfcription de cette machine.gp 7°3 -f: T
Canne, forte de mefure dont parlent Ezéchiel, « laint J eari
dans l’apocalypfe. Evaluation de la longueur de la canne, n.
^ Canne. Evaluation de la canne romaine
dont on fe fert à Naples & en divers endroits de la France. II.
599* P , L „ „ Canne, en terme de mantulffoaAct,uirree eenn foie, & en terme de YecSLn; WÊ ) v- T a- Cmn\
C A N
iteflbrt dont les verriers fefervent ponrs’abfteiiîr de faire do j
P°2 m * à fu e r e le u r defcpptiOT, leur feulture. X V . fio8, I
A On les trouve repréfentéfe.s,,vbl. VI des plonch, ^ 8 " ?
■?in\ ol roo. Elles fo n t appellées bagaces, quand dies
omnaffè au moulin. H. r a. a. Canne ratée. XHL 815. tt. Cen-
d te des racines de cannes à.lucre. XV . 794. é.‘Vin tiré des I
L n e s XVI. 443. tt. Suc des cannes, appelle vefoul. XVH.
105. tt. Obfervations par rapport.au ^vinaigre quon tire de ce I
PU C a n n e ", Vceepr.) erreur, dans cet article de l’Encyclo- I
nèàic.SuppL II. zoo. b. B B S . i
CAN N ELÉ, la: phyfique ne peut rendre raifon des can- I
nelures que la nature forme à. de. certains corps. Divers 1
moyens de l’art pour canneler. II, 5 99. b. I
C a n n e lé , ( Blafon ) partitions cannelées. Etymologie I
du mot. Suppl* IL 200. b. . • tt l I
Canneles, corps (Anatï) dëfcription de ces parties.II. 399*. • I
Cannelés , corps, ( Anatom. ) dëfcription de cette partie I
du cerveau. Suppl. IL 200. b. __ . j
Cannelés, ( corps ) Suppl. IL 611. b* Ibid. TE. 942^ - 1
C annelé, étoffe de foie : comment on forme le cannelé. I
Cannelés unis & cannelés brodés. II. 599. b.
Cannelé. Maniéré de fabriquer le cannelé. IL 702. b.Uè
monftration de l’armure d’un cannelé. 703. a.
CANNELURES , (Archit.) leur origine. Nom que leur
donnent les Anglois. D. 599. A Sur quel ordre elles forent
premièrement employées. Nombre de cannelures qu on dil-
tribue fur une colonne, félon 1 ordre auquel elle appartient.
Liftel qu’on pratique ordinairement pour féparer les cannelures.
C’eft un abus de pratiquer des cannelures torfes.
Cannelures rudentées. Cannelures accourcies quelquefois
dans l’ordre dorique. Réglé à obfervrer fur la nature des
©rnemens employés pour les cannelures. Ufage quon fait
des cannelures dans les gaines & dans les confoles. H. 600, a.
Voyez les planch. d’architetture, vol. I.
Cannelures : machine dont les tourneurs font ufage pour 1
canneler. Vol. X. des planches, Tourneur, pl. 56.Cannelures
rudentées dans l’architeôure. Suppl. IV. 689. <*.
CANNELURES des colonnes, ( ArchiteS.) maniéré de les
tracer fur les colonnes des différens ordres. On t?ille quelquefois
dans ces cannelures , pour rendre leurs côtes moins
¿•agiles, certains ornemens qu’on nomme rudentures. Suppl. 11.
301. a. Voyez ce mot & les articles R u d en tê & R u d en te r . 1
CANNES , ( Géogr. ) village d’Italie dans l’Apulie. Ba- I
taille qui s’y donna, l’an de Rome 536, entre les Romains 1
& les Carthaginois. Ruines de ce village. Suppl. II. 201. a. \
Cannes , ÇHiJl. anc. ) pont qu’Annibaléleva avec les corps
des Romains, pour traverfer un torrent, près de Cannes. XVII.
66. a. Bataille de Cannes. Suppl. 1. 444. a. Supplice que les
Romains firent fubir à un Gaulois & une Gauloife, un Grec
& une Grecque, après la défaite de Cannes.241.b.
CANNETILLE, ( Boutonnier ) à quoi on l’emploie. Oui font
ceux qui la fabriquent. Canetille qu’on appelle bouillon. H.ôoout.
CANNIBALES ,• voye^ C a ra ïb e s . /y.i
CANNULE , ( Chirurg. ) définition. Différentes formes
de cannuies félon leurs ufages. Cannule fléxible de M. Fou-
bert lorfqu’il taille à fa méthode. Cannule dont il fe fert
pour les incifions au périnée. Cannule en fpirale de M.
Petit. Son utilité, & la maniéré de s’en fervir. Cannuies
dont les anciens fiùfoient ufage pour le cautere actuel. Ibid.
b. On ne. doit pas fe fervir de cannuies fans néceluté pour
le panfement des plaies. Ibid. 601. a.
CANO , ( Sébafiien) fameux navigateur. VIT. 999. a.
C a n o , (Melchior) théologien efpagnol. XV.904. a. |
CANON, ( Théolog. ) catalogue authentique des livres qu on
'doit reconnoltre pour divins. Vérités dans; le canon de la Bible.
L’églife catholique a ajouté au canon de l’ancien Teftament
des livres qui n’étoient point auparavant dans ce canon.
¡Queftions qu’on pe.ut agiter for le fojet que nous traitons.
i°. Va-t-il eu chez les Juifs un canon des livres facrés ? Leur
unanimité ù reconnoître certains livres pour divins , vient fans
doute de ce qu’ils avoientun catalogue autorifé , qui difonguoit
de tous autres leurs livres facrés. On prouve ici quelles Juifs
n’ont reconnu pour divins qu’un certain nombre de livres, &
qu’ils fe font tous accordés à divinifer les mêmes. IL 701. a.
2°. N’y a-t-il jamais eu che^ les Juifs qu’un même 6* feul canon
des faintes Ecritures ? Génébrard , dans fa chronologie , leur
fuppofe trois différens canons, .. . diftinâion purement imaginaire.
Ibid. b. Serrarius qui eft venu après Génébrard, leur
en attribue deux. Son lentiment également réfuté par le
filence des peres à cet égard, & même par la déclaration
pofitive de quelques - uns d’entr’eux. Ibid. 602. a. D’où il
xèfulte que les Juifs n’ont eu ni trois, ni deux canons^ mais
un feul, compofé de vingt-deux livres, comme il l’ont
encore aujourcfhui. On examine s’il eft vrai que. Jofephe ait
cité l’Eccléfiaftique comme un livre divin, dans fon fécond
livre contre Appion. Ibid. b. ,
30. De combien de livres étoit compofé le canon dts Ecritures
Tome I.
CAN “5 divines chc^ les Juifs , 6* quels ¿¡oient ces livres? Les Juifs comp-
toient leurs livres, félon les vingt-deux lettres de leur alphabet.
Si quelques rabbins en ont compté vingt-quatre ou
vingt-fept,cela vient.de la maniéré dont ils divifoient leurs
livres, &non d’une addition réelle. Ils en comptent aujourd’hui
vingt-quatre. Enumération de ces livres, félon quelques
peres .Ibid. 603. a. Il n’eft pas vrai, comme-le ditBcl-
larmin , que MéKton ait mis, au rang des livres de l’ancien
Teftament, -celui de la Sagejfe. Témoignage de Jofephe fur le
nombre de vingt-deux livres renfermés dans le canon. Ibid. b.
40. Quel', efi le tems , & quel eß ■ l’auteur du canon des livres
facrés chéries Juifs ? ¿es dofteurs ont fait Efdras réparateur
des livres perdus ou altérés, réformateur de la maniéré
d’écrire, & tous auteur du canon des écritures. Il n’y auroit
aucune témérité à révoquer en doute le dernier point. Difficultés
qu’on auroit à réfoudre, pour parvenir à la folution
de la queftion dont il s’agit ici. Le concile de Garthage eft
le premier qui ait augmenté le canon des Juifs , & celui de
Trente a été plus loin encore. Soumiffion que nous devons à cet
égard, à l’autorité de l’églife. lbid. 604. a. Voye[ C an o n iq ue .
Çanqn , travaux d’Lfdras poiu- former le canon des livres
facrés. V. 948. b. Infertions qu’ajoutoient aux livres facrés,
ceux qui en compofoient le canon. Quel eft celui qui y travailla
le dernier. Xi. 85. b. Livres dont la canonicité n’a pas
été univerfeliement admife, mais que l’églife a mis néanmoins
dans le canon des livres facrés. II. 223. a.
C a n o n , (Hifl. ccd. ) regle ou décifion fur le dogme!&
fur la difcipline. Canons des apôtres de l’authenticité dèf-
quels tout le monde ne convient pas. Corps appellé code des
canons de l ’églife miverfelle> écrit en grec. Verfions latines
de ce code dont les églifes d’occident fe font fervies. Col-
| leélion de Denys-le-petit ,^ appellée corps des canons deTéglife
■ d’Afrique. Additions que firent auffi les Orientaux ä l’ancien
code. Collection de canons apportée d’Efpagne, fur là fin du
regne de Charlemagne, portant le nom d’un certain Ifidorc.
II. 604. b. On fit enfoite plufieurs compilations nouvelles des
anciens canons. Ouvrage de Gratien, intitulé : Concordance des
I canons difcôrdans. Termes danslefquelsfont conçus les canons
I des conciles. Ibid. 605. a. Voye1 D écrét é D écrétales.
1; Canons des apôtres : colleétion des loix eedéfiaftiques qué
l’on attribue à S. Clément pape, difciple de S. Pierre, comme
s’il l’eût reçue de lui. Diffentiment des Grecs à- cet égard.
Conjeftures for les auteurs de cette colleCtion. Difficultés for
le nombre des canons qu’elle doit renfermer. Papes qui en
rejettent l’autorité. Le pape Léon IX au contraire en admet
' cinquante. II. 605. a. Pourquoi ils font appellés apostoliques.
: Leur ancienneté. Les Grecs les ont toujours reçus ; mais parmi
; lçs Latins, ils n’ont pas toujours eu le même fort. Cependant
ils ont été eftimés en France. Ibid. b.
C a n o n , acceptions de ce mot en chronologie. H. 605. b.
. C a n o n pafchal, table de fêtes mobiles. II. ooj. b.
C anon , paroles facramentales de la meffe. Ce que doit
faire le peuple pendant le canon. Par qui le canon a été
mis dans la forme où nous l’avons. Ce que le concile de
Trente dit for ce canon. II. 606. a.
! Canon, pourquoi l’on s’eft fervi de ce mot en jurilprudence.
Différence entre les dogmes & les canons. III. 812. ¿.'ComÊ‘
dations qui ont été fûtes des anciens canons. IV. 707. b. & c.
)iftinétion entre canons & décrets. 716. a. Code des canons,
I DI. 571 . a f b.
C anon , ( Mufiq. ) ce qu’on entendoit par ce mot dans'
I la mufique ancienne. En mufique moderne , c’eft une forte
! de fugue qu’on appelle perpétuelle. Pourquoi ces fogues ont été
1 appeuées canons. Les plus faciles & les plus communes fe
prennent à l’uniffon ou à l’o&ave. Préceptes for la maniéré I de compofer & d’exécuter ces canons. Fugue perpétuèlle
I prife à la quarte ou à la quinte. II. 606. a. Comment il faut II fraei.ruer Cuhna cralensoVnI fdeopnlta ill’ohiatràmfàoirnei e& fàoi cth uannt epre due sv caarniéoen.s L. I’ebmidp. be-.
Canon, efpece de double canon renverfê, dont on trouve
I un exemple, vol. VII. des pl. Mufique, pl. 10. Auteur à.con-
I folter pour cette forte de compofition. Vjye^ auffi l’article
1 Système. L’efpece de canon dont on vient de parler s’ap*
j pelle auffi canon per arjin & thejin. Suppl. Ü. 201. b. Il y a
I encore le canon énigmatique, un autre canon appellé climax ,
I & enfin le canon par augmentation, lbid. 202. a.
' C a n o n , ( Blafon) meuble d’armoirie. Canon monté for I fon affût. Suppl. II. 201. b.
C anon emphytéotique. ( Jurifp. ) V. 580. b.
I C an o n , ( Art milit. ) étymologie du mot. Divers noms
I donnés à cette arme. Dëfcription du canon & de toutes.fes
I parties. II. éo6. b. Compofition du métal du canon, lbid. 607.
a. Les canons de fer ne font pas capables de la même réfi-
ftance que ceux de fonte. Cependant on s’en fert for le*
vaiffeaux, &c. On faifoit autrefois des canons de 48,8c'même
de^ôliv. de balle. Aujourd’hui les plus groffes piecés qu’on
fond en France, font de 24,8c les moindres de 4. On défi-
gne encore les canons par le-diametre de leur bouche qu’on
nomme leur calibre. Ibid. b. Voyc%C alibre. Table des dimen