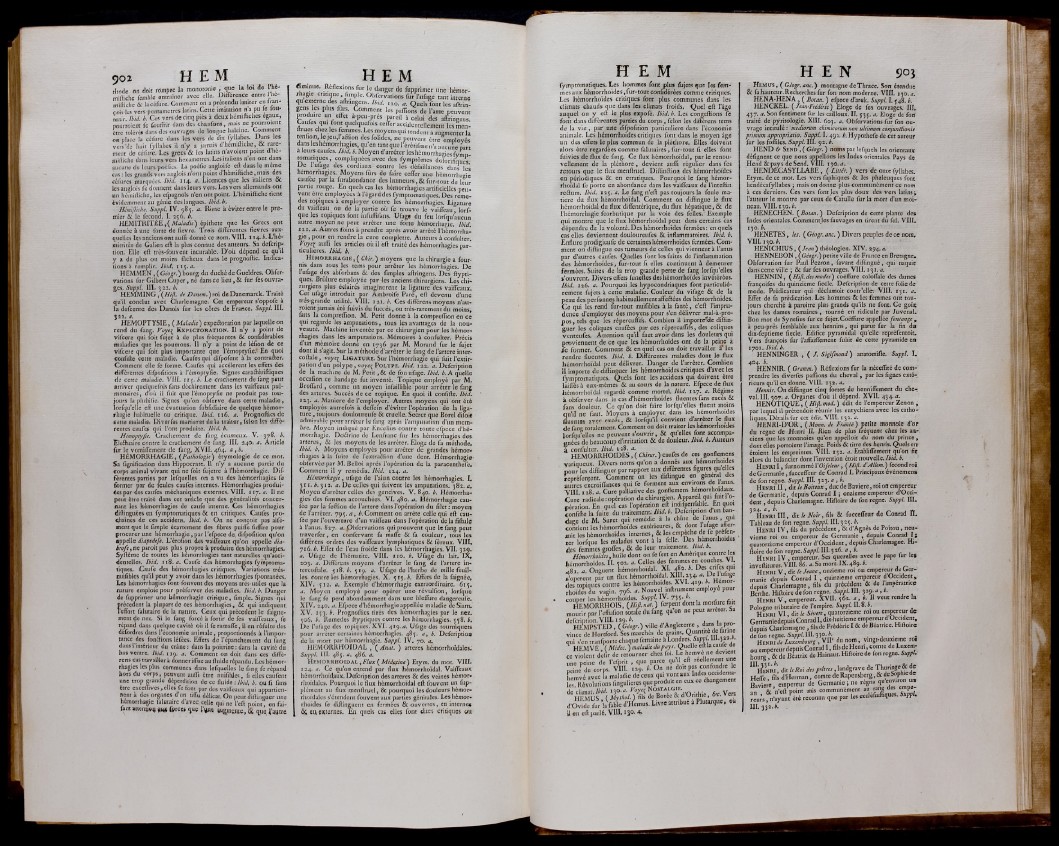
9 0 2 HEM tliodc on doit rdmpre la monotonie , que la lo i de hé
miftiche femble entraîner avec elle. Différence entre 1 ne
miftiche fie la c é fu r e . Comment on a prétendu imiter en Iran-
COis'les v ers pentamètres latins. C ette imitation n a pu le loutenir.
IHd. b. Ce» vers de cinq piés à deux hémtflichcs égaux,
pourroient fc foulTrir dans des chanfont, mais ne pourraient
être toléré» dans des ouvrages de longue Kajiniig, Comment
on place la céfure dans les vers de dix mlabc s. tjan s les
vers‘de huit iyliabes il n’y a jamais d’hemiftiche, & rarement
de céfure. Les grecs & les latins n’avoiène point d h ê -
miftiehe dans leurs vers hexamètres. Les italiens n en ont dans
aucune de leurs poéfics. La poéfie angloife cft dans le m êm e
cas : les grands vers anglois n’ont point d’hémiftiche, mais des
céfiircs marquées. Ibiu. 114* M Hcences que les italiens fie
les anglois Ce donnent dans leurs vers. Les vers allemands ont
un hémiftiche, les efpagnols n’en ont point. L’hémiftichc tient
évidemment au génie des langues. Ibid.b.
Hémiftiche. Suppl. I V .o 8<. a. Rime à éviter entre le premier
fie le fécond. I. ¿56. b.
HEM1T R IT É E ¿M a la d i e ') épithete que les Grecs ont
donnée à une forte de fièvre. T ro is différentes fièvres auxquelles
les anciens ont aulîi donné ce nom. V 111. 114. b. L ’hé-
mitricéc de Galien cft la plus connue des auteurs. Sa deferip-
tion. Elle eft très-fottvent incurable. D ’où dépend ce qu il
y a de plus ou moins fâcheux dans le prognoftic. Indications
A remplir. Ibid. 1 13 .4 .
H EM M EN , ( Géogr.) bourg du duché de Gucldres. Obfor-
vations fur Gilbert C u p e r , ne dans ce lieu , 8c fur fes ouvrages.
Suppl. 111. 3 22, b.
HEMMING , (H i f t . de Danem.) r o i deDanemarck. Traité
qu’il conclut avec Charlcmagnc. C e t empereur s’oppofe à
la defeente des Danois fur les côtes de France. Suppl. 111.
322. a.
H EM O P T Y S IE , ( Maladie) expeftoration par laquelle on
rend du fang. Voye^ E x p e c t o r a t io n . Il n y a point de
vifeere qui loit fujet à de plus fréquentes 8c conudérables
maladies que les poumons. Il n’y a point de léfion de ce
vifcerc qui foit plus importante que Vémoptyfie.* En quoi
confifte cette maladie. Caufes qui difpofent à la contracter.
Comment elle fc forme. Caufes qui accélèrent les effets des
différentes difpofitions à l’émoptyfie. Signes caraétériftiques
de cette maladie. V i l i . 113. b. L e crachement de fang peut
arriver quelquefois fans d éch ir em en t dans les vaiffeaux pulmonaires
, d où il fuit que l’émoptyfie ne produit pas toujours
la pluhific. Signes qu’on obforvc dans cette maladie,
lorfqu’elle eft une évacuation fubfidiaire de quelque hémor-
rliagie habituelle ou critique. Ibid. 1 1 6 . a. Prognoftics de
cette maladie. Diverfes maniérés de la traiter, félon les différentes
caufes qui l’ont produite. Ibid. b.
Hémopiyfie. Crachement de fang écumcux. V . 378. b.
Elcftuaire contre le crachement de lang. III. 240. a. Article
(ur le vomiffement de fang, X V I I . 464. a , b.
H ÉM O R RH AG IE , (P ath olog ie') étymologie de ce mot.
Sa fignification dans Hippocratc. I l n’y a aucune partie du
corps animal vivant qui ne foit fujette à l’hémorrhagic. Différentes
parties par lefquelles on a vu des hémorrnagics fu
former par de feules caufes internes. Hémorrhagies produises
par (les caufes méchaniques externes. VIII. 1 1 7 . a. Il ne
peut être traité dans cet article que des généralités concernant
les hémorrhagies de caufe interne. Ces hémorrhagies
diftinguées en fymptomatiques fie en critiques. Caufes prochaines
de ces accidens. Ibid. b. O n ne conçoit pas aifé-
ment que le fimple écartement des fibres puifle- fumre pour
procurer une hémorrhagie, par l ’efpece de, difpofition qu’on
Appelle diapedefe. L’éroiion des vaiffeaux qu’on appelle dia-
brofe , ne paroit pas plus propre à produire des hémorrhagies.
Syftémc de toutes les hémorrhagies tant naturelles qu’accidentelles.
Ibid. 118. a. Caufe des hémorrhagies fymptomatiques.
Caufe des hémorrhagies critiques. Variations trés-
nuifiblcs qu’ il peut y avoir dans les hémorrhagies ipontanécs.
Les hémorrhagies font fouvent des moyens trés-utiles que la
nature emploie pour préferver des maladies. Ibid. b. Danger
de fupprimer une hémorrhagie critique, fimple. Signes qui
frécedent la plupart de ces liémorrhagics, fie qui indiquent
effort falutaire de la nature. Ceux qui précèdent le faigne-
ment de nez. Si le fang forcé h fortir de fes vaiffeaux, fc
répand dans quelque cavité où il fe ramaffe, il en réfulte des
défordres dans l’économie animale, proportionnés à l’importance
des fondions léfées. Effets de l’épnnchcment du fang
dans l'intérieur du crâne : dans la poitrine: dans la cavité d u .
bas ventre. Ibid. 110. a . Comment on doit dans ces différons
cas travailler à donner iffuc au fluide répandu. Les hémorrhagies
les plus communes dans lefquelles le fang fe répand
hors du corps, penvent aufli être nuifihlcs, fi elles caufcnt
une trop grande déperdition de ce fluide : Ibid, b. ou fi fans
être exceflivcs, elles fc font par des vaiffeaux qui appartiennent
à des organes d un tiffu délicat. On peut diftinguer une
hémorrhagie falutairc d avec celle qui ne l’eft point, en fa i-
fant aitcnuoq m force* que l’une wgtnw u c, & que l’autre
HEM
qu externe des aftringcns. Ibid. rao. e. Q u e l, W les aft ™
gens les plus fûrs. Comment les paillons de l’anre peuvent
g S f J ? S i i ;PcV . res £arcil à « 1" ‘ <1“ X ln g e n s .
U f . i q 1 f Suclï uÎ fo,s ccir“ r accidentellement les men-
itrucs chez les femmes. Les m oyens qui tendent h auementer la
tenfion, le jeu,l’a&ion des folidcs, ne peuvent être employés
dans les hémorrhagies, qu en tant que Pérétiimc n’a aucune part
à leurs caufes. Ibid. b. Moyen d’arrêter les hémorrhagies fvmo-
tomatiques, compliquées avec des fymptômes dolorificmes*
U c 1 ufage des cordiaux contre les défaillances dans les
hémorrhagies. Moyens fûrs de faire ccffer une hémorrhagie
caufée par la furabondancc des humeurs,8c fur-tout de leur
partie rouge. En quels cas les hémorrhagies artificielles peuvent
être employées à l’égard des fymptomatiques. D es remèdes
tppiques à employer contre les hémorrhagies. Ligature
du vaiffeau ou de la partie où fe trouve le vaiffeau, lorf-
que les topiques font mfuffifans. Ufag» du feu lorfqu’aucun
autre moyen ne peut arrêter une forte hémorrhagie. Ibid.
i i i . a. Autres foins à prendre après avoir arrêté l’hémorrha-
g i e , pour en rendre la cure complcttc. Auteurs à confulter.
Voy e[ aufli les articles où il eft traité des hémorrhagies particulières.
Ibid. b.
H é m o r r h a g i e , ( C h ir .) moyens que la chirurgie a fournis
dans tous les tenus pour arrêter les hémorrhagies. D e
l’ufage des abforbans 8c. des Amples aftringcns. D e s ftypti-
ques. Brûlure employée par les anciens chirurgiens. Les chirurgiens
plus éclairés imagineront la ligature des vaiffeaux.
C e t ufage introduit par Ambroife Paré, eft devenu d’une
très-grande utilité. V 3IL 12 1 . b. C e s différens moyens n’au-
roient jamais été fuivis du fuccês, ou très-rarement du moins,
fans la compreifion. M. Petit donne à la compreffion en ce
qui regarde les amputations, tous les avantages de la nouveauté.
Machine inventée par ce chirurgien pour les hémorrhagies
dans les amputations. Mémoires à confulter. Précis
d’un mémoire donne en 1736 par M. Morand fur le fujet
dont il s’agit. Sur la méthode d’arrêter le fang de l’artere inter-
cofta le, voyc{ L ig a t u r e . Sur l’hémorrhagic qui fuit l’extirpation
d’un p o ly p e , voycç Po l y p e . Ibid. 122. a . Dcfcription
de la machine de M. P e tit, fie de fon ufage. Ibid. b. A quelle
occafion ce bandage fut inventé. Topique employé par M.
firoflard, comme un moyen infaillible pour arrêter le fang
des arteres. Succès de ce topique. En quoi il confifte. Ibid.
123. a. Maniéré de l’employer. Autres moyens qui ont été
employés autrefois à deffein d’éviter l’opération de la ligatu
r e , toujours doulotireufe 8c cruelle. Secret que Borcl diioit
admirable pour arrêter le fàng après l’amputation d’un membre.
Moyen indiqué par Encelius contre toute cfpcce d’hé-
morrhagic. D dû rin c de Lcnfranc fur les hémorrhagies des
arteres., 8c lés moyens de les arrêter. Eloge de fa méthode*
Ibid. b. Moyens employés pour arrêter de grandes hémorrhagies
à la fuite de Pcxtraélion d’une dent. Hémorrhagie-
obiervec par M. B elloi après l’opération de la paracenthefc*
Comment il y remédia. Ibid. 124. a.
Hémorrhagie, ufage de l’alun contre les hémorrhagies. I.
3 1 1 . b. 312. a. D e celles qui fuivent les amputations. 382. a .
Moyen d’arrêter celles des gencives. V . 840. b. Hémorrha-
gics des femmes accouchées. V I . 480. a . Hémorrhagie cau-
lée par la féâicin de l’artere dans l’opération du file t: moyen
de 1 arrêter. 795. a , b. Comment on arrête celle qui eft cau-
féc par l’ouverture d’un vaiffeau dans l’opération de la fiftulç
à l’anus. 827. a. Pbferva tions qui prouvent que le fang peut
tra v e r fe r , en confcrvant fa mafle fie fa cou leu r , tous les
différens ordres des vaiffeaux lymphatiques fie féreux. V I I I ,
7x6. b. Effet de l’eau froide dans les hémorrhagies. V I I . 329.
a . Ufage de l’hématite. VIII. 110. b. Ufage du lait. IX,
203. a. Différens moyens d’arrêter le fang de l’artere in-
tcrcoftale. 318. b. 310. a. Ufage de l’herbe de mille feuilles
contre les hémorrnagics. X . 313 ,b . Effets de la faignée,
X IV . 312. a. Exemple dliémorrhagie extraordinaire. 6 13.
a. Moyen employé pour opérer une révulfion, torique
le fang fc perd abondamment dans une bleflùrc dangereufe.
X IV . 240. a. Efpcce d’hémorrhagie appelléc maladie de Siam.
X V . 153. A. Prognoftics tirés des hémorrhagies par le nez.
306. b. Remèdes ityptiques contre les hémorrhagies. 358. b.
D e l’ufage des topiques. X V I . 419 .0. Ufage des tourniquets
pour arrêter certaines hémorrhagies. 483. o , b. Dcfcription
de la mort par hémorrhagie. Suppl. IV . 70. 4.
H EM OR RH O ID A L , ( A n a t. ) arteres hémorrhoidales.
Suppl. III. 483. a . 486. a.
M km o k k h o id a l , F lu x ( Médecine ) Etym. du mot. V I I I .
124. a. C e qu’on entend par flux hémorrhoïdal. Vaiffeaux
hémorrhoïdaux. Dcfcription des artères 8c des veines hêmor»
rhoïdalcs. Pourquoi le flux hémorrhoïdal eft fouvent un fup-
plément au flux menftrucl, fie pourquoi les douleurs héraor-
rhoidalcs s’étendent fouvent aux parties génitales. Les héinor-
rhotdes fe diftingucnt en fermées fie ouv ertes , en internai
y & externes. Eu quels cas elles font dites critiques ou
HEM H E N 903
fymptomatiques. Les hommes font plus fujets que les femmes
aux fiémorrhoïdes, fur-tout conudérées comme critiques.
Les hémorrhoïdes critiques font plus communes dans les
climats chauds que dans les climats froids. Q u e l eft l’âge
auquel on y cft le plus expofé. Ibid. b. Les congeftions fe
font dans différentes parties au corps, félon les diftérens tems
de la v i e , par une difpofltion particulière dans l’économie
animale. Les hémorrhoïdes critiques font dans le moyen âge
un des effets le plus commun de la pléthore. Elles doivent
alors être regardées comme falutaires, fur-tout fi elles font
fui vies de flux de fang. C e flux hemorrhoïdal, par le renouvellement
de la pléthore, devient aufli régulier dans fes
retours que le flux menftrucl. Diftinftion des hémorrhoïdes
en périodiques fie en erratiques. Pourquoi le fang hémor-
rhoïdal fc porte en abondance dans les vaiffeaux de l’inteftin
reëhïm. Ibid. 123. a. Le fang n’eft pas toujours la feule matière
du flux hémorrhoïdal. Comment on diftingue le flux
hémorrhoïdal du flux diflentérique, du flux hépatique, fie de
l'hémorrhagie feorbutique par la voie des folles. Exemple
qui montre que le flux hémorrhoïdal peut dans certains cas
dépendre de la volonté.Des hémorrhoïdes fermées: en quels
cas elles deviennent douloureufos fie inflammatoires. Ibid. b.
Enflure prodigieufo de certaines hémorrhoïdes formées. Comment
on diftingue ces tumeurs de celles qui viennent à l’anus
par d’autres caufes. Quelles font les fuites de l’inflammation
des hémorrhoïdes, fur-tout fi elles continuent à demeurer
fermées. Suites de la trop grande perte de fang lorfqu’elles
»’ouvrent. D iv er s effets funeftes des hémorrhoïdes invétérées.
Ibid. 126 . a. Pourquoi les hypocondriaques font particulièrement
fujets à cette maladie. Couleur du vifaee fie de la
peau des perfonnes habituellement affeftées des hémorrhoïdes.
C e qui les rend lur-tout nuifibles à la fanté, c’eft l’imprudence
d’employer des moyens pour s’en délivrer mal-à-pro-
pos I tels que íes réperenflifs. Combien il impórtenle diftinguer
les coliques caufées par ces répereuflifs, des coliques
venteufes. Attention qu’il faut ayoir dans les douleurs qui
proviennent de ce que les hémorrhoïdes ont de la peine à
f e former. Comment 8c en quel cas on doit travailler à* les
rendre fluentes. Ibid. b. Différentes maladies dont le flux
hémorrhoïdal peut délivrer. Danger de l’arrêter. Combien
i l importe de diftinguer les hémorrhoïdes critiques d’avec les
fymptomatiques. Q u els font les accidens qui doivent être
laifles à eux-mêmes 8c au cours de la nature. Efpece de flux
hémorrhoïdal regardé comme mortel. Ibid. 127. a. Régime
à obforver dans le cas d’hémorrhoïdes fluentes fans excès 8c
fans douleur. C e qu’on doit faire lorfqu’elles fluent moins
qu’il ne faut. Moyens à employer, dans les hémorrhoïdes
fluentes avec e x cè s , fie lorfqu’il convient d’arrêter le flux
de fang totalement. Comment on doit traiter les hémorrhoïdes
lorfqu elles ne peuvent »’o uv rir, 8c qu’elles font accompagnées
de beaucoup d’irritation 8c de douleur. Ibid. ¿.Auteurs
à confulter. Ibid. 128. a.
H EM O R RH O ÏD E S , ( Chirur. ) caufes de ces gonflemens
variqueux. Divers noms qu’on a donnés aux hémorrhoïdes
pour les diftinguer par rapport aux différentes figures qu el es
repréfontent. Comment on les diftingue en général des
autres excroiffances qui fe forment aux environs de lanus.
V I I I . 128. a. Cu re palliative des gonflemens hémorrhoidaux.
Cu re radicale : opération du chirurgien. Appareil qui fuit 10-
pération. En quel cas l'opètalioai eft. indifienfable. En quoi
confifte la fuite du traitement. Ibid. b. Dcfcription d un ban-
daee de M. Suret qui rcm¿die à la chute de la u u s , qui
contient les hémorrhoïdes extérieures, & dont 1 ufage affermit
les hémorrhoïdes internes, & les empêche de fe préfen-
ter lorfque les malades vont à la felle. Des hémorrhoïdes
des femmes greffes, & de leur traitement. Ibid. b .____
HimorrhoUcs, huile dont on fe fert en Amérique contre les
liémorrhoïdcs. II. s o i . | Celles des femmes en couches. V I .
4 8 1 . a . Onguent hémorrhoïdal. XL¿ f i f - A Des enfes qui
. ’opèrent par un f lu x hémorrhoïdal. X IIL 234. u. De hffage
des topiques contre les hémorrhoïdes. X V I . 419. A Hémor-
B vagin. 796. u. Nouvel inffrument employé pour
couper les hémorrhoïdes. Suppl. IV . 73 3-,^* . e .
HEM O R RH O IS , (H ift . nat. ) forpent dont la mor Aire fait
mourir par l’cffufion totale du fang qu’on ne peut arrêter, ba
h Ï Ï p S T E D , 1 ( ^Giogr. ) ville d’Angletcire , dans la pro-
Vince de Hertford. Ses marchés de grains. Q m n m t i e farine
oui s'en tranfportcchaquefematne àLondra . Suppl. 11Í .W .P .
HEM V É (M td c c . ) maladie du paya. Q u elle eft ht caufe de
ce violent deftr de retourner chez foi. Le Itemvc: ne devient
une peine de l’e fp r it , que parce qu il eft réellement une
« lu e du corps. VIII. .29. A O n ne doit pas confondre le
E ê avec lit maladie de ceux qui vontaux Indes occidentales
Révolutions Engulleres que produit eu eux ce changement
S ^ ’O rh h ie , &c. Vers
d’O v ™ fur la fable d’rfemus. Livre attrtbué à Plutarque. ou
il en cft parlé. VIII» ijo * 4*
Hem u s , ( Géogr. artc. ) montagne deThrace. Son étendue
8c fa hauteur. Recherches fur fon nom moderne. VIII. 130. a.
H E N A -H EN A , ( Bot an. \ cfpcce d’arek. Suppl. I. 348. b.
HEN CKE L. ( Jean-Frédéric ) Eloge de fos ouvrages. III»
437. a. Son fontiment fur les cailloux. II. 333. a. Eloge de fort
traité de pyritologic. XIII. 603. a. Obforvations fur fon ouvrage
intitulé : mediorum chimicorum non ultimum conjunflionit
primum appropriatio. Suppl. I. 492. b. H ypothefode cet auteur
fur les foflilcs. Suppl. III. 92. b.
HEN D & Send , ( Géogr. ) noms par lcfquels les orientaux
défignent c e que nous appelions les Indes orientales. Pays de
Hend fie pays de Send. V lI I . 130. a.
H E N D É C A S Y L L A B E , ( Littér. ) vers de onze fyllabes.
Etym. de ce mot. Les vers faphiques fie les phaleuques font
hendécafyllabes ; mais on donne plus communément ce nom
à ces derniers. Ces vers font .les plus doux des vers latins;
l’auteur le montre par ceux de Catulle fur la mort d’un moineau.
V III. 130. b.
HENECHEN. ( Botan. ) Dcfcription de cette plante des
Indes orientales. Commences fauvages en tirent du fol. V I I I .
130. b.
H EN E TE S , les. ( Géogr. anc. ) Divers peuples de ce nom,
VIII. 130. b.
H EN ICH IU S , ( J e a n ) théologien. X IV . 294.«.
H EN N E BON , (Géogr .) petite ville de France en Bretagne.
Obforvation fur Paul Pezron, favarit diftingue | qui naquit
dans cette ville ; fie fur fos ouvrages. VIII. 131. a.
H EN N IN , (H ift . des modes) coëffure coloflale des dames
françoifos du quinzième fieclc. Dcfcription de cette folie de
mode. Prédicateur qui déclamait contr’clle; VIII. 131. a.
Effet de fa prédication. Les hommes fie les femmes ont toujours
cherché â paroitre plus grands qu’ils ne font. C e goût
chez les dames romaines , tourné en ridicule par Juvénal.
Bon mot de Synefius fur ce fujet. Coëffure appcllée fontange ,
â peu-prés fomblablc aux hennins, qui parut fur la fin du
dix-foptieme fiede. Edifice pyramidal qu’elle repréfontoir.
V er s françois fur l’affaiflement fubit de cette pyramide en
1701. Ibid. b.
HENNINGER , ( /. S ig ifm o n d ) anatomifte. Suppl. I .
404. b.
HENNIR. ( Gramm.) Réflexions fur la néceflité de comprendre
les diverfes pâmons du ch e v a l, par les figues exté-,
rieurs qu’il en donne. VIII. 132. a.
Hennir. On diftingue cinq fortes de henniflement du cheval.
III. 307. a. Organes d’où il dépend. X V II. 434. a.
H E N O T IQ U E , ( Hift. mod. ) ¿dit de l’empereur Zenon ;
par lequel il prétendoit réunir les cutychiens avec les catholiques.
Détails Air cet ¿dit. V lI I . 132 .a .
HEN RI-D’O R , (Monn. de France ) petite monnoie d’o r
du regne de Henri II. Rien d e plus tréquent ch e z les anciens
que les monnoies qu’on appelloit du nom du prince,
dont elles portoient l’image. Poids 8c titre des henris. Quels en
étoient les empreintes. VIII. 132. a. Etabliflement qu’on fit
alors du balancier dont l’invention étoit nouvelle. Ibid. b.
H enri I , furnommé YOi/eleur, (H ift . d ’A llem.) fécond roi
de Germanie, fuccefleur de Conrad I. Principaux événemen*
de fon regne. Suppl. III. 323. a , b.
H enri I I , dit le B o ite u x , duc de B avicre, roi oû empereur
de Germanie, depuis Conrad I ; onzième empereur d’O cci-
d en t, depuis Charlemagne. Hiftoire de fon regne. Suppl. III.
324. <*, b. _ -y
H enri I I I , dit le N o i r , fils 8c fuccefleur de Conrad II.
Tableau de fon regne. Suppl. III. 323. b.
H enri I V , fils du précédent, 8c d’A gnès de P oitou , neuvième
roi ou empereur de Germanie , depuis Conrad I ;
quatorzième empereur d’Occident, depuis Charlemagne. Hiftoire
de fon regne. Suppl. III. 3 26. a , b.
H enri IV , empereur. Ses querelles avec le pape lur les
inveftitures. VIII. 06. a . Sa mort. IX. 489. b.
H enri V , dit le Jeune, onzième roi ou empereur de G ermanie
depuis Conrad I , quinzième empereur d Oc cident,
depuis C h a rlem a gn e , fils du précédent & de limpératr.ce
Bcrthe. Hiftoire de fon regne. Suppl. III. 3 29. a , b.
H e n r i V , empereur. X VII. 562. a , é. Il veut rendre la
Pologne tributaire de l’empire. SuppL II. 8. b.
H enri V I , dit le Sévere, quatorzième roi ou empereur de
GermaniedepuisConradI, dix-huitiemeempereurd O ccident,
depuis Charlemagne, fils de Frédértc I & de Béatrice. Htftotre
de fon regne. Suppl. 111. . •
H enri de Luxembourg, VII* du nom, vingt-deux,eme re.
ou empereur depuisConrad I , filsdei Heur, comte de Ltnrem-
b ourg, & de Bêatrix de Hainaut. Hifiorre de fon regne. Suppl.
n I i?ENRl", dit le R o i des prêtres, landgrave de T h u r in g e& d e
He ffe , fils d’Herman, comte de Rapensberg, &
Ba vière, empereur de Germante; ne régna q
on & n’eft point mis communément au rang des empe
reurs fn ’ayant été rccçnnu que par le , eedéfiaÆques. Suppl.
i l l . 332.é. .