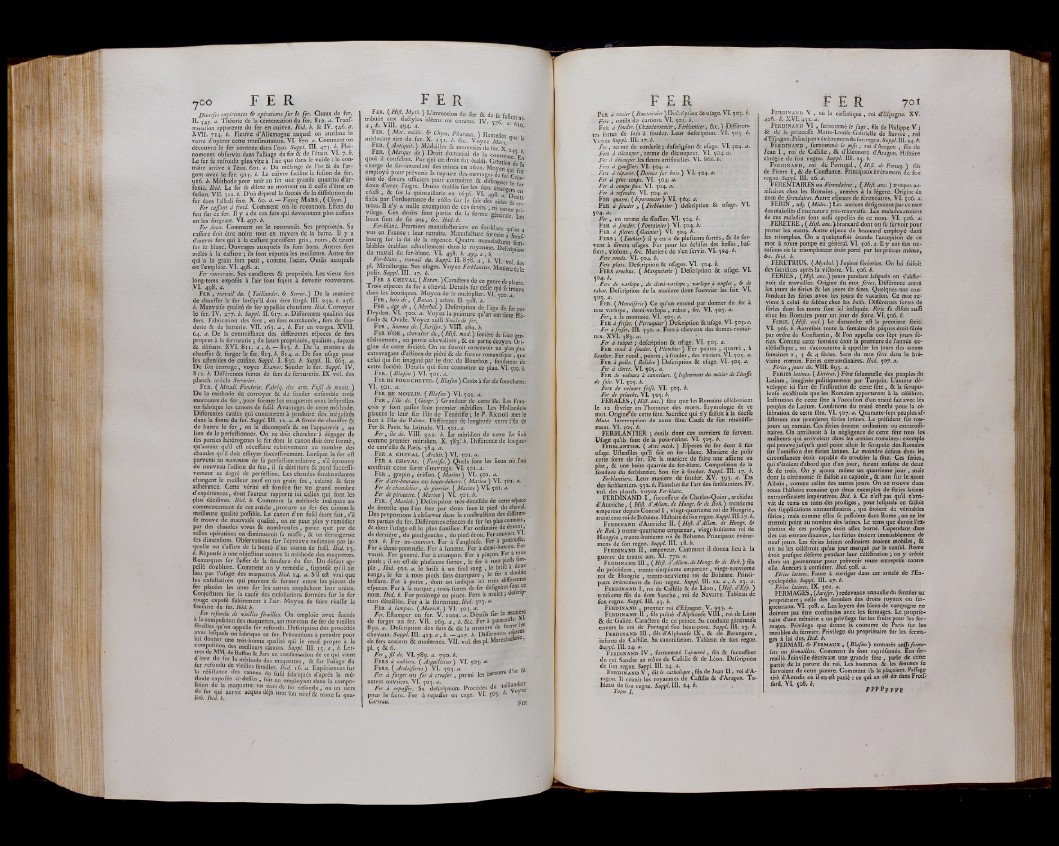
'jOO F E R
Diverfes expériences 8 opérations fur le fer. Chaux de fer.
II. ç4j. a. Théorie de la cénlentation du fer. 812. a. Tranf-
niutation apparente du fer en cuivre. Ibid. b. 8c IV. 546. a.
XVII. 7x4. b. Fletiire d'Allemagne auquel on attribue la
vertu d’opérer cette tranfmütation. VI. 870 a. Comment on
découvre le fer conteilu dans l’eau. Suppl. III. 473. b. Phénomènes
obfervés dans l’alliage du fer 8c de l’étajn. VI. 7. b.
Le fer fe refroidit plus vite à l’air que dans le vuide : le contraire
arrive à l’eau. 601. a. Du mélange de l’or & de 1 argent
avec le fer. 913. b. Le cuivre facilite la fufion du fer.
916. b. Méthode pour unir au fer une grande quantité d’ar-
fenic. Ibid. Le fer fe dilate au moment où il celle d’être en
fufion. VII. 312. b. D’où dépend le fuccès de la diffolution du
fer dans l’alkali fixe. X. 60. a. — Voye[ Mars , ( Chym. )
Fer caffant àfroid. Comment on le reconnoît. Effets du
feu fur ce fer. Il y a de ces fers qui deviennent plus caflans
en les forgeant. Vl. 497. b.
Fer doux. Comment on le reconnoît. Ses propriétés. Sa
cafiùre doit être noire tout en travers de la barre. Il y a
d’autres fers qui à la cafiùre paroifient gris, noirs, & tirant
fur le blanc. Ouvrages auxquels ils font bons. Autres fers
mêlés à la cafiùre ; ils font réputés les meilleurs. Autre fer
qui fa le grain fort petit, comme l’acier. Outils auxquels
on l’emploie. VI. 498. a.
Fer rouveram. Ses caraèteres & propriétés. Les vieux fers
long-tems expofés à l’air font fujets à devenir rouverains.
,VI. 498. gjj
F e r , travail du. { Taillander. 8 Serrur. ) De la maniéré
de chauffer le fer lorfqu’il doit être forgé. III. 252. b. 256.
b. Mauvaife qualité de fer appellee chauftùre. Ibid. Corroyer
le fer. IV. 177. b. Suppl. II. 617. a. Différentes qualités des
fers. Fabrication des fers , en ters marchands , (ers de fenderie
& de batterie. VII. 163. a , b. Fer en verges. XVII.
64. a. De la connoifiance des différentes efpeces de fers
propres à la ferrurcrie ; de leurs propriétés, qualités, façons
8c défauts. XVI. 811. a , b. — 8x3. b. De la maniéré de
chauffer & forger le fer. 813. b. 814. a. De fon ufage pour
les uftenfilcs de cuifine. Suppl. I. 830. b. Suppl. II. 665. a.
De fon étamage, voyez Etamer. Souder le ter. Suppl. IV.
8x2. b. Différentes fortes de fers de ferrureric. IX vol. des
planch. article Serrurier.
F e r . ( Mitall. Fonderie. Fabriq. des arm. Fujfil de munit. )
De la méthode de corroyer & de fonder enfemble trois
morceaux de fer, pour former les maquettes avec lefquelles
on fabrique les canons de fufil. Avantages de cette méthode.
Différentes caufes qui concourent à produire des inégalités
dans la fonte du fer. Suppl. 111. 12. a. A force de chauffer 8c
de battre le fer , on le décompofe 8c on l’appauvrit , au
lieu de le perfectionner. On ne doit chercher à dégager de
fes parties hétérogènes le fer dont le canon doit être formé,
qu’autant qu’il eu néceftaire relativement au nombre des
chaudes qu’il doit efiùyer fuccefiivement. Lorfque le fer cil
parvenu au maximum de fa perfection relative , s’il éprouve
de nouveau l’aCtion du feu , il fe détériore 8c perd iuccefiï-
vement ce degré de perfection. Les chaudes furabondantes
changent le meilleur nerf en un grain fec , calciné 8c fans
adhérence. Cette vérité eft fondée fur un grand nombre
d’expériences, dont l’auteur rapporte ici celles qui font les
plus décifives. Ibid. b. Comment la méthode indiquée au
commencement de cet article , procure au fer des canons la
meilleure qualité poffible. Le canon d’un fufil étant fait, s’il
fe trouve de mauvaife qualité, on ne peut plus y remédier
par des chaudes vives 8c nombreufes, parce que par de
telleS' opérations on diminueroit fa mafic , & on dérangeroit
fes dimenfions. Obfervations fur l’épreuve ordinaire par laquelle
on s’afiùrc de la bonté d’un canon de fufil. Ibid. i f .
b. Réponfe à une objeCtion contre la méthode des maquettes.
Remarques fur l’effet de la foudurc du fer. Du défaut apÎiellé
doublure. Comment on y remédie , fuppofé qu’il ait
E11l'
ieu par l’ufage des maquettes. Ibid. 14. a. S’il eft vrai que
les exfoliations qui peuvent fe former entre les pièces de
fer placées les unes fur les autres empêchent leur union.
Conjeétüres fur la caufe des exfoliations formées fur le fer
rouge expofé fubitement à l’air. Moyen de faire réuftir la
foudure du fer. Ibid. b.
WjÊi refondu de vieilles firailles. On emploie avec fuccés
fit 5.0mP°^,*0n des maquettes, un morceau de fer de vieilles
féraulcs qu’on 'appelle fer refondu. Defcription des procédés
avec lcfquels on fabrique ce fer. Précautions à prendre pour
donner une très-bonne qualité qui le rend propre à la
compofition des meilleurs canons. Suppl. III. 1 c. a , b. Let-
aifs; C .. I: .Buffon 8c Jars en confirmation de ce qui vient
detre dit iur la méthode des maquettes, & fur l’ufage du
fer refondu de vieilles £§|ulSj f y , Expériences fur
I I S I P i p l ée fuffl fabriqués d'après la méthode
expofée ci-delfus, foi, c„ employant dans la compo-
finon de la maquette un tiers de fer refondu, ou un tiers
n t u T b K g 1 1 1 ’ ü f0" neuf & ” " IC fa ! “»•
f e r
tribuéev au /da ayles\dé eTou°"ureti" a''
a y b. V I I I . 494. a. ' ' • ° 10.
F e r . ( Ma,, mille. «; Chym. Pharmac. ) Remedes une î -
médecine tire du fer. X. t h. &c. Viyea Mari 1 ®
F e r . CAmqmU ) Médailles 8c monnoies de fer. X /
Fer (Ma,aue du) Droit domanial de la couronne3/ '
quoi il conftftoit. Par qui ce droit fut établi. Créa**« ,
charge de fur-intendant des mines en t6oa. Moyen 1 - r
employé pour prévenir la rupture des ouvrages de fe r c t
tion de divers officiers pour connoître 8c diffineuer u ,
doux davec 1 aigre. Droits établis fur les fers étrance ' .
i6a8 , 8c fur la quincaillerie en 1636. VI. 408 „ n °
fixés par l’ordonnance de 1680 fur le fait des aides & 10
trées. Il n’y a nulle exemption de ces droits , ni aucun Ü
vilcge. Ces droits font partie de la ferme générale*
baux font de fix ans, fer. IUd. b. 6 c' Les
Fer-blanc. Premiers manufacturiers en fer-blanc au’on
vus en France : leur retraite. Manufaélure formée a Straf
bourg fur la fin de la régence. Quatre manufactures fem-
blablcs établies actuellement dans le royaume. Defcr;.»
du travail du fer-blanc. VI. 498. b. 409. a , b.
Fer-blanc y travail du. Suppl. II. 878. a y b. VI. vol des
pl. Métallurgie. Ses ufages. Voyez Ferblantier. Maniere de le
polir. Suppl. 111. 17. b.
F e r a c h e v a l . {Botan. ) Caraétere de ce genre de plante
Trois efpcces de fer à cheval. Détails fur celle qui fe trouve
dans les boutiques. Moyen de le multiplier. VI. 500. a.
F e r , bois de , ( Botan. ) arbre. II. 308. b.
F e r , âge de , {Mythol.) Defcription de l’âge de,fer par
Dryden. VI. 500. a. Voyez la peinture qu’en1 ont faite Hé-
fiode & Ovide. Voyez aufli Siècle de fer.
F e r , homme de. {Jurifpr.) VIII. 280. b.
F e r d ’o r , chevalier du, {Hifl. mod. ) fociété de feize gentilshommes
, en partie chevaliers, 8c en partie écuyers. Origine
de cette fociété. O11 ne fauroit concevoir un plan plus
extravagant d’aélions de piété 8c de fureur romanefque, que
celui qui fut imaginé par le duc de Bourbon , fondateur de
cette fociété. Détails qui font connoître ce plan. VI. <00. b.
F e r . {Blafon) VI. 301.a.
F e r d e f o u r c h e t t e . ( Blafon ) Croix à fer de fourchette.
VI. 501. a.
F e r d e m o u l i n . ( Blafon ) VI. ç o x . a.
F e r , l'île de. ( Géogr. ) Grandeur de cette île. Les François
y font paficr leur premier méridien. Les Hollandois
placent le leur1 fur l’île ae Ténériffe j le P. Riccioli met le
lien à l’île de Palma. Différence de longitude entre 111e de
Fer & Paris. Sa latitude. VI. soi. a.
Fer, île de. VIII. 922. b. Le méridien de cette île fixé
comme premier méridien. X. 383.* b. Différence de longitu-'
de entr’elle 8c Paris. 384. a.
F e r a c h e v a l . {Archit.) VI. 301. a.
F e r a c h e v a l . {Fortifie.) Quels font les lieux où l'on
conftruit cette forte d’ouvrage. VI. 501. a.
F e r , grapin, ériffon. {Marine) VI. 301. a.
Fer d’arc-boutans ou boute-dehors. ( Marine ) VI. 301. a.
Fer de chandelier, de pierrier. ( Marine) VL 301. a.
Fer de pirouette. {Marine) VI. 301. é.
F e r . {Maréch.) Defcription tres-détaillée de cette efpece
de femelle que l’on fixe par clous fous le pied du cheval.
Des proportions à obferver dans la conftruélion des différen-
tes parties du fer. Différentes efpeces de fer les plus connues,
& aont l’ufage eft le plus familier. Fer ordinaire de devant ,
de derrière , du pied gauche , du pied droit. Fer couvert. V I .
301. b. Fer mi-couvert. Fer :i l’angloifc. Fer à pantoufle.
Fer à demi-pantoufle. Fer â lunette. Fer à demi-lunette, ber
voûté. Fer geneté. Fer à crampon. Fer a pinçon. Fer a tons
pieds y il en eft de plufieurs fortes , le fer à tous pieds «impie
, Ibid. 302. a. le brifé à un feul rang , le brifé a deux
rangs, le fer à tous pieds fans étampure , le fer a doub e
brilurc. Fer à patin , dont on indique ici trois différente
efpeces. Fer à la turque ; trois fortes de fer défignées fous c
nom. Ibid. b. Fer prolongé en pince. Fers à mulet j deicrip*
tion détaillée. Fer à la florentine. Ibid. 303. a.
F e r à lampas. {Maréch.) VI. 303. a.
Fer. Eftamper un fer. V. xooi. a. Détails fur la maryer
de forger un fer. VII. 169. a , b. 8cc. Fer à pantoufle. •
830. a. Defcription des fers 8c de la maniere de ferrer
chevaux. Suppl. III. 423.a, b. — 427. b. Différentes/sjpe
de fers anciens 8c modernes. VII. vol. des pl. MaréchaJi »
pl. 3 8c 6.
Fer y fil de. VI. 789. a. rr<)0. b.
Fers à cahiers. { Aiguilletier) VI. 503. a.
F e r s . ( Ardoifieres ) VI. 303.a. _ jw &
Fer à forger ou fer à creufer , parmi les batteurs
autres ouvriers. VL 303. a. , íiuwlícr
Fer à repaffer. Sa defcription. Procédés du ta»
pour le faire. Fer à repaffer en cage. VI. S°3’ y
Carreau, ptK
F E R
F e r à rouler {Boutonnier)Defcription 8bufage. Vl. 303. b.
Fers y outils de carriers. VI. 303. b.
F e r à fonder. {Chauderonnier, Ferblantier y 8cc. ) Differen*
tes fortes de fers à fonder. Leur defcription. VI. 303. b.
Voyez Suppl. III; 17. b.
Fer, terme de corderié j defcription 8c ufage. VI. 304. a.
F et s à découper \ terme de découpeur. VI. 304; ai
Fer à découper les fleurs artificielles. VI. 866. bi
Fers à gaujfren VI; 304. a;
Fers Préparer. |Doreur fur bois ) VL 304. a;
Fer à gros coups. VI. 304; a.
Fer à coups fins. VI. 504. a-.
Fer à refendre. VL 304. a.
Fer quarré. {Eperonnier) VI. 3Ô4; a;
F e r à fouder , ( Ferblantier ) defcription & ufage; VI.
304. m ,
Fer y en terme de filafiier. VI. 304. b.
F e r à fouder. {Fontainier) VI. 304. b;
F e r à fileter. {Gainier) VI; 304. b.
F e r s ; {Luthier) il y en a de plufieurs fortes» 8c ils fervent
à divers ufages. Fer pour les édifies des baffes, baf-
fons y violons , &c. Maniéré de s’en fervir. V I. 304. bi
Fers ronds. VI. 304. b.
Fers plats. Defcription 8c ufages. VI. 304. b.
F e r s crochus. ( Marqueterie ) Defcription 8c ufage. VI.
$04; b-
Fers de varlope , de demi-varlope , varlope à onglet , & de
rabot. Defcription de la maniéré dont l’ouvrier les fait. VI.
Î e r . {Menuiferie) Ce qu’on entend par donner du for à
tine varlope, demi-varlope, rabot » 8c. VI. 303. a;
Fer y à la monnoie. VI. 503. a,
F e r à frifer. {Perruquier) Defcription 8c ufage. VI. 503«a.
Fer à frifer, III. 390. a. Fers à cheveux des dames romaines.
XVI. 383. a,
Fer à toupet ; defcription 8c ufage. VI. 303 .a.
F e r rond à fouder. ( Plombier ) Fer pointu , auarré , à
fouder. Fer rond , pointu, à fouder, des vitriers. Vl. 303. a.
F e r à polir. {Rcliûre ) Defcription 8c ufage. VI. 303. a.
Fer â dorer. VI. 303. a.
F e r de velours à cannelure. { Infirument du métier de T étoffe
de foie. VI. 303. b.
Fers de velours frifé. VI. 303. b.
Fer de peluche. VI. 303. b.
FERALES » {Hift. a ne.) fête que les Romains célébroient
le 12 février en l’honneur des morts. Etymologie de ce
mot. Originale cette fête. Sacrifice qui s’y faifoit à la déefle
Muta. Interruption de cette fête. (Jaufe de fon rétabliffs-
ment. VI. 303. b.
FERBLANTIER } outils dont ces ouvriers fe fervent.
Ufage' qu’ils font de la poix-réfine; VI. 303. b.
F e r b l a n t i e r . ( Arts méch. ) Efpeces de fer dont il fait
ufage. Uftenfiles qu’il fait en fer-blanc. Manière de polir
cette forte de fer. De la maniéré de faire une afiiette ou
plat t 8c une boîte quarrée de fer-blanc. Compofition de la
foudure du ferblantier. Son fer à fouder. Suppl. III. 17. b.
Ferblantiers. Leur maniéré de fouder. XV. 393. a. Tas
des ferblantiers. 932. b. Planches fur l’art des ferblantiers. IV.
Vol. des planch. voyez Fer-blanc.
FERDINAND I , fucceffeur de Charles-Quint, archiduc
d’Autriche, ( Hifl. d'Allem. de Hongr. & de B o h trentième
empereur depuis Conrad I , vingt-quatrieme roi de Hongrie,
trentième roi deBohême. Hiftoiredefon regne. Suppl.Wl.17. b.
F e r d in a n d d’Autriche II. {Hifl. d’Allem. de Hongr. &
de Boh. ) trente-quatrieme empereur, vingt-huitieme roi de
Hongrie, trente-huitieme roi de Boheme. Principaux événe-
mens de fon reene. Suppl. III. 18. b. ■
F e r d in a n d I I , empereur. Comment il donna lieu a la
guerre de trente ans. XI. 770. a.
F e r d in a n d III, {Hifl. d'Allem. de Hongr. 8 de Boh.) fils
du précédent, trente-cinquieme empereur, vingt-neuvieme
roi de Hongrie , trente-ncuvieme roi de Bohême. Principaux
événemens de fon regne. Suppl. III. 22. a , b. 23. a.
F e r d in a n d I , roi de Caltille 8c de Léon, {Hjfi. d’Efp. )
troifieme fils de dom Sanchc, roi de Navarre. Tableau de
fon regne. Suppl. III. 23. b.
F e r d in a n d , premier roi d’Efpagne. V. 933. a.
F e r d in a n d I I , fils puîné d’Alphonfe VIII, roi de Léon
8c de Galice. Caraétere de ce prince. Sa conduite généreufe
envers le roi de Portugal fon beau-pere. Suppl. lll. 23. b.
F e r d in a n d I I I , fils d’Alphonfe IX , 8c de Berengere ,
infante de Cafiille. Sa canonifation. Tableau de fon regne.
Suppl. III. 24. a. .
F e r d in a n d IV , furnommé l’ajourné, fils 8c fucceffeur
du roi Sanche au trône de Caftille 8c de Léon. Defcription
de fon regne. Suppl. III. 24. a.
F e r d in a n d V , dit le catholique, fils de Jean I I , roi d’A-
. ragon. Il réunit les royaumes de Caftille 8c d’Aragon. Tableau
de fon regne. Suppl,- III. 24- b. ,
Topte I,
F E R 7 0 1
F e r d in a n d V , ou ic catholique, roi d’Efpagne; XV.
426. b. XVI. 432; a.
F e r d in a n d VI , furnommé U fage, fils de Philippe V j
8c de la princcfle Marie-Louifc-Gabriclle de Savoie , roi
d’Efpagne. Principaux événemensde fon regne. Suppl. III. 24. b.
F e r d in a n d , furnommé le itifle ; toi d’Aragon , fils de
Jean I , roi de Caftille, 8c d’Ëléonore d’Aragon. Hiftoire
abrégée de fon regne. Suppl. III. 23. b.
F e r d in a n d , roi de Portugal, {Hifl. de Portug.) fils
de Pierre 1, 6c de Confiance. Principaux événemens de fon
regne. Suppl. III. 26; a.
FÉRENTAIRES ou Férendatres , ( Hifl. and ) troupes auxiliaires
chez les Romains, armées à la légère. Origine dû
nom de férendatres. Autre efpeces de férendaires. VI. 306. a.
FERlN , adj. ( Médec. ) Les anciens défignoient par ce mot
des iffaladièsd’trneinature trés-mauvaife. Les malades atteints
de ces maladies font aufu appelles de ce nom. VI. 306. a.
FERETRE , {Hifl. anc.).brancard dont on fe fervoit pour
Îiorter les morts. Autfe efpece de brancard employé dans
es triomphes. On a quelquefois étendu l’acception de ce
mot à toute pompe en général. VI. 306. a. U y eut des oc-
cafions où le triomphateur étoit porté par les prêtres même,
8c. Ibid. b.
FERETRIUS. {MythoL) Jupiter férétrius. On lui faifoit
des facrifices après la viéloire. VI. 306. b.
FERIES, (Hifl. anc.) jours pendant lefcraels' on s’abfie-
noit de travailler. Origine du mot fériés. Différence entré
les jours de fériés 8c les jours de fêtes. Quelques-uns confondent
les fériés avec les jours de vacation. Ce mot revient
à celui de fabbat chez les Juifs. Différentes fortes de
fériés dont les noms font ici indiqués. Férié fe difbit aufli
chez les Romains pour un iour de foire. VI. 306. b.
. F e r ie . {Hifl. eccl.) Le oimanche efi la première fbxïéé:
VI. 306; b. Autrefois toute la femaine de pâques étoit fêtée
par ordre de Confiandn, 8c l’on appella ces fept jours fériés;
Comme cette femaine étoit la première de l’année ec-
défiafiique , on s’accoutuma à appeuer les jours des autres
femaines 2 , 3 8c 4 fériés. Sens au mot ferie dans le bré-.
viaire romain. Fériés extraordinaires. Ibid. 307. a;
Fériés, jours de. .VIII. 893. a.
F e r ie s latines. { Littéral. ) Fête folemtïelle des peuples du
Latium, imaginée politiquement par Tarquin. L’auteur développe
ici l’art de l’infiuution de cette fête, 8c la ferupu-
leufe exactitude que les Romains apportèrent à la célébrer.
Inftitution de cette fête à l’occafion d’un traité fait avec lés
peuples du Latium. Conditions du traité conclu pour la célébration
de cette fête. VI. 307. a. Quarante-fcpt peuples af-
fifterent aux premières fériés latines. Le préfident fut toujours
un romain. Ces fériés étoient ordinaires ou extraordinaires.
On attribuoit à la négligence de cette fête tous les
malheurs qui arrivoient dans les armées romaines : exemple
Jiui prouve jufqu’à quel point alloit le fcrupule des Romains
ur l’omiflion des feries latines. Le moindre définit--dans les
circonfiances étoit capable de troubler la f%te. Ces fériés,
qui n’étoientd’abord que d’un jour, furent enfuite de deux
8c de trois. On y ajouta même un quatrième jour, mais
dont la cérémonie fe faifoit au capitole, 8c non fur le njont
Albain, comme celles des autres jours. On ne trouve dans
toute l’hifioire romaine que deux exemples de fériés latines
extraordinaires impératives. Ibid. b. Ce n’efi pas qu’il n’arrivât
de tems en tems des prodiges, pour lefquels on faifoit
des fupplicàrions extraordinaires, qui étoient de véritables
fériés ; mais comme elles fe paffoient dans Rome, on ne les
mettoit point au nombre des latines. Le tems que duroit l’expiation
de ces prodiges étoit affez borné. Cependant dan9
des cas extraordinaires, les fériés étoient immuablement de
neuf jours. Les fériés latines ordinaires étoient mobiles, 8c
on ne les célébrait qu’au jour marqué parle conful. Rome
étoit prefque déferre pendant leur célébration ; on y créoir
alors un gouverneur pour prévenir toute entreprife contre
elle. Auteurs à confulter. Ibid. 308. a.
Fériés latines. Faute à corriger dans cet article de l’Eû-
cyclopédie. Suppl. III. 27. b.
Fériés latines. IX. 301. a.
FERMAGES, {Jurifpr. ) redevance annuelle du fermier au
propriétaire ; celle des fermiers des droits royaux ou fei-
gneuriaux. VI. 308. a. Les loyers des biens de campagne ne
doivent pas être confondus avec les fermages. Le propriétaire
d’une métairie a un privilège furies fruitspour les fermages.
Privilège que donne la coutume dç Paris fur le»
meubles du fermier. Privilège du propriétaire fur les fermages
à lui dus. Ibid. b>
FERMAIL 8 FERM AU X , ( Blafon ) noitimés aufli ferma-
lets ou fermailUts. Comment ils font repréfentés. Ecu fer-
maillé. Joinville décrivant une grande fête , parle de cette
partie de la parure du roi. Les hommes 8c les femmes fe
fervoient de cette parure. Comment ils la plaçoient. Paflage
tiré d’Amadis où il en eft parlé ; ce qui en1 eft dit dans Froifif
. fard, VI. 308. b,
jp P P P p p p g