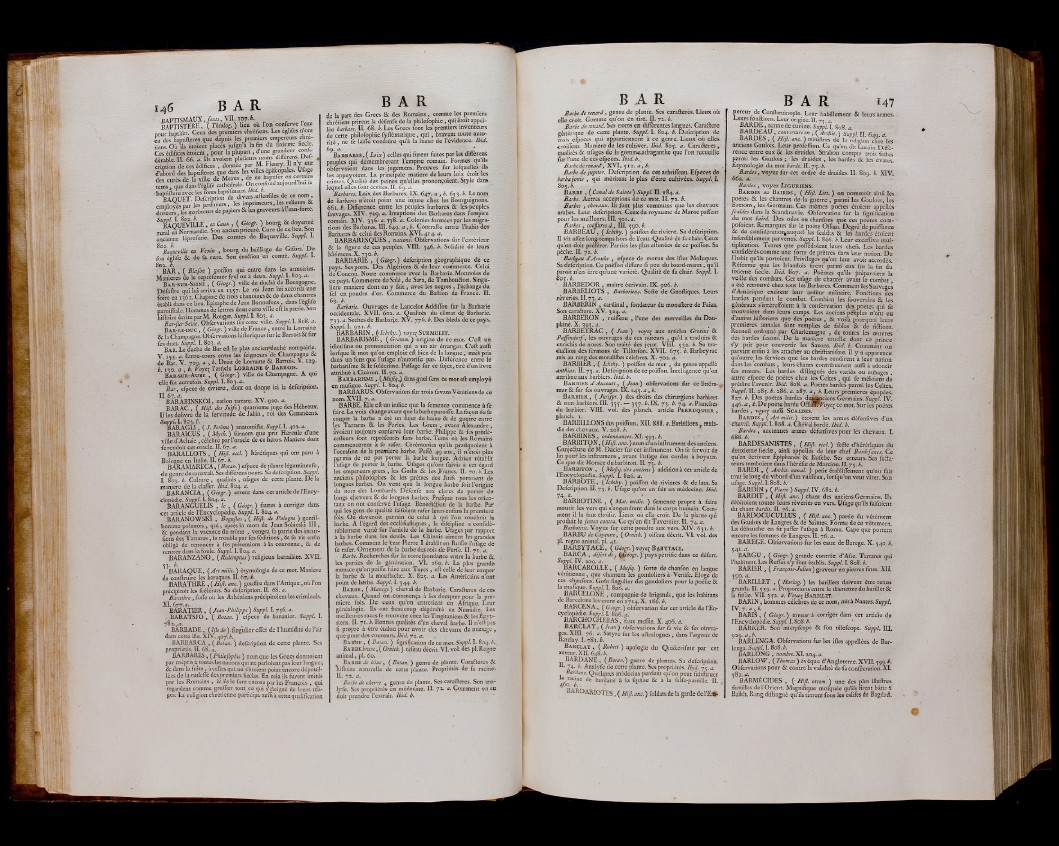
1 4 6 BAR BAPTISMAUX t fonts, VII. 107. A
BAPTISTERE, ( Thiolog. ) lieu où Ton conferve Uau
pour baptifer. Ceux des premiers chrétiens. Les églifes n’ont
ïu des baptifteres que depuis les premiers empereurs chrétiens.
Où ils ètoient places jufqu’a la fin du fixieme fiecle.
Ces édifices ètoient, pour la plupart, d’une grandeur conü-
dérable. 11. 66. a. Us avoient plufieurs noms a
cription de ces édifices , donnée par M. Fleury. B n v eut
d’abord des baptifteres que dans les viUes ép.rcopdes. Uiage
des curés de la ville de Meaux, de ne bapnTer en certains
tems , que dans l’éÿife cathédrale. On confoni anjourd hm le
■haptiftere avec les fonts baptifmaux. Ibtd.b.
BAOUET. Defcription de divers .uftenfiles de ce nom ,
em p lo f& p a r le s ja rL te , les imprimeurs, les reiten« &
xloreurs, les marbreurs de papiers & les graveurs à l eau-forte.
ST a OUEVILLE , en Caux , ( Gioge. ) bourg & doyenné
rural en Normandie. Son ancien prieuré. Cure 4e ce lieu. Son
ancienne léproferie. Des comtes de Baquevdle. Suppl. 1.
S°SntueyiUe m Vexin , bourg du bailliage de Gilbrs. Do
Ion églile & de fa cure. Son creftion en comté. Suppl. 1.
8d2. A i S l , . . . .
B A R , ( Blafon ) poiffon qui entre dans les armoiries
Maniérés de le repréfenter feul ou à deux. Suppl. 1. 803. a.
B a r -sur-Seine , ( Giogr.) ville du duché de Bourgogne.
Défaire qui lui arriva en 1337. Le roi Jean lui accorda une
îbire en 1362. Chapitre de trois chanoines & de deux chantres
établi dans ce lieu. Epitaphe de Jean Bonnefons, dans l’églife
paroifliale. Hommes de lpttres dont cette ville eft la patrie. Son
hiftoire écrite par M. Rouget. Suppl. I. 803. a.
Bar-fur-Sctnc. Obfervarions fur cette ville. Suppl. I. öiö. a.
Ba r -le-duc , (.Giogr. %ville de France, entre la Lorraine
& la Champagne. Obfervarions hiftoriques fur le Barrois & finies
ducs. SuppL I. 803. a.
Ba r . Le duché de Bar eft le plus ancien^duchè non-pairie.
V. 135. <z. Entre-cours entre les feigneurs de Champagne &
de Rar. V. 729. a , A Droit de Lorraine & Barrois. V . 129.
b. 130.* a , b. Voye[ l’article LORRAINE & BARROIS.
* Ba r-su r-Au be , ( Giogr. ) ville de Champagne. A qui
elle fut autrefois. Suppl. 1. 803. a.
Bar, efpece de civiere, dont on donne ici la defcription.
ÏI.67.A. ' ‘
' BARABINSKOI, nation tartare. XV. 920. a.
BARAC, (B iß . des Juifs) quatrième juge des Hébreux.
11 les délivré de la fervitude de Jabin, roi des Cananéens.
Suppl.1. 803. b.
BARAGLI , ( /. Jérôme ) anatomiftc. Suppl. I. 402. a. »
BARAICUS , ( Myth. ) fùrnom que prit Hercule d’une
ville d’Achaïe, célébré par l’oracle de ce héros. Maniéré dont
fe rehdoit cet oracle. II. 67. a.
BARALLOTS , ( Hiß. eccl. ) hérétiques qui ont paru a
Bologne en Italie. II. 67. b.
BARAMARÈCA, (Botan.) efpece de plante légumineufe,
du genre du canavali. Ses différens noms. Sa defcription. Suppl.
I. 803. b. Culture , qualités , ufages de cette plante. De la
maniéré de la daffer. Jbid. 804. a.
BARANCIA, (Giogr.) erreur dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. 1.804. a.
BARANGUELIS , le , ( Giogr. ) fautes à corriger dans
cet article de l’Encyclopédie. Suppl. 1. 804. a.
BARANOWSKI , Bogufias, ( Hiß. de Pologne > gentilhomme
polonois, qui , après la mort de Jean Sobieski 111,
& pendant la vacance du trône , vengea fa patrie des incursions
des Tartares, la troubla par fes féditions, & fe vit enfin
obligé de renoncer à fes prétentions à la couronne, & de
rentrer dans la foule. Suppl. 1. 804. a.
BARANZANO, ( Redemptus ) religieux barnâbite. XVII.
«3. b. ■ *
BARAQUE, (.Art milit.) étymôlogie de ce mot. Manier
de conftruire les baraques. H. 67/A
BARATHRE, ( Hifi. anc. ) gouffre dans l’Attique, où Fon
précipitoit les fcélérats. Sa defcription: II. 68. a.
Barathre, foffe où les Athéniens précipitoientles criminels.
XI. 677.4-
BARATIER , ( Jean-Phïlippe ) Suppl. 1. 756. a.
. BARATSJO, ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl.
7%i.ta.
BÀRBADE, (Ille de )-fingulier effet de l’humidité de l’air
dans cette ifle. XlV. 407'. A.
BARBARCA, ( Botan. j defcription de cette plante. Ses
propriétés. II. 68. a.
BARBARES, ( Philofophie ) nom que les Grecs donnoient
par mépris 4 toutes les nations qui ne parloient pas leur langue
& dans la fuite, a celles qui ne s’étoient point encore dépouillées
de la rudeffe des premiers fieclcs. En cela ils furent imités
par les Romains > & ils le font encore par les François , qui
regardent comme greffier tout ce qui s’èloigné de leurs ula-
ges. La religion chrétienne participa auffi à cette qualification
BAR de la part des Grecs & des Romains, comme les premiers
chrétiens prirent la défenfe de la philofophie, quiétoit appelée
barbare. II. 68. b. Les Grecs font les premiers inventeurs
cette philofophie fyftématique, qui, bravant toute autorité,
ne fe laifle conduire qu’à la lueur de l’évidence. Jbid.
69. a. •
Barbares , ( Loix) celles qui furent faites par les différens
peuples qui démembrèrent l’empire romain. Formes qu’ils
obfçrvoient dans les jugemens. Preuves fur lesquelles ils
les appuyoient. La principale matière de leurs loix étoit les
crimes. Qualité des peines qu’elles prononçoient. Style dans
lequel elles font écrites. H. 69. a.
Barbares. Loix des Barbares. IX. 647. a , b. 653. b. Le nom
de barbares n’étoit point une injure chez les Bourguignons.
661. b. Différence entre les peuples barbares & les peuples
fauvages. XIV. 729. a. Irruptions des Barbares dans l’empire
romain. XIV. 336.- a .f 38. a. Colonies formées par les migrations
des Barbares. HL 049. a , b. Contrafte entre l’habit des1
Barbares & celui des Romains. XVI. 414. a.
BARBARESQUES , nations. Obfervations fur l’extérieur
& la figure de ces peuples. VIH. 346. b. Solidité de leurs
bâtimens. X. 730. b.
BARBARIE, (Giogr.) defcription géographique de ce
pays. Ses ports. Des Algériens & de leur commerce. Celui
de Coucou. Notre commerce avec la Barbarie. Monnoies de
çe pays. Commerce de Salé, de Sara, de Tambouâon. Singulière
maniere dont on y lait, avec les negres , l’échange du
fel en poudre d’or. Commerce du Baftion de France. H.
69. b.
Barbarie. Ouvrages de Lancelot Addi (Ton fur la Barbarie
occidentale. XVH. 602. a. Qualités du climat de Barbarie.
733. a. Seches de Barbarie. XV. 776. b. Des bleds de ce pays.
Suppl. I. 921. b.
BARBÀRIN, f Ichthy. ) voye^ Surmulet.
BARBARISME, ( Gramm. ) origine de ce mot. C*eft un
idiotifine ou prononciation qui a un air étranger. C’eft aulii
lorfque le mot qu’on emploie eft bien de la langue, mais pris
dans un fens que l’ufage n’autorife pas. Différence entre le
barbarifme & le folécilme. Paffage fur ce fujet, tiré d’un livre
attribué à Cicéron. II. 70. a.
Barbarisme , (Mùjîq.) dans quel fens ce mot eft employé
en mufiqùe. Suppl. I. 804. f>.
BARBARUS. Obfervarions fur trois favans Vénitiens de ce
nom. XVII. 7. a.
BARBE. Elle eft un indice que la femence commence à fe
faire. La voix change avant que la barbe paroiffe. La façon de fe
couper la barbe a été un lujet de haine & de guerre entre
les Tartares & les Perfes. Les Grecs, avant Alexandre,
avoient toujours confervé leur barbe. Philippe & fes prédé-
çeffeurs font repréfentés fans barbe.. Tems où les Romains
commencèrent à fe rafer. Cérémonies qu’ils pratiquoient à
l’occafion de la premiere barbe. Paffé 49 ans, il n’étoit plus
pprmis de ne pas porter la barbe longue. Adrien rétablit
l’ufage de porter la, barbe. Ufages qu’ont fuivis à cet égard
les empereurs grecs, les Goths & les francs. II. 70. b. Les
anciens philofophes & les prêtres des Juifs portoient de •
longues barbes. On veut que la longue barbe foit l’origine
du nom des Lombards. Défenfe aux clercs de porter de
longs cheveux & de longues barbes. Prefque tous les orientaux
en ont confervé l’ufage. Bénédiâion de la barbe. Par
qui les gens de qualité faifoient rafer leurs enfans la premiere
fois; On deYCnoit parrain de celui , à qui l’on touchoit la
barbe. A l’égard des eccléfiaftiques , la difeipline a considérablement
varié fur l’article de la barbe. Ulages par rapport
à la barbe dans les deuils. Les Chinois aiment les grandes
barbes. Comment le tzar Pierre I établit en Ruflie l’uiàge de
fe rafer. Ornement de la barbe des rois de Perfe. II. 71. a.
Barbe. Recherches fur la correfpondaüce entre la barbe 8c •
les parties de la génération. VL> 160. b. La plus grande
menace qu’on puiffe faire aux Turcs, eft celle de leur couper
la barbe & la mouftache. X. 825. a. Les Américains n’ont
point de barbe. Suppl. I. 344. b.
Barbe , ( Manège ) cheVal de Barbarie.. Carafteres de ces
chevaux. Quand on.commença à les dompter pour la premiere
fois. De ceux qu’on entretient en Afrique. Leur
généalogie. Ils ont beaucoup dégénévé en Numidie. Les
meilleures races fe trouvent chez lesTingitaniens & les égyptiens.
II. 71. b. Bonnes qualités d’un cheval barbe. Il n’eit pas
fi propre à être étalon pour avoir des chevaux de manege,
que pour des coureurs. Jbid. 72. a.
B a rTBE , ( Botan. ) lignification de ce mot. Suppl. I. 804. h,
Ba rbe brune, ( Ornith7) oifeau décrit. VI. vol. des pl. Regne
animal, pl. 60.
Barbe de bouc, ( Botan. ) genre de plante. Caraéteres 8c
liiftoire naturelle de cette plante. Propriétés de fa racine:
II. 72. m
Barbe de chevre , genre de plante. Ses caraôeres. Son ana-
ïyfe. Ses propriétés en médecine. II; 72. a. Comment on en
doit prendre l’extrait. Jbid. b.
BAR Barbe de renard, gfenre de plante. Ses caraéteres. Lieux où
elle croît. Gomme qu’on en tire. II. 72. b.
Barbe de renard. Ses noms en différentes langues. Caraétere
•générique de cette plante. Suppl. I. 804. b. Defcription de
trois elpeces qui appartiennent à ce genre. Lieux où elles
croiffent. Maniéré de les cultiver. Jbid. 805. a. Caraéteres,
Jualités & ufages de la gomme.adraganthe que l’on recueille
ùr l’une de ces efpeces. Jbid. A.
Barbe de renard, XVI, 512. a , b.
Barbe de jupiter. Defcription de- cet arbriffeau. Efpeces de
barba jovis, qui méritent le plus d’être cultivées. Suppl. J.
805. b.
B a rb e , ( Canal de Sainte ) Suppl. II. 184. a.
Barbe. Autres acceptions de ce mot. II. 72. b.
Barbes , chevaux. Ils font plus communs que les chevaux
arabes. Leur defcription. Ceux du royaume de Maroc paffent
pour les meilleurs. lH. 301.4.
Barbes , coiffures à , III. 590. b.
BARBEAU, ( Ichthy. ) poiffon de riviere. Sa defcription.
H vit affez long-temps hors de l’eau.-Qualité de fa chair. Ceux
qu’on doit préférer. Parties les plus eftimées de ce poiffon. Sa
pèche. II. 72. b.
• Barbpau dArouke , efpece de morue des ifles Moluques.
Sa defcription. Ce poiffon différé fi peu du baard-mann, qu’il
paroit n’en être qu’une variété. Qualité de fa chair. Suppl. I.
ooç. b.
BARBEDOR , maître écrivain. IX. 906. b.
BARBELIOTS , Barboriens. Seéte de Gnoftiques. Leurs
rêveries. H. 73. a.
BARBERIN , cardinal, fondateur du monaftere de Faiza.
Son caraétere. XV. 324.C.
BARBERON , ruiffeau , l’une des merveilles du Dau-
phiné. X. 393. a.
BARBEYRAC , ( Jean ) voyeç aux articles Grotius 8c
Puffendorf, les ouvrages de ces auteurs , qu’il a traduits &
enrichis de notes. Son traité des jeux. VIIi. 532. b. -Sa tra-
duétion des fermons de Tillotfon. XVII. 675. b. Barbeyrac
mis au rang des moraliftes célébrés. X. 702. a.
BARBIER, ( Ichthy. ) poiffon de mer , du genre appellé
an t h ¿as. II. 73. a. Defcription de ce poiffon. Intelligence qu’on
attribue aux barbiers. Jbid. b.
B a rbier d'Aucoun, ( Jean ) obfervations fur ce littéra-^
teur & fur fes ouvrages. IX. 24t. a , b.
B a r b ie r , ( Jurijpr. ) des aroits des chirurgiens barbiers
& non barbiers, n i. 333. — 337. b. IX. 73. b. 74. a. Planches
du barbier. VIH. vol. des planch. article P e r r u q u ie r ,
planch. 1.
BARBILLONS des poiffons. Xïï. 888. a. Barbillons. maladie
des chevaux. V. 208. b.
BARBINES , ordonnances. XI. 393. b. • •
BARBITON, (Hift. anc. ) nom d’un infiniment dés anciens.
Conje&ure de M. Dacier fur cet inftrument. On fe fervoit de
lin poui les inftrumens , avant l’ufage des cordes à boyaux.
Ce que dit Horace dubarbiton. H. 72. b.
B a r b it o n , ( Mufia. des anciens ) addition à cet article dp
l’Encyclopédie. Suppl. I. 806. a.
BARBOTE, ( Ichthy. ) poiffon de rivieres & de lacs. Sa
Defcription. H. 73. b. Ufage qu’on en fait en médecine. Jbid.
74- a- • .
BARBOTINE , ( Mat. midic. ) femence propre à foire
mourir les vers qui s’engendrent dans le corps humain. Comment
il la fout choifir. Lieux où elle croit. De la plante qui
produit le femen contra. Ce qu’en ditTavernier.II. 74. a.
Barbotine. Voyez fur cette poudre aux vers. XIV. 631. A
BARBU de Cayenne, ( Ornith. ) oifeau décrit. VI. vol. des
pl. regne animal.pl. 41;
BARBYTACE, ( Giogr. ) voye{ Ba b y ta c e .
BARCA, difert de? (jfpiogr. ) 'pays pétrifié dans ce défert.
Suppl. IV. 209. a.
BARCAROLLE, ( Mujiq. ) forte de chanfon en langue
vénitienne, que chantent les gondoliers à -Venife. Eloge de
ces chanfons. Goût fingulier des gondoliers pour la poéfie &
la muüque. Suppl. I. 806. a.
BARCELONE , compagnie de brigands, que les habitans
de Barcelone levèrent en 1714.X. 186Î b.
BARCENA, (' Giogr. ) obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. I. 806. a.
BARCHOCHEBAS, faux meffie. X. 406.4.
BARCLAY, ( Jean ) obfervations fur fa vie & fes ouvrages.
XIII. 76. a. Satyre fur les aftrologues, dans Yargenis de
Barclay. L781. b.
B a r c l a y , ( Robert ) apologie du Quakerifine par cet
auteur. XII. 648. A v
BARDANE, (Botan.) genre déplantés. Sa defcription.
P k Anîdy fe cette phuHC* Ses propriétés. Jbid. 7 ¿.a.
Bardane. Quelques médecins penfent qu’on peut fubftitucr
46c>aClne karthue à la fqifine & à la foife-pareille. n . ,
BARDARIOTES. ( Hifi |anc.) foldats de la garde dcl’Ei#«
BAR 1 4 7
pereur de Çonffannnople. Leur habillement & leurs armes.
Leurs tonétions. Leur origine. II. i p a.
BARDE, terme de cuifine. Suppl. I 808 i l f l l i üftii 6 40 .1
BARDES , ( pifi.' g™. ) mimilres de la relia,on chez les
anciens Gaulois. Leur proieffion. Ce qu’en dit Lucain. Différence
entre eux & les druides. Strabon compte trois fe&es
I>armi les Gaulois ; les druides , les bardes & les évates.
Etymologie du mot barde. H. 73. A
Bardes, voyez fur cet; ordre de druides. II. 809. A XIV.
662. a.
Bardes, voyez L ig u r ien s .
B a rd e s o u B a ird s , ( Hifi. Litt. ) on nommoit ainfi les
poètes & les chantres de la guerre , parmi les Gaulois, les
•Bretons, les Germains. Ces mêmes poètes ètoient appellés
fcaldes dans la Scandinavie. Obfervation fur la lignification
du mot baird. Des odes ou chanfons que ces poètes com- p
pofoient. Remarques fur le poète Ollian. Degré de puiffonce
& de confidératioi^auquel les fcaldes & les bardes é toient
mfenfiblement parvenus. Suppl. I. 806. A Leur exceflive mul-
-tiplication. Terres que poflédoient leurs chefs. Les bardes
confédérés: comme une forte de prêtres dans leur nation. De
l’habit qu’ils portoient. Privilèges qu’on leur avoit aécordés.
Réforme que les Irlandois firent parmi eux fur la fin du
fixieme fiecle. Jbid. 807. a. Poèmes qu’ils pféparoient la
veille des combats. Cet ufoge dé chanter avant le combat,
a été retrouvé chez tous les Barbares. Comment les Sauvages
d’Amérique excitent leur ardèur militaire. Fondions des
bardes pendant le combat. Combien les fouverains & les
généraux s’intéreffoient à la conieryation des poètes qui fe
trouvoient dans leurs camps. Les anciens péùples n’ont eu
d’autres hiftoriens que des poètes , & voilà pourquoi leurs
premières annales font remplies de fobles & de fixions.
Recueil ordonné par Charlemagne , de toutes les oeuvres
des bardes foxons. De la maniéré cruelle dont ce prince
s’y prit pour convertir les Saxons. Jbid. A Comment on
parvint enfin à les attacher au chriftianifme. Il y a apparence
qu’outre, les fervices que les bardes rendirent à le,ur nation
dans les combats , leurs chants contribuèrent aufli à adoucir
fes moeurs. Les bardes dîftingués des vaciès ou eubages.
autre efpece de poètes chez les Celtes, qui fe mêloient de
prédire l’aven;r. Ibid. 808. a. Poètes bardes parmi les Celtes.
Suppl. II. 283. A 286. a. 287. a, A Leurs premières épopées.
827. A Des poètes bardes dejflucicns Germains. Suppl. IV.
446. a, A Du poète barde ce mot. Sur les poètes
bardes , voyet auffi Scaldes.
B a rd e s , ( Art milit.) ètoient les armes défenfives d’un
cheval. Suppl. 1. 808. a. Cheval bardé. Jbid. b.
Bardes , anciennes armes défenfives pour les chevaux. I.
BARDESANISTES , ( Hifi. eccl. ) fefte d’hérétiques du
deuxième fiecle, ainfi appellés de leur chef Barde fanes. Ce'
qu’en écrivent Epiphanes 8c Eufebe. Ses erreurs. Ses feâa-
teurs tomboient dans l ’héréfie de Marcion. H. 73. A
BARDI , ( Archit. naval. ) petit établifiement qu’on foit
tout le long du vibord d’un vaifleau, loriqu’on veut virer. Son
ufage. Suppl. 1. 808. b:
BARDIN 9 ( Pierre ) Suopl. IV. 682. A
BARDIT, (Hifi. anc.) chant des anciens Germains. Ils
débitoient toutes leurs rêveries en vers. Ufage qu’ils faifoient
du chant bardit. II. 76. a.
BARDOCUCULLU5 , ( Hifi. anc. ) partie du vêtément
des Gaulois de Langres & de Saintes. Forme de ce vêtement.
La débauche en fit paffer l’ufaee à Rome. Cape que portent
encore les femmes de Langres. II. 76. a.
BARÉGE. Obfervations fur les eaux de Barege. X. 340. A
341. a.
BARGU, (Giogr.) grande contrée d’Afie. Tartares qui
l’habitent. Les Ruffes s’y font établis. Suppl. 1. 808. A
BARIER, ( François-Julien) graveur en pierres fines. XII.
390. a.
BARILLET , (Horlog. ) les barillets doivent être tenus
grands. II. 339. a. Proportions entre le diamettre du barillet &
la fufée. VII. 3 32. a. Voye^ B a r i l le t .
BARIN, hommes célébrés de ce nom, nés à Nantes. Suppl.
IV. 7. a %b.
BARIS , ( Giogr. ) erreur à corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. 1. 808. A
BARKER. Son mierpfeope & fon têlefeope. Suppl. IH.
929. a, b.
BARLENGA. Obfervations fur les ifles appellées de Bar-
lenga. Suppl, I. 808. A
BARLONG, nombre. XI. 204. a.
BARLOW, ( Thomas ) évêque d’Angleterre. XVH. 399. A
Obfervarions pour & contre la validité de fa consécration. XI.
382. a.
BARMÉCIDES , (• Hifi. ottom. ) une des plus illuftres
familles de l’Orient. Magnifique mofquée qu’ils firent bâtir à
Balkh. Rang diftinguè qu’ils tinrent fous les califes de Bagdad,