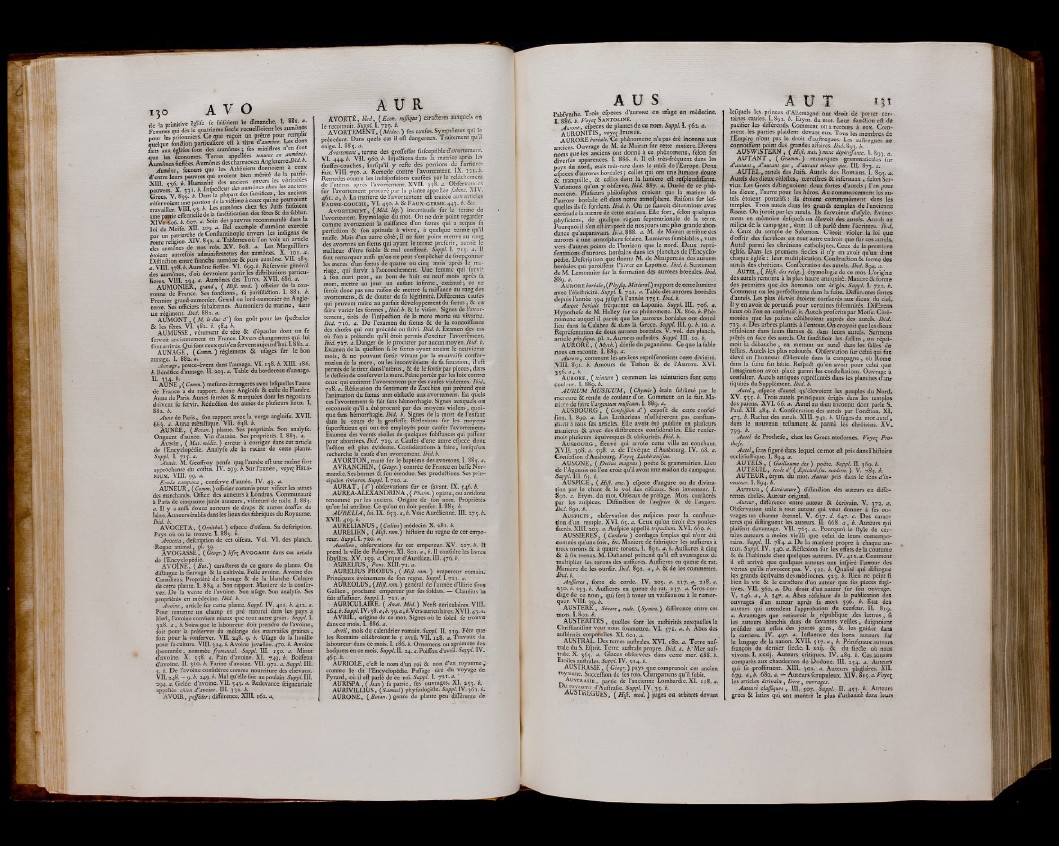
130 A V O
nour les prifonmers. Ce que reçoit un prêtre pour remplir
quelque fonâion particulière eft à titre iaumint. Les dons
fins aux églifes font des aumônes; fes mimftres nentont
que les économes. Terres appellées mures m uumôuts.
Aumônes fieffées. Aumônes des charruesen Angleterre^«. *.
Aumône, fecours que les Atliéniens donnoient à ceux
'd’entre leurs pauvres qui avoient bien ménté de la pâme.
XIII. « 6 . é. Humanité des anciens envers les véritables
muvres X 1 ; 1. b. Inipeâeur des aumônes chez les anciens
Sïrecs V. 899. i. Dans la plupan des facrifices, les anciens
aéfervoient une portion de la viftime ê ceux qui ne pouvoient
travailler V lilo l-é - Les aumônes chez les Jrnfi fàifoient
une paniê effendeUedela falsification des fêtes & du fabbat.
X Iw S o i i 607. a. Soin des pauvres recommandé dans la
loi de Moife. XII. 209. ». Bel exemple d’aumône exercee
nar un patriarche de Conftantinople envers les mdigens de
îoure relieion. XIV. 8 ta. a. Tablettes ou l’on voit un amcle
3S anmlnes de nos mis. XV. 808. a. Les Marguilliers
étoient autrefois adminiftrateurs des aumônes. X. 101. a.
Diftinétion entre franche aumône & pure aumône. VII. 283.
*. V in . 578.¿.Aumône fieffée. VI. 6p.b. Réfervoir général
des aumônes, d’où devroient partir les diftributions particu-
Reres. VIIL 294. a. Aumônes des Turcs. XVII. 686. a.
AUMONIER, grand, ( Hift. mod. ) officier de la couronne
de France. Ses fondions, fa jurifdidion. I. 881. b.
Premier grand-aumonier. Grand ou lord-aumonier en Angleterre.
Ses officiers fubalternes. Aumôniers de marine, dans
un régiment. Ibid. 882. a.
AUMONT, (M. le duc d’ ) fon gout pour les ipeitacles
& les fêtes. VI. 582. b. 584. b. r
AUMUSSE, vêtement de tête 8c d épaulés dont on le
fervoit anciennement en France. Divers changemens qui lui
fontarrivés.Quifontceuxquis’enferventaujourd’hui.I.882.û.
AUNAGE, ( Comm. ) réglemens 8c ufages fiir le bon
annage. I. 882. a. ,
Aunage, pouce-évent dans l’aunage. VI. 138. b. XIII. 186.
k Bénéfice d’aunage. II. 203. a. Table du bordereau d’aunage.
II. 334. b.
AUNE, ( Comm.) mefures étrangères avec lefquelles l’aune
de France a du rapport. Aune Angloife & celle de Flandre.
Aune de Paris. Aunes ferrées & marquées dont les négocians
doivent fe fervir. Réduction des aimes de plufieurs lieux. L
882. b. ' x .
Aune de Paris, fon rapport avec la verge angloife-. XVII.
663. a. Aune métallique. VU. 638. b.
AUNÉE, ( Botan.) plante. Ses propriétés. Son analyfe.
Onguent d’aunée. Vin d’aunée. Ses propriétés. I. 883. a.
ÂUNÉE, {Mat. médîc. ) erreur à corriger dans cet article
de l’Encyclopédie. Analyfe .de la racine de cette plante.
Suppl. I. 715. a.
Aunée. M. Geoffroy penfe quç l’aunée eft une racine fort
approchante du coftus. IV. 299. b. Sur l’aunée, vpye^ Hele-
nium. VIII. 99. a.
Enula campana 3 conferve d’aunée. IV. 43. a.
AUNEUR, ( Comm. ) officier commis pour vifiter les aunes
des marchands. Office des auneurs à Londres. Communauté
à Paris de cinquante jurés auneurs, vifiteurff de toile. I. 882.
a. Il y a auffi douze auneurs de draps 8c autres étoffes de
laine. Auneurs établis dans les lieux des fabriques du Royaume.
ibid. b. ,
A VOOE TA , ( Omithol.') efpece d’oifeau. Sa defeription.
Pays où on le trouve. I. 803. b.
Avoceta, defeription de cet oifeau. Vol. VI. des planch.
iRegne animal, pl. 39.
AVOGASSE, ( Géogr. ) lifa Avogasie dans cet article
de l’Encyclopédie.
AVOINE, (Bot.) carafteres de ce genre de plante. On
diftingùe la fauvage & la cultivée. Folle avoine. Avoine des
Canadiens. Propriété de la rouge 8c de la blanche. Culture
de cette plante. I. 884. a. Son rapport. Maniéré de la confer-
ver. De la vente de l’avoine. Son ufage. Son analyfe. Ses
propriétés en médecine. Ibid. b.
Avoine., article fur cette plante. Suppl. IV. 411. b. 412. a.
Pour remettre un champ en pré naturel dans les pays à
bled, l’avoine convient mieux que tout autre grain. Suppl. L
328. a , b. Soins que le laboureur doit prendre de l’avoine,
foit pour la préierver du mélange des mauvaifes graines,
foit pour là conferver. VII. 248. 9. b. Ufage de la houille
pour fa culture. VIII. 324. b. Avoine javellée. 470. b. Avoine
Ipontanée, nommée fromcntal. Suppl. III. 150. a. Minot
d’avoine. X: 538. a. Pain d’avoine. XI., 749. b. Boifléau
d’avoine. II. 310. b. Farine d’avoine. VII. 971. Suppl. III.
3. b. De l’avoine confidéree comme nourriture des chevaux.
VII. 248. - 9 .b. 249. b. Mal qu’elle fait au poulain: Suppl. III.
294. a. Gelée d’avoine. VU. 343. a. Redevance feigneùriale
appellée chien d'avoine, ni. 332. b.
AVOIR, pojjcdcn différence, XUL 162. aK
A U
AVORTÉ, bled, | Econ. ruftique) cara&èrés âirtqüèîs on
le recónnoit. Suppl. I. 719. b. | A
AVORTEMENT, (Médec. ) fes caufes. Symptômes qui le
précèdent. Dans quels cas il eft dangereux. Traitement qu il
exige. I. 883. a.
Avortement, terme des groffeffes fufceptible d ayoïtëmenr.
VI. 444. b. VIL 960. b. Injeétions dans la matricè'après les
faufles-couches, íorfqu’il y refte des portions de 1 aiïiere-
faix. VIII. 730. a. Remede contre l’avortement. IX. izt.b.
Remedes contre les indilpofitions caufées par le relâchement
de l’utérus après l’avortement. XVII. 338. a. ObfervarionS
fur l’avortement procuré par la plante appellée fabine. XIV.
461. a, b. La matière de l’avortement eft traitée aux articles
F ausse-co u ch e, VI. 4<o. b. 8c Fa u x -germe. 443. b. 8cc.
A vortemen t , (Méd. lég.) incertitude fur le terme de
l’avortement. Etymologie du mot. On ne doit point regarder
comme avortement la naiffance d’un foetus qui a acquis fa
perfeétion & fon aptitude à vivre, à quelque terme qu’il
naiffe. Mais d’un autre côté, il ne faut point mettre au rang
des avortons un foetus qui ayant le terme preferit, auroit le
malheur d’être foible oc mal conftitué. Suppl. I. 713. a. Il
fout remarquer auffi qu’on ne peut s’empêcher de foupçonner
lesmeres d’un foetus de quatre ou cinq mois après le mariage
, qui furvit à l’accouchement. Une femme qui furvit
à Ion mari peût, au bout de huit ou neuf mois après fa
mort, mettre au jour un enfant infirme, exténué; ce ne
ferait donc pas une raifon de mettre fa naiffance au rang des
avortemens, 8c de douter de fa légitimité. Différentes caufes
qui peuvent nuire au parfait développement du foetus, 8c eir
taire varier les formes, Ibid. b. 8c le vicier. Signes de l’avortement,
tirés de l’infpeétion de la mere morte ou vivante.
Ibid. 716. a. De l’examen du foetus 8c de la connoiffance
des chofes qui ont précédé ou fuivi. Ibid. b. Examen des cas
où l’on a prétendu qu’il étoit permis d’exciter l’avortèment.
Ibid. 717. a. Danger de le procurer par aucun moyen. Ibid-. b.
Examen de la queffion fi le foetus ayant atteint le neuvième
mois, 8c ne pouvant fortir vivant par la mauvaifé conformation
de la mere, ou les inconvéniens de fa fituation, il eft
permis de le tirer dans l’utérus, 8c de le fortir par pièces, dans
le deffein.de conferver la mere. Peine portée par les loix contre
ceux qui excitent l’avortement par des caufes violentes. Ibid.
718. a. Réfutation du fentimerit de Zacchias qui prétend que
l’animation du foetus met obftacle aux avortemens. En quels
cas l’avortement fe fait fans hémorrhagie. Signes auxquels on
reconnoît 3ue qu’il a été procuré par des moyens violens, quoi- fans hémorrhagie. Ibid. b. Signes de la mort de l’enfant
ans le cours de la groffeffe. Réflexions fur les moyens
1 fuperftitieux qui ont été employés pour caufer l’avortemenr.
Examen des vernis réelles de quelques fubftances qui paffent
pour abortives. Ibid. 719. a. Caufes d’une autre efpece dont
l’aétion eft plus évidente. Confidérations à faire, lorfqu’on
recherche la caufe d’un avortement. Ibid. b.
AVORTON, traité fur le baptême des avortons. I. 883. a.
AVRANCHIN, ( Géogr. ) contrée de France en bafle Normandie.
Ses bornes 8c fon étendue. Ses productions. Ses prin-
• cipales rivieres. Suppl. 1. 720. a.
AURAT, (d’ ) obfcrvations fur ce favant. IX. 346. b.
AUREA-ALEXANDRIN A ,(Pharm.) opiate, ou antidote
renommé par les anciens. Origine de fon nom. Propriétés
qu’on lui attribue. Ce qu’on en aoit penfer. 1. 883. b.
AURELIA, /oi.IX. 633. a,b. Voie Aurélienne. III. 273. b.
XVn. 419. b.
AURËLIANUS, ( Calius) médecin. X. 281. b.
AUREL1EN, (Hiß. rom.) hiftoire du regne de cet empereur.
Suppl. I. 720. a.
Aurilien, obfervations -fur cet empereur. XV. 227. b. Il
prend la ville de Palmyre. XI. 80 t. a , b. Il confuí te les livres
fibyllins. XV. 139. a. Cirque d’Aurélien. III. 476. b.
AURELIUS, Pons. XÛL71.«.
AURELIUS PROBUS, ( Hiß. rom. ) empereur romain."
Principaux: évéïiemens de fon regne. Suppl. I.721. a.
AUREOLUS, ÇHiß.rom.) général de l’armée d’Illirie fous
Gallien, proclame empereur par fes foldats. — Claudius le.
fait affaffiner. Suppl. I. 721. a.
AURICULAIRE. ( Anat. Méd. ) Nerfs auriculaires. VIII.
264. b.Suppl. IV. 38.0 ,¿. 39 .a, ¿.Vers auriculaires. XVII. 43.^.
ÁVRIL, qrigine de ce mot. Signes où le foleil fe trouve
dans ce mois. L 886. a.
Avril, mois du calendrier romain. Suppl. IL 119. Fête que
; les Romains célébraient le 3 avril. VII. 128. a. Travaux du
laboureur , dans ce mois. 1. 186. b. Ornemens ou agrémens des
bofquets en ce mois. Suppl. II. 24.0. Poiflon d’avril. Suppl. IV.
463..AÀURIOLE,
c’eft le nom d’un roi 8c non d un,royaume
comme le dit l’Encyclopédie. Paffage tiré du voyage de
Pyrard, où il eft parlé de ce roi. Suppl. I. 721. a. ’
AURISPA, (Jean) fa patrie, fes ouvrages. XI. 233. b.
AURIVILLIUS, (Samuel) phyfiologifte. Suppl.YV. 361. b.
AURONE, (Botan.) genre de plante peu différente de
AUS l’abfynthe Trois éfpeces d’aurane en ufage ën mèdetiôë.
I. 886. b. Voye{ Santoline.
Aurone> efoeces de plantes de ce nom. Suppl. L 562. a.
AURONITIS, voyei Itu rÉE.
AURORE boréale. Ce phénomène n’a pas été inconnu aux
anciens. Ouvrage de M. de Mairan fur cette matière. Divers
noms que les anciens ont donné à ce phénomène „ félon fes
diverfes apparences. I. 886. b. Il eft très-fréquent dans les
pays du nord, mais très-rare dans le midi de 1 Europe. Deux
efpeces d’aurores boréales ; celles qui ont une lumière douce
8c tranquille, 8c celles dont la lumière eft refplendiftànte.
Variations qu’on y obferve. Ibid. 887. a. Durée de ce phénomène.
Plufieurs philofophes croient que la matière de
l ’aurore boréale eft dans nptre atmofphere. Raifons fur lefquelles
ils fe fondent. Ibid* b. On ne fauroit déterminer avec
certitude la nature de cette matière. Elle fort, félon quelques
phyficiens, de quelque région feptentrionale de la terre.
Pourquoi il s’en eft évaporé de nos jours une plus grande abondance
qu’auparavant. Ibid. 888. a. M. de Mairan attribue ces
aurores à une atmofphere folaire. Lumières femblables, vues
vers d’autres points de l’horizon que le nordl Deux repré-
-fentations d’aurores boréales dans les planches de l’Encyclopédie.
Defeription que donne M. de Maupertuis des aurores
boréales qui paroiffent l’hiver en Lapdhie. Ibid\ b. Sentiment
de M. Lemonnier fur la formation des aurores boréales. Ibid.
889. a. t ’
A urore boréale, (Phyfiq. Météorol.) rapport de cette lumière
avec l’éleftricitè. Suppl. I. 721. a. Table des aurores boréales
depuis l’année 394 iufqu’à l’année 1731. Ibid, b.
Aurore boréale fréquente en Laponie. SuppL III. 706. a.
Hypothefe de M. Halley fur ce phénomène. IX. 860. b. Phénomène
auquel il paraît que les aurores boréales ont donné
lieu dans la Calabre 8c dans la Greçe, Suppl. III. p. b. 10. a.
Repréfentation de deux aurores boréales. V. vol. des planch.
article phyfique. pl. 1, Aurores auftrales. Suppl. III. ïo . b.
AURORE, ( Myth.) déeffe du paganifme. Ce que la fable
nous en raconte. I. 889. a.
Aurore, comment les anciens repréfentoient cette divinité.
VIII. 891. b. Amours de Tithon 8c de l’Aurore. XVI.
336. a , b.
A urore , ( teinture ) comment les teinturiers font cette
couleur. I. 889. b.
AURUM MUSICUM, (Chymie) étain fublimé par le
mercure 8c rendu de couleur d’or. Comment on le fait. Maniéré
de faire Y argent um muficum. I. 889. a.
ÀUSBOURG, ( ConfeJJion d’ ) expofé de cette confef-
fion. 1. 890. a. Les Luthériens n’adhérerent pas conftam-
ment à tous fes articles. Elle avoit été publiée en plufieurs
maniérés 8c avec des différences confidérables. Elle renfer-
snoit plufieurs équivoques 8c obfcurités. Ibid. b.
A u sbourg , fleuve qui arrofe cette ville au couchant.
XVII. 308; a. 398. a. de l’évêque d’Ausbourg. IV. 68. a.
Confeffion d’Ausbourg. Voye^ Luthéranifme.
AUSÜNE, ( Decius magnus ) poëte 8c grammairien. Lieu
de l’Agenois où l’on croit qu’il avoit une maifon de campagne.
Suppl. III. 63. b.
. ÀUSPICE, ( Hiß. anc. ) efpece d’augure ou de divination
par le chant 8c le vol des oifeaux. Son inventeur. I.
890. a. Etym. du mot. Oifeaux de préfage. Mots coniàcrés
par les aufpices. Diftinétion de Yaufpice 8c de Y augure.
Ibid. 891. b.
A uspices , obfervatîon des aufpices pour la conftruc-
tion d’un temple. XVI. 63. a. Ceux qu’on tirait des poulets
iacrés. XIII. 202. a. Aufpice appelle tripudium. XVI. 660. b.
ÀUSSIERES, ( Corderie ) cordages fimples qui n’ont été
commis qu’une fois, 6*c. Maniéré de fabriquer les auffieres à
trois torons 8c à quatre torons. I. 891. a. b. Auffiores à cinq
8c à fix torons. M. Duhamel prétend qu’il eft avantageux de
multiplier les. torons des auffieres. Aullieres en queue de rat.
Maniéré de les ourdir. Ibid. 892. a , b. 8c de les commettre.
Ibid. b.
Auffieres, forte de corde. IV. 203. a. 217. a. 218. a.
230. b. 233. b. Auffieres en queue de rat. 237. a, Gros cordage
de ce nom, qui fert à touer un vaiffeau ou à le remorquer.
VIII. 39. b.
AUSTERE, Sèvere, rude. (Synôn.) différence entre ces
mots. 1.892. b.
AUSTÉRITÉS, quelles font les auftérités auxquelles le
Chriftianifme veut nous foumettre. VI. 371. a. b. Abus des
auftérités corporelles. XI. 601. a.
AUSTRAL. Des terres auftrales. XVI. 180. a. Terre auf-
trale du S. Efprit. Terre auftrale propre. Ibid. a. b: Mer auf-
trale. X. 363. a. Glaces obfervèes dans cette mer! 688. b.
Etoiles auftrales. Suppl. IV. 914. b.
AUSTRASIE, (Géogr.) pays quecomprenoit cet ancien
Toyaume. Succeffion de fes rois. Changemens qu’il fubit.
A ustrasie, partie de l’ancienne Lombarcue. XI. 1x8. a.
d’Auftraiie- $uppl- IV. 33. b.
AUSTREGUES, ( Hiß. mod. ) juges ou arbitres devant
A U T
îefquels les princes d’Allemàgné. bat droit de pôïtef cer*
taines caufes. 1. 892. ¿. Etym. du mot. Leur fonâioa eft de
pacifier les différends. Comment on a recours à eux. Combinent
les parties plaident devant eux. Tous les membres de
l’Empire n’ont pas le droit d’auftregues. Les auftregues ne
connoiffent point des grandes affaires. /¿i<&-893. b
AUSWÍSTERN , ( Hift. nat, ) mine dèpériffantc. 1. 893. Æ_
AUTANT , ( Gramm. ) remarques grammaticales fur
d'autant, d'autant que, d'autant mieux que. III. 873. a.
AUTEL, autels des Juifs. Autels des Romains. I. 893.a.
Au tels des dieux céléftes, terreftres 8c infernaux, félon Ser-
vius. Les Grecs diftinguoient deux fortes d’autels ; l ’un pour
les dieux, l’autre pour les héros. Au commencement les autels
étoient portatifs : ils étoient communément dans les
temples. Trois autels dans les grands temples de l’ancienne
Rome. On juron par les autels. Ils ferment d’aiyle. Evéne-
mens en mémoire defquels on élevoit des autels. Autels au
milieu de la campagne, dont il eft parlé dans l’écriture. Ibid.
¿- Ceux du temple de Salomon. C’étoit violer la loi que
d’offrir des facrifices en tout autre endroit que fur ces autels.
Autel parmi les chrétiens catholiques. Ceux de la première
églife. Dans les premiers fiecles il n’y en avoit qu’un dans
chaque églife : leur multiplication. Conftruftion 8c forme des
autels des chrétiens. Confécration des autels. Ibid. 894. a.
A utel , ( Hift. des relig.) étymologie de ce mot. L’orig'ne
des autels remonte à la plus haute antiquité. Matière 8c forme
des premiers que Jes nommes ont érigés. Suppl. I. 722. b.
Comment on les perfectionna dans la fuite. Différentes fortes
d’autels. Les plus élevés étoient confacrés aux dieux du cieL
Il y en avoit de portatifs pour certaines folemnités. Différons
lieux où l’on en conftruiicir. Autels proferits par Moife. Cérémonies
que les païens célébraient auprès des autels. Ibid.
722. a. Des arbres plantés à l’entour.On croyoit que les dieux
réfidoient dans leurs ftatues 8c dans leurs autels. Sermens
prêtés eft face des autels. On fanétifioit les feftins, on répri-
moit la débauche , en mettant un autel dans les falles de
feftins. Autels les plus redoutés. Obfervation fur celui qui fût
élevé en l’honneur (l’Hercule dans la campagne, où Rome
dans la fuite fut bâtie. Refpeét qu’on avoit pour celui que
l’imagination avoit placé parmi les conftellations. Ouvrage à
confulter. Autels antiques repréfentés dans les planches iVaiu
tiquités du Supplément. Ibid. b.
Autel, efrece d’autel qu’élevoient les peuples du Nord.
XV. 333. b. Trois autels principaux érigés dans les temples
des païens. XVI. 66. a, Autel au dieu inconnu dont parle S.
Paul. XII. 484 b. Confécration des autels par l ’onétion. XI.
473. b. Rachat des autels. XIII. 742. b. Ufages du mot autel %
dans le nouveau teftament 8c parmi les chrétiens. XV.
799. b.
Autel de Prothefe, chez les Grecs modernes. Voyez Pro*
thffe. . ..
Autel, fens figuré dans lequel ce mot eft pris dans l’hiftoirc
eccléfiaftique. I. 894. a.
AUTELS, ( Guillaume des ) poëte. Suppl. II. 369. b.
AUTEUIL, école d ' ( Epicurcifm> modem. ) V. 783. b.
AUTEUR, étym. du mot. Auteur pris dans le fens d'in-
venteur. I. 894. b.
A u t eu r , (Littérature) diftinétion des auteurs en différentes
dafles. Auteur original.
Auteur, différence entre auteur 8c écrivain. V. 372. a.
Obfervation utile à tout auteur qui veut donner à fes ouvrages
un charme éternel. V. 637. d. 647. c. Des caracteres
qui diitinguent les auteurs. U. 668. a , b. Auteurs qui
plaifent davantage. VII. 763. a. Pourquoi le ftyle de certains
auteurs a moins vieilli que celui de leurs cofttempo-
rains. Suppl. IL 784 a. D e la maniere propre à chaque auteur.
SuppL IV. 340. a. Réflexion fur les effets de la coutume
8c de l’habitude chez quelques auteurs. IV. 411.a. Comment
il eft arrivé que quelques auteurs ont inipiré l’amour des
vertus qu’ils n’avoient pas. V. 521. ¿. Qualité qui diftingùe
les grands écrivains des médiocres. 523. b. Rien ne peint fi
bien la vie 8c le caraétere d’un auteur que fes pièces fugitives.
VIL 360, a. Du droit, d’un auteur fur fon ouvrage.
V. 146. a , b. 147. a. Abus réfultant de la publication des
ouvrages d’un auteur après fa mort. 396. ¿» Etat des
auteurs qui attendent l’approbation du cenfeür. IL 819.
a. Avantages que rarireroir la . république ries lettres, fi
les auteurs blanchis dans de favantes. veilles, daignoient
préfider aux effais des jeunes gens, 8c les guider dans
la carrière. IV. 497. a. Influence des bons auteurs fur
le langage de la nation. XVIL 317. a , b. Principaux auteurs
françois du dernier fiede. L xxij. ,8c du fiecle où nous
vivons. L xxxij. Auteurs critiques. IV. 489. b. Ces àûteurs
comparés aux chauderons dç Dodone. III. 234; a. Auteurs
qui fe proftituent. XIII. 302. a. Auteurs plagiaires. XIL
079. a, b. 680. a. •— Auteursfçrupuleux. XIV. 01 a. Voyeç
les articles écrivain, livre, ouvrages.
Auteurs clajjiques , III. 307. Sûppl. ÍI. 433. b. Auteür9
grecs 8c latins qui ont montré le plus d’urbanité dans leurs