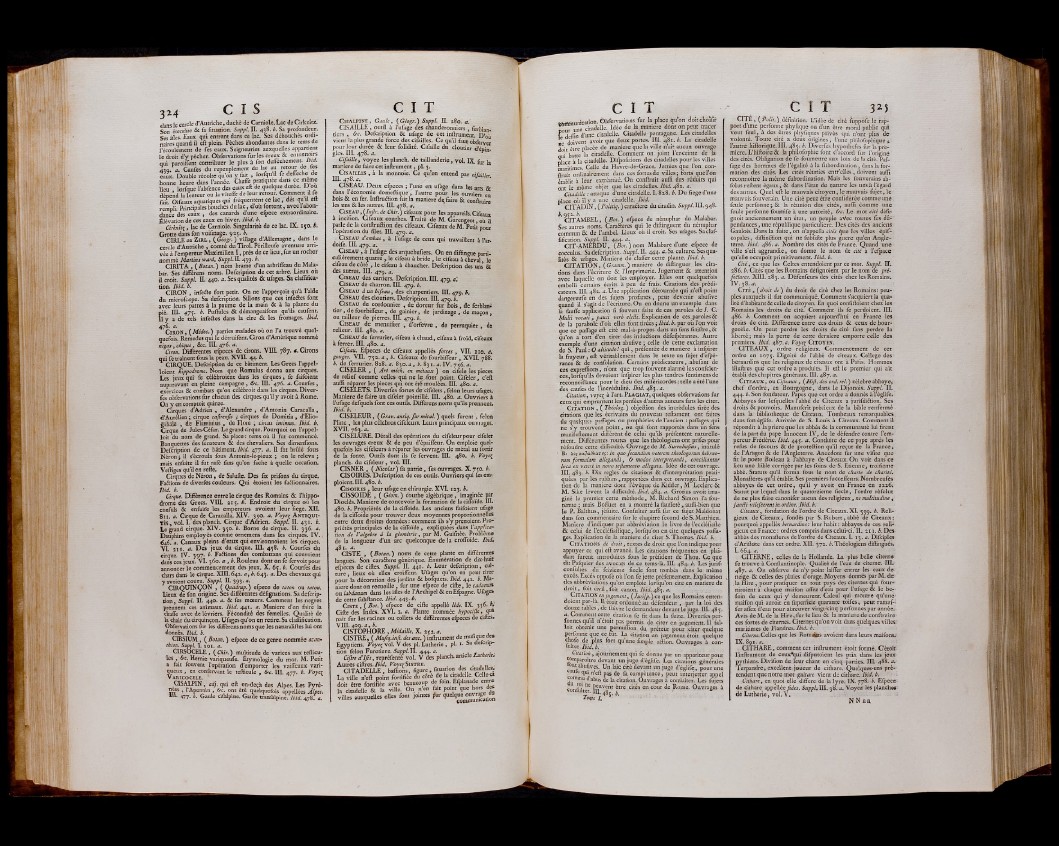
3 2 4 C I S
dans le cercle d’Autriche, duché de Camiole. Lac dé Cirknitz.
Son étendue & fa fituation. Suppl. II. 438. b. Sa profondeur.
Ses ides. Eaux qui entrent dans ce lac. Ses débouchés ordinaires
I
quand il eft plein. Pêches abondantes dans le tems de
l’écoulement de fes eaux. Seigneuries auxquelles appartient
le droit d’y pêcher. Obfervations furies creux & entonnoirs
qui paroilïent contribuer le plus à fon defféchement. Ibtd.
439. a. Caufes du repeuplement du lac au retour de, us
eaux. Double récolte qu’on y fait , lorfqu il fe defleche de
bonne heure dans l’année. Chaffe pratiquée dans ce même
lieu , lorfque l’abfence des eaux eft de quelque durée. D ou
dépend la lenteur ou la vitefle de leur retour. Comment il fe
fait. Oifeaux aquatiques qui fréquentent ce lac, des quil eft
rempli Principales bouches du lac, d ou fortent, avec 1 abondance
des eaux , des canards d’une efpece extraordinaire.
Élévation de ces eaux en hiver. lbid.b.
Cirknit{ , lac de Carniole. Singularité de ce lac. IX. iço. b.
Grotte dans fon voifinaee. 925. b.
CIRLE ou ZiRL, ( Géogr. ) village d Allemagne, dans le
cercle d'Autriche , comté duTirol. Périlleufe aventure arrivée
à l’empereur Maximilien I , prés de ce lieu ,fur un rocher
nommé Martinsward. Suppl. II. 439. b.
CIRITA, ( Botan.) nom brame d’un arbnffeau du Malabar.
Ses différens noms. Defcription de cet arbre. Lieux où
il croît. Suppl. U. 440. a. Ses qualités & ufages. Sa claflifica-
rion. Ibid. b. ^
CIRON, infeâe fort périt. On ne l’apperçoit quà laide
du microfcope. Sa defcription. Sillons ç[ue ces infeâes font
-tvec leurs pattes à la paume de la main & à la plante du
lié. ÜI. 473. b. Pullules & démangeaifons qu’ils caufent.
1 y a de tels infeâes dans la cire & les fromages. Ibid.
4 7C ir o n , ( Midec. ) parties malades où on l ’a trouvé quelquefois.
Reraedes qui le détruifent. Ciron d’Amérique nommé
nigas , chique, &c. III. 476. a.
Ciron. Différentes efpeces de cirons. VIU. 787. *. Cirons
qui fe traînent fous la peau. XVII. 44. b.
CIRQUE. Defcription de ce bâtiment. Les Grecs l’appel-
loient hippodrome. Nom que Romulus donna aux cirques.
Les jeux qui' fe célébraient dans les cirques, fe faifoient
auparavant en pleine campagne, &c. III. 476. a. Courfes,
exercices & combats qu’on célébrait dans les cirques. Diver-
fes obfervations fur chacun des cirques qu’il y avoit à Rome.
On y en comptoit quinze.
Cirques d Adrien , d’Alexandre , d’Antonin Caracalla,
d’Auràien ; cirque cafrenfis ; cirques de Domitia, d’Elio-
gabale , de Flaminius , de Flore ; eircus intimas. Ibid. b.
Cirque de Jules-Céfar. Le grand cirque. Pourquoi on l’appel-
loit du nom de grand. Sa place-: tems où il fut commencé.
Banquettes des fénateurs & des chevaliers. Ses dimenfions.
Defcription de ce bâtiment. Ibid. 477. a. Il fût brûlé fous
Néron ; il s’écroula fous Antonin-le-pieux ; on le releva ;
mais enfuite il fut rafé fans qu’on fâche à quelle occafion.
Vertiges qu’il en refte.
Cirques de Néron, de Salurte. Des fix priions du cirque.
Faâions de diverfes couleurs. Qui étoient les factionnaires.
Ibid. b.
Cirque. Différence entre le cirque des Romains & l’hippodrome
des Grecs. VIIL 21 ç. b. Endroit du cirque où les
confuls & enfuit’e les empereurs avoient leur fiege. XII.
811. a. Cirque de Caracalla. XIV. 350. a. Voytç A n t iq u i t
é s , vol. I. desplanch. Cirque d’Adrien. Suppl. II. 431. b.
Le grand cirque. XIV. 350. b. Borne de cirque. II. 336. a.
Dauphins employés comme omemens dans les cirques. IV . ,
646. a. Canaux pleins d’eaux qui environnoient les cirques.
VL 'a n . a. Des jeux du cirque. IQ. 458. b. Courfes du
cirque. IV. 397* b. Faâions des combattans qui couraient
dans ces jeux. VI. 360. a , b. Rouleau dont on fe fervoitpour
annoncer le commencement des jeux. X. 6ç. b. Courfes des
chars dans le cirque. XIII. 642. a,b. 643. a. Des chevaux qui
y avoient couru. Suppl. IL 393*a"
CIRQUINÇON , ( Quadrup. ) efpece de taton ou tatou.
Lieux de fon origine. Ses différentes défignations. Sa defcription
, Suppl. II. 440. a. & fes moeurs. Comment les negres
prennent ces animaux. Ibid. 441. a. Maniéré d’en faire la
charte avec de lévriers. Fécondité des femelles. Qualité de
la chair du cirquinçon. Ufages qu’on en retire. Sa dailirtcation.
Obfervations fur les différens noms que les naturaliftes lui ont
donnés. Ibid. b.
CIRSIUM, ( Botan. ) efpece de ce genre nommée acan-
thion. Suppl. L 101. a.
CIRSOCELE, ( Chir. ) multitude de varices aux tefticu-
les ,_6»c. Hernie variqueufe. Étymologie du mor. M. Petit
a fait fouvent l’opération d’emporter les vaifleaux variqueux
, en confervant le tefticule , &c. III. 477. b. Foyer
V a r ic o c e l e . J
CISALPIN, ad}, qui eft cn-deçà des Alpes. Les Pyrénées
, l’Apennin , >c. ont été quelquefois appellées Alpes.
477* b. Gaule cifalpine. Gaule tranfalpinc. Ibid. 478. a.
C I T
C i s a lp in e , Gaule, ( Géogr.) Suppl. II. 280. a.
CISAILLE, outil à l’ufage des chaudcronnicrs , ferblantiers
, ire. Defcription & ufage de cet infiniment. D’où
vient la plus grande force des ciiailles. Ce qu’il faut obferver
pour leur durée & leur folidité. Cifaille du cloutier riv.«;.,
gies. III. 478. a . Pm'
Cifaille, voyez lesplanch. de taillanderie, vol. IX. fur la
maniéré de faire cet inltrument, pl. 3.
C isa il l e s , à la monnoie. Ce qu^on entend par cifailUr
III. 478. a.
CISEAU. Deux efpeces ; l’uné en ufage dans les arts &
dans l’économie domeftique, l’autre pour les ouvriers en
bois & en fer. Inftruâion lut la maniéré de faire & conftruire
les uns & les autres. III. 478. a.
C ise a u Mnjlr. de Chir. ) cifeaux pour les appareils. Cifeaux
à incifion. Cifeaux courbes. Traité de M. Garengeot où il
parle de la conftruftion des cifeaux. Cifeaux de M. Petit pour
l’opération du filet. III. 479. a.
, d embas • à l’ufage de ceux qui travaillent à l’ar»
doue. 111.479. a.
C is e a u , à l’ufage des arquebufiers. On en diftingue particulièrement
quatre , le cifeau à bride, le cifeau à cheval le
cifeau de côté, le cifeau à ébaucher. Defcription des uns &
des autres. III. 479. a.
C i s e a u des carriers. Defcription. ÜI. 479. a'.
C i s e a u de charron. III. 479. b.
C ise a u à un bifeau, des charpentiers. III. 479. b.
C i s e a u des cloutiers. Defcription. III. 479. b.
C i s e a u de cordonnier , de doreur fur bois, de ferblantier
, de fourbifieur, de gainier, de jardinage , de maçon,
ou tailleur de pierres. IIL 479. b.
C ise a u de menuifier , d’orfevre , de perruquier , de
relieur. III. 480. a.
C is e a u de ferrurier, cifeau à chaud, cifeau à froid, cifeaux
à ferrer. III. 480. a.
Cifeau. Efpeces de cifeaux appellés forces , VII. 110. a,
gouges. VII. 752. a , b. Cifeaux de fourbifieur , XVIL 788.
b. de ferrurier. 828. a. 830. a , b. 831. a. IV. 756. a.
CISELER , ( Art méch. en métaux ) on cifele les pièces
de relief comme celles qui ne leJont point. Gfeler, c’eft
auffi réparer les pièces qui ont été moulées. III. 480. a.
CISELETS. Diverfes fortes a&cifelets, félon leurs ufages.
Maniéré de faire un cifelet pointillé. III. 480. a. Ouvriers à
l’ufage defquels font ces outils. Différens noms qu’ils prennent.
Ibid. b. •
CISELEUR, (Grav. antiq.fur métal. ) quels furent, félon
Pline , les plus célébrés cifeleurs. Leurs principaux ouvrages.
XVn.763.1r.
CISELURE. Détail des opérations du cifeleurpour cifeler
les ouvrages creux & de peu d’épaifieur. On emploie quelquefois
les cifeleurs à réparer les ouvrages de métal au fortir
de la fonte. Outils dont ils fe fervent. III. 480. b. Voytç
planch. du cifeleur, vol. III.
CISNER , (Nicolas) fa patrie, fes ouvrages. X.750. b.
CISOIRES. Defcription de ces outils. Ouvriers qui les emploient.
III. 480. b.
C iso ir e s , leur ufage en chirurgie. XVI. 123. b.
CISSOIDE , ( Géom. ) courbe algébrique , imaginée par
Dioclés. Maniéré de concevoir la formation de la cifioïde. III.
480. b. Propriétés de la cifioïde. Les anciens faifoient ufage
de la cifloïae pour trouver deux moyennes proportionnelles
entre deux droites données : comment ils s’y prenoient. Pro-‘
priétés principales de la cifioïde, expliquées dans Vapplica-
lion de l’algebre à la géométrie, par M. Guifnée. Problème
de la longueur d’un arc quelconque de la crofloïde. Ibid,
481. a. .
CISTE , ( Botan. ) noms de cette plante en différentes
langues. Son caraâere générique. Énumération de dix-huit
efpeces de cilles. Suppl. II. 441. b. Leur defcription, culture
, lieux où elles croiflent. Ufages qu’on en peut tirer
pour la décoration des jardins & bofquets. Ibid. 442. b. Maniéré
dont on recueille, fur une efpece de cille, le cadanum
ou labdanum dans les illes de l’Archipel & enEfpagne. Ufages
de cette fubftance. Ibid. 443. b.
C iste , ( Bot. ) efpece de cille appellé léde. IX. 336. bi
Cille des Indes. XVi. 2. a. Plante nommée hypocife, qui
naît fur les racines ou collets de différentes efpeces ae cilles.
VIII. 409.a, b.
CISTOPHORE, Médaille. X. 2Ç2. a. r
CISTRE, ( Mufti], inji. des anc.) infiniment de mufique des
Egyptiens. Voye[ vol. V des pl. Lutherie, pl. x. Sa defcription
félon Furetiere. Suppl. II. 444. a. . . ,
Cijire d'Ifis y repréfente vol. V des planch. article Lutherie.
Autres ciftres. Ibid. Voyez S istr e . , . . .
CITADELLE, bâfrions, figure, fituation des ciwdelles.
U ville n’eft point fortifiée tfo côté de h ctadelle Celle-a
doit être fortifiée avec beaucoup de foin. Efplanade enne
la citadelle & la viUe. On n*en fait point que hors des
villes auxquelles elles fon. jointe, ?ar
C I T
«Iffflnumcatlon. Obfervations fur la place qu'on doltchoifir
- une citadelle. Idée de la maniéré dont on peut tracer
fcdefiin d’une citadelle. Citadelle pentagone. Les citadelles
ne doivent avoir que deux portes. III. 481. b. La citadelle
doit être placée de maniéré que la ville n’ait aucun ouvrage
oui batte la citadelle. Comment on joint l’enceinte de la
place à la citadelle. Difpofirions des citadelles pour les villes
maritimes. Celle du Havre-dc-Grace. Jettées que l’on confirait
ordinairement dans ces fortes de villes; forts que l’on
établit à leur extrémité. On confirait auffi des réduits qui
ont le même objet que les citadelles. Ibid.482. a.'
Citadelle : attaque d’une citadelle. 1. 828. b. Du fiege d’une
place où il y a une citadelle. Ibid.
CITADIN, ( Politiq. ) caraâere du citadin. Suppl. III. 948.
k^ITAMBEL, (Bot.) efpece de nénuphar du Malabar.
Ses autres noms. Caraâeres qui le diftinguent du nénuphar
commun & de l’ambel. Lieux où il croit. Ses ufages. Saclaf-
fification. Suppl. II. 444. a. '
CIT-AMÉRDU, (Bot. ) nom Malabareduiie efpece de
cocculus. Sa defcription. Suppl. II. 444- ^-Sa culture. Ses qualités
& ufages. Maniéré de claffer cette plante. Ibid. b.
CITATION, ( Grarnrn.) maniéré de diftinguer les citations
dans l’écriture & l’Imprimerie. Jugement & attention
avec laquelle on doit les employer. Elles ont quelquefois
embelli certains écrits à peu de frais. Citations des prédicateurs.
III. 482. a. Une application détournée qui n’eft point
dangereufe en des fujets profanes, peut devenir abufive
quand il s’agit de l’écriture. On en donne un exemple dans
la faufle application fi fouvent faite de ces paroles de J. Ci
Multi vocat i , pauci verb eleEli. Explication de ces .paroles &
de la parabole d’où elles font tirées ; Ibid. b. par où l’on voit
que ce partage eft cité mal-à-propos dans un fensfiniftre,&
qu’on a tort d’en tirer des induâions défefpérantes. Autre
exemple d’une citation abufive ; celle de cette exclamation
de S. Paul : Ô altitudol qui, préfentée de maniéré à infpirer
la frayeur -, eft véritablement dans le texte un fujet d’efpé-
rance & de confolation. Certains prédicateurs, -abufant de
ces expreffions, n’ont que trop fouvent alarmé les confcien*
ces, lorsqu’ils devoient infpirer les plus tendres fentimensde
reconnoifiance pour le dieu des miléricordes : telle a été l’une
des caufes de l’incrédulité. Ibid. 483. a.
èitation, voye^ à l’art. Pl a g i a t , quelques obfervations fur
ceux qui empruntent les penfées d’autres auteurs fans les citer.
C i t a t io n , ( Théolog. ) objeâion des incrédules tirée des
citations que les écrivains du nouveau teftament ont faites
de quelques partages ou prophéties de l’ancien : partages qui
iie s’y trouvent point, ou qui font rapportés dans un fens
manifeftement différent de celui qu’ils préfentent naturellement.
Différentes routes que les théologiens ont prifes pour
réfoudre cette difficulté. Ouvrage de M. Surenhujius, intitulé
• B; Aoj mlaActnvi: in quo fecundum velerem theologorum hebrceo-
jum formulant allegandi , & modos interpretandi, conciliantur
loca ex veteri in novo teflamento allegata. Idée de cet ouvrage.
III. 483. b. Dix réglés de citations & d’interprétation pratiquées
par les rabbins, rapportées dans cet ouvrage. Explication
de la maniéré dont l’évêque de Kidder, M Leclerc &
M. Sike lèvent la difficulté. Ibid. 484. a. Grotius avoit imaginé
le premier cette méthode, M. Richard Simon l’a fou-
tenue ; mais Bofiùet en a montré la fàufieté , auffi-bien que
le P. Balthus, jéfuite. Confulter auffi fur ce fujet Maldonat
dans fon commentaire fur le chapitre fécond de S. Matthieu.
Maniéré d’indiquer par abbréviation le livre de l’eccléfiafte
& celui de l’eccléfiallique, lorfqu’on en cite quelques partages.
Explication de la maniéré de citer S. Thomas. Ibid. b.
C i t a t io n s dé droit, textes de droit que l’on indique pour
appuyer ce qui eft avancé. Les citations fréquentes en plaidant
furent introduites fous le préfident de Thou. Ce que
dit Pafquier des avocats de ce teins-là. III. 484. b. Les jurif-
confultes du feizieme ftede font tombés dans le même
excès. Excès oppofé où l’on fe jette préfentement. Explication
des abbréviations qu’on emploie lorfqu’on cite en matière de
droit, foit civil, foit canon. Ibid. 485. a.
C i t a t io n en jugement, (Jurifp.) ce que les Romains enten-
doient par-là. Il étojt ordonné au défendeur , par la loi des
douze tables, dè fuivre le demandeur devant le juge. III. 485.
a. Comment cette citation fe fit dans la fuite. Qiverfes per-
lonnes quil nétoit pas permis de citer en jugement. Il fal-
loit ^obtenir une permiffion du prêteur pour .citer quelque
perfonne que ce fut. La citation en jugement étoit quelque
choie de plus fort qu’une fimple aâion. Ouvrages à confulter,
Ibid. b . ' .
Citation, ajournement qui fe donne par un appariteur pour
comparaître devant un juge d’églife. Lçs citations générales
»ont abufives. Un laïc cité devant.un juge d’églife , pour une
. e n’eft pas de fa compétence, peut interjetter appel
jOmin.e ^’abus de la citation. Ouvrages à confulter. Les fujets
confulter ^trc en c°ur Rome. Ouvrages à M j.48**b'
C I T 3*5
CITÉ, ( Polit. ) définition. L’idée de cité fuppôfe le rapport
d’une perfonne phyfique ou d’un être moral public qui
veut feul, à des êtres phyfiques privés qui n’ont plus de
volonté. Toute cité a deux origines, l’une philofophique *
l’autre hiftorique. III. 485. b. Diverfes hypothefes fur la première.
L’hiftoire & la philofophie font d accord fur l’originé
des cités. Obligation de fe-foumettre aux loix de la cité. Paf-
fage des hommes de l’égalité à la fubordination, dans la formation
des cités. Les cités réuriies entr’elles, doivent auffi
reconnoître la même fubordination; Mais les fouverains ab-
folus relient égaux, & dans l’état de nature les uns à l’égard
des autres. Quel eft le mauvais citoyen, le mauvais fujet, le
mauvais fouverain. Une cité peut être confidérée comme une
feule perfonne; & la réunion des cités, auffi comme une
feule perfonne foumife à une autorité, &c. Le mot cité défi-
gnoit anciennement un état, un peuple aVec toutes fes dé- '
pendances, une république particulière. Des cités des anciens
Gaulois. Dans la luite, on n’appella cités ¿(lie les villes épif-
copales, diftinâion qui ne fubfifte plus guere qu’en Angleterre.
Ibid. 486; a. Nombre des cités de France. Quand une
ville s’eft aggrandie, on donne le nom de cité à l’efpace
qu’elle occupoit primitivement. Ibid. b.
Cité ÿ ce que les Celtes entendoient par ce mot. Suppl. II;
286. b. Cités que les Romains défignoient par le nom de préfectures.
XIII. 283. a. Défenfeurs des cités chez les Romains;
IV. 38. a:
C i t é , (droit de) du droit de cité chez les Romains: peuples
auxquels il fut communiqué. Comment s’acquiert la qualité
d’habitant & celle de citoyen. En quoi confiftoient chez les
Romains les droits de cité. Comment ils fe perdoient. III;
486. b. Comment on acquiert aujourd’hui en France les
droits de cité. Différence entre ces droits & ceux de bour-
geoifie. On peut perdre les droits de cité fans perdre la
liberté; mais la perte de cette derniere emporte celle des
premiers. Ibid. 487. a. Voye^ C i t o y e n .
C1TEAUX, ordre religieux. Commencement de cet
ordre en 1075. Dignité de l’abbé de cîteaux. Collège des'
bernardins que les religieux de citeaux ont à Paris. Hommes
illuftres que cet ordre a produits. Il eft le premier qui ait
établi des chapitres généraux. III. 487. a.
C i t e a u x , ou Cifeaux, (Hifl. des ordi rel-.) célébré abbaye j
chef d’ordre, en Bourgogne, dans le Dijon ois. Suppl. II.
444. b. Son fondateur. Papes que cet ordre a donnés à l’églife;
Abbayes fur lefquelles 1 abbé de Citeaux a jurifdiâion. Ses
droits & pouvoirs. Manufcrit précieux de la bible renfermé
dans la bibliothèque de Citeaux. Tombeaux remarquables,
dans fon églife. Arrivée de S. Louis à Citeaux. Comment il
répondit à la priere que les abbés & la communauté lui firent
de la part du pape Innocent IV, de le défendre contre l’empereur
Frédéric. Ibid. 445. a. Conduite de ce pape après les
refus de fecours & de proteâion qu’il reçut de la France j
de l’Aragon & de l’Angleterre. Anecdote fur une vifite que
fit le poète Boilcau à l’abbaye de Citeaux. On voit dans ce
lieu une bible corrigée par les foins de S. Etienne, troificme
abbé. Statuts qu’il forma fous le nom de charte de charité,
Monafteres qu’il établit. Ses premiers fuccerteurs; Nombreufes
abbayes de cet ordre, qu’il y avoit en France en 1226;
Statut par lequel dans le quatorzième fiecle, l’ordre réfolut
de ne plus faire canonifer aucun des religieux, nemultitudine 4
fanfli vilefcerent in ordine. Ibid. b.
Citeaux, fondation de l’ordre de Cîteaux. XI. 599. b. Religieux
de Citeaux,' fondés par S.Robert, abbé (le Cîteaux:
pourquoi appellés bernardins: leur habit: abbayes de ces religieux
en France : ordres compris dans celui-ci. II. 211. b. Des
abbés des monafteres de l’ordre de Citeaux. 1. 13 .a. Difciples
d’Ariftote dans cet ordre. XII. 372. b. Théologiens diffingués.
1 .664. a.
CITERNE, celles de la Hollande. La plus belle citerne
fe trouve à Conftantinople. Qualité de l’eau de citerne. III;
487. a. On obferve de n’y point laitier entrer les eaux de;
neige & celles des pluies d’orage. Moyens donnés par M. dè1
la Hire, pour pratiquer en tout pays des citernes qui four-*
ni raient à chaque maifon allez d’eau pour l’ufage & le be-
foin de ceux qui y* demeurent. Calcul qui montre qu’une»
maifon qui aurait en fuperficie quarante toifes, peut ramaf-.
fer affez d’eau pour abreuver vingt-cinq perfonnes par année;-
Avis de M. de la Hire, fur le lieu & la maniéré de conftruire>
ces fortes de citernes. Citernes qu’on voit dans quelques villes:
maritimes de Flandres. Ibid. b.:
Citerne. Celles que les Romains avoient dans leurs maifons;'
IX. 891. d.
CITHARE, comment cet infiniment étoit formé. C’étolf-
Tinflrument de ceux*qui difputoient les prix dans les jeux
pythiens. Divifion de leur chant en cinq.parties. III.- 488. a;
Terpandre, excellent/joueur de cithare. Quelques-uns prétendent
que notre mot guitare vient de cithars. Ibid. b.
Cithare, en quoi elle diffère de la lyre. IX. 778; b. Efpece-
de cithare appellée fides. Suppl. 111. 38. a. Voyez les planches
de Lutherie, vol. V.
N N n n