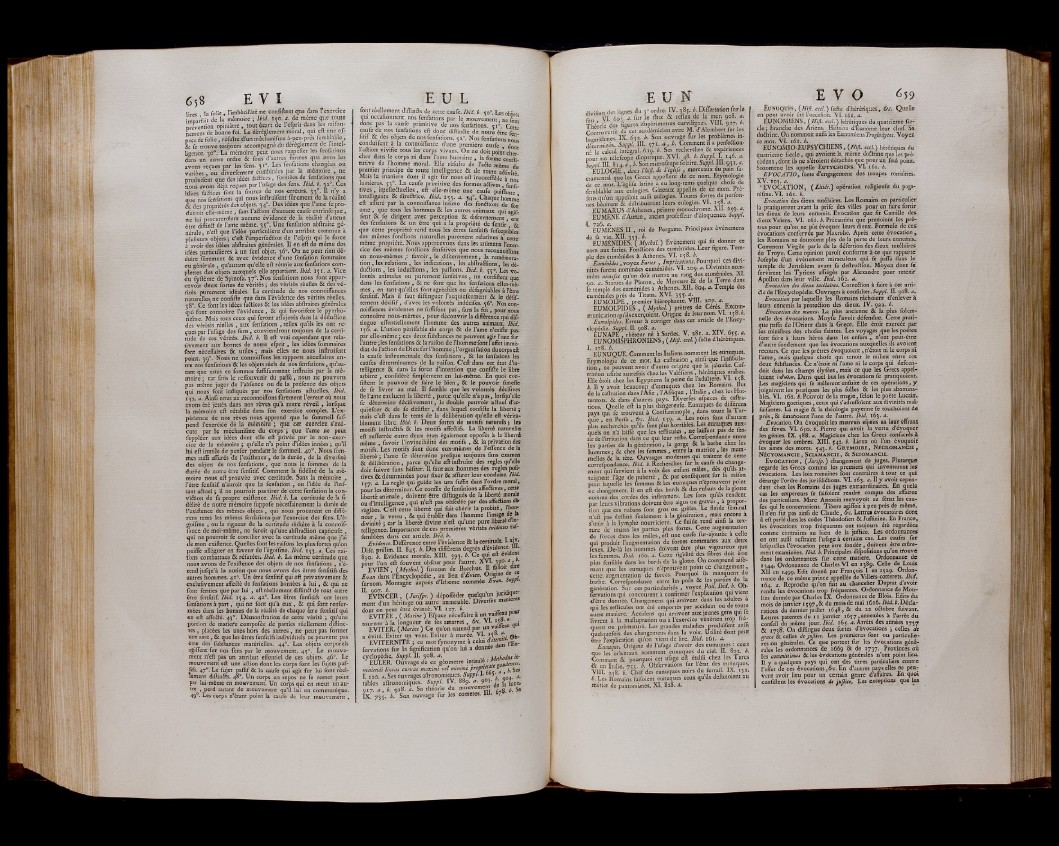
658 E V I
)a folie, l'imbécillité ne confiftent que dans l’exercice
îmnarfàit de la mémoire ; Ibid. ïj'c f a. de même que toute
urirention opiniâtre , tout écart de l’efprit dans les raifon-
nemens de bonne foi. Le dérèglement moral, qui eft une ef-
pecede folie, réfulte d’un mêchanifme â-pett-pres femblable,
& fe trouvé tmljours accompagné du dérèglement de 1 mtel-
lieence. 30°. La mémoire peut nous rappeller les fenfations
dans un autre ordre & fous d’autres formes que nous les
avons reçues par les fons. 3 i°. Les fenfations changées ou
variées, ou aiverfement combinées par la mémoire , ne
produifent que dés idées ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ | , formées de fenfations que
nous avons déjà reçues par l’ufage des fens. lb,d. b. 32«. Ces
idées faiKces font la fource de nos erreurs. 33 II n y a
que nos fenfations qui nous inftruifent lurement de la réalité
8c des propriétés des objets. 340. Des idées que.l’ame fe pro-
duiroit elle-même, fans l’aétion d’aucune caufe extrinfeque,
ne lui procureraient aucune évidence de la réalité d’aucun
être diitinft de l’ame même. 350. Une fenfation abftraite générale
, n’eft que l’idée particulière d’un attribut commun à
plufieurs objets ; c’eft l’imperfeétion de l’efprit qui le force
à avoir des idées abftraites générales. Il en eft de même des
idées particulières à un feul objet, 3 6°. On ne peut rien déduire
iurement & avec évidence d’une fenfation fommaire
ou générale, qu’autant qu’elle eft réunie aux fenfations com-
plettes des objets auxquels elle appartient, Ibid. 151. a. Vice
du fyftême de Spinofa. 370. Nos fenfations nous font apper-
cevoir deux fortes de vérités ; des vérités réelles & des vérités
purement idéales. La certitude de nos connoiflances
naturelles, ne confifte que dans l’évidence dés vérités réelles,
g jg Ce font les idées faftices 8c les idées abftraites générales
qui font connoître l’évidence, 8c qui favorifent le pyrrho-
nifme. Mais tous ceux qui feront affujettis dans la déduction
des vérités réelles , aux fenfations , telles qu’ils les ont reçues
par l’ufage des fens, conviendront toujours de la certitude
de ces vérités. Ibid. b. Il eft vrai cependant que relativement
aux bornes de notre efprit, les idées fommaires
font néceffaires & utiles ; mais elles ne nous inftruifent
point. 390. Nous ne connoiflbns les rapports néceffaires entre
nos fenfations & les objets réels de nos fenfations, qu’autant
que ndus en fommes fuffifamment inftruits par la mémoire
; car fans le reffouvenir du paffé, nous ne pouvons
pas même juger de l’abfence ou de la préfence des objets
qui nous font indiqués par nos fenfations aftuelles. Ibid.
x 52. a. Ainfî nous ne reconnoiffons lurement l’erreur où nous
avons été jettés dans nos rêves qu’à notre réveil , lorfque
la mémoire eft rétablie dans fon exercice complet. L’expérience
de nos rêves nous apprend que le fommeil fuf-
pend l’exercice de la mémoire ; que cet exercice s’exécute
par le mêchanifme du corps'; que l’ame ne peut
ftippléer aux idées dont elle eft privée par le non-exercice
de la mémoire ; qu’elle n’a point d’idées innées ; qu’il
lui eft inutile de penfer pendant le fommeil. 40°. Nousfom-
mes aufli affurés de l’exiftence, de la durée, de la diveriité
des objets de nos fenfations, que nous le fommes de la
durée de notre être fenfitif. Comment la fidélité de la mémoire
nous eft prouvée avec certitude. Sans la mémoire ,
l’être fenfitif n’auroit que la fenfation , ou l’idée de l’inf-
tant aftuel ; il ne pourroit pas tirer de cette fenfation la conviction
de fa propre exiftence. Ibid. b. La certitude de la fidélité
de notre mémoire fuppofe néceffairement la durée de
l’exiftence des mêmes objets , qui nous procurent en diffe-
rens tems les mêmes fenlations par l’exercice des fens. L’é-
goïfme , ou la rigueur de la certitude réduite à la connoif-
fonce de moi-même, ne feroit qu’une abftraâion captieufc ,
qui ne pourroit fe concilier avec la certitude même que j’ai
de mon exiftence. Quelles font les raifons les plus fortes qu’on
puiffe alléguer en faveur de l’égoïfme. Ibid. 153. a. Ces rai-
lons combattues & réfutées. Ibid. b. La même certitude que
nous avons de l’exiftence des objets de nos fenfations , s’étend
jufqu’à la notion que nous avons des êtres fenfitifs des
autres hommes. 41°. Un être fenfitif qui eft privativement 8c
exclufivement affe&é de fenfations bornées a lu i, & qui ne
font fenties que par lui , eft réellement diftinét de tout autre
être fenfitif. Ibid. 154. a. 42°. Les êtres fenfitifs ont leurs
fenfations à part, qui ne font qu’à eux, & qui font renfermées
dans les bornes de la réalité de chaque être fenfitif qui
en eft affeâé. 43°. Démonstration de cette vérité ; qu’une
portion de matiefe compofée de parties réellement dlftinc-
tes, placées les unes hors des autres, ne peut pas former
une ame, 8c que les êtres fenfitifs individuels 11e peuvent pas
être des fubitances matérielles. 44°. Les objets corporels
agiffent fur nos fens par le mouvement. 450. Le mouvement
n’eft pas un attribut effentiel de ces objets. 46°. Le
mouvement eft une aCtion dont les corps font les fujets paf-
fifs. 470. Le fujet paflif 8c la caufe qui agit fur lui font réellement
diftinCts. 40°. Un corps en repos ne fe remet point
par lui-même en mouvement. Un corps qui en meut un autre^
, perd- autant de mouvement qu’il lui en communique.
49°. Les corps n’étant point la caufe de leur mouvement,
conduifent à la connoiflancc d'une première caufe donr
l’action vivifie tous les corps vivans. On ne doit point cher
cher dans le corps ni dans l’ame humaine , la forme confti"
tutive de l’homme moral. Elle réfulte de l’afte même dû
premier principe de toute intelligence & de toute aâivité
Mais la maniéré dont il agit fur nous eft inaccefiible à nos
lumières. 33°. La caufe primitive des formes aétives, fenil-
tives, intellectuelles, eft elle-même une caufe puiffante *
intelligente & dit-eSrice. Ibid. t S5. a. 14”. Chaque homme
eft allure par la connoiffance intime des fondions de fon
ame , que tous les hommes 8c les autres animaux qui aeif-
fent 8c fe dirigent avec perception 8c difeemement, ont
des fenfations oc un être qui a la propriété de fentir &
que cette propriété rend tous les êtres fenfitifs fufceptibles
des mêmes fondions naturelles purement relatives à cette
même propriété. Nous appercevons dans les animaux l’exercice
des mêmes fondions fenfitives que nous reconnoiffons
en nous-mêmesfavoir, le .difeernement, la remémoration
, les relations , les indications, les abftradions, les dé-
dudions, les indudions, les paffions. Ibid. b. 530. Les volontés
animales ou purement fenfitives , ne confiftent que
dans les fenfations , 8c ne font que les fenfations elles-mêmes
, en tant qu’elles font agréables ou défagréables à l’être
fenfitif. Mais il faut diftinguer l’acquicfcement 8c le défif-
tement décifif, d’avec les volontés indécifes. 56°. Nos connoiffances
évidentes ne fufRfent pas, fans la foi , pour nous
connoitre nous-mêmes, pour découvrir la différence qui dif-
tingue effentiellement l’homme des autres animaux. Ibid.
156. a. L’union périffoble du corps 8c de l’ame n’exifte pas
far elle-même : ces deux fubftances ne peuvent agir l’une fur
autre ; les fenfations 8c la raifon de l’homme font f effet immédiat
de l’adion de Dieu fur l’homme ; l’organifation du corps eft
la caufe inftrumcntale des fenfations , 8c les fenfations les
caufes déterminantes de la raifon. C ’eft dans cet état d’intelligence
8c dans la force d’intention que confifte le libre
arbitre , confidéré Amplement en lui-même. En quoi confiftent
le pouvoir tie foire le bien, 8c le pouvoir funefte
de fe livrer au mal. 11 femble que les volontés décifives
de l’ame excluent la liberté , parce qu’elle n’a pas, Iorfqu’elle
fe détermine décifivement, le double pouvoir aftuel d’ac-
quiefeer 8c de fe défifter, dans lequel confifte la liberté ;
mais c’eft dans le tems de la délibération qu’elle eft véritablement
libre. Ibid. b. Deux fortes de motifs naturels ; les
motifs inftru&ifs 8c les motifs affectifs. La liberté naturelle
eft refferrée entre deux états également oppofés à la liberté
même , favoir l’invincibilité des motifs , & la privation des
motifs. Les motifs font donc eux-mêmes de l’effence de la
liberté ; l’ame fe détermine prefque toujours fons examen
8c délibération, parce qu’elle eft inftruite des réglés qu’elle
doit fuivre fans héfiter. Il faut aux hommes des réglés pofi-
tives 8c déterminées pour fixer 8c affurer leur conduite. Ibid.
ïey. a. La réglé qui guide les uns fuffit dans l’ordre moral,
pour les déterminer. Ce conflit de fenfations affeftives, cette
liberté animale, doivent être distingués de la liberté morale
ou d’intelligence, qui n’eft pas obfedée par des affeâions ab
réglées. C’eft cette liberté qui fait chérir la probité, l’honneur,
la vertu , 8c qui établit dans l’homme l’image de »
divinité ; car la liberté divine n’eft qu’une pure liberté d intelligence.
Importance de ces premières vérités évidentes rai-
fcmDlées dans cet article. Ibid. b. . .
Evidence. Différence entre l’évidence 8c la certitude. 1. xj v*
Difc. prélim. II. 845. b. Des différens degrés
890. b. Evidence morale. XIII. 392. b. Ce qui eft év
pour l’un eft fouvent obfcur pour l’autre. XVI. 390-a , -
EVIEN, ( Mythol. ) furnom de Bacchus. Il falloir dire
Evan dans l’Encyclopédie , au lieu d'Evien. Origine e
furnom. Montagne auprès d’Ithome nommée Evan. o pp •
U'ÉVINCER , (Jurifpr. ) dépoffétler quelqu’un
ment d’un héritage ou autre immeuble. Diverfes man
dont on peut être évincé. VI. n y. b. , D01ir
ÉVITÉE, ( Marine ) Efpace néceffaire à u n vaifleau p
tourner à la longueur de les amarres , «■£. V I t!»-«- .
EVITER. (Marine ) Ce qu’on entend par un vailleau t
a évité. Eviter un vent. Eviter â marée. VI. »«f; a-
EVITERN1TÉ ; ce mot fynonyme à celui “ " '.“ " pEn-
fervatipns fur la fignification qu’on lui a donnée o**1
cyclopêdle. Suppl.ll. 908. a. u • Mcthodiu tu*
EULER. Ouvrage de ce géomètre intitulé.■ m
venundï lintas curvas maximi vtl minïmi propritr 6
I. n o . u. Sesouvragesaftronomiques. Supp/.l.oei- »
bles allronomiqucs. Suppl. IV. 88p. u. 9° 3* ' ? jdnêt
> o * C_ .LA/r.'.n tables — P U rIi t! moI uvement rUiCe ia «*••_—
917. a , b . 918. a Sa théorie du mouvement ne ^ ^
IX. 735. b. Son ouvrage fur les cometes. lu . 7.
E U N E V O 659
divlfion des lignes du 3' ordre, S Æ D'ifertatlon Air ié
feu VI. 603. ... fur le flux & reflux de la mer. 908. a.
Thénriè des figures ifopérimetres curvilignes. VIII. 927, b.
Controvc'rfe de cet académicien avec M. d’AIembert fur les
iogaritlimes. IX. 63 i .b . Son ouvrage fur les problème im
déterminés Suppl. (IL I I f | Comment .1 a perfeèbon.
nA le calcul intégral. 619. b. Ses reçherchea & expériences
pour un télefcope dioptrique. XVI. 48. b. Suppl. I. 146. a.
Suppl III. 8 i 4. g , b. Son microfcope Polaire. Suppl. 111.931. a.
EULOGIE , dans thijl. d, l'igtifi , morceaux du pam fa-
cramentai que les Grecs appellent de ce nom. Etymologie
de ce mou.L’èglife latine a eu long-tems quelque choie de
femblable aux euloglcs. Gâteaux appellés de ce nom. Pré-
fens qu’on appelloit aufli eulogles. Toutes fortes deperfon-
nes bénirent &. dlflribuerent leurs eulogies. VI. 138. a
EUMARUS d’Athcncs»peintre monochrome. XII. 239.a.
EUMENE d’Autun, ancien profeffeur d’éloquence; Suppl.
\. 726. a. •- _ . . , .
EUMENES II , roi de Pergame. Principaux evenemens
de fa vie. XII.353. b.
EUMÉNIDES. ( Mythol. ) Evénement qui fit donner ce
nom aux furies. Fonôions des euménides. Leur figure. Temple
des euménides à Athènes. VI. 158. b.
Euménides, voyez Furies , Imprécations. Pourquoi ces divinités
furent nommées euménides. VI. 209. a. Divinités nommées
némefes qu’on doit mettre au rang des euménides. Al.
00. a. Statues de Pluton, de Mercure & de la Terre dans
ie temple des euménides à Athènes. XII. 804. a. Temple des
euménides près de Titana. XVI. 353. a.
EUMOLPE .premier hiérophante. VIII. 207. a.
EUMOLPIDES , ( Mythol.) prêtres de Céres. Excommunication
qu’ils exerçoient. Origine de leur nom. VI. 158.0.
Eumolpides, Erreur à corriger dans cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. II. 908. a. ^
EUNAPE , rhéteur né à Sardes. V. 281. a. XIV. 655. a.
EUNOMISPHRONIENS, ( Hijl. eccl. ) feéte d’hérétiques.
1. 178. b.
EUNUQUE. Comment les Italiens nomment les eunuques.
Etymologie de ce mot. La caftration , ainfi que l’mfibula-
tion, ne peuvent avoir d’autre origine que la jaloufie. Caftration
ufitée autrefois chez les Valefiens, hérétiques arabes.
Elle ¿toit chez les Egyptiens la peine de l’adultere. VI. 158.
b. U y avoit beaucoup d’eunuques chez les Romains. But
de la caftration dans l’Afie » l’Afrique , l’Italie, chez les Hot-
tentots. 8c dans d’autres pays. Diverfes efpeces de caltra-
tions. Quelle eft la plus dangereufe. Eunuques de difterens
pays qui fe trouvent à Conftantinople , dans toute la I ur-
quie, en Perfe, &c. Ibid. 159. a. Les noirs font dautant
plus recherchés qu’ils font plus horribles. Les eunuques auxquels
on n’a laiffé que les tefticules , ne laiffent pas de fentir
de l’irritation dans ce qui leur refte. Correfpondarice entre
les parties de la génération, la gorge 8c la barbe chez les
hommes ; 8c chez les femmes, entre la matrice, les mam-
anelles 8c la tête. Ouvrages modernes qui traitent de cette
correfpondance. Ibid. ¿.Recherches fur la caufe du changement
qui furvient à la voix des enfans mâles, dés quils atteignent
l’âge de puberté , 8c par conféquent fur la raifon
pour laquelle les femmes 8c les eunuques n’éprouvent point
ce changement. U en eft des bords 81 des rubans de la glotte
comme des cordes des inftrumens. Les fons qu ils rendent
par leurs vibrations doivent être aigus ou graves , à Proportion
que ces rubans font gros ou grêles. Le fluide fémmal
n’eft pas deftiné feulement à la génération, mais encore à
s’unir à la lymphe nourricière. Ce fluide rend ainfi la texture
de toutes les parties plus fortes. Cette augmentation
de forces dans les mâles,eft une caufe fur-ajoutée à celle
qui produit l’augmentation de forces communes aux deux
fexes. Dc-là les hommes doivent être plus vigoureux que
les femmes. Ibid. 160. £ Cette rigidité des fibres doit être
plus fcnfible dans les bords de la glotte. On comprend ailé-
ment que les eunuques n’éprouvent point ce changement,
cette augmentation de forces. Pourquoi ils manquent de
barbe. Correfpondance entre lés poils 8c jfs.Pa/Vj5,
génération. Sur ces particularités , voyez, Pou. Ibid. b. Ub-
fervations qui concourent à confirmer l’explication qui vient
d’être donnée. Changemens qui arrivent dans les adultes à
qui les tefticules ont été emportés par accident ou de toute
autre maniéré. Accidens qui arrivent aux jeunes gens qm fe
livrent à la maftupration ou à l’exercice vénérien trop fréquent
ou prématuré. Les grandes maladies produifent aufli
quelquefois des changemens dans la voix. Utilité dont peut
être {’explication qu’on vient de lire. Ibid. 161. a.
Eunuque. Origine de l’ufage d’avoir des eunuques : ceux
que les orientaux nomment eunuques du ciel. II. 802. b.
Comment 8c pourquoi cet ufage eft établi chez les Turcs
& en Italie. 755. b. Obfervations fur l état des eunuques.
VIII. 258. ¿. Chef des eunuques noirs du ferrail. IX. 131.
b. Les Romains fajfoient eunuaues ceux qu’ils deftinoicnt au
métier de pantomimes. XI. 8zo. a.
Eunuques, (Hifi. eccl.) feile d’hérétiqueS, &C. Quelle
en peut avoir été l’occafioh. VI. 161. a.
EUNOMIENS, ( Hifti ècçlS hérétiques du quatriemê ficelé;
branche des Ariens. Hiftoirc d’Éunome leur chef. Sa
doélrine. Oii nommoit aufli les Eünomiens Troglodytes. Voyez
ce mot. Vl. 16 i. b.
EUNOMIO-EUPSYCHIENS, (Hijl. eccl.) hérétiques du
quatrième fiecle, qui avoient la même doârine que les pré-'
çédens, dont ils ne s’étoient détachés que pour un feul poinf.
Sozomene les appelle Eutychiens. VI. 161. b.
EVOCÀTIO, forte d’engagement des troupes romaines.
XV. 103. a •
‘ EVOCATION, (Liitér.) opération religieufe du paga-
nifme.VI. 161. b. #
Evocation des dieux tutélaires. Les Romains en particulier
la pratiquèrent avant la prife des villes pour en faire fortir
les dieux de leurs ennemis. Evocation que fit Camille des
dieuxVeïens. VI. i6i. b.Précaution que pfenoient.ies prêtres
pour qu’on ne pût évoquer leurs dieux. Formule de ces
évocations confervee par Macrôbe. Après cette évocation,
les Romains ne doutoient plus de la perte de leurs ennemis.
Comment Virgile/ parle de la défertion des dieux tutélaires
de Troye; Cette opinion paroît conforme à ce que rapporte
Jofephe d’uii événement miraculeux qui fe paffa dans le
temple de Jerufalem avant fa deftruftion. Moyen dont fe
fervirent les Tyriens affiégés par Alexandre pour retenir
Apollon dans leur ville. Ibid. 102. a.
Evocation des dieux tutélaires. Correôion à foire à cet article
de l’Encyclopédie. Ouvrages à confulter. Suppl. II. 008. a.
Evocation par laquelle les Romains tâchoient d’enlever à
leurs erinemis la protection des dieux. IV. 92a. b.
Evocation des mancsi La plus ancienne 8c la plus folem-
nelle des évocations. Moyfe l’avoit défendue. Cette pratique
paffa de l’Orient dans la Grecê. Elle étoit exercée par
les miniftres des chofes faintes. Les voyages que les poètes
font faire à leurs héros dans les enfers , h ont peut-être
d’autre fondement que les évocations auxquelles ils avôient
recours. Ce que les prêtres évoquoient, n’étoit ni le corps ni
l’ame, mais quelque chofe qui tenoit le milieu entre ces
deux fiibftances. Ce n’étoit ni l’ame ni le corps qui defeen-
doit dans les champs élyfées, mais ce que les Grecs appel-
loient e/JWor. Dans quel but les évocations fe pratiquoient.
Les magicieiis qui fe mêlèrent enfuite de ces opérations , y
joignirent les pratiques les plus folles 8c les plus abominables.
VI. 162. b. Pouvoir de la magie, félon le poëte Lucain.
Magiciens goetiques, ceux qui s’aareffoient aux divinités mal-
foifontes. La magie 8c la théologie payerine fe touchoient de
prés, 8c émanoient l’une de l’autre. Ibid. 163. a.
Evocation. On èvoquoit les mauvais efprits en leur offrant
des feves. VI. 650. b. Pierre qui avoit la vertu d’évoquer
les génies. IX. 588. a. Magiciens chez les Grecs confacrés à
évoquer les ombres. XIIL 342. b. Lieux où l’on évoquoit
les âmes des morts. 543. b. Gr ym o ir e , Nécroman cie ,
NÉCYOMANCIE , SCIAMANCIE , 8c SCIOMANCIE.
Ev o c a t io n , ( Jurifp.) changement de juges. Plutarque
regarde les Grecs comme les premiers qui inventèrent les
évocations. Les loix romaines font contraires à tout ce qui
dérange l’ordre des jurifdiétions. VL 163. a. Il y avoit cependant
chez les Romains des juges extraordinaires. En quels
cas les empereurs fe foifoient rendre compte des affaires
des particuliers. Marc Antonin renvoyoit au iênat les caufes
qui le concernoient. Tibere agiffoit à peu près de même.
Il n’en fut pas ainfi de Claude, 6-c. Lettres évocatoires dont
il eft parlé dans les codes Théodofien 8c Juftimen. En France,
les évocations trop fréquentes ont toujours été regardées
comme contraires au bien de la juftice. Les ordonnances
en ont aufli reftraint l'ufage à certains cas. Les caufes fur
lefquellcs l'évocation peut être fondée, doivent être mûrement
examinées. Ibid. b. Principales difpofîtions qu’on trouve
dans les ordonnances fur cette matière. Ordonnance de
1344. Ordonnance de Charles VI en 1389. Celle de Louis
XII en 1499. Edit donné par François I en 1329. Ordonnance
de ce même prince appellée de Villers-cotterets. Ibid.
164. a. Reproche qu’on foit au chancelier Duprat d’avoir
rendu les évocations trop fréquentes. Ordonnance de Moulins
donnée par Charles IX. Ordonnance de Blois. Edit9 du
mois de janvier 1597,8c du mois de mai 1616. Ibid. b. Déclarations
du dernier juillet 1648,8c du 22 o&obre fuivant.
Lettres patentes du 11 janvier 1657,annexées à l’arrêt du
confeil du même jour. Ibid. 165. a. Arrêts des années 1737
8c 1738. On diftingue deux fortes d’évocations ; celles de
grâce oc celles de jujl'ice. Les premières font ou particulières
ou générales. Ce que portent fur les évocations générales
les ordonnances de 1669 8c de 1737. Provinces où
les commiuimus 8c les -évocations générales n’ont point lieu.
Il y a quelques pays qui ont des titres particuliers contre
l’effet de.ces évocations,6*c. En d’autres pays elles ne peuvent
avoir lieu pour un certain genre d’affaires. En quoi
confiftent les évocations de jujlice. Les exceptions que les