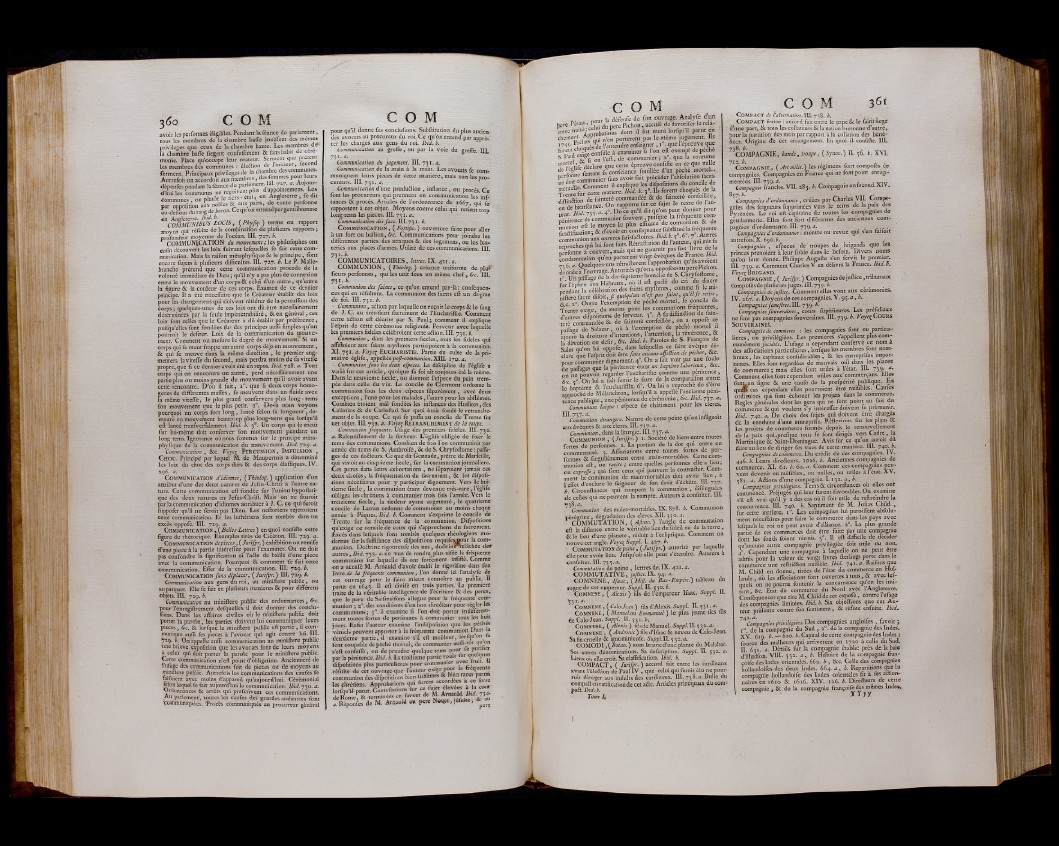
3 6o COM „voir lesperfonncs étigtbles.Pendant lafêance du parlement,'
tous les membres de la chambre baffe jouiffent des mêmes
privileges que ceux de la chambre haute. Les membres- des
la chambre baffe fiegent confufémcnt & fans habit de cérémonie.
Place qu’occupe leur orateur. Serment que preterit
les membres des communes : élection de 1
ferment. Principaux privileges de la chambre d •
Autrefois on accordoit aux membres, des Sommes £
dépenfes uendant la féance du pariement. - 7 7- - ^
d’„pui les
communes. ou plutôt ie tier» » » r
par oppofition aix nobles & g g P a,re> fe ,ou,e É É ® Î
L d e iL s du rang de baron. Ce qu on entendpar gentilhomme
en Angleterre. ieid. A - ■ - je
COMMUNIBUS LOCIS, ( Phyfiq. ) terme ou rapport
moyen qui réfulce de la combmaifon de plufieurs rapports;
profondeur moyenne de l’océan. III. 727. b.
COMMUNICATION du mouvement ; les philolophes ont
enfin découvert les loix fuivant lefquelles fe fait cette communication.
Mais la raifon métaphyfique & le principe, font
encore fujets à plufieurs difficultés. III. 727. b. Le P. Malle-
branche prétend que cette communication procédé de la
volonté immédiate de Dieu ; qu’il n’y a pas plus de connexion
entre le mouvement d’un corps-& celui d’un autre, qu’entre
la figure & la couleur de ces corps. Examen de ce dernier
principe. Il a été néceffaire que le Créateur établît des loix
pour les changemens qui doivent réfulter de la pereuflion des
corps ; quelques-unes de ces loix ont dû être néceffairement
déterminées par la feule impénétrabilité ; & en général, ces
loix font celles que le Créateur a dû établir par préférence,
puifqu’elles font fondées fur des principes aufli fimples qu’on
ponrroit le defirer. Loix de la communication du mouvement.
Comment on mefure le degré de mouvement. Si un
corps qui fe meut frappe un autre corps déjà en mouvement,
& qui fe meuve dans la même direction, le premier augmentera
lavîteffe du fécond, mais perdra moins de fa vîtelle
propre, que fi ce dernier avoit été en repos. lbid. 728. a. Tout
corps qui en rencontre un autre, perd néceffairement une
parue plus ou moins grande du mouvement qu’il avoit avant
cette rencontre. D’ou il fuit, i°. que fi deuxeoros homogènes
de différentes maffes , fe meuvent dans un fluide avec
la même vîteffe, le plus grand confervera plus long-tems
fon mouvement que le plus petit. 20. De-là nous voyons
pourquoi un corps fort long, lancé félon fa longueur, demeure
en mouvement beaucoup plus long-tems que lorfqu’il
eft lancé tranfverfalement. ibid. b. 3°. Un corps qui fe meut
fur lui-même doit conferver fon mouvement pendant un
long tems. Ignorance où nous fommes fur le principe méta-
phyfique de la communication du mouvement. Ibid. 729. a.
Communication , & c. Voye^ PERCUSSION, IMPULSION ,
C h o c . Principe par lequel M. de Maupertuis a déterminé
les loix du choc dès coipsdursflc des corps élaftiques. IV.
296. à.
Communication d'idiomes, ( Théolog.) application d’un
attribut d’une des deux natures de Jcfus-Chriftà l’autre nature.
Cette communication eft fondée fur l’union hypoftati-
que des deux natures en Jefus-Chrift. Mais on ne fauroit
par la communication d’idiomes attribuer à J. C. ce qui feroit
fuppofer qu’il ne feroit pas Dieu. Les neftoriens rejettoient
cette communication. Et les luthériens font tombés dans un
excès oppofé. 111. 729. a. . • -
C ommunication , ( Belles-Lettres ) en quoi confifte cette
figure de rhétorique. Exemples tirés de Cicéron. III. ’719. a.
Commu n ic a tion de pieces, ( Jurifpr. ) exhibition ou remife
d’une piece à la partie intéreffée pour l’examiner. On ne doit
pas confondre la lignification ni l’afte de baHlé d'üne piece
avec la communication. Pourquoi & comment fe fait cette
communication*. Effet de la communication. III. 729.b.
Commu n ic a tion fans déplacer, ( Jurifpr.) III. 729. b.
Communication aux gens du roi, au miniftere public, ou
au parquet. Elle fe fait en plufieurs maniérés & pour différens
objets. HI. 729. b.
Communication au miniftere public des ordonnances, &c.
pour l’enregiftrement defquellés il doit donner des conclurions.
Dans les affaires civiles t>ù le miniftere public doit
porter la parole, les parties doivent lui communiquer leurs
pieces S &c. & lorfquc le miniftere public’ eft partie ; il communique
aufli fes pieces à Tavocar qui agit contre lui. III.
729. b. Oii’àppelÎe aufli communication au miniftere public
une brieve expofirion que les avocats font de leurs moyens
à celui qui doit porter la parole i pour le miniftere public.
Cette communication n’eft point d’obligation. Ancienneté de
l ^dùgc des communications foit de pieces ou de moyens au
miniftere public. Autrefois les communications des caiifes fe
faifoient avec moins d’appareil qu’aujourd’hui. Cérémonial
«Ion lequel fe fait aujourd hui la communication. Ibid. 730. a.
^Ordonnances & arrêts qui preferivent ces communications.
Au parlement’, toutes les caufes des grandes audiences font
'communiquées. "Procès communiqués au procureur général
C O M
pour qu’il donne fes concluflons. Subftitution du plus ancien-
des avocats au procureur du roi. Ce qu’on entend par apprêter
les charges aux gens du roi. lbid. b.
Communication au greffe, ou par la voie du greffe. HT.
ÉJ||Éj
Communication du jugement. III. 731 .a.
Communication de la main à la main. Les avocats fe corn--
muniquent leurs pièces de cette maniéré, mais non les procureurs.
III. 731. a.
. Communication d’une production , inftance , ou procès. Ce
font les procureurs qui prennent en communication les inf-
tances 8c procès. Articles de l’ordonnance de 1667, qui fe
rapportent à cet objet.. Moyens contre celui qui retient trop,
long-tems les pièces. III. 731. a.
Communication des facs. III. 731. b.
C o m m u n i c a t i o n , ( Fortifie. ) ouverture faite pour aller
à un fort ou baition, &c. Communications pour joindre les
différentes parties des attaques & des logemens, ou les batteries
aux places d’armes. Utilité de ces communications. III.
73COMMUNICATOmES, lettres. IX. 421. a.
COMMUNION , ( Théolog. ) créance uniforme de plu^
fieurs perfonnes, qui les unit fous un même chef, &c. III.
7 31. b.
Communion des faints y ce qu’on entend par-là: conféquen-
ces qui en réfultent. La communion des faints eft un dogme
de foi. 111.731. b.
■ Communion, aétion par laquelle on reçoit le corps & le fang
de J. C. au très-faint facrement de l’Euchariftie. Comment
cette àâion eft décrite par S. Paul; comment il explique
l’efprit de cette cérémonie religieufe. Ferveur avec laquelle
les premiers fideles célébraient cette aétion. III. 731 .b. '
Communion y dans les premiers fiecles, tous les fideles qui
affiftoient aux faints myfteres participoient à la communion:
XI. 751 .a. Voye[ E u c h a r i s t i e . Partie du. culte de la primitive
églife, appellce pojl-communion. XIII. 170. a.
Communion fous les deux efpeces. La difeipline de Téglife a
varié fur cet article, quoique fa foi ait toujours été la même.
Dans le neuvième fiecle, ou donnoit l’efpece du pain trempée
dans celle du vin. Le concile de Clermont ordonne la
communion fous les deux -efpeces féparém'ent, avec deux
exceptions, l’une pour les malades, l’autre pour les abftêmes;
Combien étoient mal fondées les inftances des Huflites, des
Calixtins & de Carloftad. Sur quoi étoit foridé-le retranchement
delà coupe. Ce qui fe paffa au concile de Trente fur
cet objet. III. 73 a. a. Voyc^ R e t r a n c h e m e n t de la coupe. •
Communion fréquente. Ufage des premiers fideles. Ilf. 732.
a. Ralentiffement de la ferveur. L’églife obligée de fixer le
tems des communions. Combien de fois l'on communioit par
année du tems de S. Ainbroifé, & de S. Chryfoftome : pairages
de ces doâeurs. Ce que dit Gennade, prêtre de Marieille, 2ai vivoit au cinquième fiecle, fur la communion journalière,
les peres dans leurs exhortations, ne réparaient jamais ces
deux chofes, la fréquentation du facrement, & les difpofi-
tions néceffaires pour y participer dignement. Vers le huitième
fiecle, la communion étant devenue très-rare, l’églife
obligea les chrétiens à communier trois fois l’année. Vers le
treizième fiecle, la tiedeur ayant augmenté, le quatrième-
concile de Latran ordonna de communier au moins chaque
année à Pâques. Ibid. b. Comment s’exprime le concite de
Trente fur la fréquence de la communion. Difpofitions
Ï u’exige ce concile de ceux qui s’approchent du facrement.
xcès dans lefquels font tombés quelques théologiens modernes
fur la fuffifance des difpofitions requife&»our la communion.
Doftrine rigoureufe des uns, doélrinWrelâchée des*
autres ,Jbid. 733. a. en vue de rendre plus aifée la fréquente
communion fur laquelle iis ont fortement infifté. Comme
on a accufé M. Arnauld d’avoir établi' le rigorifme dans fon
livre .de la fréquente- communion, l’on tionne ici l’analyfe de
cet ouvrage pour le faire mieux connoître au public. H
parut en 1643. Il eft divifé en trois parties. La première
traite de la véritable intelligence de l’écriture 8c des peres,
que le pere de Saifmaifons allégué pour la fréquente communion
; 20. des conditions d’un bon directeur pour régler les
communions; 30. il examine fi l’on doit porter indifféremment
toutes fortes de perfonnes à communier tous les huit
jours. Enfin l’aUteur examine l’indifpofition que les péchés
véniels peuvent apporter à la fréquente communion. Dans la
-deuxième partie, il examine s’il eft meilleur, lorfqu’on^ie
fent coupable de péché mortel, de communier aufli-tot quprt
s’eft çonfeffé, ou de prendre quelque tems pour fe purifier
par la pénitence, lbid. b. Latroifieme partie foule fur quelques
difpdfitidhs plus particulières pour communier avec r
-réfÏÏie de cet ouvrage I I Tautcur exfgepour lafréquentè
communion
- le s îlft-étièns.-Approbations qui turcn it , y .--- -----
lorfqu’il^ parut.-¿ontuftations fur ce | | « «
de^ome, iSc-terminées on ftveur de M-Arnauld. IM. 71+
.Réponfes de M. ArnauW « pere Nouer, )HMn.|M
C O M COM 3 6 1
- , nour b défenfe de fon ouvrage. Anajyfe d’uti
uere Peiau, P d ETcíioñ, acciifé de favorifer le relâ-'
■ P v a n S dont il for muni lorfcju’il parut en
-chement. APP ,en . orterelM pas 16 même |ug6menr. Us
>745- l-entcndreenfeigner, 1“. quêl-épreuve que
f s f S confifte à «aminer 11 l’on eft eiempf de péché
s. Paul e»ge ^ ¿(¡ comraun;er ; 2”. que la coutume
r & f d é c l a r e que certe épreuve confifte en ce que nu le
de 1 S (entant fa confcience fouillee d un péché mortel...
pCf r c o m S e t fins avoir fait précéder l'ifoluûon faem-
Gomment il explique les difpofmons du concile de
jnentelie. ,„atiere. Ibid. b. 3°. Ils furent choqués de la
ÆffinKon de fainteté commandée & de fainreté confeillee;,
í f d e Wenféance. On rapporte fur ce fujet le reitte de lau-
h S vas a 4°. De ce qu’il dit qu'on peut domter pour
‘ s^ence de communier fouvent, puifque la fréquente com-
8 B B K le moyen le plus efficace de conyeífién & de
îhnaification; & d’avoir en conféquence fubftitué la fraduotte
communion aux oeuvresfatisfaftoires. lbid. b: 5 .6 . 7 - Autres
reproches qui lui fout faits. Rétraflation de l'auteur qutm.t fa
perfonne à couvert, mais qui ne garantit pas¡fe r fln g , * £
condamnation qu’en portèrent vingt évêques de France. Ibt .
7,6 a Quelques-uns rétraaerent l'approbation quikavoient
donnée a l’ouvrage. Autorités qu’on a oppoféMaupere Pichón.
1" Un pitffage de la dix-feptleme homélie de: S. Chryfoftome,
fur l’épure lux Hébreux, ou il eft parlé du en du thacre
pendam la célébration des faints myfteres, comme fi le mt-
mftere factè dlfolt.y? quelqu'un n eft pus fume, qu elfe relire,
&c 2°. Outre l’exemption de péché mortel, le concile de
Trente exi”e, du moins pour les communions fréquentes,
atures diipofitions de feiveur. 3". A fa dlfti„aiOn de fatn-
teté commandée & de fainteté confeillee, on a oppofê ce
paffitge de Salazar, où à l’exemption de péché mortel il
aioute la drolntre d’intentions, l’attention, la révérence, &
la dévotion ou défit, Sec. lbid. b Paroles de S. François de
Sales qu’on lui oppofe, dans lefquelles ce fimt évêque déclare
que l’efprit doit être jdru aucune affeihon de picher, Sic.
pour communier dignement. 4”. On a filt voir par une foule
de Dalfaees que 'la pénitence étant un bapteme laborieux, etc.
on ne pouvolt regarder l’eucharlftic çomme une pénitence,
On lui a fiit fentir le faux de la comparaifon entre
le -baptême & l'eucharlflîe. 6°. On lui a reproché de setre
approché de Mélanchton, lorfqu’il a appcüé 1 ancienne pénitence
publique, une pénitence de cérémonie, Sec. Ibid. 727. n.
Communion Inique : efpece de châtiment pour les clercs.
m 'cVJrnûnion dérangere. Nature de cette peine qu’on inffigeoit
aux té-vv ês-qnujuex-sj &vw —au x c--le--rc;-s-.- I-II . 7r3i /7-a-
Communion, dans la liturgie. III. 737’ a‘
Communion, ( Jurifpr.) § Société de biens entre toutes
fortes de perfonnes. 2. La portion de la dot qui entre en
communauté. 3. Affociations entre toutes fortes de perfonnes
& fingutiérement entre mam-mortables. Cette communion
eft, ou tacite; entre queües perfonnes elle a lieu;
ou exprejfe; qui font ceux qui peuvent la contracter. t-.om-
ntent la communion de main-mortables doit avoir lieu , a
l’effet d’exclure le feigneur de fon droit d’échûte. III. 727.
b. Circonftances qui rompent la communion , diftinguêes
de celles qui ne peuvent la rompre. Auteurs à confulter. 111.
Communion des maùis-mortables. IX. 878. b. Communioit
béréerine, dégradation des clercs. XII. 3 ço. a.
COMMUTATION, ( Aflron.) l’angle de commutation
eft la diftance entre le véritable heu du foleil ou de la terre,
& lè lieu d’une planete, réduit à l’écliptique. Comment on
trouve cet angle. Voye^Suppl. I. 427. b.
■ C o m m u t a t i o n de peine t {Jurifpr.) autorité par laquelle
elle peut avoir lieu. Jufqu’oùelle peut s’étendre. Auteurs a
conlulter. III. 73 5. a. __
Commutation de peine , lettres de. IX. 421.0.
COMMUTATTVE, juftice. IX. 94. a.
COMNENE, Ifaac, (flifli du Bas-Empire.) tableau du
É*egne de cet empereur. Suppl. II. 530: b.
G o m n e n e , ( Alexis ) fils de l’émpereur Ifaac. Suppl. II.
V3IC
o m n e n e , ( Calo-Jcan ) fils d’Alexis. Suppl. II. 531-a-
C o m n e n e j ( Manuel ou Emmanuel) le plus jeune des fils
de Calo-Jean. Suppl. II. 531. ^
C o m n e n e , ( Alexis ) nlsde Manuels Suppl.ll.
C o m n e n e , ( Andronic) fils d’Ifaac & neveu de Calo-Jean.
Sa fin cruelle'8c ignominieufe. Suppl.ll. 532. «.
COMODI y(Botan.) nom brame d’une plante du Malabat*.
Ses autres dénominations. Sa defeription. Suppl. 11. 532.
lieux où elle croît. Sa daffification. lbid. b.
COMPACT, ( Jurifpr. ) accord fait entre les cardinaux
avant l’èleftion de Paul lV , que celui qui feroit élu ne pour-
toit déroger aux induits des cardinaux. III. 738*. a. Bulle du
compaften ratification de cet afte. Articles principaux du com-
. baft. Ibid.- b.
COMPACT de t alternative. III. 738. b.
C o m p a c t breton : accord fait entre le pape éc le faint fiegé
d’une part, 8c tous les collatcurs 8cla nation bretonne'd’autre,
pour la partition des mois par rapport à .là collation des bénéfices.
Origine dé cet arrangement. En quoi il confifte. III.
738. b. . .
COMPAGNIE, bande, iroupe, ( Synon.) II. 36. é; XVI.
C o m p a g n i e , ( Artmilit.) les régimens font compofés de
compagnies. Compagnies en France qui ne font point enrégimentées.
III. 739- _ . a. j vt\t
Compagnie franche. VU. 283. b. Compagnie enfetond.XIV.
^Compagnies d’ordonnance, créées par Charles VIL Compagnies
des feigneurs fiipprimées vers le tems de la paix des
Pyrénées. Le roi eft capitaine de toutes les compagnies de
gendarmerie. Elles font fort différentes des anciennes com-
pagrtics d’ordonnance. III. 739. a. . . . •
Compagnies d’ordonnance -, mônti-ë ou revue qui s en failoit
autrefois. X. 690. b. >
Compagnies , eipeCes de troupes de . brigands que les
princes pienòient à leur folde dans le befoin. Divers noms
•qu’ôn leur donnei Philippe Augiifte s’en fenrit le premier.
III. 739. a. Comment Charles V en délivra la France« Ibid. v.
Voye{ B r i g a n d . . , . . .,
C o m p a g n i e , ( Jurifpr.) Compagnies de juihee, tribunaux
compofés de plufieurs juges, ili. 739. b. ‘ . ,
Compagnies de jufiiee.-Comment elles vont aux cérémonies*
IV. 267: «*. Doyens de ces compagnies. V. b.
Compagnies Jémefires. 111.739.*. ...
Compagnies fouveraines, cours fupéneures. Les préiidiaux
ne font pas compagnies fouveraines. III. 739. b- Voye^ C o u r s
S o u v e r a in e s . . ..
Compagnie de comnïcrce : les compagnies lont ou particulières
, Ou privilégiées. Les premières s’appellent plus communément
fociétés. L’ufage a cependant confervé ce nom à
des affociations particulières, lorfque les membres font nombreux
, les capitaux confidérablqs , & les entreprîtes importantes.
Elles font regardées de mauvais^ oeil dans les places
de commerce ; mais elles font utiles a l’état. III. 739. «t.
Comment elles font cependant utiles aux commerçons. Elles
fonuun figne & une caufe de la profpé'rite publique. En
quoi cas ccpéndant elles pourraient être nuifibles. Gaules
ordinaires qui font échouer les projets dans le commerce.
Réglés générales dont les gens qui ne font point au fait du
commerce & qui veulent s’y intéreffer doivent le prémunir.
Ibid- 740. à* Du choix des fujets'qui doivent être chargés
de la conduite d’une entreprife. Réflexions fur les plans &
les projets de commerce formés depuis le renouvellement
de la paix qui.prefque tous fe font dirigés vers Cadix, la
Martinique oc Saint-Domingue. Avis fur ce qu’on aurait du
faire au lieu de diriger fes vues de cette maniere. III. 74a. b.
Compagnies de commerce. Du crédit de des compagnies. IV*
446. b. Leurs directeurs. 1026. b. Anciennes compagnies de
commerce. XI. 61. | 62. a. Comment ces compagnies peuvent
devenir òli nuifibles, ou nulles, ou utiles à 1 état. XV.
ç8i. a. ACtions d’une compagnie. 1. 132. at b. ^ ■
Compagnies privilégiées. Tems 8c circonftances ou elles ont
Commencé. Préjugés qui leur furent favorables. On examine
s’il eft vrai qu^l y a des cas où il foit utile de reftreindre la
concurrence, ili. 740. b. Sentiment de M. Jofias Child ,
fur cette matière. i°. Les compagnies lui paroiffent abfolu-
’rtiènt néceffaires pour faire le commerce dans les pays avec
lefquels le roi ne peut avoir d’alliance. 20. La plus graudê
partie de ces commerces doit être faite par une compagnie
dont les fonds foient réunis. M II eft difficile de décider
qu’aùcurie autre cômpaghiè privilégiée foit utile ou non.
4°. Cependant une compagnie à laquelle on ne peut être
admis pour là valeur de vingt livres fterlings porte dans le
commerce une reftriétion nuifible. Ibid. 741. a. Raifons_que
M. Child en donné, tirées de l’état du commerce en Hollande,
où les affociations font ouvertes à tous, oc aveclel-
auels on ne pourra foutenir la concurrence qu en les imitant,
&c. Etat du commerce du Nord avec 1 Angleterre.
I Conféquènces que tiré M. Child de cet exposé, contre 1 ufage
des compagnies limitées. Ibid.b. Six objeraons que cet Auteur
préfente contre fon fentiment, oc réfute enfuite. lbid\
^^"compagnies privilégiées. Des compagnies angloifes , favoirj
1°. delà compagnie du Sud, 20. de la compagnie des Indes.
XV. 619- b. — 620. b. Capital de cette compagnie des Indes;
fourcé des malheurs qui arrivèrent en 1720 à celle du Sud.
II. 631. à. Détails fiir la compagnie établie près dè la baie
d’Hudfon. VIII. 332. a , b. Hiftoire de la compagnie fran-
çoife des Indes orientales. 662. b , &c. Celle des compagnies
hollandoifes dès deux Indes. 664. a , b. Répartitions que la
compagnie liollaiidoife des IndeS orientales fit à fes actionnaires
en 1610 & 1616. XIV. 126. b. Direâeurs de cette
5 . . 1 . 1 . c mAmiK lu n e s .