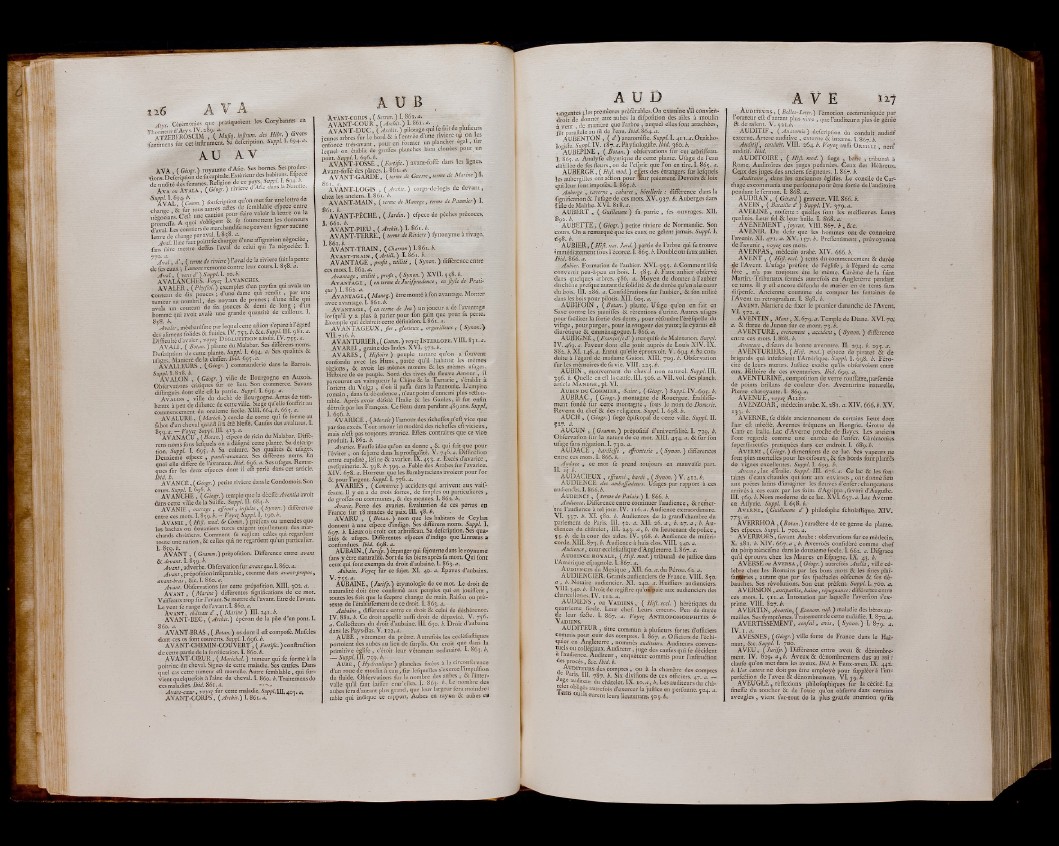
A V A Â Ü B
Aiys. Cérémonies que praùqnoient les Corybanfcs en
^'aTZEBErSÎsCIM M é i - mfinm. dis Hibr. ) Avers
ienrimcns fer cet inftniment. Sa defeription. Suppl. 1. 6.94- *
AU A V
S u p p lX ^ i^ m ) fo,|fcripii°n qu'on met fer une lettre de
AVAL., ( tous autres a&es de femblable efge.ee entre
change , caution aiégoei^is. C eft une^ca^o t pP&o u|r f aire valoir la^ le tdtroen noeuu rlas
S w ! ! Us courtiers de marchandife ne peuvent ligner aucune
' “ “ . Î i S a u t poînifectarewd’une affignation négociée
fans faire mettre deffus l'aval de celui qui la négociée: I.
77Aval y d'y ( terme de riviere) Y aval de la riviere fuit la pente
de fes eaux ; Y amont remonte contre leur cours. I. »58. a.
Avait (vent d ') Suppl.\. 1 0 . b.
AVALANCHES. Voycÿ L a v a n ch e s . .
AVALER , (Pfyjîel ) exemples d’un payfan qui avala un
couteau de dix pouces ; d’une dame qui rendit , par une
tumeur au nombril, des noyaux de prunes; dune fille qui
avala un couteau de fut pouces & demi de long ; dun
homme qui avoit avalé une grande quantité de cailloux. 1.
^Avaler, méchanifme par lequel cettelaffion, s’opèrek l’égard
des alimens folides & fluides. IV. 753. i. &c. Suppl-M. 981. «.
DilHctdtéd’avaler, voye^ DEGLUTITION jp iL jK i 75î. a.
AVALI, ( Botan.) plante du Malabar. Ses différens noms.
Defeription de cette plante. Suppl. I. 694. a. Ses qualités &
ufages. Maniéré delà claffer.iMd. 695.a. .
AVALLEURS, (Géogr.) commandenc dans le Danois.
Suppl. 1.818. b. .
AVALON , ( Géogr. ) ville de Bourgogne en Auxois.
Obfervations critiques fur ce lieu. Son commerce. Savans
diftingués dont elle eft la patrie. Suppl. 1. 695. a. '
A v a lo n , ville du duché de Bourgogne. Amas de tombeaux
à peu de diftance de cette ville. Siege qu’elle fouffrit au
commencement du onzième fiecle. XIII. ¿64. A 665. a.
AVALURE, (Maréck.) cercle de corne qui fe forme au
fabot d’un cheval quand il a été bleiTé. Caufes des avalüres. L
839.4. — Voye{ Suppl.lll. 4 1 3 . 4 . _ „ t
AVANACU , (Botan.) efpece de ricin du Malabar. Diffe-
rens noms fous lefquels on a défigné cette plante. Sa description.
Suppl. I. 695. A Sa culture. Ses qualités 8c ufages.
Deuxiemé efpece , pandi-avanacu. Ses différens noms. En
quoi elle différé de l’avanacu./M. 696. a. Ses ufages. Remarques
fur les deux eipèces dont il eft parlé dans cet article.
Ibid. b. _
AVANCÉ, ( Géogr.) petite riviere dans le Condomois. Son
cours.Suppl. 1 .696. b. .
AV ANCHE , | Géogr.) temple que la déefle Aventia avoit
dans cette ville de la Suiffe. Suppl. U. 684. b.
AVANIE | outrage , affront, infulte, (Synon. ) différence
entre ces mots. 1.859. b. — Voye£ Suppl. I. 190. b.
A v an ie , | Hifi. mod. 6* Comm. ) préfens ou amendes que
les baclias ou douaniers turcs exigent injuftement des marchands
chrétiens. Comment fe règlent celles qui regardent
toute une nation, 8c celles qui ne regardent qu’un particulier.
Ï.839.A S É f i
A vA N T , ( Gramm.) prépoütion. Différence entre avant
8c devant. 1.859. b.
Avant, adverbe. Obfervation fur avant que. 1.860. a.
Avant, prépofition inféparable, comme dans avant-propos,
avant-bras, 8cc. I. 860. a.
Avant. Obfervations fur cette prépofition. XIII. 30a. a. .
A v a n t , (Marine) différentes lignifications de ce mot.
Vaiffeaux trop fur l’avant. Se mettre de l’avant. Etre de l’avant.
Lèvent fe range de l’avant. 1. 860. a.
Avan t , château d’ , ( Marine ) III. 241. b.
AVANT-BEC, ( Archit.) épéron de la pile d’un pont. I.
860. a. Rfi
AVANT-BRAS, ( Botan.) os dont il eft compofé. Mufcles
•dont ces os font couverts. Suppl. 1.696. b.
AVANT-CHEMIN-COUVERT, ( Fortifie. ) conftruétion
de cette partie de la fortification. 1. 860. b.
AVANT-COEUR, ( Maréchal.") tumeur qui fe forme à la
poitrine du cheval. Signes de cette maladie. Ses caufes. Dans
quel cas cette tumeur eft mortelle. Autre femblable, qui fur-
vient quelquefois à l’aine du cheval. I. 860. ATraitemensdc
ces maladies./¿¿f. 861. a. | — -s>
Avant-caur, voyeç fur cette maladie. Suppl.UJ, 403. a.
AVANT-CORPS, ( Archit.) 1. 861 f.
A v a n t - c o rp s , ( Serrur. ) 1. 861. a-
AVANT-COUR , {Archit.) 1. 861. 4. . . -
AVANT-DUC, ( Archit. ) pilotage qui fe fait de plufieurs
ieunes arbres fur le bord Sc à l’entrée d’une riviere <y on les
enfonce très-avant, pour eu former un plancher égal, fur
lequel on, établit de groffes planches bien clouees pour un
P° A V a S t - F 09SSÉ , (Fortifie. ) avant-foffé dans les lignes.
Avant-foffé des places.}. 861. a. . . ,
AVANT-GARDE, ( terme de Guerre , terme de Marine ) U
861. a . ...............................................................................|
AVANT-LOGIS , ( Archit. ) corps-de-logis de devant ’
chez les anciens. 1 .861. b.
AVANT-MAIN, ( terme de Manege, terme de Paumter ) 1.
^AVANT-PÊCHE, ( Jardin. ) efpece de pêches précoces,
L 661. b.
AVANT-PIEU , ( Archit. ) I. 861. b. g S M
AVANT-TERRE, ( terme de Riviere ) fynonyme à rivage,
i. 861./>.
AVANT-TRAIN, ( Charron ) 1.86i. b.
A v an t -tr ain , (Artilh ) 1. 861. b. n t t
AVANTAGE , profit, utilité, ( Synon. ) différence entre
ces mots. I. 862. a. v
Avantage, utilité, profit, (Synon.) X V 11. 3 3 0 . A
A v a n t a g e , 1 en terme de Jurifprudence, en fiyle de Pratique
) I. 862. a.
A van t ag e , ( Maneg.) être monté à fon avantage. Monter
avec avantage. 1 .861. b.
A v a n t a g e , ( en terme de Jeu) un joueur a de 1 avantage
lorfqu’il y a plus à parier pour ion gain que pour fa perte.
Exemple qui éclaircit cette définition.!. 861. a.
AVANTAGEUX, fier, glorieux , orgueilleux ( Synon.)
VU .716. A
AVANTURIER, ( Comm. ) voyez Interlope. VIII. 831. a.
AVAREI, graine des Indps. XVI. 372. b.
AVARES, I Hifioire ) peuple tartare qu’on a fouyent
confondu avec les Huns, parce qu’il habitoit les mêmes
régions, 8c avoit les mêmes moeurs 8c les mêmes ufages,
Hiftoire de ce peuple. Sorti des rives du fleuve Amour , il
I parcourut en vainqueur la Chine 8c la Tartarie , s’établit à
l’orient du Volga , d’où il paifa dans la Pannonie. L’empire
romain, dans fa décadence, n’eut point d’ennemi plus redoutable.
Après avoir défôlê l’Italie 8c les Gaules, il fut enfin
détruit par les Francois. Ce fléau dura pendant 489 ans. Supplt
I. 696. b. H „ Ml
AVARICE, |Morale ) l amour des richefles n’eft vice que
par fon excès. Tout amour immodéré de,s richeffes eft vicieux,
mais n’eft pas toujours avarice. Effets contraires que ce vice
produit. I. 862. b.
Avarice. Fauffe idée qu’on en donne , 8c qui fait que pour
l’éviter , on fe jette dans la prodigalité. V. 746. a. Diftinclion
entre cupidité, Îéfine 8c avarice. IX. 453. a. Excès d’avarice ,
mefquinerie. X. 398. b. 399. a. Fable des Arabes fur l’avarice.
XIV. 678. a. Horreur que les Bamby taciens avoient pour l’or
8c pour l’arcent. Suppl. 1. 776. a.
AVARIES , f Commerce ) accidens qui arrivent aux vaiffeaux.
Il y en a de trois fortes, de fimples ou particulières
de groffes ou communes, 8c des menues. 1 .862. b ..
Avarie. Perte des avaries. Évaluation de ces pertes en
France fur 18 années de paix. III. 58. b.
AVARU , ( Botan. ) nom que les habitans de Ceylan
donnent à une efpece d’indigo. Ses différens noms. Suppl. I.
697. b. Lieux où croît cet arbriffeau. Sa defeription. Ses qualités
8c ufages. Différentes efpeces d’indigo que Linnæus a
confondues. Ibid. 698. a.
AUBAIN ,{JuriJ"p.) étranger qui féjourne dans le royaume
fans y être naturalifé. Sort de fes biens après fa mort. Qui font
ceux qui font exempts du droit d’aubaine. 1 .863. a.
Aubain. Voyc{ fur ce fujet. XI. 40. a. Épaves d’aubains.
'/¿BAINE , ( Jurifp.) étymologie de ce mot. Le droit de
naturalité doit être confirmé aux peuples qui en jouiflent,
toutes les fois que le feeptre change de main. Raifon ou prétexte
de l’établiffement dé ce droit. 1 .863. a.
Aubaine , différence entre ce droit 8c celui de déshérence.'
IV. 882. b. Ce droit appellé aufli droit de dépavité. V. 736.
a. Colleéteurs du droit d’aubaine. III. 630. b. Droit d’aubaine
dans les Pays-Bas. V. 122. a. _
AUBE , vêtement du prêtre. Autrefois les eccléfiaftiques
portoient des aubes au lieu de furplis. On croit que dans la
primitive églife , c’étoit leur vêtement ordinaire. I. 863. b.
— Suppl. III. 739. b. . i
A ube , ( Hydraulique ) planches fixées a la circonférence
d’un roue de moulin à eau, fur lefquelles s’exerce 1 im pulii on
du fluide. Obfervations fur le nombre des aubes, 8c 1 intervalle
qu’il finit laifler entr’elles. I. 863. g Le nombre des
aubes fera d’autant plus grand, que leur largeur fera moindre:
table qui indique ce rapport. Aubes en rayon 8c aubes e»
A U D À V Ë 12.7
tangentes ; les premières préférables. On examine s’il conviert-
drmt de donner aux aubes la difpofition des ailes à moulin
à vent de maniéré que l’arbre , auquel elles font attachées,
fiit parallele au fil de l’eau. Ibid. 864. a.
AUBENTON, ( d" ) anatomille. Suppl. I. 411. avOrnitho-
logifte. Suppl. IV. 187. a. Phyfiologifte. Ibid. 360. b.
. ^UBErlNE , ( Botan. ) obfervations fur cet arbriffeau.
I. 863. a. Analyfe chymique de cette plante. Ufage de l’eau
diftiîlée de fes fleurs, ou de l’efprit que l’on en tire.I. 863. a.
AUBERGE, {Hiß.mod.) effets des étrangers fur lefquels
les aubergiftes ont attion pour leur paiement. Devoirs 8c Ioix
qui leur font impofés. I. 863. A
Auberge ,. taverne , cabaret , hôtellerie : différence dans la
lignification 8c l’ufage de ces mots. XV. 937. b. Auberges dans
l’ifle de Malthe. XVi. 8x8. a.
AUBERT , ( Guillaume) fa-patrie , fes ouvrages. XII.
B92 .b.
AUBETTE, ( Géogr. ) petite riviere de Normandie. Son
"cours. On a remarqué que les eaux ne gelent jamais. Suppl. L
698. b.
AUBIER, ( Hifi. nat. Jard.) partie de l’arbre qui fe trouve
immédiatement fous l’écorce. 1.863. b. Double ou faux aubier.
Ibid. 866. a.
Aubier. Formation de l’aubier. XVI. 933. A Gomment il fe
convertit peu-à-peu en bois. I. 383. b. Faux aubier obfervé
dans quelques arbres. 386. a. Moyen de donner à l’aubier
du chêne prefque autant de folidîté 8c de durée qu’en aie coeur
dubois. III. 286. a. ConAciérations fur l’aubier, 8cfon utilité
dans les bois pour pilotis. XII. 603. a.
AUBIFOIN , ( Botan. ) plante. Ufage qu’on en fait en
Saxe contre les jauniffes 8c rétentions d urine. Autres .ufages
pour faciliter la lortie des dents, pour réfoudre l’éréfipelle du
vifage, pour purger, pour la rougeur des yeux ; le cyanus eft
diurétique 8c emménagogue. I. 806. a.
AUBIGNÉ , ( Franqoije d ') marquife de Main tenon. Suppl.
IV. 469. a. Faveur dont elle jouit auprès de Louis XIV. IX.
882. A XI. 146. a. Ennui qu’elle éprouvoit. V. 694. A Sa con^
duite à l’égard de madame Guion. XIII. 709. b. Obfervation
fur les mémoires de fa vie. VIII. 223. A
AUBIN , mouvement du cheval non naturel. Suppl. III.
'396. A Quelle en eft la caufe. III. 306. a. VII. vol. desplançh.
article Man eg e , pl. VI.
A u bin du C ormier , Saint, ( Géogr. ) Suppl. IV. 693. A
AUBRAC , ( Géogr. i montagne de Rouergue. ÉtabÜffe-
ment fondé fur cette montagne, fous le nom de Domerie.
Revenu du chef 8c des religieux. Suppl. I. 698. A
AUCH , ( Géogr. ) fiege épifcopal de cette ville. Suppl. H.
327. a.
AUCUN , ( Gramm. ) prépofitif d’univerfalité. I. 729. A
Obfervation fur la nature de ce mot. XIII. 434. a. 6c fur fon
ufage fans négation. I. 730. a.
AUDACE , hardieffe , effronterie , ( Synon. ) différences
entre ces mots. I. 866* A
Audace , ce mot fe prend toujours en mauvaife part.
II. iij b.
AUDACIEUX , effronté, hardi, ( Synon. ) V. 412. A
AUDIENCE des ambaffadeurs. Ufages par rapport à ces
audiences. 1. 866. A
A udience , (terme de Palais ) I. 866 A
Audience. Différence entre continuer l’audience, 8c remettre
l’audience à tel jour. IV. 116. a. Audience extraordinaire.
VI. 337. A XI. 380. A Audiences de la grand’ehambre du
parlement de Paris. III. 3 2. a. XII. 26. a , A 27. a , A Audiences
du châtelet, III. 243. a, b. du lieutenant de police,
53. A de la cour des aides. IV. 368. A Audience de miféri-
corde. XIII. 873. A Audience à huis clos. VIII. 3 40. a.
Audience, cour eccléfiaftique d’Angleterre. I. 867. a.
A udience r o y a l e , ( Hifi. mod.) tribunal de juftice dans
l’Amérique efpagnole. 1. 067. a.
A udiences du Mexique, XII. 60. a. du Péroiu 62. a.
AUDIENCIER. Grands audienciers de France. VIII. 830.
a , b. Notaire audiencier. XI. 240. a. Huifliers audienciers.
VIII. 340. A Droit de regiftre qu’oiSpaie aux audienciers des
chancelleries. IV. 112. a.
AUDIENS, ou V adiens , ( Hifi. eccl. ) hérétiques du
quatrième fiecle. Leur chef. Leurs erreurs. Peu de durée
de leur feite. I. 867. a. Foyer A ntropomorphites 6*
V adiens.
AUDITEUR , titre commun à plufieurs fortes d’officiers
commis pour ouïr des comptes. I. ¡ ¡ ¡g a. Officiers de l’échi-
quier en Angleterre , nommés auditeurs. Auditeurs conventuels
ou collégiaux. Auditeur, juge des caufes qui fe décident
a l audience. Auditeur , enquêteur commis pour l’inftru&ion
des procès, 8tc. Ibid. A
A uditeurs des comptes, ou à la chambre des comptes
c Pans. III. 787. b. Six divifions de ces officiers. 47. a. —
teP5 *lî',cîlteilr du châtelet. IX. io. a, b. Les auditeurs du châ-
T*mc0^'m aiUrefois d’exercer la juftice en perfonne. 304. a.
1 *ms 0u ils eurent leurs Ueutenans. 303. A
A uditeurs, ( Bclles-Lcttr.) l’émotion communiquée par
I orateur eft d’autant plus vive , que l’auditeur a plus de génie
&c de talent. V. p i .A .
AUDITIF , ( Anatomie ) defeription du conduit auditif
externe. Artere auditive , externe & interne. 1. 867. A
Auditif, conduit. VIIL 264. A Voye| aufli O re ille , nerf
auditif. Ibid.
. AUDITOIRE , I Hifi. mod. ) fiegé , bâtie \ tribunal à
Rome. Auditoires des juges pedanées. Ceux des Hébreux.
Ce^ix des juges des anciens feigneurs. I. 867. A
Auditoire , dans les anciennes églifes. Le concile de Car-
thage excommunia une perfonne pour être fortie de l’auditoire
pendant le fermori. I. 808. a.
AUDRAN , ( Gérard ) graveur. VII. 866; A
. AVE1N , ( Bataille d’ ) Suppl. IV. 379. a.
. AVELINE, noifette : quell ies fönt les meilleures. Leurs
qualités. Leur fel 8c leur huile. I. 868. a.
AVÈNEMENT, joyeux. VIII. 867. b,6cc.
AVENIR. Du defir que les hommes ont de connoître
l’avenir. XI. 471. a. XV. 137. b. PreiTentimènt, prévoyance
de l’avenir , voyer ces mots.
AVENPAS, médecin arabe. XIV. 666. A
AVENT , ( Hifi. eccl. ) tems du commencement 8c durée
de l’Avent. L’ufage 'préfent de l’églife, à l’égard de cette
fête , n’a pas toujours été le même. Carême de la faint
Martin.-Tribunaux fermés autrefois en Angleterre pendant
ce tems. Il .y eft encore défendu de marier en ce tems fans
difpenfe. Ancienne coutume de compter les femaines de
l ’Avent en rétrogradant. I. 898. A
■ A vent. Maniéré de fixer le premier dimanche dé l’Avent.'
VI. 372.*.
AŸENTIN, Mont , X.6yy. a. Temple de Diane. XVI. 70«
a. 8c ftatue de Junon fur ce mont. 73. A
AVENTURE , événement , accident, ( Synon. ) différence
entre ces mots. 1. 868. A
Aventure, difeurs de bonne aventure. II. 294; A 293. a.
AVENTURIERS, ( Hifi. mod.) efpece de pirates 8c de
brigands qui infeftoient l’Amérique. Suppl. 1. 698; A Férocité
de leurs moeurs. Juftice - exa&e qu’ils obfervoient entre
eux. Hiftoire de ces aventuriers. Ibid. 699. a.
AVENTURINE, compofition de verre rouiTâtre,parfemée
de points brillans de couleur d’or. Aventurine naturelle.
Pierre chatoyante. I. 869. a.
AVENUE, voye{ A llée.
AVENZOAR, médecin arabe. X. ¿81.0. XIV. 666. A XV;
*33- M
AVERNE,fe difoit anciennement de certains lieux dont
l’air eft infeâé. Avernes fréquens en Hongrie. Grotte dé
Cani- en Italie. Lac d’Averne proche de Bayes. Les anciens
l’ont regardé comme .une entrée de l’enfer. Cérémonies
fuperftitieufes pratiquées dans cet endroit. I. 6891A
A v e rn e , ( Géogr. ) dimenfions de ce lac. Ses vapeurs ne
font plus mortelles pour les oifeaux, 8c fes bords font plantés
de vignes excellentes. Suppl. I. 699. A
Averne, lue d’Italie. Suppl. III. 676.a. Ce lac 8c les fontaines
d’eaux chaudes qui font aux environs, ont donné lieii
aux poètes latins d’imüginer les fleuves d’enfer : changemens
arrivés à ces eaux par les foins d’Agrippa j favori d’Auguftc.
III. 369. A Nom moderne de ce lac. XVI. 637. a. Lac Averne
en Aftyrie. Suppl. 1. 638; AA
ve rn e , {Guillaume d ' ) philofophe fcholaftique. XIV.
773. a.
AVERRHOA, (Botan.) caradere de ce genre de plante.
Ses efpeces. Suppl. 1. 700. 4.
AVERROÈS, favant Arabe : obfervations fur ce médecin;
X; 281. b. XIV; 667. a , A Averrbès confidéré comme chef
du pèripatéticifme dans le douzième fiecle. 1. 662. a. Diigrace
qu’U éprouva chez les Maures en Efpagne. IX; 43. A-
AVERSE ou A versa ,( Géogr.) autrefois Atella, ville célébré
chez les Romains par les bons mots 8c les fines plâi-
fanféries, autant que par fes fpe&acles obfcenes 8c fes débauches.
Ses révolutions. Son état préfent. Suppl. I. 700. ai
AVERSION, antipathie, haine, répugnance : différence entré
ces mots. I. 311. a. Intonation par laquelle l’averfion s’exprime.
VIII. 827. A
AVERTIN, Avortini (Économ. ruß. ) maladie des bêtes au-
mailles. Ses fymptômes. Traitement ae cette maladie. I. 870. a.
AVERTISSEMENT, confeil, avis, ( Synon.) I. 879, a-.
IV. I. a.
AVESNES, ( Géogr. ) ville forte de France dans le Hai-
naut, 8cc. Suppl. I. 700.
AVEUj ( Jurifp.) Différence entre aveu 8c dénombrement.
IV. 829; a j b. Aveux 8c dénombremens dus au roi :
daufe qu’on met dans les aveux. Ibid. A Faux-aveu. IX. 442;
b. Uet cetera ne doit pas être employé pour fuppléer à l’im-J
perfeilion de l’aveu & dénombrement. VI. 39. A
AVEUGLE, réflexions philofophiques fur la cécité. Là
fineffe du toucher 8c de l’ouie qu’on obferve dans certains
aveugles, yient fur-tout de la plus grande attention qu’il;